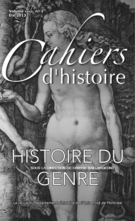Corps de l’article
Il n’est sans doute pas exagéré de dire que le concept de genre a été au coeur même des bouleversements de la discipline historique depuis une bonne quarantaine d’années. Emprunté à la psychologie[1], le terme a d’abord été utilisé par les historiennes pour rejeter le déterminisme biologique auquel les femmes étaient constamment renvoyées, et qui servait à justifier les inégalités entre les sexes, pour mieux souligner que la féminité, loin de constituer le reflet de la nature profonde et donc immuable des femmes, était une construction sociale et culturelle visant à légitimer la domination masculine. Dans cette perspective, le genre désignait l’ensemble des caractéristiques et attributs que chaque société, à différentes époques, avait prêtés aux femmes — mais aussi aux hommes — et dont découlaient les rôles et les fonctions que chaque sexe devait assumer, de même que la part de pouvoir revenant à chacun. Faisant écho à la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme : on le devient »[2], cette manière de concevoir le genre supposait que la dimension sociale et idéologique de la différence sexuelle pouvait varier alors que la dimension anatomique demeurait immuable, établissant ainsi une dichotomie un peu factice qui a été contestée par la suite[3] ; mais cette vision avait au moins le mérite de « dénaturaliser » les femmes et leurs activités et, du fait même, de les considérer de plein droit comme sujets de l’histoire.
La théorisation du genre comme catégorie d’analyse a pris une nouvelle dimension, tout en suscitant un débat enflammé, en 1986 avec la parution de l’article de l’historienne américaine Joan Scott intitulé « Gender. A Usefull Category of Historical Analysis »[4] dans lequel elle définit le genre de deux façons : comme « un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes » et comme « une manière première de signifier des rapports de pouvoir »[5]. Inspirée des théories poststructuralistes, cette définition à deux volets insistait donc, d’une part, sur l’interdépendance de la construction des identités sexuées (le féminin ne pouvant se comprendre sans considérer le masculin et inversement), les différences présumées entre la féminité et la masculinité étant au fondement des rapports de pouvoir qui les relient, et, d’autre part, sur la dimension genrée de tout rapport de pouvoir (social, politique, économique, etc.), le genre représentant le prisme à travers lequel ces rapports sont construits et appréhendés. En d’autres termes, pour Joan Scott, non seulement le genre est une catégorie d’analyse utile, fondamentale même, pour conceptualiser les identités sexuées et leurs rapports ; il s’avère aussi un outil indispensable en ce qu’il permet d’examiner tous phénomènes et événements historiques dans une perspective renouvelée, c’est-à-dire en considérant que les perceptions de la différence sexuelle « structurent, naturalisent et légitiment non seulement les rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les nations, les empires et leurs colonies, ou, de manière globale, entre les dominants et dominés »[6].
La conceptualisation de Scott a donc transformé l’histoire du genre pour en faire une dimension incontournable du fonctionnement de tous les rapports de pouvoir, élargissant ainsi considérablement son champ d’application ; elle a aussi stimulé les études sur la masculinité, tout comme elle a débouché sur une intense réflexion au sujet de l’imbrication des identités sociales (genre, classe, race, nationalité, âge, orientation sexuelle, etc.). Depuis quelques années, l’approche intersectionnelle, comme on la désigne couramment, a parfois conduit à remettre en question la prééminence de l’identité de genre dans la construction de la subjectivité des individus, tout comme des systèmes d’oppression[7], mais ces débats, comme ceux qui les ont précédés, sont sans doute le meilleur témoignage du caractère heuristique de ce concept, qui demeure toujours un outil d’analyse incontournable.
Chacun à leur manière, les textes réunis dans cette édition spéciale des Cahiers d’histoire cherchent surtout à voir comment l’identité de genre se construit, trouve à s’exprimer ou est instrumentalisée à différentes périodes ou dans différents contextes, des deux côtés de l’Atlantique. Ainsi, l’article de Sarah Templier, qui ouvre ce numéro, propose une analyse de la correspondance d’Elizabeth Willing Powell, femme de lettres américaine du xviiie siècle, afin d’examiner sa conception de la place des femmes dans la société et de l’éducation féminine. Se situant dans la lignée des nombreuses études qui se sont penchées sur les écrits féminins des xviiie et xixe siècles[8], Templier fait valoir que cette femme de l’élite philadelphienne endosse l’opinion des théoriciens républicains de son époque qui ont été à la source de l’idéologie des sphères séparées[9], mais tout en contournant leurs prescriptions puisqu’elle se positionne dans l’espace public du seul fait de son activité épistolaire. Si Elizabeth Powell considère que les femmes doivent demeurer à l’écart des débats publics et qu’elles doivent préparer leurs filles à jouer le même rôle domestique qu’elles, elle fait néanmoins preuve d’agentivité[10] en diffusant ses idées ou celles des hommes qu’elle approuvait et en distribuant ses avis et ses conseils, tout en s’assurant de préserver ses échanges pour la postérité en recopiant sa correspondance.
L’éducation des filles est aussi au coeur des recherches de Julie Plourde qui s’intéresse à la place du théâtre dans la formation des couventines au Québec au tournant du xxe siècle. L’auteure ouvre ici une nouvelle avenue de recherche, car si la formation et la socialisation des filles à l’école et dans la famille ont été parmi les premières thématiques explorées en histoire des femmes[11], le rôle joué par les arts, et notamment le théâtre, n’avait pas encore fait l’objet d’études attentives. Dans cet article, Ploude montre que les pièces montées dans les couvents, et parfois jouées devant un public choisi, contribuaient à la construction du genre féminin en proposant aux jeunes filles des modèles empreints des valeurs et des idéaux que leurs enseignantes désiraient les voir adopter. L’analyse d’un corpus d’essais que les couventines ont rédigés au sujet d’une oeuvre classique du répertoire français, Les femmes savantes, révèle pour sa part qu’elles ont exprimé une large variété d’opinions au sujet de l’éducation des filles, tournée en ridicule par la pièce de Molière. Si la pratique du théâtre visait un certain « formatage » du genre féminin pour reprendre l’expression de l’auteure, la lecture de ces devoirs tend à montrer que cette opération n’excluait pas l’expression d’une certaine dissidence cependant (mais à l’intérieur de limites acceptables), une analyse qui soulève également la question de l’agentivité évoquée dans le texte précédent.
La contribution de Catherine Tourangeau, qui nous entraîne dans le monde atlantique français du tournant du xviiie siècle, examine pour sa part le discours des autorités métropolitaines et coloniales au sujet de l’ordre social afin de voir comment ces discours appréhendent le corps des femmes et la sexualité féminine. Lieu de tous les désordres aux yeux des administrateurs, la Nouvelle-France paraît d’autant plus vulnérable que le métissage non contrôlé en menace la stabilité, nous dit l’auteure. La mauvaise réputation que s’attirent les Filles du roi, pourtant envoyées dans la colonie précisément pour rétablir l’ordre sexuel, doit être comprise dans ce contexte ; si elles ont souvent été considérées comme des prostituées ou des femmes aux moeurs légères, en dépit du fait que la très grande majorité d’entre elles se sont mariées et ont fondé des familles relativement nombreuses, c’est que les autorités françaises associaient volontiers le désordre colonial à une sexualité féminine débridée qu’elles semblaient incarner, même si une seule d’entre elles a effectivement été accusée de prostitution. Cet essai, qui cherche à ouvrir le champ de l’histoire du genre et du corps à l’histoire impériale et aux études atlantiques, propose donc une nouvelle interprétation des Filles du roi et surtout de la réputation peu enviable dont elles ont été auréolées durant fort longtemps, un phénomène qui avait fait l’objet d’une virulente critique de la part des premières historiennes féministes[12].
Les deux textes suivants se penchent sur les représentations du genre dans le discours publicitaire en circulation au Québec au cours de la première moitié du xxe siècle. Considérés comme le reflet des valeurs et des normes de la société dans lesquelles ils s’inscrivent et qu’ils contribuent par ailleurs à renforcer, les messages publicitaires constituent une source quasi inépuisable de représentations de la féminité et de la masculinité et, pour cette raison, ont déjà suscité de multiples analyses empruntant une perspective genrée[13]. Les articles de Myriam Sills et Marc Myre représentent des apports des plus intéressants à cette historiographie encore balbutiante au Québec. Dans son étude des annonces pour les gouttes oculaires Murine diffusées entre 1925 et 1950 dans trois magazines québécois, Myriam Sills montre que si la beauté et la santé représentent les deux principaux arguments de vente sur lesquels elles s’appuient, durant les dix premières années, alors qu’elles ciblent principalement les femmes, leurs mises en scène insistent tout particulièrement sur l’importance du regard pour séduire le sexe opposé, alors que par la suite, leur discours met davantage l’accent sur la santé des yeux, en même temps qu’il devient plus rationnel et s’adresse tout autant aux hommes qu’aux femmes. Dans le contexte particulier de la Crise et de la Deuxième Guerre mondiale, nous dit l’auteure, les publicitaires ont estimé qu’il valait mieux souligner la dimension thérapeutique du produit, un argument plus susceptible d’attirer les consommateurs, ce qui montre que les considérations économiques n’ont pas été sans influencer le discours genré des publicitaires.
De son côté, Marc Myre s’intéresse aux publicités pour la bière durant les années 1920, associées à une ère de prospérité. Son étude, qui repose sur le dépouillement de plusieurs quotidiens et magazines québécois, montre que le discours publicitaire s’appuie sur les conceptions dominantes de la féminité et surtout de la masculinité qui ont cours durant cette période, notamment l’hypermasculinité. Issue des craintes de dévirilisation suscitées par l’industrialisation et l’urbanisation, cette nouvelle identité masculine se caractérise par une insistance sur la force physique, la vigueur et l’endurance, le culte du corps viril devant permettre aux hommes de se réaffirmer face à une société jugée « féminisante ». Comme Myre le souligne, c’est seulement quand les publicitaires manient l’humour qu’ils se permettent d’inverser les rôles de genre, les parodies qu’ils mettent en scène visant, au final, à « naturaliser » les rôles traditionnels. Malgré la présence de quelques femmes dans les publicités de bière durant cette période, Myre conclut au caractère résolument masculin de ces annonces qui cherchent surtout à séduire les hommes.
Le dernier texte qui clôt ce numéro nous ramène au xviiie siècle, alors que nous suivons le parcours social et littéraire de Johann Joachim Winckelmann, un antiquaire, bibliothécaire et historien de l’art d’origine allemande qui connut une brillante carrière en Italie. À partir des textes qu’il a publiés, et tout en s’inspirant du concept de genre tel que théorisé par Joan Scott et Judith Butler[14] et des études Queers, Shawn McCutcheon montre que l’homoérotisme présent dans l’oeuvre de cet érudit épris d’art hellénique témoigne de la construction, par Winckelmann lui-même, d’une identité masculine comportant deux dimensions ; d’une part, une masculinité « sociale » qui renvoie au connaisseur érudit qu’il est devenu et, d’autre part, une masculinité « sexuelle » influencée par les pratiques pédérastiques grecques auxquelles il s’adonnait. Inscrite dans une société européenne tournée vers la culture hellénique et empreinte d’homoérotisme, cette identité masculine particulière était tout à fait acceptable, soutient l’auteur qui espère par cette étude montrer le caractère « construit, transformable et perméable du genre et de l’érotisme ».
Parties annexes
Notes
-
[1]
Sur la généalogie du concept de genre, voir Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS éditions, 2007 et Sonya Rose, What is Gender History ?, Cambridge, Polity Press, 2010.
-
[2]
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, t.1, Paris, Gallimard, 1949, p. 285.
-
[3]
Pour une synthèse très accessible de ces débats, Rose, What is Gender History ?, chap. 2., p. 17-35.
-
[4]
Joan Scott, « Gender ; A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical Review, 91, 5 (décembre 1986), p. 1053-1075.
-
[5]
Selon la version française de son article, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique», Les cahiers du Grif : le genre de l’histoire, 37-38 (printemps 1988), p. 141.
-
[6]
Traduction libre de Joanne Meyerowit, « AHR Forum : A History of ‘Gender’ », American Historical Review, 113, 5 (décembre 2008), p. 1351. On pourrait penser ici aux rapports Canada-Québec que Susan Mann a déjà représentés en termes genrés, le premier incarnant, bien évidemment, le pôle masculin dominant. Voir Susan Mann, The Dream of Nation. A Social and Intellectual History of Quebec, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2002 [1982], en particulier le chapitre 20.
-
[7]
Pour deux points de vue théoriques récents sur cette question, voir Sirma Bilge, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, 225, 1 (2009), p. 70-88 et Danielle Juteau, « ‘Nous’ les femmes : sur l’indissociable homogénéité et hétérogénéité de la catégorie », L’Homme et la société, 2, 176-177 (2010), p. 65-81.
-
[8]
Voir par exemple, Dena Goodman, The Republic of Letters, A Cultural History of the French Enlightenment, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1994 et Susan Dalton, Engendering the Republic of Letters : Reconnecting Public and Private Spheres in Eighteenth-Century Europe, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2003.
-
[9]
Par sphères séparées, on entend les lieux où s’exercent les principales activités liées à la famille et à la société et qui incombent respectivement aux femmes et aux hommes. Idéologiquement présentées comme séparées et étanches, les sphères privée et publique sont, en réalité, en constante interaction et fonctionnent de manière interdépendante.
-
[10]
Le concept d’agentivité réfère à la capacité des individus à agir, à être l’agent de leur destin, en dépit des contraintes que leur imposent la société ou les relations de pouvoir dans lesquelles ils sont imbriqués.
-
[11]
Pour le Québec, voir notamment Nicole Thivierge, Écoles ménagères et Instituts familiaux. Un modèle féminin traditionnel, Montréal, Boréal, 1982 et l’ouvrage collectif dirigé par Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, Les couventines : l’éducation des filles au Québec dans les congrégations religieuses enseignantes, 1840-1960, Montréal, Boréal, 1986.
-
[12]
Le Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour éditeur, 1992, p. 60 et Yves Landry, Orphelines en France, pionnières au Canada. Les Filles du roi au xviie siècle, Montréal, Leméac, 1992.
-
[13]
Pour un exemple québécois d’étude sur les représentations genrées dans la publicité voir Denyse Baillargeon, « Medicine Advertising, Women’s Work and Women’s Bodies in Montréal Newspapers, 1919-39 », dans Cheryl Wrash et Dan Malek (dir.), Consuming Modernity, Changing Gendered Behaviours and Consumerism, 1919-1940, Vancouver, UBC Press, 2013, p. 78-101.
-
[14]
Judith Butler, Trouble dans le Genre ; Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006 (trad. française de Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity, New-York, Routledge, 1990).