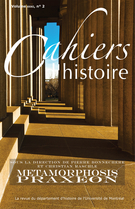Corps de l’article
L’histoire s’est depuis longtemps débarrassée de son image d’un simple catalogue de noms, de dates, d’idées et de faits. Voilà plusieurs décennies maintenant que de nouvelles approches et méthodes voient le jour et se développent, qui interpellent les historiens et les forcent à revoir sans cesse leurs techniques de lecture, d’analyse et de synthèse. Elles sont notamment inspirées de l’anthropologie, de la sociologie, ou encore de l’histoire de l’art, et amènent l’historien à structurer son questionnement autour de concepts nouveaux, comme l’histoire du genre ou la théorie du discours par exemple. Conscients de l’intérêt que la théorisation et la conceptualisation suscitent chez les jeunes chercheurs, fût-ce au plan conceptuel ou appliqué, nous les avons encouragés à présenter l’avantage de nouveaux cadres théoriques, ou encore de concepts renouvelés qui constituent une part de leur outillage intellectuel.
Ce numéro des Cahiers d’histoire constitue ainsi un lieu de réflexion : quels sont les avantages et les limites que telle ou telle approche, passant par la théorisation et la conceptualisation, issue d’une réflexion moderne, apporte à la recherche sur les sociétés anciennes ? Dans quelle mesure les thèmes aujourd’hui privilégiés par les historiens s’en trouvent-ils modifiés ? Comment l’approche méthodologique des sources en ressort-elle renouvelée ? Comment enfin faire progresser encore et toujours nos connaissances à partir de documents connus depuis longtemps ?
Les questions théoriques sont d’évidence davantage prisées dans les champs de l’histoire plus proche de nous, et en fait dans tout type d’histoire pour lequel subsiste une masse critique de documents, qui peut seule contrebalancer la puissance conceptuelle d’une nouvelle théorie ou d’une nouvelle méthode. L’histoire ancienne n’est pas revêche à la théorie, et elle a toujours été à l’avant-garde des collaborations interdisciplinaires, qu’elles fussent centrées sur les disciplines classiques, littérature, archéologie et histoire, ou sur les apports méthodologiques : la théorie économique a de longue date envahi les terres de l’historien des royaumes hellénistiques ou de l’Empire romain, la prosopographie y a gagné ses lettres de noblesse, l’anthropologie religieuse y a fleuri dès les années 1960, les concepts d’altérité et d’identité y ont trouvé un de leurs premiers terreaux fertiles. Mais si l’histoire ancienne n’est pas revêche à la théorisation, bien des historiens, non sans raison, considèrent d’un mauvais oeil tout un pan de la recherche qui fait primer la théorie sur les faits que l’on peut extraire des sources anciennes, souvent sporadiques et incomplètes, et qui en réalité ne font que justifier — en apparence — l’a priori de départ en plaquant quelques faits mal connus sur l’armature d’un raisonnement logique qui emporte l’adhésion. En ce sens, s’il est toujours nécessaire de rester ouvert à la nouveauté, il reste capital aussi de s’armer de garde-fous pour éviter les dérives, dont les effets pernicieux et autres dommages collatéraux sont souvent longs à identifier et ensuite à récuser.
Les articles qui suivent reflètent assez bien ces brefs propos : aucun auteur ne s’est lancé dans une vaste entreprise abstraite. Au contraire, c’est toujours à partir de l’évolution d’un paradigme, d’un concept, d’une habitude, que se trouvent appréhendés différemment les faits antiques.
À l’origine, les cultes isiaques ont été étudiés dans une perspective philologique et historico-religieuse traditionnelle. L’avènement des « sciences des religions », avec leur dette à l’égard de la sociologie, a radicalement transformé leur image, comme le montre Stéphanie Briaud. De même, la quantification, à la mode en numismatique et en histoire économique, a permis de remarquables avancées quant à l’établissement de l’origine, de la répartition des objets et des coutumes relatives, par exemple, à tel ou tel dieu, ou sous tel ou tel souverain. En politique, les historiens ont longtemps parlé d’usurpation du pouvoir, et d’usurpateurs dans l’Empire romain. La réévaluation des concepts de « coup d’état » et de légitimité, et leur meilleure définition, permettent à Hermann Amon d’éclairer d’un jour intéressant tout un pan de l’histoire politique antique. La conception de l’identité des peuples antiques a fortement subi les courants de remise en question lancés au courant des années 1970. Avec les apports de l’histoire des mentalités et la mise en lumière des topoi (lieux communs) de la rhétorique, c’est plus d’un siècle de recherches qui a volé en éclats : à peu de choses près, comme le montre Raphaël Weyland, c’est tout ce qu’on a pu avancer sur les peuples « autres » qui est passé, en deux décennies seulement, du registre de la réalité tangible à celui de la façon dont les Grecs ou les Romains concevaient l’altérité de leurs voisins ou de leurs communautés. Dans la même veine, Steeve Bélanger insiste sur les identités sociales, religieuses et communautaires, incroyablement fluides, et plaide pour une souplesse d’interprétation qui contredit les modèles monolithiques (les chrétiens, les Juifs, etc.) de la génération antérieure. Jacques Leibovici puise aux nouvelles sciences de la communication (et notamment les programmes de conceptions de réseaux) pour tenter d’identifier divers vestiges potentiels de sites-relais dans les systèmes de communication antiques, qui fonctionnaient grâce à des signaux lumineux. La méthode mise en oeuvre pourrait ainsi indiquer aux archéologues où prospecter avec le plus d’efficacité possible.
Sur les terres de l’histoire de l’art cette fois, Christelle Ansel s’attarde à la ressemblance iconographique entre deux bas-reliefs romains. En émettant l’hypothèse d’un remploi de l’un d’eux, le « relief de Carthage », elle met en lumière une réutilisation améliorée (la fertilité du sol de l’Égypte) de l’intention propagandaire de base (la fertilité du sol). Anastasia Painesi tente, quant à elle, de répondre aux carences de l’iconographie grecque perdue des batailles historiques par le recours aux sources littéraires ainsi qu’aux « copies » fragmentaires sur les vases, qui nous en apprennent davantage sur l’idéologie civique que sur le détail des combats. En cela, les anciennes méthodes de catalogage, de comparaison — notamment la confrontation de divers types de sources — peuvent elles aussi enrichir la nouvelle histoire des mentalités. C’est le même principe, en fin de compte, qui guide Maude Lajeunesse quand elle tente de trouver, de comprendre, le droit et les conceptions relatives aux enfants et aux descendants, non en ressassant le corpus déjà trop exploité des orateurs attiques, mais par l’analyse de lois conservées par l’épigraphie, en provenance de cités diverses, et examinées sous l’angle de la parenté. Ces textes sont connus depuis longtemps, mais sont ici relus avec une nouvelle grille d’analyse qui porte ses fruits, et nourrie aux dernières tendances interprétatives.
Dans l’ensemble, ce dossier des Cahiers d’histoire est riche d’enseignements, de résultats et de promesses. L’histoire ancienne a certes peu en commun avec le présent, mais sa maîtrise offre aux chercheurs une remarquable école de pensée toujours en éveil.