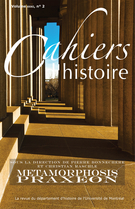Résumés
Résumé
Les excursus faisant la description des habitudes de vie des peuples environnant le monde gréco-romain pullulent dans la littérature antique. S’ils ont longtemps été utilisés pour étudier ces peuples étrangers (Gaulois, Huns, Germains), les historiens ne leur accordent plus aujourd’hui la même valeur historique. Cet article suit l’évolution de l’historiographie du dernier siècle concernant ces documents d’ethnographie antiques, du positivisme de Félix Jacoby à sa remise en question par le post-modernisme. Nous nous efforçons aussi de proposer de nouvelles manières d’interpréter ces documents en nous inspirant des tendances récentes de cette historiographie.
Abstract
Classical texts are full of ethnographic content about the various neighbouring people of the Greek-Roman world, usually presented to the reader as excursus. For a long time, historians used these documents to study the foreign people that they describe, may they be Gauls, Huns or Germans. But post-modernism washed away the confidence modern specialists put into these texts and introduced new methods and objectives in their use. This article presents more than a century of modern historiography on ancient ethnography, from Félix Jacoby’s positivism to François Hartog’s challenges of his theories, and proposes new ways to use these numerous excursus.
Corps de l’article
Le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la paix fut décerné à l’Union européenne. Le comité de sélection nommé par le parlement norvégien expliqua cette surprenante décision par la lutte réussie pour la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme. Ce choix a depuis été accueilli avec stupéfaction ou ironie par un grand nombre d’observateurs soucieux de rappeler que la réalité de la construction européenne et de la vie quotidienne des habitants de ses pays-membres ne reflète pas le discours triomphaliste et unificateur des milieux europhiles[1]. Outre la crise financière et politique, plusieurs éléments ternissent en effet la face brillante de l’Union. L’adoption par certains parlements de lois permettant de passer outre aux votes populaires refusant le traité de Lisbonne fissure par exemple le vernis de démocratie du Vieux Continent. Le discours ambiant faisant des Grecs, des Espagnols ou des Portugais les uniques instruments de leur propre malheur et des difficultés des autres pays de l’Union par leur paresse ou leurs habitudes de vie décadentes, relayé par les principaux quotidiens et médias allemands ou anglais, semble d’autre part contredire l’idée selon laquelle les haines entre les peuples auraient été enfouies sous l’amour de la communauté européenne. À l’intérieur de certains pays, comme la France ou la Hongrie, des partis politiques proposent des lois en totale opposition à ces idéaux récompensés avec tant d’empressement et obtiennent des soutiens massifs dans l’opinion publique et les cercles dirigeants. L’un des points communs de ces différents exemples est leur construction d’un ennemi, inférieur et responsable des malheurs de tous, que celui-ci soit la minorité non-magyare, le Grec vil et voleur ou le chômeur manipulé par les communistes pour voter contre les traités européens.
Ces discours sur l’Autre s’inscrivent dans une tradition culturelle millénaire. Les plaintes des journaux allemands expliquant l’impécuniosité des Grecs par le climat de leur pays ou par leur système politique sont en effet le lointain écho des propos que tenait Hippocrate dans son Traité des Airs, des Eaux et des Lieux[2]. Cette tradition s’est transmise en évoluant au cours des siècles et il est possible d’en suivre la transformation au cours des 2500 dernières années. Cherchant à décrire les peuples étrangers et à expliquer leurs coutumes, ce type de littérature est appelé par les spécialistes modernes ethnographie, bien qu’elle partage peu de choses avec la science actuelle portant le même nom. Cette tradition d’ethnographie, présente sous forme d’excursus dans la plupart des textes historiques de l’Antiquité, influença profondément les élites de l’Europe des xviiie et xixe siècles, les textes antiques servant alors de base d’éducation aux jeunes gens bien nés d’Eton à Heidelberg[3]. Mais cette influence, encore perceptible aujourd’hui, est loin d’être unilatérale. Tout comme le décrit avec ironie David Lodge dans son roman Small World, il est en effet possible pour T.S. Elliot d’influer sur l’interprétation que les spécialistes font de Shakespeare ; l’image que nous gardons de la Grèce en général ou d’un auteur ancien en particulier pèse sur l’interprétation que nous faisons des événements relatés dans un texte. Les discours de la littérature gréco-romaine sur les étrangers, soumis à des contraintes stylistiques, à des préjugés issus de systèmes étiologiques que nous devons tenter de reconstruire ainsi qu’à nos propres impressions, colorées par des siècles d’étude admirative de ces « classiques », passionnent toujours les historiens tout en présentant des difficultés nombreuses et variées. Dans ce jeu d’influences et de miroirs, il est parfois difficile de se retrouver et nous nous proposons donc ici de tracer les principales étapes de l’évolution de l’historiographie moderne sur l’ethnographie antique, depuis les débuts de son organisation par Félix Jacoby jusqu’aux tentatives récentes pour dépasser la grille d’analyse issue des travaux sur l’altérité des années 1970 et 1980.
Les débuts de l’étude de l’ethnographie antique
Certains des documents qui nous sont parvenus de l’Antiquité gréco-romaine contiennent des commentaires théoriques ou stylistiques sur le reste de la littérature de leur temps. Nous possédons ainsi les textes de grammairiens ou de rhéteurs ainsi que les oeuvres d’historiens se plaignant du travail de certains de leurs prédécesseurs et élaborant dans leur oeuvre des règles à suivre[4]. Pourtant, malgré le fait que des récits ethnographiques soient présents dans bon nombre de ces textes antiques, il n’existe pas réellement de critique de cette ethnographie antique dans les textes de l’époque[5]. Nous appelons en fait par commodité « ethnographie » ce qui n’est que la tradition d’encyclopédies, de compilations et d’excursus décrivant les moeurs des peuples étrangers dans les sources antiques[6]. Cette tradition est présente tout au long de l’Antiquité. S’il est rare de trouver des textes entièrement consacrés à la description des moeurs des peuples étrangers[7], de petites parenthèses ethnographiques ornent les textes antiques, notamment les textes historiques. On les retrouve généralement sous la forme d’un excursus introduisant un moment particulièrement important du récit. Ils remplissent en général deux rôles : ils permettent à l’auteur d’étirer le temps et donc d’exacerber l’attention de ses auditeurs/lecteurs avant un événement particulier ; ils lui offrent l’occasion de prouver sa connaissance du sujet et des textes anciens, mais aussi de critiquer et de surpasser ceux-ci[8]. L’ethnographie ancienne obéit à des règles diverses. Il semble qu’elle n’ait aucun problème à conjuguer les archives administratives les plus absconses avec les légendes les plus farfelues[9] et, malgré les prétentions à l’autopsie de ses auteurs, elle ne se formalise pas trop de rapporter des informations qui sont, de notre point de vue, pertinemment fausses.
Ces récits, émaillant les oeuvres historiques considérées comme classiques et, à ce titre, enseignées dès leur plus jeune âge aux enfants de la bonne société européenne depuis le xviiie siècle, ont fait l’objet de nombreuses études de la part des historiens modernes. À la fin du xixe siècle, les officiers britanniques, envoyés servir dans différentes parties de l’immense empire de Sa Majesté, étaient ainsi encouragés à se munir d’exemplaires de ces récits antiques sur des peuples étranges et lointains pour se préparer à leur mission[10]. Certains de ces officiers produisaient par la suite eux-mêmes, durant le temps passé en garnison ou leur retraite, des récits ethnographiques des lieux visités et conquis par la civilisation sur la barbarie. Il n’est donc pas étonnant que nombre de ces monographies publiées par de fringants officiers britanniques dans l’Angleterre victorienne possèdent de nombreux points communs avec ceux qu’un Appien, par exemple, avait fait publier sur le Pakistan 1900 ans auparavant[11]. Les excursus, ethnographiques et autres, qui parsèment les textes antiques, préoccupaient d’autre part les historiens professionnels qui se demandaient notamment quelle place accorder à ce genre de documents dans leur reconstitution factuelle de l’histoire antique[12]. C’est cependant au début du xxe siècle que l’étude moderne de l’ethnographie antique en tant que genre littéraire distinct commence.
Félix Jacoby[13], protégé d’Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, lui-même gendre de Theodor Mommsen, annonça en 1909 son intention de publier un recueil des divers fragments d’historiens grecs antiques, le Fragmente der griechischen Historiker. Ce travail colossal, entrepris dans l’esprit des classicistes de l’Allemagne wilhelmienne, désireux de cataloguer les documents et de poser les bases nécessaires à l’étude rationnelle et scientifique de l’Antiquité, et en particulier des Fragmenta historicorum graecorum publiés par Karl et Theodore Müller entre 1841 et 1870 et de la Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, impliquait notamment la répartition de ces différents auteurs anciens dans des catégories littéraires qui n’avaient pas encore été clairement déterminées. Celles-ci, qui évoluèrent au cours de la vie du savant allemand, furent finalement regroupées en six grands thèmes : les mythographies, les histoires, les biographies, la géographie, les récits concernant les cités grecques (parfois appelés atthidographies) et l’ethnographie, récits sur des sujets non grecs.
Outre sa volonté de préparer le terrain pour les futures générations de classicistes, Jacoby nourrissait d’autres ambitions en débutant son imposant travail. Sa démarche s’inscrit en effet dans un métarécit faisant des Grecs les ancêtres de la civilisation occidentale et de celle-ci le stade ultime de l’avancement humain[14]. Il lui semble donc nécessaire de s’opposer aux travaux de Georges Bataille et de l’École de Paris, qui considéraient l’ethnographie comme l’étude des moeurs humaines, aussi bien en Occident qu’ailleurs, gommant ainsi ce qui semblait une frontière naturelle entre les peuples civilisés et les autres. Le genre ethnographique tel que défini par Jacoby est dès lors propre à la littérature grecque et constitue pour lui le premier pas vers la littérature scientifique et rationnelle[15]. Si les mythographies d’Homère ou d’Hésiode, pleines de dieux et de monstres, constituent le début de la culture littéraire occidentale, l’ethnographie serait ainsi la phase d’évolution nécessaire à ce que naisse la grande historiographie, dont Thucydide aurait été le père. Elle se caractérise dès lors par le fait que seuls des Barbares puissent en être le sujet et que seuls des Grecs puissent en être les auteurs : la description des habitudes de vie ou des structures politiques de cités considérées comme grecques par la critique historique du début du xxe siècle est ainsi concentrée dans une autre section des Fragmente. L’ethnographie antique, telle que définie par Jacoby, oppose donc ethnè et polis, dans la tradition de la « Grèce de marbre blanc ». Cette définition sera appelée à un grand succès et demeure d’actualité dans les écrits de certains spécialistes[16], même si les Fragmente ne furent jamais terminés.
L’influence de Jacoby fut déterminante. Éminent savant, il ne fut pas remis en question avant que des changements de paradigme profonds n’apparaissent dans l’étude de l’Antiquité. Ainsi, pendant quelques décennies, la critique scientifique se concentra sur la datation précise de cette évolution dans la pensée grecque qui aurait amené celle-ci à un genre littéraire plus rationnel. Si quelques voix s’élevèrent pour souligner le fait que les excursus ethnographiques demeurèrent longtemps après l’apparition de la grande historiographie[17], le modèle d’interprétation ne fut pas remis en question en profondeur. L’arrivée du concept d’altérité et la montée du post-structuralisme dans les sciences sociales contribuèrent à bouleverser l’étude moderne de l’ethnographie antique.
Une remise en question moins fondamentale qu’il n’y paraît
Le philosophe français Emmanuel Lévinas est généralement considéré comme le père de la notion d’altérité en philosophie. Sa pensée est particulièrement bien exposée dans Altérité et transcendance, une série de ses articles parus de 1967 à 1989 et réunis en 1995[18]. Ses pensées sont progressivement adaptées à d’autres champs d’études, comme l’anthropologie[19] ou la science politique[20], alimentant des débats houleux. En publiant en 1978 son oeuvre maîtresse, Orientalism, Edward Saïd va quant à lui transformer le débat en exposant l’idée que le rapport à l’autre et sa représentation se coulent forcément dans une logique impérialiste, la description d’un peuple étranger ne devenant qu’un outil de conquête et de justification de la conquête. La pensée post-structuraliste, et notamment les travaux d’Hayden White sur l’histoire comme littérature plutôt que comme science et de Jacques Derrida sur la déconstruction des lieux communs et des discours, va influencer profondément la perception des textes anciens, d’autant qu’elle suit des décennies de découvertes archéologiques qui ont la plupart du temps conduit à reconsidérer les descriptions antiques[21]. Plusieurs articles et monographies, publiés dans les années 1980 et se plaçant dans le courant des cultural studies, vont révolutionner la discipline sans pour autant, nous le verrons, parvenir à s’extraire tout à fait de la pensée de Jacoby. Pour des raisons d’espace, nous n’en examinerons que trois.
Le premier de ceux-ci est une étude de cas menée par Brent Shaw sur la description que les auteurs anciens faisaient de peuples divers, les classant selon leur alimentation et expliquant par ce moyen leurs différences avec les Grecs ou les Romains[22]. Utilisant le concept de l’altérité et mettant de l’avant une certaine sensibilité pour la construction de l’Autre par l’écriture, Shaw omet cependant de traiter ses sources comme des documents plus ou moins indépendants, provenant d’époques et de lieux divers. Il ne tente, d’autre part, aucunement de faire de cette perception de l’Autre, à travers son alimentation, un trait dominant de la littérature antique et ne remet pas réellement en question la validité historique des sources écrites.
François Hartog publie à peu près au même moment un livre qui aura un impact autrement plus profond que l’article de Shaw : Le miroir d’Hérodote[23]. Hartog, soulignant l’inadéquation entre les propos d’Hérodote sur les coutumes des Scythes et les découvertes archéologiques récentes, suggère non pas d’abandonner le texte, mais de l’utiliser à des fins différentes : plutôt que de tenter de connaître les Scythes ou même les Grecs, les Enquêtes devraient servir de « miroir » permettant de tenter d’apercevoir l’Athènes d’Hérodote à travers sa description de ces « super-barbares » qu’étaient les Scythes. Hartog met de l’avant l’existence, dans cet ouvrage, de trois miroirs : celui du texte lui-même, que le lecteur regarde pour tenter d’y retrouver ses racines et son identité ; celui qu’Hérodote aurait présenté à son audience, à tous ses lecteurs/auditeurs grecs à qui il aurait offert des images diverses d’Autres pour renforcer leur image d’eux-mêmes ; le dernier miroir est celui qui permet d’apercevoir les techniques d’écriture d’Hérodote et, notamment, selon Hartog, la manière dont il crée des liens entre des sujets divers par inversion. L’influence de cet ouvrage sur l’étude moderne de l’ethnographie antique ne peut être exagérée, puisque sa proposition de faire l’étude des textes antiques en tant que documents littéraires (ce qui n’était pas tout à fait nouveau pour les classicistes) ne servant pas à connaître directement les actions passées, mais plutôt les préjugés et la représentation que se faisaient de différents événements, peuples ou personnages les auteurs de ces textes (ce qui était tout à fait révolutionnaire) fit florès. En mettant de l’avant l’importance d’Hérodote comme père de l’ethnographie et en conservant l’idée d’une opposition fondamentale entre Grecs et Barbares, Hartog resta cependant rattaché à la tradition de Jacoby.
La troisième de ces publications est l’étude d’Edith Hall sur la place du Barbare (et notamment du Perse) dans les tragédies athéniennes du ve siècle[24]. Cet ouvrage, toujours cité et souvent contesté depuis quelques années, s’attarde à la manière dont les textes et la présentation des pièces (à quel moment, en utilisant quels acteurs, quelles récompenses ont été accordées, etc.) contribuèrent à créer une image du Barbare et à exposer celle-ci au public athénien. Tentant de s’extraire de certaines des critiques qui avaient été formulées à l’égard de textes classiques (nous reviendrons à celles-ci plus loin), comme leur côté élitiste et l’impossibilité de connaître leur impact réel, Hall cherche à montrer que ces tragédies, sélectionnées et subventionnées par l’État athénien, présentées devant un public de plusieurs milliers de personnes, sont un exemple clair de construction identitaire inversée et de manipulation des masses. Ses conclusions sont notamment qu’on assiste à une certaine évolution de cette construction, entre un Eschyle considéré comme violemment anti-perse et un Sophocle presque philobarbaros , et que celle-ci répond au besoin de définition identitaire des Grecs dans un ve siècle qui constituerait le premier moment de leur ouverture au monde extérieur.
Le changement de paradigme amené par la montée des cultural studies dans les années 1980 et 1990 a cependant été depuis violemment critiqué, autant par ceux qui leur reprochent d’avoir dénaturé les études classiques par haine de l’Occident[25] que par ceux considérant que leurs artisans ne sont pas parvenus à s’extraire tout à fait du carcan de l’interprétation jacobienne. On a ainsi reproché à Hartog ou à Hall de continuer à considérer Hérodote et le ve siècle athénien comme un tournant dans l’évolution de la littérature grecque, sans voir que l’auteur des Enquêtes se plaçait dans la tradition de la recherche scientifique ionienne dont les oeuvres, bien que presque toutes perdues, n’en ont pas moins existé et été influentes, et qu’Athènes n’est pas la Grèce. Leur fut aussi reproché de continuer à considérer la civilisation grecque comme l’ancêtre de la civilisation occidentale et de trop s’appuyer sur le concept d’altérité en opposant Grecs et Autres comme des pôles contraires. Bien que des ouvrages récents, oeuvres d’érudits impressionnants, continuent à défendre cette vision[26], il demeure incontestable que cette image d’une Grèce monolithique, se créant une identité en utilisant diverses figures d’Autres (la femme, l’esclave, le Barbare) pour répondre à une ouverture nouvelle sur le monde après les guerres médiques, se heurte à de nombreux problèmes.
La question de l’ethnographie pose en effet, comme l’avait souligné Hartog, celle de l’identité de celui qui écrit, de celui qui lit et de celui sur lequel on écrit. De nombreux historiens ayant travaillé sur des textes ethnographiques en vinrent donc à étudier l’ethnicité et la « grécité » définie par ces textes, ce qui ne va pas sans soulever de nombreuses interrogations. En effet, quels sont les critères qui devraient être utilisés pour considérer quelqu’un comme Grec ? Jacoby utilisait une définition assez floue, basée sur la langue, la position géographique et tout un ensemble de caractéristiques qui, selon la science de son époque, paraissaient grecques : amour de la liberté, panthéon commun, vie dans une cité-état, etc[27]. Ce cadre peut cependant sembler singulièrement restrictif et, surtout, influencé par l’image que le xixe siècle voulait se faire des Grecs. Rappelons ainsi que ceux-ci parlaient des langues aux racines communes, mais différant sur bien des points. Il est probable qu’un philologue aussi éminent que Wilamowitz-Moellendorf ait été capable d’écrire et de parler un grec attique plus pur et plus fin que la plupart des Athéniens du ve siècle. La langue semble donc un faux critère, conduisant à plus de problèmes qu’il n’en résout. La position géographique est aussi, par essence, une caractéristique terriblement subjective : les Grecs ayant colonisé une bonne partie des côtes du bassin méditerranéen et de la mer Noire, faudrait-il réserver le titre de Grec aux seuls descendants de ceux restés dans le Péloponnèse ou en Attique ? Les divinités grecques offrent de la même manière de nombreuses facettes : Zeus peut ainsi être à la fois protecteur et destructeur des navires selon la cité. La division entre habitants des cités et ceux vivant en dehors du système de la polis prête elle aussi aisément le flanc à la critique : d’une part, la définition de la polis ne provient pas des textes antiques et la majorité des habitants de ces cités-états vivait d’une manière tout à fait semblable à celle de ceux ne vivant que dans des villages ; les différentes cités variaient d’autre part énormément entre elles, Sparte l’oligarchique dorienne n’étant pas Athènes la démocratique ionienne. Ces critiques, qui peuvent être résumées par la mise de l’avant d’une construction de l’identité grecque devant plus au xixe siècle européen qu’aux textes antiques, amenèrent nombre de spécialistes à tenter de redéfinir la « grécité » des Athéniens ou des Spartiates en se servant des documents ethnographiques et du miroir d’Hartog[28].
Ces efforts restent cependant limités par divers éléments et donnent des résultats assez peu satisfaisants. Se servir d’un passage d’Hérodote ou de Thucydide pour tenter d’apercevoir l’identité grecque, extrapoler à partir de ces éléments à l’ensemble de la population de leur cité et de là à tous les Grecs revient à nier toute individualité et toute nuance. Il est en effet évident que la perception de l’étranger peut varier selon les personnes, selon les lieux et selon les moments. Étant donné la faible quantité de sources qui nous est parvenue et leur caractère monosocial et monointellectuel, comment espérer reconstruire l’identité grecque ? Une telle identité a-t-elle seulement existé, étant donné la vaste dispersion des établissements fondés ou s’estimant fondés par des Grecs ? Les efforts des historiens s’intéressant à l’ethnographie et à l’identité ayant tenté de s’extraire du cadre défini par Jacoby aboutissent donc souvent à une sorte de retour à la case départ, présentant la Grèce comme une entité monolithique[29].
Au-delà du monolithe
De ces critiques diverses sont nées des tentatives pour véritablement transcender la définition apportée par Jacoby à l’ethnographie antique. Il est important de souligner immédiatement cependant qu’il ne s’agit que rarement d’un conflit personnel ou générationnel : plusieurs des historiens qui s’étaient les premiers intéressés au concept de l’altérité comme outil pour l’étude de l’ethnographie antique sont ceux qui ont critiqué ce concept le plus vigoureusement et qui tentent aujourd’hui de lui trouver des alternatives[30]. Paul Cartledge a ainsi tenté de répondre aux critiques contre son livre The Greeks[31] en ajoutant dans une seconde édition datant de 2002 l’analyse de quelques représentations picturales de scènes présentant des Autres. Cette approche, cherchant à contourner le problème de l’origine des sources textuelles en utilisant des documents physiques (vases, mosaïques, frises, bas-reliefs), représentée notamment par un ouvrage publié sous la direction de Beth Cohen[32], se heurte cependant à l’habituelle difficulté à définir les codes culturels de ces images[33]. Elle conserve de plus l’idée générale d’une construction par opposition. C’est justement contre celle-ci que le projet entrepris depuis une décennie par Erich Gruen tente de se positionner. Par un travail rejoignant souvent celui d’Andrew Erskine ou de Josef Wiesehöfer[34], Gruen s’efforce de montrer qu’outre l’opposition et l’inversion de nombreux autres mécanismes et artifices littéraires ou artistiques existaient pour faire la description de différents peuples et les relier entre eux. Dans un livre publié en 2011 et se voulant une réponse directe à Benjamin Isaac[35], il choisit ainsi de structurer ses chapitres selon le même ordre que celui d’Isaac. Là où ce dernier soulignait les traits négatifs de la description de divers peuples dans la tradition littéraire antique, Gruen met au contraire de l’avant leurs points communs ou les liens que ces mêmes textes pouvaient établir. Le dernier ouvrage dirigé par Gruen insiste aussi sur une définition de l’identité comme un concept fluide et changeant selon les lieux, les époques et les personnes, en perpétuelle reconstruction[36].
Deux autres auteurs ont récemment suggéré des évolutions possibles pour l’historiographie moderne sur l’ethnographie antique. Le premier est Joseph Skinner qui, dans un ouvrage critiquant assez violemment le concept d’altérité, propose de déconstruire le modèle de Jacoby en considérant les textes écrits sur les Grecs comme aussi ethnographiques que ceux écrits sur les Barbares afin de réduire ce qui lui semble une frontière artificiellement hermétique. Il rejoint en cela les travaux de Gruen. Il réfute cependant l’idée souvent considérée comme évidente[37] selon laquelle le ve siècle et les guerres médiques auraient amené une grande évolution dans la perception de l’Autre et dans sa description. Se servant d’exemples divers tirés de chants de l’Iliade, de fragments de Pindare ou d’hymnes homériques, il met de l’avant l’existence d’un discours sur les étrangers et sur les Grecs dès le viie siècle et insiste notamment sur le fait que celui-ci a existé dans l’art oral et la poésie. Il est cependant important de préciser que Skinner semble parfois exagérément critique à l’égard de certains de ses collègues afin de souligner ses propres innovations. Nous considérons néanmoins très intéressante sa proposition d’étudier les textes sur les moeurs des Grecs de la même manière que ceux traitant des non-Grecs. Bien des articles traitant de la représentation d’un peuple donné chez un auteur ancien semblent en effet se concentrer à l’excès sur la description faite de ce peuple[38].
Le second de ces auteurs est Greg Woolf. Celui-ci, particulièrement connu pour ses travaux sur la romanisation progressive de la Gaule et sur les processus d’acculturation et de syncrétisme qui l’accompagnent[39], a tenté récemment d’adapter des concepts anthropologiques à l’étude de l’ethnographie antique. Il se base pour cela sur deux constats principaux : la frontière romaine est un lieu perméable et non pas un mur infranchissable séparant la civilisation de la barbarie[40]; lorsque la domination militaire n’est pas totale, lorsque les échanges locaux sont nombreux et bilatéraux (commerciaux, religieux, mixité des mariages), l’étude du colonialisme nord-américain[41] a montré que se développaient des relations spéciales dans lesquelles chacune des parties pouvait manifester des actions directes plutôt que de n’être que l’objet (la victime) de l’action d’une autre. Ce lieu, physique, mais aussi et surtout intellectuel, correspond au Middle Ground [42].
L’objet de cette nouvelle méthode est la création du savoir ethnographique antique plutôt que sa rédaction. Woolf remarque en effet que les spécialistes modernes, très intéressés par la véracité et les méthodes de présentation de ce savoir, ont délaissé le processus d’acquisition de celui-ci pour préférer considérer les informations présentées par ces textes comme essentiellement fictives. Rejetant cette idée d’une littérature qui ne serait qu’une construction mentale sans aucune prise sur la réalité, dans laquelle les Scythes d’Hérodote, les Gaulois de Tite-Live ou les Huns d’Ammien Marcellin ne seraient que des animaux de zoo plus propres à nous renseigner sur leurs visiteurs que sur eux-mêmes, il s’attarde donc au processus d’acquisition de connaissances des auteurs anciens. Outre le Quellenforschung, recherche des auteurs disparus sur lesquels les auteurs survivants auraient copié leurs écrits et dont les méandres ont happé plus d’un spécialiste, il faut pour ce faire composer avec la méthodologie proposée par Woolf.
Repoussant l’idée selon laquelle les constantes prétentions à l’autopsie des auteurs antiques seraient autant de mensonges, celui-ci cherche à déterminer de quelle manière un intellectuel vivant à Rome a bien pu obtenir des informations sur l’origine d’une tribu germaine ou les détails du culte d’une bourgade celtibère. Pour Woolf, « if we ask, then, how Tacitus knew about Germania, there is only one reasonable answer : he knew what Germans told him, and it was probably told in Latin by Germans who had learned the language in the course of years spent involved with Romans »[43]. Ceux-ci, jeunes membres de l’élite étudiant avec un grammatikos des mythes grecs qui se mélangeaient à leur mythologie locale, marchands recevant dans des transactions des bribes de savoir sur les tribus d’outre-Rhin, auxilia partageant les épreuves de jeunes officiers comme Tacite, forment le Middle Ground de Woolf. Celui-ci ne nous est aujourd’hui accessible que par les oeuvres des encyclopédistes (Pline, Strabon, etc.), seules à avoir survécu à l’épreuve du temps. Cette méthodologie, consistant à essayer d’imaginer les rencontres, les discussions et les échanges dont les excursus ethnographiques ne seraient qu’un lointain substrat, ne peut cependant s’appliquer qu’aux provinces occidentales de l’Empire romain et aux premiers temps (ier siècle avant, ier siècle après) de celui-ci, selon Woolf. La partie orientale a en effet conservé sa capacité à s’exprimer, contrairement à la Gaule ou à l’Ibérie dont les cultures pré-conquêtes se fondirent rapidement dans le moule gréco-romain[44].
Cette dernière affirmation de ce spécialiste ne nous semble cependant pas aussi évidente qu’il le laisse entendre. L’Orient romain n’a en effet jamais été entièrement grécisé et il s’agit avant tout d’un lieu de rencontres entre peuples aussi divers que les tribus arabes, les montagnards du Caucase, les élites hellénisantes des capitales des Successeurs et les cavaliers parthes issus des steppes. Nous considérons ainsi le royaume d’Arménie comme un bel exemple de mixité culturelle dans lequel, aucun des groupes en présence ne dominant clairement les autres militairement, le jeu des influences accouche justement d’une sorte de Middle Ground. Au ier siècle av. J.-C., Parthes, Romains et princes locaux, eux-mêmes partiellement hellénisés et tentant de conserver leur indépendance entre deux voisins puissants, mais somme toute assez peu présents, se partagent ainsi le pouvoir dans une région demeurant suffisamment difficile d’accès et disputée pour conserver des traits culturels propres en y mêlant ceux de ses envahisseurs/protecteurs[45]. Cette région, qui gardera pendant des siècles un rôle d’état-tampon entre Romains et Parthes, puis entre Romains et Perses avant de devenir l’un des lieux de rencontres et de frictions entre Islam et Christianisme[46], développera ainsi des traditions culturelles (notamment chrétiennes) particulières et issues de cette situation de carrefour[47]. Dans un tel entrelacs d’influences, politiques comme culturelles, dont la compréhension est nécessaire à l’analyse des événements marquant la région, le concept de Middle Ground, et notamment sa version intellectuelle développée par Woolf, pourrait permettre d’étoffer l’étude de la réaction arménienne à la conquête arabe en redynamisant l’étude des textes y faisant référence et en offrant des outils méthodologiques nouveaux permettant de détailler le contexte culturel de cet événement[48]. Le concept de Middle Ground intellectuel reste néanmoins à peaufiner.
L’exemple d’un passage des Histoires d’Ammien Marcellin, auteur romain du ive siècle apr. J.-C., permet d’illustrer cette évolution de la perception et de l’utilisation des sources ethnographiques par les historiens modernes. Dans son excursus sur les Huns[49], cet auteur détaille en effet les us et coutumes de ce peuple. Il y décrit les traits grossiers de leur physionomie, rendus plus repoussants encore par leur habitude de taillader les joues des enfants. Il évoque aussi leur posture courbée par les longues chevauchées, leur vie « sans toit », leur méfiance irrationnelle des habitations en bois ou en dur, leur ignorance du feu, leur humeur changeante et leur mépris des traités. La véracité des excursus d’Ammien Marcellin, considéré depuis Edward Gibbon comme « an accurate and faithful guide »[50], n’avait pas vraiment été remise en question par Mommsen ou Jacoby, qui se plaignaient cependant, à une époque de Quellenforschung, de ce que ses excursus n’apportaient aucun élément nouveau par rapport aux descriptions de ses prédécesseurs[51]. Les études archéologiques des dernières décennies ont pourtant montré que les Huns étaient d’une part d’habiles forgerons, fabriquant notamment les outils nécessaires à la cuisson d’aliments divers, et que leurs squelettes ne présentaient pas de déformations particulières[52]. Certains historiens ont d’autre part insisté sur les origines sociales d’Ammien pour lui prêter un programme politique d’accord avec les Goths pour contrer les Huns[53], mais surtout pour en faire le représentant de la pensée politique des petits aristocrates urbains, sans pour autant remettre fondamentalement en question le crédit que leurs prédécesseurs avaient accordé à l’ensemble de son oeuvre. Thompson avait cependant souligné l’importance de l’autopsie dans la méthode historique d’Ammien, prenant en cela le contre-pied de Mommsen ou Jacoby. Cette idée déclencha une réflexion importante au sein de la communauté scientifique, amenant par exemple Ronald Syme à tracer des parallèles entre l’Histoire Auguste et les Histoires et à affirmer que l’oeuvre de l’historien latin devait être considérée comme une oeuvre littéraire et pas seulement historique et donc replacée dans son contexte littéraire. Klaus Rosen, s’appuyant sur Thompson comme sur Syme, se basa quant à lui sur une étude de l’historiographie d’Ammien pour remettre en question l’authenticité de son récit[54], affirmant que les Res Gestae n’étaient qu’un mélange de la tendance moralisatrice de la littérature latine et de clichés hellénistiques. Cette question de l’équilibre entre faits objectifs et inventions littéraires dans l’oeuvre d’Ammien, approchée par Gibbon, développée par Thompson et affinée par Rosen, a sous-tendu depuis les années 1960 le débat historiographique.
On a observé au cours des trente dernières années à la fois une résurgence des tendances positivistes de Jacoby, l’influence des théories post-modernistes ainsi que des tentatives pour dépasser ces deux tendances. John Matthews, auteur d’un ouvrage très remarqué sur Ammien Marcellin[55], considérait ainsi que l’historien du ive siècle était somme toute suffisamment fiable pour servir de principale base à l’étude de que Matthews appelait « son » Empire romain. S’il reconnaissait que certains passages, notamment les excursus sur les Sarrasins et sur les Huns, étaient brodés à partir de topoi sur les eaters of flesh et les drinkers of milk, il ne considérait toutefois pas qu’on puisse remettre en question les Histoires à partir de ces éléments. Timothy Barnes, dans son Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality[56], insistait au contraire sur la dimension littéraire de l’oeuvre d’Ammien et notamment sur la manière dont il réutilisait des passages entiers d’oeuvres d’auteurs plus anciens, dans le but de prouver sa culture et de servir de porte-voix aux volontés politiques de l’aristocratie romaine en décrivant les Huns comme des « autres » indignes de confiance et monstrueux. Plus récemment, Gavin Kelly, dans un livre très remarqué tentant à la fois de faire la synthèse de la recherche passée et d’ouvrir de nouvelles avenues à la réflexion, met de l’avant l’intérêt de lire Ammien pour ce qu’il est et non pour ce que nous souhaiterions qu’il soit[57]. Dans son Ammianus Marcellinus : The Allusive Historian, il traite l’oeuvre du ive siècle comme une pièce de littérature plutôt que comme une source, soumettant les métaphores à une analyse critique et tentant de décoder (parfois un peu trop librement) les allusions d’Ammien. Il n’est cependant pas aussi catégorique que Barnes dans son explication de la divergence entre le contenu de ses excursus et les trouvailles archéologiques, n’insistant pas sur une quelconque volonté politique de création d’un ennemi à combattre et soulignant au contraire la nécessité pour les auteurs de l’Antiquité de se placer dans la continuité de leur tradition littéraire. Les travaux s’intéressant à cet excursus ont donc suivi une évolution semblable à celle de l’historiographie moderne sur l’ethnographie antique, se cristallisant dans un premier temps sur la question de la véracité et de l’utilité possible (étude des Huns ? étude des Romains à travers leur description des Huns ?) pour tendre, dans les dernières années, vers des efforts pour dépasser ce débat. En dépit de cette évolution, et malgré ces attentions, l’idée d’une Grèce monolithique, différente de ses contemporaines en tant qu’ancêtre des Lumières occidentales, à la Jacoby, ou raciste et se définissant par opposition à ses voisines, à la Hartog, demeure toujours majoritaire. Dans une ère où l’individualisation des identités semble pourtant la nouvelle norme, cette résistance est la preuve de la difficulté des spécialistes de l’histoire antique en particulier et des êtres humains en général à conjuguer le devoir de nuance et le besoin de spécifier les liens qui unissent différents sujets entre eux.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cédric Durand et Razmig Keucheyan, « Vers un césarisme européen », dans Le Monde diplomatique, 704 (novembre 2012), p. 3.
-
[2]
Hippocrate, Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, 16.
-
[3]
Gabor Klascinay, Michael Werner M. et Otto Gecser, Multiple Antiquities, Multiple Modernities : Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, Francfort, New York, 2011.
-
[4]
Le cas le plus évident, mais loin d’être unique, étant Polybe se plaignant au livre xii de son Histoire de la crédulité de Timée de Tauroménion face aux miracles rapportés par la populace.
-
[5]
Si ce n’est par l’appel, aussi véhément que peu respecté, à rapporter ce dont on a été soi-même témoin. Voir James Romm, The Edges of the World in Ancient Thought, Princeton, 1992 et Hans Teitler, « Visa vel lecta? Ammianus on Persia and the Persians », dans The late Roman World and its Historian : Interpreting Ammianus Marcellinus, Jan Drijvers et David Hunt, dir., Londres, 1999, p. 202-218.
-
[6]
Gregg Woolf, Tales of the Barbarians. Ethnography and Empire in the Roman West, Malden, 2011. p. 13-14.
-
[7]
L’exemple le plus connu, encore qu’imparfait, en étant probablement la Germanie de Tacite. Remarquons au passage que même dans ce genre de texte, l’objectif n’est jamais la simple description des moeurs, mais plutôt leur comparaison à des fins moralisatrices ou politiques avec celles de la culture de l’auteur. Sur la Germanie, lire Ellen O’Gorman, « No Place Like Rome. Identity and Difference in the Germania of Tacitus », Ramus, 22 (1993), p. 135-154.
-
[8]
Gregg Woolf, Tales of the Barbarians..., p. 33-36.
-
[9]
Pline l’Ancien décrit ainsi la Maurétanie en utilisant visiblement un document officiel pour citer et situer les cités avant de les placer de manière générale dans la région des Lotophages, les mangeurs de lotus drogués et inhumains évoqués par Homère dans l’Odyssée. Sur Pline, lire Valérie Naas, Le projet encyclopédique de Pline l’ancien, Rome, 2002.
-
[10]
Katherine Clarke, Between Geography and History, Oxford, 1999, cite notamment le cas du colonel Holdich et de son History of the Origins of the Kafir in the Hindu Kush.
-
[11]
Si la véracité de ces récits nous intéresse dans le cadre de cette étude, elle n’en forme pas le point central. Pour des raisons d’espace, nous renvoyons donc le lecteur intéressé par la question de la formation de ces récits ethnographiques et sur les raisons possibles expliquant qu’un officier britannique stationné au Pakistan préfère s’inspirer d’Appien que de ce qui se passe autour de sa tente à Gregg Woolf, Tales of the Barbarians...
-
[12]
Citons pour l’exemple Theodor Mommsen, « Ammians Geographica », Hermes, 16 (1881), p. 602-636.
-
[13]
Remarquons au passage que la vie de Félix Jacoby est elle-même intéressante dans le cadre de cette étude. Juif, il perdit en effet son poste de professeur en 1934 et dut s’exiler à Oxford. Il était cependant reconnu pour ses opinions politiques conservatrices et nationalistes et il avait salué l’arrivée au pouvoir d’Hitler en s’exprimant ainsi lors d’une lecture publique d’Horace en 1933 : « En tant que Juif, je me trouve dans une situation difficile. Mais en tant qu’historien, j’ai appris de ne pas considérer les événements historiques dans des perspectives privées. J’ai voté pour Adolf Hitler depuis 1927 et je m’estime heureux de pouvoir, en cette année de réveil national, lire le poète d’Auguste. Car Auguste est la seule figure historique que l’on peut comparer avec Hitler ». L’opposition entre individu et groupe étant l’un des fils rouges de l’historiographie moderne sur l’ethnographie antique, il est intéressant de constater que même le père de celle-ci ait été conscient de cette tension. Sur la vie de Jacoby et les grandes influences intellectuelles qui présidèrent à l’oeuvre de sa vie, Ward Briggs et William Calder, Classical Scholarship. A Biographical Encyclopedia, New York, 1990.
-
[14]
Andrea Zambrini, « Aspetti dell’etnografia in Jacoby », dans Carmela Ampolo, Aspetti dell’opera di Felix Jacoby. Atti del primo Seminario Arnaldo Momigliano, tenutosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2002, Pise, 2006, p. 189-200.
-
[15]
Joseph Skinner, The Invention of Greek Ethnography, Oxford, 2012, p. 30-34.
-
[16]
Victor Hanson, Why the West Has Won, Londres, 2002.
-
[17]
Henry Immerwahr, « Aspects of Historical Causation in Herodotus », Transactions of the American Philological Association, 87 (1956), p. 241-280, Henry Immerwahr, Form and Thought in Herodotus, Cleveland, 1966, Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom : The Limits of Hellenization, Cambridge, 1975.
-
[18]
Édouard Lévinas, Altérité et transcendance, Lyon, 1995.
-
[19]
Johannes Fabian, Time and the Other : How Anthropology Makes Its Object, New York, 1983.
-
[20]
Edward Said, Orientalism, New York, 1978.
-
[21]
Les principaux adaptateurs de la pensée d’Hayden White aux textes antiques sont certainement Timothy Wiseman, Clio’s cosmetics. Three studies in Greco-Roman Literature, Leicester, 1979 et Anthony Woodman A. J., Rhetoric in Classical Historiography. Four Studies, Londres, 1988.
-
[22]
Brent Shaw, « Eaters of Flesh, Drinkers of Milk », dans Ancient Society, 13/14 (1982-83), p. 5-31.
-
[23]
François Hartog, Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’Autre, Paris, 1980.
-
[24]
Edith Hall, Inventing the Barbarian, Oxford, 1989.
-
[25]
Victor Hanson, Why the West..., 2002 ou Anthony Pagden, Worlds at War: The 2,500-Year Struggle Between East and West, New York, 2008.
-
[26]
Paul Cartledge, The Greeks : A Portrait of Self and Others, Oxford, 1993 (2002). Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton, 2004. Jonathan Hall, Hellenicity : Between Ethnicity and Culture, Chicago, 2002. Cartledge est un exemple parfait de la méthode et des limites des historiens ayant fait de l’altérité leur principal outil méthodologique. Il sait en effet que les Grecs se pensaient supérieurs, physiquement et psychologiquement, aux Barbares parce qu’il l’a lu dans Aristote (Politique, 1327b, 29-32), dans des pièces d’Eschyle et d’Euripide ainsi que dans des discours d’avocats du ive siècle. Si tous les membres de l’élite intellectuelle athénienne ayant laissé des oeuvres nous étant parvenues écrivent la même chose, cela peut-il vraiment s’appliquer à toute la population de la ville d’Athènes, partant à celle de toutes les cités grecques ?
-
[27]
Robert Norton, « Wilamowitz at War », Journal of the Classical Tradition, 15/1 (2008), p. 74-97.
-
[28]
Joseph Skinner, The Invention..., p. 34-44.
-
[29]
Ibid., p. 44-58.
-
[30]
Un bon exemple de cette évolution est Erich Gruen. Ayant publié en 1992 Culture and National Identity in Republican Rome, il est depuis devenu, nous allons le voir, l’un des critiques les plus virulents de l’idée d’altérité et de construction identitaire par opposition et inversion, notamment dans Rethinking the Other in Antiquity publié en 2011.
-
[31]
Paul Cartledge, The Greeks..., Oxford, 1993 (2002).
-
[32]
Beth Cohen, dir., Not the Classical Ideal : Athens and the Construction of the Other in Greek Art, Leyde, Boston, Cologne, 2000. Notons que Paul Cartledge participa à cette publication.
-
[33]
Voir Christine Sourvinou-Inwood, Reading Greek Culture : Texts and Images, Rituals and Myths, Oxford, 1991 et François Lissarague, « Images dans la cité », Metis, 9-10 (1994-1995), p. 237-244.
-
[34]
Ils publient ainsi régulièrement dans les ouvrages les uns des autres. Ainsi Erich Gruen, dir., Cultural Borrowings and Ethnic Appropriations in Antiquity, Stuttgart, 2005, qui contient des articles d’Erskine (« Unity and Identity: Shaping the Past in the Greek Mediterranean ») et de Wiesehöfer («Rome as Enemy of Iran») et est publié dans une collection dirigée par ce dernier.
-
[35]
Erich Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton, 2011. Benjamin Isaac, The Invention of Racism…, 2004.
-
[36]
Erich Gruen, Cultural Identity in the Ancient Mediterranean, Los Angeles, 2011.
-
[37]
Remarquons cependant que plusieurs auteurs, à la suite de Benjamin Isaac, considèrent que le discours ethnographique antique, basé selon eux sur l’altérité, ne débute qu’au ive siècle, notamment avec Isocrate.
-
[38]
Citons par exemple Jan Drijvers, Ammianus Marcellinus, « Image of Sasanian Society », dans Josef Wiesehöfer et Philip Huyse, Eran und Aneran : Studien zu den Beziehungen zwischen dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt, Stuttgart, 2006, p. 46-71. Drijvers considère ainsi qu’Ammien oppose la mollesse et la violence du Roi des Rois à la mesure de l’empereur Julien dans le but de symboliser les différences entre Occidentaux et Orientaux. Pourtant, le comportement du roi perse est semblable à celui de l’essentiel des personnages romains du récit d’Ammien. Peut-être que l’objectif d’Ammien était plutôt d’opposer la mollesse générale de l’époque au caractère de son héros, Julien.
-
[39]
Greeg Woolf, Becoming Roman : the Origins of Provincial Civilization in Gaul, New York, 1998.
-
[40]
Charles Whittaker, Frontiers or the Roman Empire, Baltimore, 1994.
-
[41]
Richard White, The Middle Ground. Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815, Cambridge, 1991.
-
[42]
Gregg Woolf, Tales of the Barbarians: Ethnography and Empire in the Roman West, Malden, 2011. Gregg Woolf, « Cruptorix and his kind. Talking ethnicity on the middle ground », dans Ton Derks et Nico Roymans, dir., Ethnic Constructs in Antiquity, Amsterdam, 2008, p. 207-217. Précisons que les publications sur le Middle Ground dans l’Antiquité ont été très nombreuses dans les années 1990 et 2000 (voir notamment Irad Malkin, « Middle Ground », dans Kernos, 11 (1998), p. 131-141 et Irad Malkin, Small Greek World, Oxford, 2011, mais qu’elles se sont surtout intéressées à la question de la colonisation grecque et des rapports entre colons et autochtones. Woolf innove en tentant d’inventer un Middle Ground intellectuel et en étendant celui-ci à tout l’Occident romain.
-
[43]
Gregg Woolf, Cruptorix and his Kind..., p. 212.
-
[44]
Gregg Woolf, Becoming Roman..., New York, 1998.
-
[45]
Benjamin Isaac, The Limits of Empire, Oxford, 1990. Fergus Millar, The Roman Near East, Cambridge-Oxford, 1994. Édouard Dabrowa, dir., The Roman Near East and Armenia, Cracovie, 2003. Édouard Dabrowa, « Marc Antoine, les Parthes et l’Arménie », Rudiae, 18 (2006), p. 341-352.
-
[46]
L’Arménie chrétienne, entre Empire romain païen puis chrétien et Perse tolérante, puis mazdéenne, est l’objet de la très belle étude de Marie-Louise Chaumont : Marie-Louise Chaumont, La christianisation de l’empire iranien : des origines aux grandes persécutions du ive siècle, Louvain, 1988.
-
[47]
Nina Garsoïan, Armenia Between Byzantium and the Sassanians, Londres, 1985. Nina Garsoïan et Jean-Pierre Mahé, Des Parthes au Califat, Paris, 1997.
-
[48]
Iran Shadîd, Byzantium and the Arabs : Late Antiquity, 3 tomes, Bruxelles, 2005-2006. Sur la frontière orientale de l’Empire romain en général, Peter Edwell, Between Rome and Persia : the Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra Under Roman Control, Londres, New York, 2008.
-
[49]
Ammien, 31, 2, 1-11.
-
[50]
Gavin Kelly, « Ammianus Marcellinus : Tacitus’ Heir and Gibbon’s Guide », dans Andrew Feldherr, dir., The Cambridge Companion to the Roman Historians, Cambridge, 2009, p. 348-360.
-
[51]
Theodor Mommsen, « Ammians Geographica », p. 602-636.
-
[52]
Michel Kazanski, « Les sites archéologiques datés du ive au viie s. au Nord et au Nord-Est de la mer Noire : état des recherches », Travaux et mémoires, 1987 (10), p. 437-489, Wolfgang Richter, « Die Darstellung der Hunnen bei Ammianus Marcellinus (31,2,1-11) », Historia, 23 (1974), p. 343-377, Charles King, « The veracity of Ammianus Marcellinus’ description of the Huns », American Journal of Ancient History, 12/1 (1987), p. 77-95, Antoine Foucher, « Deux approches romaines du nomadisme : Tacite et Ammien Marcellin », Euphrosyne, 33 (2005), p. 391-401.
-
[53]
Edward Thompson, Ammianus Marcellinus, Oxford, 1947.
-
[54]
Klaus Rosen, Studien zur Darstellungskunst und Glaubwürdigkeit des Ammianus Marcellinus, Heidelberg, 1968.
-
[55]
John Matthews, The Roman Empire of Ammianus Marcellinus, Baltimore, 1989.
-
[56]
Timothy Barnes, Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality, Ithaca, 1998.
-
[57]
Gavin Kelly, Ammianus Marcellinus : The Allusive Historian, Cambridge, 2008.