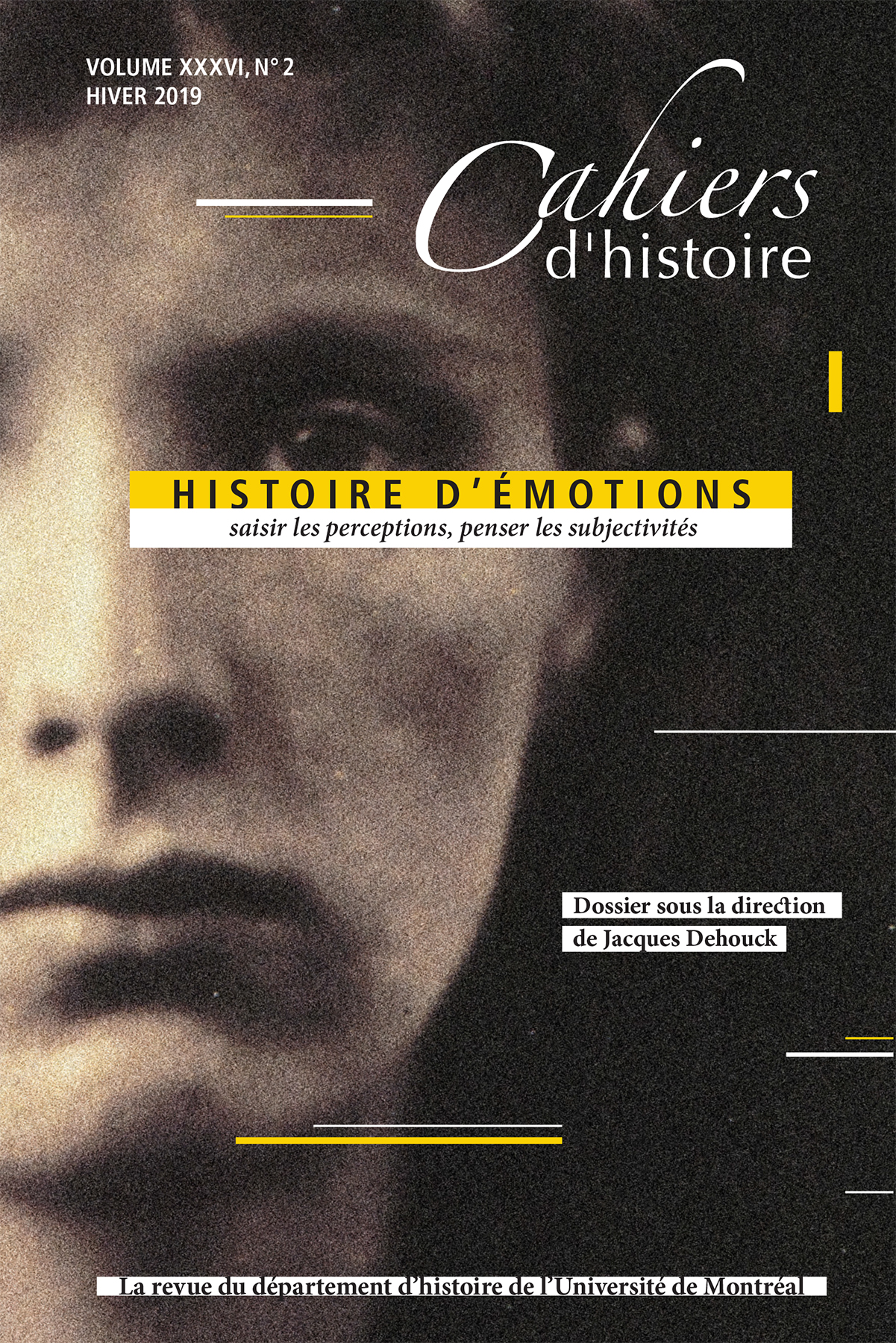Corps de l’article
De mai 68 au massacre de Tlatelolco, 1968 a été une année charnière pour divers mouvements étudiants. Dans Uruguay, 1968, l’historienne Vania Markarian cherche à démontrer en quoi le mouvement étudiant uruguayen s’inscrit dans un contexte politique et culturel global. Comment le 1968 uruguayen entre-t-il en dialogue avec les idées, les discours ou encore la contreculture qui circulent à l’échelle mondiale ? Ici, Markarian s’attarde à éclaircir la façon dont la contreculture globale contribua à façonner les identités politiques de la jeunesse et les pratiques de contestation étudiante en Uruguay. Au-delà du jeu d’échelles entre le local et le global, l’auteure cherche à mettre de l’avant l’intersection entre la violence politique, le militantisme de gauche et la nouvelle identité générationnelle, pour saisir le 1968 uruguayen comme étant le produit du chevauchement entre des phénomènes politiques et culturels.
Bien que Markarian ait recours essentiellement à des sources déjà étudiées, elle propose néanmoins une lecture révisionniste du mouvement étudiant de 1968 et, plus largement, des années 1960 en Amérique latine. Elle combine l’analyse de périodiques nationaux et des comptes-rendus administratifs de l’Universidad de la República ainsi que le magazine Huevos de la Plata et l’oeuvre d’Ibero Gutiérrez, des sources issues de la contre-culture, pour comprendre l’émergence des jeunesses étudiantes en tant qu’acteurs politiques. L’auteure remet en question le métarécit du 1968 uruguayen qui tend à proposer l’histoire d’un combat politique héroïque de la gauche, réduit à un préambule des années de dictature et de répression qui suivront. Elle considère que ces analyses ne prennent pas en compte la dimension générationnelle de la jeunesse étudiante, souvent peu politisée et influencée par la contre-culture, qui sera le coeur du mouvement de 1968. Markarian pose un nouveau regard sur ce mouvement que les historiens ont étudié en tant qu’événement au plan strictement national et politique, un regard qui témoignerait de la division entre l’ancienne et la nouvelle gauche.
Dans le premier chapitre, Markarian narre les six mois de protestation étudiante. Elle démontre que, au fil des semaines, l’université se positionnera en tant que chef de file militant pour un changement social profond, bien au-delà des seuls enjeux universitaires. Face aux méthodes répressives des forces de l’ordre, Markarian affirme que la violence devint le principal outil de revendication des étudiants, influencés par les tendances contre-culturelles adoptées par leurs homologues européens et nord-américains. Ainsi, ils revendiquaient une identité générationnelle propre, basée sur la culture de la jeunesse, face aux mobilisations étudiantes précédentes et au sein de leur propre enceinte universitaire. Au-delà du recours à la violence, Markarian propose que cette identité se manifestât aussi à travers la reconfiguration des modes de protestation traditionnels ; les manifestations de nuit assuraient une présence quasi permanente dans les rues, au grand dam du recteur de l’université, et faisaient également foi d’une rupture générationnelle.
Dans le chapitre suivant, Markarian dresse un portrait des organisations protagonistes du moment charnière de 1968 pour comprendre les changements dans le paysage politique de la gauche uruguayenne post-1968. Tandis que l’historiographie avait mis l’accent sur les divisions au sein de la gauche, Markarian propose que l’expérience directe de répression fût plus significative que l’appartenance à une tendance idéologique spécifique. Bien qu’il existait différents alignements politiques, les étudiants, politisés ou non, avaient la conviction que le pouvoir de l’action et de la rue, que leur inspirait le mai 68 français, était la voie à suivre. Plutôt que de débattre sur le contenu doctrinal de « l’ancienne gauche », ce sont ses modes d’organisation et de contestation que les étudiants rejetèrent. Cette « fluidité idéologique » pousse l’auteure à remettre en question les catégories statiques d’« ancienne » et de « nouvelle gauche » employées par l’historiographie. Markarian affirme qu’il existait plus d’éléments de convergence que de divergence au sein des activistes étudiants, ce qui témoigne de leur singularité générationnelle.
Le dernier chapitre aborde les expressions culturelles du mouvement étudiant au travers de ses représentations culturelles, pour saisir l’entrelacement entre le politique et le culturel. Elle analyse comment des icônes telles le Che, la musique de Daniel Viglietti ou encore le Ballet Guerrillero de Mary Minetti façonnaient une façon d’être jeune, faisaient appel aux sentiments et contribuaient à affirmer l’esprit de contestation des étudiants parallèlement à leur présence dans les rues. Bien que l’auteure annonce la superposition entre le politique et le culturel ainsi que le local et le global comme des axes transversaux de l’ouvrage, ce n’est que dans ce dernier chapitre qu’elle aborde réellement la façon dont la circulation globale de la contre-culture s’est incarnée en Uruguay. Par ailleurs, Markarian fait de la « culture » un concept fourre-tout utilisé à toutes les occasions, faisant ainsi rimer violence, condition féminine, productions artistiques et personnages politiques.
Cette publication en anglais s’adresse à un lectorat historien spécialiste, non seulement aux chercheurs qui s’intéressent aux années 1960 en Amérique latine, mais aussi ceux qui se penchent aux mouvements étudiants et la contre-culture globale. Somme toute, Markarian propose une réflexion stimulante sur l’émergence de la jeunesse comme acteurs politiques et sur la façon dont celle-ci changea la politique.