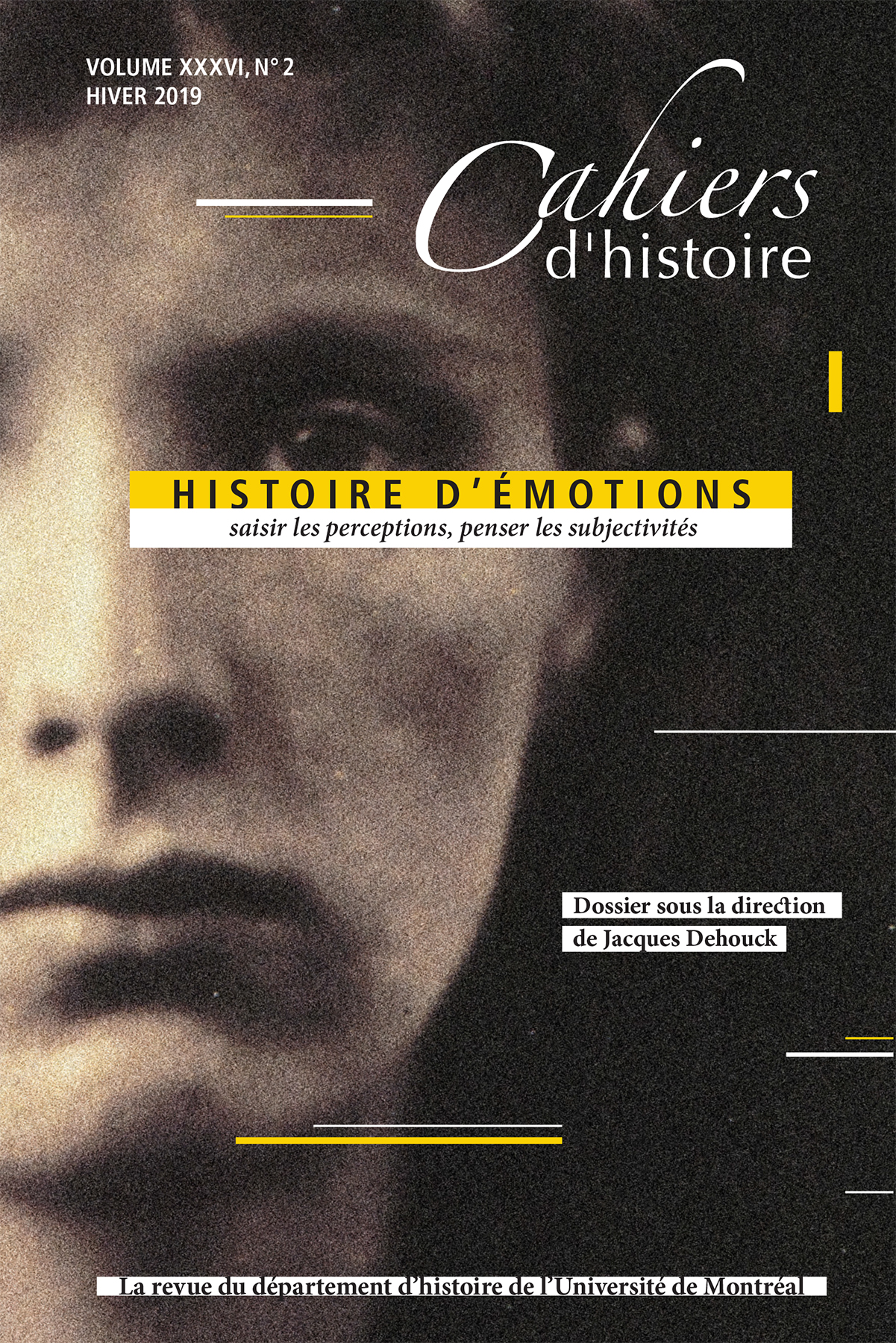Résumés
Résumé
Souvent méprisés par les critiques ou relégués à la catégorie « littérature de plage », les romans d’amour ont pourtant beaucoup à nous apprendre sur la façon dont le sentiment amoureux a évolué au fil des siècles. Que s’est-il produit pour que l’on passe de l’amour héroïque de l’époque médiévale à l’amour fluide de l’époque moderne ? Dans cette communication, nous verrons comment la définition de l’amour s’est transformée pour s’adapter aux réalités et aux exigences de la société occidentale. Nous verrons aussi le rôle prédominant de l’époque victorienne dans l’établissement d’une définition de l’amour, mais aussi du flirt, du mariage et de la félicité conjugale. Ceci nous amènera à examiner comment l’amour est appréhendé aujourd’hui et comment nous négocions l’écart entre la vision victorienne de l’amour et les impératifs du XXIe siècle.
Corps de l’article
Pourquoi parler d’amour ?
L’amour est un sujet indémodable, de Shakespeare à aujourd’hui, il n’a cessé de stimuler les passions, d’être au centre de nos conversations et de nourrir tous les domaines de l’art : théâtre, poésie, roman, musique, cinéma. L’amour est le thème universel, il existe en tout temps et en tout lieu, il va du plus banal au plus épique et il semble que les histoires d’amour ne meurent jamais, qu’elles ne sont jamais démodées. Cette omniprésence de l’amour à travers le temps et l’espace nous donne l’impression qu’il est immuable et toujours égal à lui-même. Pourtant, l’amour est constamment en transformation, il évolue au même rythme que la société dans laquelle il prendre place, suivant les valeurs dominantes et les contraintes socioéconomiques. Sa nature, son expression et son rôle se transforment, bref l’amour est en grande partie une construction sociale. Il sera ainsi question dans cet article de cette transformation du sentiment amoureux en Occident, particulièrement dans la tradition anglo-saxonne. Pour tracer le chemin de cette évolution, les romans que l’on qualifie de sentimentaux seront utilisés. Si les romans n’ont pas pour tâche de renvoyer une image parfaite de la société dans laquelle ils ont été écrits[1], ils ont l’avantage de faire ressortir, parfois de manière un peu caricaturée, les valeurs dominantes de cette société. Pourquoi choisir les romans anglais plus que les romans français ou italiens pour parler d’amour et pour tracer son évolution ? D’abord, à cause de la grande puissance politique et économique de l’Angleterre pendant des siècles (principalement du XIIIe au XXe siècle). Cette puissance a permis une large diffusion de la culture anglaise (par exemple avec ses romans) et de ses valeurs tout autour du globe, notamment à travers son empire colonial. Le Roméo et Juliette de Shakespeare est connu partout à travers le monde. Il est un symbole fort de l’amour, voire une référence universelle. Ensuite, parce que Jane Austen, les soeurs Brontë et d’autres auteures britanniques ont façonné une vision de l’amour qui dominera l’imaginaire sentimental de l’Occident pendant plus de deux cents ans. Leur contribution au développement du roman d’amour et à l’expression de ce sentiment est non seulement remarquable, mais aussi incontournable.
Cet article est divisé en trois parties, avec pour objectif une meilleure vue d’ensemble sur l’amour et ses transformations, afin de mieux comprendre l’expérience amoureuse au XXIe siècle. Les travaux de Gordon Clanton et d’Eva Illouz seront principalement considérés[2]. Nous présenterons, d’abord, la chronologie amoureuse développée par Clanton, en y ajoutant des références littéraires. Ensuite, nous aborderons les enjeux de l’amour dans la postmodernité. Finalement, nous verrons comment les romans de chick lit permettent de faire face aux exigences de la postmodernité.
Une chronologie amoureuse
Le sociologue Gordon Clanton, dans son article A historical Sociology of Sex and Love, définit six grandes périodes de l’amour en Occident. Parmi celles-ci, trois peuvent être directement reliées à d’importants courants de la littérature sentimentale.
Au début de cette périodisation, on retrouve les Grecs et l’invention de l’amour. L’amour, selon les Grecs de l’Antiquité, combine le plaisir charnel au plaisir émotionnel. Le mariage n’a aucun lien avec l’amour, il est purement utilitaire au niveau social et économique : « Greek men married women of their own class in order to produce heirs but they found “love” in their affairs with boys. »[3] Durant cette époque, il y a donc une dissociation entre amour et mariage.
La deuxième grande période de l’amour arrive avec la diffusion de la chrétienté à travers l’Occident. C’est une période où le dogme religieux soutient que d’éprouver du plaisir lors d’une relation sexuelle est un péché mortel. Comme la peur de la colère de Dieu est une menace constante, l’association de l’amour aux plaisirs corporels et émotionnels proposée par les Grecs est rejetée. L’amour doit être chaste, jamais charnel et l’acte sexuel accompli dans la peur. Il y a ainsi une dissociation entre l’amour et le plaisir. Le mariage n’est par conséquent toujours pas un lien d’amour, puisqu’il doit d’abord et avant tout servir à la gloire de Dieu. Le dogme chrétien a longtemps influencé les normes de conduites de la vie conjugale et il est possible d’en retrouver des traces dans la littérature jusqu’au XXe siècle. Cependant, la grande majorité des oeuvres de cette époque traitent de questions religieuses ou politiques et la littérature de divertissement n’existe pas. De plus, la vaste majorité de la population est analphabète et donc la définition de l’amour ne peut se transmettre de façon écrite, mais seulement de façon orale. Ainsi, bien que l’héritage chrétien soit indéniable, il n’est pas possible de lui associer un courant littéraire contemporain.
La troisième période commence au XIe siècle et prend fin avec le règne de Louis XVI (1754–1793). C’est pendant ce temps que se développe le roman, jusqu’à ce qu’il prenne la forme qu’on lui connait aujourd’hui[4]. C’est la grande époque de l’aristocratie médiévale et de la chevalerie. Cette période est marquée par l’invention de l’amour courtois, qui s’accompagne évidemment du roman courtois. Ici, il n’est pas encore question d’amour conjugal, en fait les plus grandes histoires d’amour sont généralement extra-conjugales. Le mariage est encore considéré comme un accord politique qui permet de perpétuer la lignée, élément essentiel pour maintenir le pouvoir de l’aristocratie. Encore une fois, nous pouvons observer une dissociation entre amour et mariage, puisqu’il n’est pas question de mettre des sentiments dans une affaire politique. On trouve donc l’amour ailleurs que dans la vie conjugale et comme c’est un sentiment que l’on ne rattache pas à la vie politique, on se permet d’être excessif dans son expression et dans son ressenti. L’amour courtois est caractérisé par la tendresse et la passion, mais il n’est jamais consommé[5] ; on se brûle d’amour, on meurt d’amour, on se noie dans la souffrance de ne pouvoir dire et prouver à l’être tant désiré tout ce que l’on ressent. C’est un amour dévastateur, voire dangereux. Toutefois, c’est un amour qui doit rester chaste, parce qu’on ne peut pas se permettre d’avoir des héritiers illégitimes qui pourraient avoir des prétentions au titre ou à la fortune. L’amour courtois, c’est aussi la grande époque des chevaliers qui sont contraints de toujours être prêt au combat pour défendre leur terre, leur roi, l’honneur et Dieu lui-même. Dans de telles circonstances, les romans se doivent de montrer l’exemple. Ils présentent donc un amour qu’il faut mériter, gagner et défendre au même titre que sa foi et son royaume. Comme le soulève Ellen Constans, la valeur de l’amour réside dans le dépassement de soi, il faut être prêt au sacrifice[6]. Les chevaliers partent donc en guerre afin de prouver leur valeur à l’être tant désiré. Cependant, le roman courtois a habituellement une fin tragique, l’un des deux amoureux, parfois même les deux, meurt généralement avant d’avoir pu embrasser l’être aimé. Ce sont souvent des amours inachevés. Parmi les romans courtois les plus connus, il y a La princesse de Clèves de Madame de la Fayette, L’Astrée d’Honoré d’Urfé et Tristan et Iseut. Toutefois, l’intensité et la passion de l’amour courtois soulèvent de nombreuses inquiétudes tant au sein du clergé que de la noblesse elle-même. Cet amour finit par se transformer pour devenir une sorte de jeu où le vainqueur est celui qui s’exprime le mieux et maîtrise l’art de la poésie. On maintiendra les grandes déclarations d’amour, sans véritablement se laisser consumer. Ainsi, cette époque laisse derrière elle de nombreuses expressions pour décrire la passion amoureuse : « Many motifs of courtly love are still with us today, for example, the belief that there is one right person in the world for each of us, that we fall in love, that love is blind to the lover’s faults, and that love conquers all. »[7] Cependant, cet idéal de la passion non consommée est une frivolité de la noblesse qui s’est quelque peu libérée du joug de l’Église et qui craint moins le jugement de Dieu grâce aux indulgences. La naissance du protestantisme vient changer cette définition de l’amour comme étant passionnelle et frivole.
Ce sont donc les protestants qui permettent la délimitation de la quatrième période en développant l’amour puritain et en inventant le mariage moderne. En effet, ils sont les premiers à réunir l’amour, le sexe et la camaraderie à l’intérieur du mariage. Le sexe n’est plus vu comme un pêché honteux, quoi qu’il reste encore un sujet tabou. La femme est considérée comme un compagnon, voire un associé, presque égal à l’homme. Le mariage est non seulement une association économique et sociale, mais aussi sentimentale. C’est durant cette période que l’on développe le concept d’âme soeur et que l’on commence à parler d’une unité familiale. L’amour puritain se développe particulièrement en Amérique du Nord et dans les autres colonies britanniques[8]. Bien qu’il y ait peu de romans qui aient été écrits à l’époque, la littérature américaine et canadienne porteront les traces de cet amour puritain pendant plusieurs décennies. On peut notamment penser aux romans d’Édith Wharton.
Bien que certains traits et certaines caractéristiques de l’amour développés au cours de ces quatre premières périodes persistent jusqu’à aujourd’hui, c’est surtout la cinquième période identifiée par Clanton qui aura la plus grande influence quant à la construction de l’amour moderne : c’est celle de l’ère victorienne et de l’invention de la pudeur. En termes de littérature, les auteurs n’attendent pas l’ascension de la reine Victoria sur le trône pour mettre en place les principales caractéristiques de l’amour victorien. Un amour qui, comme nous le verrons, est construit à travers de rigides normes sociales, un amour que l’on tente le plus possible de rationaliser.
Au XIXe siècle, l’élévation de la pudeur comme une qualité relevant de la sainteté est une conséquence inattendue de l’industrialisation. En effet, avec la montée en puissance à la fois politique et économique de la bourgeoisie, ces nouveaux riches tentent d’adopter ce qu’ils croient être les manières de l’aristocratie :
The newly-rich bourgeois factory-owners lacked the social standing of the families with “old money” and social position. Perhaps to compensate, these nouveau riche entrepreneurs—and, especially, their wife—adopted what they believed to be the manners of the aristocracy, a style calling for strict control of the emotions and, especially, of sexuality[9].
L’influence que ces derniers ont sur la société britannique est si importante à cette époque, que leur éthique de la pudeur se répand rapidement à travers toutes les classes sociales, puis en dehors des frontières de l’Angleterre. C’est une époque où il faut protéger la pudeur des gens, ne pas les soumettre à la tentation. On évite donc de parler de cuisse ou de poitrine de poulet et on adopte la mode des robes à taille empire, qui se gardent bien de souligner les courbes des femmes. On ira plus loin encore, au cours du XIXe siècle, non seulement l’éducation des filles et des garçons se fait séparément, mais même après l’enfance, hommes et femmes évoluent dans des sphères différentes. Ils ont chacun leurs pièces dans la maison, chacun leurs activités et se côtoient somme toute très peu. Les moments d’intimités entre l’homme et la femme sont rares et ne peuvent avoir lieu qu’entre un couple marié. La cour, elle, se fait toujours en public sous l’oeil attentif des chaperons (lors des bals par exemple) et le mariage est considéré de façon pragmatique : l’homme a besoin d’héritiers, la femme a besoin de sécurité financière et sociale. L’amour ou le manque d’amour dans ce genre de mariage relève du hasard. Il est souhaitable, mais pas nécessaire pour que l’union soit considérée comme bonne. Le mariage victorien n’a pas intégré la vision puritaine où l’amour, le sexe et la camaraderie se retrouvent tous à l’intérieur du mariage. Bien que certains auteurs, comme Jane Austen, présentent l’idée qu’un mariage sans amour est une faute éthique, il faudra attendre encore un peu pour voir dans l’amour un critère important pour le mariage, nous y reviendrons.
Au XIXe siècle, les romans occupent une place plus importante dans les loisirs, particulièrement pour les femmes. Le roman est à la fois une source de divertissement et d’éducation morale pour ses lecteurs, mais surtout pour ses lectrices. L’époque victorienne donne naissance à deux genres de romans sentimentaux, qui connaîtront chacun une grande popularité : le roman gothique et le roman de l’amour conjugal. Un des représentants les plus célèbres du roman d’amour gothique est sans doute Les mystères d’Udolpho par Ann Radcliff. Le roman gothique est une grande source de divertissement contre la monotonie de la bonne société anglaise et de ses mariages platoniques de convenance. Il permet d’échapper quelques instants à l’étiquette oppressante, ne serait-ce que dans l’imagination. Celles-ci se délectent de pouvoir vivre leurs émotions interdites ou réprimées sans aucun risque d’atteinte à leur réputation. Le roman gothique situe généralement son action dans le sud de la France, en Espagne ou en Italie, là où les moeurs sont considérées plus légères, les gens plus frivoles et la vie plus libre, voire sauvage. Pour les auteurs comme pour les lectrices, il est évident que ce genre de situation ne peut jamais arriver sur le sol anglais. Le roman gothique divertit, mais il enseigne aussi, par l’intermédiaire d’une héroïne un peu naïve, l’importance de la maîtrise de soi. En effet, l’héroïne n’a le droit à l’amour qu’une fois qu’elle sait surmonter toutes ses peurs irrationnelles et prouver qu’elle peut résister à la tentation[10]. Pour leur part, les romans de type amour conjugal, parmi lesquels on retrouve ceux de Jane Austen, sont beaucoup plus attachés aux valeurs de la société anglaise. Il n’y a pas de donjon hanté ou de forêt effrayante, simplement une jeune fille qui apprend à naviguer dans la société : comment choisir les bons cercles sociaux, à qui faire confiance, mais surtout comment protéger sa réputation et sa vertu. Bien que l’héroïne trouve toujours l’amour, celui-ci ne sort jamais des conventions sociales, car « l’amour conjugal n’est légitime qu’entre des jeunes gens socialement et culturellement compatibles. »[11] Il n’y a donc pas d’aventure, de grandes émotions ou de mariage en dehors de son rang, car le bonheur est dans le respect des conventions. Parmi les romans du genre amour conjugal, on retrouve aussi le grand succès de Samuel Richardson : Pamela ou la vertu récompensée. Ici, pas d’apparition surnaturelle ou de débordement d’imagination. On reconnait tout de suite la société anglaise et les moeurs qui lui sont associées. L’héroïne est récompensée parce qu’elle résiste aux avances de son patron, elle protège sa vertu et elle fait preuve de résilience devant l’adversité. Elle a donc le droit à un mariage qui lui donne une bien meilleure sécurité sociale.
Bien que le style soit complètement différent, ces deux genres de romans ont pour objectif d’enseigner le courage, la maîtrise de soi et le respect des conventions. Une crainte subsiste tout de même sur l’effet que ces romans pourraient avoir sur la jeunesse, particulièrement féminine, qui est perçue comme légère, crédule et facilement impressionnable. Ces femmes pourraient également avoir tendance à croire que l’amour est la chose le plus importante, au-dessus des principes et du maintien d’une bonne réputation. Cette crainte des effets dévastateurs des romans d’amour sur ses lectrices perdure jusqu’à ce jour. La sociologue Eva Illouz relève que :
La généralisation de la lecture chez les femmes fut dénoncée tout au long du XVIIIe siècle en raison du caractère moralement pernicieux du roman, laissant entrevoir la peur qu’il ne change la nature des attentes émotionnelles et sociales des femmes. La féminisation du genre romanesque, de son public et de ses auteurs, exacerba l’idée selon laquelle les romans encourageaient des sentiments dangereux[12].
Ce type de roman emmène ainsi une pléiade de publications, romans, essais, articles de magazine, qui ont pour objectif de guider les femmes en amour, afin d’éviter les écueils et de trouver le bon partenaire tout en respectant les règles de la bienséance. C’est peut-être pour cette raison que les romans de type amour conjugal sont mieux accueillis que les romans gothiques.
Malgré la méfiance envers le roman d’amour, c’est l’époque victorienne qui donne naissance à deux des auteures les plus influentes du genre sentimental : Jane Austen et Charlotte Brontë. La première s’inscrit dans la tradition du roman de l’amour conjugal, alors que la deuxième est une héritière du roman gothique. Leur influence sur la littérature et sur notre définition de l’amour est tellement grande qu’elle perdure encore aujourd’hui. Nombre de romans contemporains utilisent encore la structure narrative de Charlotte Brontë dans Jane Eyre, où dès la première scène le lecteur est plongé dans l’action, le contexte et le passé du personnage ne lui seront révélés que plus tard. Les héroïnes de Jane Austen, vives d’esprit, autonomes, indépendantes et refusant de se marier si ce n’est pas pour un amour véritable, sont devenues l’archétype de l’héroïne du roman sentimental. Plus encore, notre définition de l’amour est encore, à ce jour, un savant mélange entre la prudence rationnelle d’Elizabeth Bennet et la passion dévorante de Jane Eyre. Ensemble, elles ont instauré le précepte selon lequel il faut non seulement aimer la personne, mais il faut aussi que le mariage soit convenable. Pour Austen, comme pour Brontë, c’est seulement dans un mariage respectable que l’héroïne peut trouver l’amour. On assiste, enfin, à la fusion entre le mariage et l’amour. L’amour victorien se doit d’être rationnel, il faut donc, d’abord, s’assurer que c’est un bon parti. Ensuite, il est possible de développer des sentiments à l’égard du prétendant, l’amour prend du temps : « La ritualisation de l’amour protégeait les femmes du règne des émotions, qui pouvaient les submerger. »[13] Les lectrices apprennent alors à suivre les codes, poser les bons gestes et dire les bons mots afin de naviguer en toute sécurité sur le marché matrimonial. Elles apprennent aussi à faire une liste de critères et à peser les pour et les contres avant de baisser leur garde et de se laisser aller aux sentiments. C’est une approche de l’amour et des relations amoureuses qui est encore mise en pratique au XXIe siècle, bien que les codes sociaux aient grandement évolué.
La sixième et dernière période définie par Clanton est celle de l’amour au XXe siècle, qui est entre autres marqué par la révolution sexuelle. Depuis l’époque puritaine, dans une progression lente, mais constante, l’amour est devenu un facteur de plus en plus important lorsqu’il est question de mariage. C’est enfin l’époque où les amours sont libérés, les contraintes socioéconomiques et raciales ne pèsent plus autant dans la balance lorsque vient le temps de faire un choix et l’on peut profiter d’une vie sexuelle épanouie. Au XXe siècle, un mariage sans amour est devenu un fait presque inconsidérable, puisque les attentes face à une telle union ont changé.
Bien qu’il y ait eu une multiplication de la production et de la publication des romans au cours du siècle dernier, en matière sentimental, une catégorie se distingue nettement du reste : les romans Harlequin. La plus grande différence entre le roman victorien et le roman Harlequin se retrouve sans doute dans la prédominance du langage de la psychologie : « The new twist in the twentieth century and byond is the language of psychology, not yet available to the victorians […]. »[14] En effet, les héroïnes elles-mêmes n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque de Jane Austen et les romans Harlequin semblent vouloir trouver la formule magique qui donnera un mariage heureux à tous les coups. Comme si pour avoir une fin heureuse, l’héroïne doit absolument avoir certaines qualités et agir d’une façon bien précise avec la gent masculine. Cette fois seulement, il ne s’agit pas tant de respecter les conventions sociales, mais plutôt d’apprendre à s’aimer, à faire confiance, à ne pas se laisser guider par la passion, mais aussi être capable de s’abandonner au désir le moment venu. À la fin, si elles ont bien joué leur rôle, chacune a le droit à son dénouement heureux. Bien que jouissant d’une grande popularité, les romans Harlequin sont durement critiqués, notamment par les approches féministes des années 1970 et 1980. Ils sont jugés insignifiants, répétitifs et donnant des modèles féminins faibles aux lectrices[15]. Rapidement, les romans Harlequin sont qualifiés de « lecture d’évasion », car même si les lectrices n’ont pas eu leur propre Happy-Ending, elles peuvent au moins y rêver à travers ces romans à l’eau de rose. Les critiques adressées au roman Harlequin ne sont pas sans rappeler celles essuyées par le roman gothique plusieurs décennies plus tôt. Dans les deux cas, on craint les effets négatifs que pourraient avoir de telles lectures sur les femmes, faisant passer les émotions avant la raison et créant des attentes irréalistes. Dans tous les cas, on semble douter de la capacité des lectrices à faire la distinction entre la réalité et la fiction.
La périodisation proposée par Clanton se termine au XXe siècle. Trois décennies se sont écoulées depuis la publication de son article et l’âge d’or du roman Harlequin est bien derrière nous. De nombreuses transformations, qui affectent les relations amoureuses au quotidien, ont eu lieu, que ce soit le développement des technologies de communication (Internet et les sites de rencontre), la présence accrue des femmes sur le marché du travail et aux postes de pouvoir ou encore la banalisation du divorce. L’amour semble être à un tournant et il serait nécessaire d’ajouter une septième période au découpage : celle de la postmodernité.
L’amour fait plus mal dans la postmodernité
Nous avons vu qu’à l’époque victorienne le bonheur et l’amour dans un mariage relevaient du hasard. Il ne servait à rien de se préoccuper des sentiments de l’autre, de chercher à savoir s’il nous aime véritablement, puisque la respectabilité du mariage primait sur les sentiments amoureux qui pouvaient en être la source. Le mariage avait d’abord et avant tout une fonction sociale, il n’était pas encore un pur symbole romantique. Au XXIe siècle, l’amour doit être à la source de toute union et il faut savoir l’entretenir, voire le rallumer, puisque c’est l’amour qui doit être la raison principale pour rester avec cette autre personne. Ce n’est plus tellement le respect des conventions sociales ou le maintien d’une sécurité socioéconomique qui donne son importance au mariage, mais plutôt la garantie de maintenir le sentiment amoureux dans un engagement très personnel, individuel. C’est pourquoi il est étonnant de constater que malgré la transformation et l’évolution des conventions sociales en matière d’amour et de mariage, l’idéal-type de l’amour, lui, n’a pas changé, il est encore issu de l’époque victorienne, inspiré de Jane Austen et de Charlotte Brontë. En effet, ces deux auteures continuent de connaître une grande popularité, leurs romans sont régulièrement adaptés au cinéma ou à la télévision, ils sont étudiés dans les universités et ils font partie de la culture populaire. De nombreux admirateurs ont écrit des suites (fanfiction) à Orgueil et préjugés et à Jane Eyre, nous continuons d’admirer le caractère vif d’Elizabeth Bennet et Mr. Darcy est devenu l’archétype du grand brun ténébreux. Plus encore, il existe de nombreux livres qui se veulent des guides sur comment agir pour « avoir un mariage à la Jane Austen » ou « trouver son propre Mr. Darcy ». Bref, ces romans continuent de faire rêver et de soulever les passions, ils continuent d’assumer leur rôle de guide. Pourtant, il y a bien un écart entre la réalité du XXIe siècle et celle de Jane Austen. On ne peut plus flirter comme il y a deux cents ans, on ne tombe plus en amour de la même façon ni pour les mêmes raisons. C’est en partie cet écart entre le modèle amoureux Austen-Brontë, qui continue d’être perpétué et utilisé comme idéal à atteindre, et la réalité des contraintes de la postmodernité, qui crée un désenchantement face à la promesse de l’amour. On ne peut et ne veut être une héroïne victorienne, mais on souhaiterait vivre un amour aussi simple, profond et constant que celui présenté dans cette littérature.
Parmi toutes les différences entre l’amour victorien et l’amour postmoderne, trois semblent être particulièrement importantes pour creuser cet écart d’insatisfaction. La première grande différence est la responsabilisation de l’individu dans pratiquement toutes les sphères de sa vie. Dès la fin du XXe siècle, on assiste à une grande autonomisation de l’individu qui devient enfin le maître de sa vie et peut donc agir comme il le désire. C’est aussi une transformation du type de contraintes sociales, il ne suffit pas de prendre sa place dans la société et de jouer son rôle, il faut trouver sa place, être le héros de sa propre histoire, prendre ses propres décisions et travailler à son bonheur. Chacun est donc libre de choisir le métier qu’il veut faire, l’endroit où il veut habiter, les vêtements qu’il veut porter et la personne qu’il veut aimer. C’est une grande libération de l’individu, mais cela veut aussi dire que chacun est responsable de son propre bonheur et par conséquent de son propre malheur. Ce n’est plus une question de hasard. Dans cette logique de responsabilisation, si l’on n’est pas satisfait et heureux avec notre emploi, notre logement ou notre conjoint on ne peut blâmer que soi-même. Ainsi, le succès d’une relation amoureuse repose sur l’individu, contrairement à l’époque de Jane Austen où cela reposait sur la chance. Cette transformation est notamment remarquable dans l’évolution des romans d’amour à travers le choix de la narration. Alors que les romans de l’époque victorienne préconisent généralement un narrateur omniscient qui connait et contrôle la destiné des personnages, au XXIe siècle c’est la narration à la première personne, particulièrement sous la forme d’un journal intime, qui dominera dans la littérature sentimentale, faisant du personnage principal le narrateur de sa propre histoire et donc le maître de son propre destin, de son propre bonheur (Le diable s’habille en Prada, par Lauren Weisberger est un bon exemple de ce type de narration).
Ceci nous amène à la deuxième grande différence entre l’époque victorienne et la postmodernité : l’injonction au bonheur. Dans la postmodernité, le bonheur est la quête ultime[16], tout le monde doit être heureux tout le temps, avec ou sans prozac. Il ne suffit pas de vivre ou même de bien vivre, il faut être heureux ou du moins être en train de travailler à son bonheur. Ceci veut dire que chaque action entreprise doit contribuer d’une façon ou d’une autre à atteindre cet état de bonheur, entrainant la fameuse phrase : « Je vais être heureux lorsque […]. » Idéalement, il faut que ce soit un bonheur continu, chaque minute de chaque jour. C’est un rythme lourd à suivre, voire angoissant, qui pousse l’individu postmoderne à constamment remettre en question et à réévaluer son mode de vie, ses choix et ses relations. Donc, s’il n’est pas heureux d’aller travailler tous les jours il peut changer d’emploi, si ses vêtements ne le font pas sentir bien il peut changer de garde-robe, s’il ne vit pas le parfait amour à chaque instant il peut changer d’amour. Le pouvoir et la facilité d’être en mesure de changer d’emploi, de ville ou d’amour à chaque instant et plusieurs fois dans une vie entraînent une grande instabilité qui peut être affolante et oppressante. L’individu postmoderne se retrouve face à une question sans réponse : « est-ce le mieux que je puisse faire ? Est-ce la meilleure personne pour moi ou existe-t-il sur terre une autre personne qui me rendrait encore plus heureux ? » Ce genre d’angoisse n’existe pas dans l’univers de Jane Austen et c’est peut-être, entre autres, pour cela que l’on veut continuer de croire à l’amour victorien. Ce sont les sages paroles de Charlotte Lucas dans Orgueil et préjugés qui expriment peut-être le mieux cette logique amoureuse rassurante : « Vous savez que je ne suis pas romanesque—je ne l’ai jamais été-, un foyer confortable est tout ce que je désire […]. »[17] Charlotte ne se demande pas si elle peut faire mieux, elle semble être satisfaite avec l’adjectif « confortable ». À l’époque victorienne, il n’est donc pas question de bonheur, mais plutôt de respectabilité et de sécurité. En choisissant le taciturne Mr. Darcy, Élizabeth Bennet s’assure une sécurité qu’elle n’aurait jamais connue avec le charmant Wickham. Il est vraisemblable de croire que ce n’est pas la joie tous les jours avec Mr. Darcy qui n’a pas un caractère conciliant, mais Elizabeth n’a probablement jamais songé à le quitter parce que ses dix mille livres de rente par année[18] lui assuraient une sécurité et une respectabilité plus importante que son bonheur conjugal. Elizabeth n’avait pas besoin de faire en sorte que son mariage fonctionne, par contre, elle devait s’assurer que leur statut social soit maintenu en s’occupant de l’entretien de la maison, en donnant des réceptions et en produisant des héritiers. Ajoutons à cela que cette apaisante stabilité économique et sociale semble être un objectif plus réaliste pour les lecteurs du XXIe siècle que de vouloir vivre une félicité conjugale perpétuelle. L’injonction au bonheur de la postmodernité met donc énormément de pression sur l’individu, mais aussi sur le couple, parce que chacun est responsable de faire en sorte que la relation fonctionne, sans cela ils feront tous les deux face à l’échec.
La troisième et dernière grande différence qui sera abordée ici est celle du risque. À l’époque victorienne, il y a tout un processus de séduction bien établie qui se déroule entièrement en public. Chacun sait comment agir ou connait les codes et les gestes. Il est facile de savoir si un gentleman est intéressé, il n’y a qu’à suivre le protocole[19]. Il y a donc peu de place pour l’incertitude dans le processus de cour et une fois que le mariage a eu lieu, il est fort probable que ce soit effectivement la mort qui sépare les deux époux. Aujourd’hui, il n’existe plus de marche à suivre pour savoir si quelqu’un est intéressé, s’il nous aime bien ou si cela peut devenir une relation durable. Il faut constamment interpréter les signes, qui peuvent changer d’un endroit à l’autre, d’un partenaire à l’autre. De plus, le mariage est de moins en moins considéré comme une promesse à vie, puisque le divorce est maintenant une option accessible. Il faut donc prendre le risque, mais puisque c’est la recherche du bonheur qui prime, « tomber en amour » devient l’un des plus grands risques du XXIe siècle. Comment savoir si cette personne nous rendra vraiment heureux à court, moyen ou long terme ? Est-ce qu’une autre personne aurait été en mesure de nous rendre encore plus heureux ? Lorsque le doute plane et que le risque est grand, il semble préférable d’adopter une attitude très rationnelle pour appréhender l’amour, afin de faire le bon calcul coût-bénéfice. Il n’est pas étonnant, alors, que l’on cherche une formule ou un procédé qui pourra nous garantir le bonheur ou du moins minimiser les risques. L’industrie du développement personnel (self-help) a bien compris cet enjeu de la postmodernité où l’injonction au bonheur oblige l’individu à prendre des risques, ce qui crée de l’angoisse. On offre donc des méthodes pré-faites pour atteindre nos objectifs de bonheur. Les livres de self-help promettent de montrer en quelques étapes faciles comment être plus performant, comment devenir riche et bien sûr comment trouver l’amour. On se retrouve alors loin de la prémisse du roman Harlequin ou l’amour est dépeint comme un bonheur anticipé et non comme une source de risque et d’angoisse. Il devient alors évident que les romans Harlequin ne répondent pas à la réalité de la postmodernité. Toutefois, cette dernière a vu naître son propre genre littéraire pour faire face à la vie du XXIe siècle : la chick lit.
La chick lit à la rescousse des amours postmodernes
Si les romans de Jane Austen pouvaient servir de guide à leur lectrice pour les aider à gérer leurs relations amoureuses, à l’époque victorienne, sans faire de faux pas, la chick lit a définitivement repris ce rôle pour guider les femmes du XXIe siècle dans les méandres des amours postmodernes. La chick lit est un genre littéraire qui fait son apparition au début des années 1990, notamment avec l’iconique Journal de Bridget Jones, par Helen Fielding. Ce sont des romans écrits par des femmes et pour des femmes dans un style ironique et léger[20]. La chick lit serait une descendante directe des romans d’amour conjugal de l’époque victorienne, particulièrement ceux de Jane Austen (de nombreuses auteures de chick lit font d’ailleurs des clins d’oeil au personnage de Mr. Darcy dans leurs romans). Cependant, les romans de chick lit se démarquent de l’oeuvre d’Austen, ou même des romans Harlequin, en mettant en scène des héroïnes imparfaites. En effet, l’héroïne de chick lit typique a dans la fin vingtaine, début trentaine, elle travaille généralement en journalisme, en télévision ou en publicité, elle habite dans une grande ville occidentale, elle a une meilleure amie, mais surtout elle est imparfaite. Elle boit trop, elle fume trop, elle a quelques kilos en trop, elle est maladroite et impulsive. Plus encore, sa vie amoureuse semble être un désastre au début du roman, puisqu’elle n’arrive pas à décoder les signes, à dire les bonnes phrases ou même à bien juger les hommes qu’elle rencontre. Elle est constamment tiraillée entre écouter son coeur et suivre les conseils des magasines féminins, se mettant ainsi régulièrement les « pieds dans les plats » lorsqu’elle choisit d’écouter le mauvais conseil. Bref, elle se sent souvent inadéquate et pas toujours à la hauteur des défis proposés par la société dans laquelle elle vit. C’est une héroïne qui se veut aussi ordinaire, à travers laquelle nombre de lectrices pourront se reconnaître. Pourtant, cette héroïne imparfaite remplit le même rôle qu’Elizabeth Bennet : elle montre la voie à suivre pour trouver l’amour et avoir sa fin heureuse. Cette fois seulement, l’héroïne de chick lit répond aux exigences de la postmodernité et semble réduire l’écart entre la réalité et la fiction. L’innovation majeure réside dans le fait que l’héroïne de chick lit a le droit à l’erreur. Elle peut en faire autant qu’elle le veut et se tromper dix fois d’amour. Tant qu’elle continue de travailler à être la meilleure version d’elle-même, elle aura le droit à sa fin heureuse, c’est ce que nous apprend par exemple Carrie dans Sex and the City. C’est en effet la solution que propose la chick lit pour contrer l’anxiété générée par les exigences de la postmodernité. Ces romans nous disent que le bonheur est quelque chose qui se travaille, que malgré toutes les erreurs et les maladresses il est toujours possible de prendre la bonne décision qui nous remettra sur le bon chemin, celui du bonheur. Ils nous disent qu’il faut prendre le risque, quitte à devoir recommencer, parce que l’amour existe, plus encore il aimera les imperfections. L’amour dans la postmodernité devient un outil qui sert à réaliser cette injonction au bonheur.
Nous n’avons sans doute pas fini d’entendre parler d’amour. Des Grecs jusqu’à nos jours, il semble être en effet un sujet indémodable, qui soulève passion et débat. Bien qu’il semble relever d’une force immuable, être toujours égal à lui-même, l’amour change au même rythme que la société dans laquelle il se trouve. Il me semble que nous sommes justement à l’un de ces moments de transition. L’amour tel que défini par l’époque victorienne, par Jane Austen et Charlotte Brontë, n’existe plus, son rôle n’est plus le même. Il est peut-être temps, alors, de revoir notre définition, nos attentes et même nos institutions afin de réduire l’écart avec la réalité et minimiser nos déceptions. Nous sommes peut-être seulement nostalgiques des amours à la Jane Austen, qui semblent si simples de notre point de vue, mais nous savons qu’ils appartiennent à une autre époque.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Gisèle Sapiro, Sociologie de la littérature, Paris, La Découverte, 2014.
-
[2]
Gordon Clanton, « Historical Sociology of Sex and Love », American Sociological Association, Teaching Sociology, vol. 15, n°3, 1987, pp. 307–311 ; Eva Illouz, Pourquoi l’amour fait mal : L’expérience amoureuse dans la modernité, Paris, Éditions du Seuil, 2012, 452 p.
-
[3]
Clanton, « Historical Sociology », p. 308.
-
[4]
Dans la tradition anglaise, cette période est appelée « rise of the novel ».
-
[5]
Ibid., p. 309.
-
[6]
Ellen Constans, Parlez-moi d’amour : le roman sentimental : des romans grecs aux collections de l’an 2000, Limoges, PULIM, 1999, p. 52.
-
[7]
Clanton, « Historical Sociology », p. 309.
-
[8]
Ibid.
-
[9]
Ibid.
-
[10]
Valérie De Courville Nicol, Le soupçon gothique : L’intériorisation de la peur en Occident, St-Nicolas, Les Presses de l’Université Laval, 2004.
-
[11]
Pierre Lepape, Une histoire des romans d’amour, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p. 158.
-
[12]
Illouz, Pourquoi l’amour fait mal, p. 378.
-
[13]
Ibid., p. 65.
-
[14]
Susan Ostrov Weisser, The glass slipper, women and love stories, New Brunswick, Rutgers University Press, 2013, p. 51.
-
[15]
Janice A. Radway, Reading the Romance; Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press, 1991, 276 p.
-
[16]
Sara Ahmed, The Promise of Happiness, Durham, Duke University Press, 2010.
-
[17]
Jane Austen, Orgueil et Préjugés, Paris, Éditions 10/18, 2007, p. 136.
-
[18]
Illouz, Pourquoi l’amour fait mal, p. 230.
-
[19]
Ibid.
-
[20]
Caroline J. Smith, Cosmopolitan Culture and Consumerism in Chick Lit, New York, Routledge, 2008, p. 2.