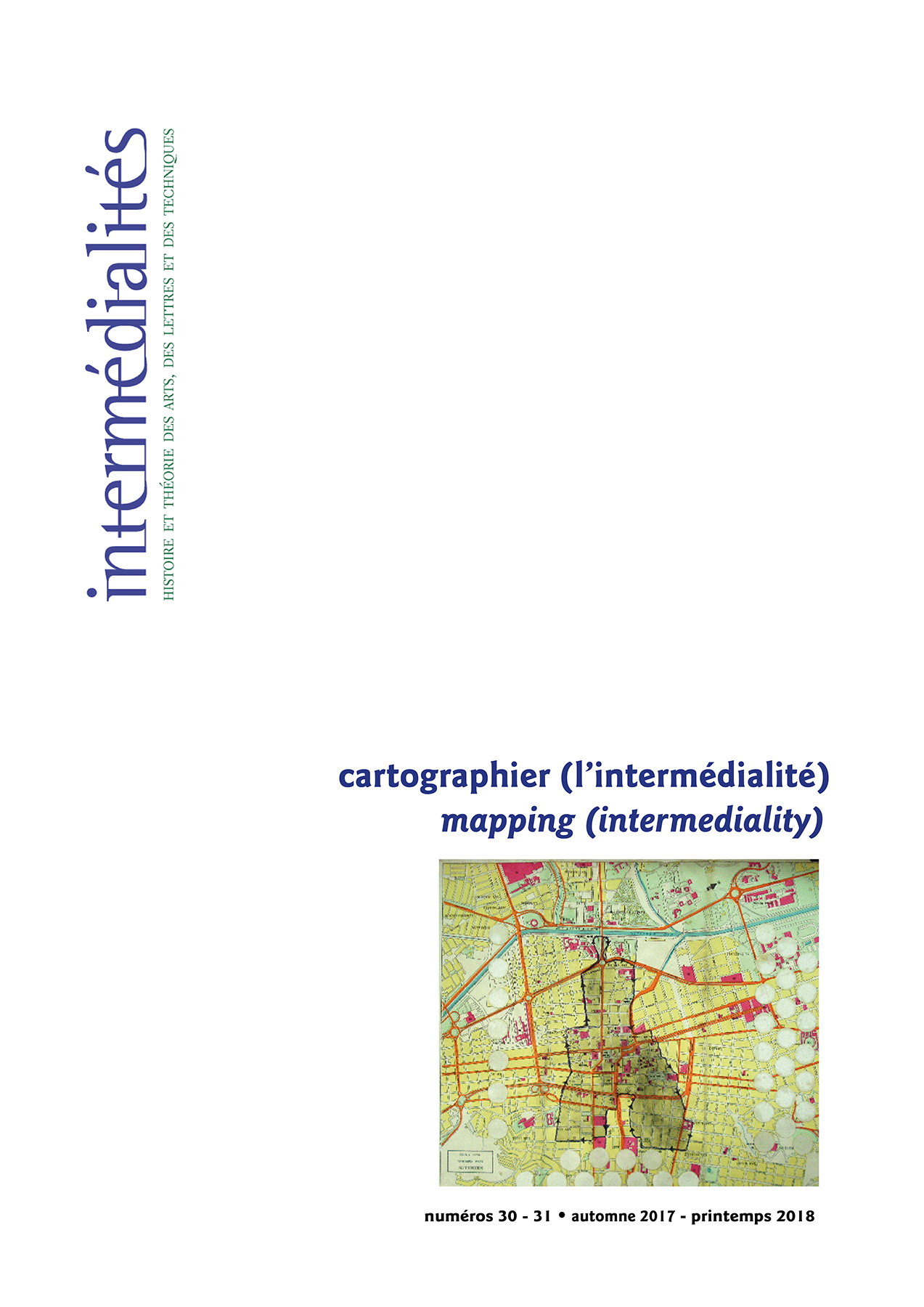Résumés
Résumé
À partir d’une comparaison entre intermédialité et écologie des médias — qui partagent une quantité étonnante de traits communs, tant du point de vue de leur développement historique et institutionnel que de celui de leurs fondements épistémiques et méthodologiques —, cet article tente de saisir ce qui lie et ce qui distingue ces deux « interdisciplines ». Nous essaierons ensuite de comprendre ce qu’elles peuvent nous apprendre sur le contexte médiatique et institutionnel de leur émergence et de leur développement dans les interstices disciplinaires de nos « universités en ruines » (Readings).
Abstract
Through a comparison of intermediality and media ecology–that share a surprising number of common traits not only from the point of view of their historical and institutional development but also from that of their epistemological and methodological principles–this essay tries to determine what these two “interdisciplines” actually have in common and what distinguishes them from each other. We will then try to understand the technological and institutional context of their emergence and evolution within the disciplinary interstices of our “universities in ruins” (Readings).
Corps de l’article
Dans les pages de cette revue, Éric Méchoulan dressait en 2010 une longue liste de « ressemblances familiales » (au sens wittgensteinien) entre l’intermédialité et une série de « conceptions théoriques » qui l’avaient précédée ou qui lui étaient plus ou moins contemporaines. Dans son impressionnante « généa(na)logie » de l’intermédialité, il reliait cette dernière — sous des « genres voisins d’opération » (parler, voir, communiquer, agir, relier[2]) — au dialogisme bakhtinien, à l’intertextualité (Kristeva), à l’interdiscursivité (Foucault, J. Link), à l’intericonicité (Panofsky), à la transmission warburgienne, aux figures de l’ekphrasis et de l’allégorie (chez Coleridge, Benjamin, De Man), aux études sur l’oralité et les cultures manuscrites ou imprimées (Zumthor, Goody, Ong, McLuhan, Chartier), aux systèmes discursifs (Kittler), aux dispositifs (Foucault, Agamben), à la notion d’appareil (Déotte), à la médiologie (Debray), au New Historicism (Greenblatt), à la microhistoire (Ginzburg), aux études postcoloniales et féministes, à l’hypertextualité (Engelbart) et à la remédiation (Bolter/Gruslin)[3].
Bien que cette famille paraisse déjà trop nombreuse, nous proposons ici d’y ajouter un nouveau membre : l’écologie des médias (media ecology), un courant de pensée peu connu dans le monde francophone et qui, bien qu’il n’ait jusqu’à maintenant entretenu aucune relation avec l’intermédialité, partage avec elle une quantité étonnante de traits qui nous fait soupçonner un « lien de parenté » (au sens wittgensteinien) au point où on pourrait penser qu’il ne s’agit de rien de moins que d’« interdisciplines » soeurs séparées à la naissance et élevées dans des pays différents. La cartographie comparative que nous proposons ici vise non seulement à montrer la forte ressemblance entre intermédialité et écologie des médias, mais aussi à identifier les caractéristiques distinctives de l’école montréalaise de l’intermédialité et de la branche nord-américaine de l’écologie des médias tout en jetant un éclairage sur le contexte médiatique, épistémique et institutionnel qui a pu présider à leur émergence et à leur développement.
Ainsi, après avoir évoqué brièvement l’étonnant parallélisme historique qui relie ces deux approches, nous nous concentrerons plus longuement sur les origines et aspects conceptuels similaires de l’intermédialité (plus particulièrement dans son incarnation théorique montréalaise[4]) et de l’écologie des médias , avant de mettre ensuite en relief des différences idéologiques et géographiques significatives (à partir notamment d’un inventaire de leurs principales sources intellectuelles). Enfin, nous proposerons, en conclusion, une réflexion sur la nature (inter)disciplinaire, complexe et fragile de ces deux courants dans le contexte de l’université actuelle. Les conditions de leur émergence, comme leur destin institutionnel actuel, y paraîtront à la fois symptomatiques et révélatrices de ce que Bill Readings a appelé les « ruines » de l’université de la culture[5].
Cartographie historique
Il nous faut avouer, d’entrée de jeu, que ce sont des similitudes d’ordre bêtement chronologique qui nous ont mis sur la piste de cette quête comparative, car les parallèles temporels entre l’intermédialité et l’écologie des médias sont si frappants et se caractérisent par une telle synchronicité qu’il paraît surprenant que personne n’ait encore fait de rapprochements entre elles.
On sait, par exemple, que la première occurrence moderne du mot intermedia, dans un sens proche de celui qui intéressera plus tard l’intermédialité, survient en 1966 et est attribuée à Dick Higgins, un artiste new-yorkais lié au groupe Fluxus et fortement inspiré par la pensée de Marshall McLuhan [6]. La locution media ecology, quant à elle, est utilisée pour la première fois deux ans plus tard, en 1968, par un autre new-yorkais, Neil Postman, également sous l’influence directe de McLuhan[7].
Les deux approches — dont les racines plongent dans le terreau vivace de la contreculture des années 1960 au moment où apparaissent aussi les premiers réseaux informatiques et où se multiplient, comme on le verra plus loin, les appels à l’interdisciplinarité — se développent conceptuellement et institutionnellement dans les trois décennies qui suivront : dès les années 1970 pour l’écologie des médias (à la New York University, autour de Neil Postman plus particulièrement) et plus tard en Allemagne, au milieu des années 1980 pour l’intermédialité « théorique », dans le sillage entre autres des travaux de Jürgen E. Müller [8]. Cependant, c’est surtout à partir des années 1990, au moment où explose la culture numérique (et alors que la pensée de McLuhan connaît aussi une renaissance[9]), que des structures associatives formelles voient le jour en Europe, aux États-Unis et au Canada et que des courants de pensées commencent leur expansion internationale : ainsi l’International Society for Intermedial Studies (ISIS)[10] est fondée en 1996 à l’Université de Linné, en Suède, de même que la Media Ecology Association (MEA) est fondée en 1998 à la University of Maine, aux États-Unis[11]. Le Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI) est fondé quant à lui à Montréal en 1997. Quelques années plus tard, en 2002, la revue de la MEA, Explorations in Media Ecology, publie son premier numéro, alors que la première revue entièrement consacrée à l’approche intermédiale, Intermédialités, affiliée au CRI de l’Université de Montréal, sort le sien en 2003[12].
Depuis, les approches européenne et nord-américaine connaissent une expansion internationale assez similaire, bien que dans des espaces géographiques relativement différents, comme en témoignent leurs courbes de croissance depuis le milieu des années 1990[13]. Par ailleurs, soulignons que les deux associations ont traversé l’Atlantique presque au même moment : tandis que le premier congrès de l’association nord-américaine MEA tenu en Europe a eu lieu à Bologne en 2016[14], le premier congrès de l’association européenne ISIS tenu en Amérique du nord a eu lieu à Montréal en 2017[15].
On pourrait arguer bien sûr que l’apparition quasi simultanée et le développement parallèle de ces deux courants de pensée relèvent de la pure coïncidence — ou plutôt d’une série de coïncidences — s’il n’y avait aussi un nombre significatif de traits communs d’ordres conceptuel et méthodologique qui confirment l’hypothèse d’une parenté plus qu’historique à tout le moins entre la branche nord-américaine de l’écologie des médias et l’école montréalaise de l’intermédialité.
Cartographie épistémique
On pourrait d’abord supposer, étant donné l’influence mcluhanienne commune qui a inspiré les créateurs des termes qui ont servi à décrire l’écologie des médias et l’intermédialité, que ces dernières ont hérité aussi d’un certain nombre d’idées ou de principes méthodologiques liés au penseur canadien des médias, et ce, même si elles ont pu ensuite s’en détacher ou s’enrichir de perspectives intellectuelles diverses.
De fait, on note dès le début l’importance cruciale accordée par les deux approches aux médiums eux-mêmes, à leur matérialité technologique ou à leurs potentialités inhérentes (« affordances »), une prémisse qui doit évidemment beaucoup à McLuhan, le plus célèbre apôtre de ce primat du médium, résumée dans la formule bien connue The medium is the message. Cet axiome figure au fondement même de l’écologie des médias. Éric Méchoulan en a montré aussi l’importance pour l’intermédialité[16] dans son introduction au premier numéro de la présente revue, lorsqu’il souligne le contexte foncièrement intermédial dans lequel apparaît l’expression pour la première fois (du moins à l’écrit[17]) chez McLuhan dans Understanding Media :
Le message du médium cinéma, c’est le passage des connexions linéaires à la configuration. [...] Le cubisme substitue au « point de vue » ou à l’illusion de la perspective une vision simultanée de toutes les faces de l’objet. [...] N’est-il pas clair qu’au moment où le séquentiel le cède au simultané, nous passons dans un monde de structure et de configuration ? N’est-ce pas ce qui s’est produit en peinture, en poésie et dans le domaine des communications ? Des segments spécialisés d’attention ont disparu au profit de la totalité du champ, et nous pouvons désormais dire le plus naturellement du monde : « Le message, c’est le médium[18] ».
Cet intérêt pour la matérialité des technologies (et pour ses « effets [19] »), qui anticipe de plusieurs années le récent tournant « matérialiste » dans l’étude des médias et des technologies [20], est décelable très tôt tant chez Higgins que Postman, qui, inspirés par McLuhan, paraissent tous deux fascinés par les potentialités transformatrices des médias — ou de la combinaison de médiums employée — que ce soit pour l’artiste intermédial chez Higgins ou sur le simple citoyen, assailli par les nouveaux médias audiovisuels, pour Postman. Cette préoccupation pour les médias en eux-mêmes et pour eux-mêmes continue d’être au fondement des recherches intermédiales et de l’écologie des médias—, même si elles ne peuvent bien sûr y être réduites et si les modes d’appréhension de cette matérialité des médias ont pu se diversifier et se complexifier depuis.
Une autre particularité évidente qui relie l’écologie des médias et l’intermédialité se situe dans leur commune conception « non monadique » des médias et de la médialité dans son ensemble. Cette idée « plutôt banale », comme le note Jens Schröter, a amené les chercheurs intermédiaux comme les écologistes des médias auparavant à récuser les « tendances isolationnistes[21] » de certaines théories ou histoires des médias au profit d’une attention au « processus complexe des interactions et des rencontres entre médias[22] ». Cette attention paraît en effet fondamentale pour les deux courants de pensée, et ce, même si les modèles et concepts utilisés pour penser ces interactions, ces relations et ces environnements médiatiques sont fort divers et continuent d’évoluer : de l’idée mcluhanienne de l’ancien média qui devient le « contenu » du média qui lui succède[23] jusqu’aux théories « postmédiatiques » plus récentes[24] en passant par la « dialectique » des médias de Higgins, la métaphore écologique développée par Postman ou la « remédiation » de Bolter et Gruslin.
En outre, cette tendance non isolationniste dans l’approche des médias s’étend, dans les deux cas encore, bien au-delà de la seule appréhension des médias eux-mêmes et de leurs interactions, puisque les technologies, les disciplines artistiques ou les institutions y sont vues, dans les deux courants encore, comme insérées ou interreliées dans un complexe environnement esthétique, épistémique, économique et sociopolitique. Ici aussi l’influence de McLuhan est déterminante : pour ce dernier, l’outil technologique lui-même n’est que la « figure » qui cache un « fond » (ground) dont l’extension et l’importance sont beaucoup plus déterminantes que l’outil technologique en lui-même. Dans une conférence prononcée en 1974, par exemple, il explique, à partir de l’exemple de l’automobile, la conception « environnementale » qui sous-tend son fameux axiome qu’il a toujours répugné à « expliquer » :
When I say the medium is the message, I’m saying that the motor car is not a medium. The medium is the highway, the factories, and the oil companies. That is the medium. In other words, the medium of the car is the effects of the car. When you pull the effects away, the meaning of the car is gone. The car as an engineering object has nothing to do with these effects. The car is a figure in a ground of services. It’s when you change the ground that you change the car. The car does not operate as the medium, but rather as one of the major effects of the medium. So ‘the medium is the message’ is not a simple remark, and I’ve always hesitated to explain it. It really means a hidden environment of services created by an innovation, and the hidden environment of services is the thing that changes people. It is the environment that changes people, not the technology[25].
Voilà pourquoi l’écologie des médias, comme l’explique Lance Strate dans son introduction au premier numéro de la revue Explorations in Media Ecology, s’intéresse à la fois aux médias vus comme des environnements et aux environnements envisagés eux-mêmes comme médias[26]. De même, dans une sphère distincte, mais selon une logique tout de même comparable, l’intermédialité ne s’intéresse pas qu’aux médias ou aux arts en eux-mêmes, comme le stipule, entre autres, un texte descriptif publié sur le site Web du CRIalt (Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, à Montréal)[27] :
[...] le concept [d’intermédialité] désigne aussi ce creuset de médias d’où émerge et s’institutionnalise peu à peu un nouveau média bien circonscrit (ainsi, le cinéma entre peinture, photographie, panorama et fête foraine) : l’intermédialité apparaît avant le média. Enfin, il recouvre le milieu dans lequel les médias prennent forme et sens (milieu social, institutionnel, culturel aussi bien que technologique[28]).
Cette compréhension du média à la fois comme outil technologique de transmission ou d’archivage et comme « milieu » rejoint tout à fait celle de McLuhan (et, par là, des écologistes des médias), comme on l’a vu dans la citation précédente et comme le rappelait récemment son petit-fils : « [...] we rely on the current definition of “medium” as simply a technology, when that’s not the same definition Marshall McLuhan used. He preferred “milieu” or “environment”[29]. »
Cette conception « environnementale » du médium, et la métaphore écologique qui en a émergé[30], se retrouve d’ailleurs explicitement utilisée dans un document interne daté de 2009 sur les « Enjeux scientifiques du CRI » (document composé d’extraits des demandes de subvention au FRQSC du Centre de recherche sur l’intermédialité à destination de ses membres) où, parmi les cinq « aspects » des « contributions du Centre à l’avancement des connaissances », on trouve justement une « écologie médiatique » ainsi définie :
Par cette notion le CRI entend l’étude des relations entre les médias et le milieu auquel elles donnent et duquel elles prennent forme. Plus précisément, l’écologie médiatique permet d’étudier individus et communautés à travers leurs rapports aux médias. L’approche intermédiale a modifié les pratiques de recherche en privilégiant l’analyse de la relation active entre les éléments d’un système à l’analyse des éléments seuls. [...] Ce déplacement méthodologique a permis dans un cas d’appréhender différemment et de façon plus intégrative les échanges communicationnels et dans l’autre cas d’élargir notre compréhension des phénomènes médiatiques et du milieu que les médias informent[31].
Il n’y a pas de référence explicite ici à la veine nord-américaine de l’écologie des médias (avec laquelle l’intermédialité n’a jamais entretenu de liens à notre connaissance), mais il nous semble évident qu’une telle description aurait très bien pu se retrouver presque telle quelle dans un document de la Media Ecology Association.
Enfin, on trouve au moins une autre similitude importante entre les deux écoles de pensée dans leur courant respectif du fait qu’elles considèrent que ces environnements médiatiques sont en perpétuelle transformation selon les aires géographiques et les ères historiques. Ainsi, bien que ces deux approches des médias, de la culture et de la société soient apparues au moment où émergeaient les premiers réseaux informatiques et qu’elles se soient développées en parallèle de la « grande conversion numérique[32] » qui s'est imposée tout particulièrement à partir des années 1990, ni une ni l’autre n’ont un corpus assimilable à celui d’autres approches qui leur sont contemporaines, telles les « digital studies » ou les « humanités numériques », puisqu’elles s’intéressent toutes deux aux médias, aux technologies, aux expressions culturelles et aux environnements médiatiques de toutes les époques historiques et de toutes les régions géographiques. Un simple coup d’oeil aux tables des matières des revues Intermédialités et Explorations in Media Ecology donne une idée de la diversité historique et géographique des corpus, des objets et des champs d’études qui s’intéressent tout autant à l’oralité, aux sociétés ou aux artefacts manuscrits ou imprimés qu’aux médias audiovisuels analogiques, au cinéma des premiers temps ou aux technologies numériques les plus récentes, et ce, dans des cultures et à des époques extrêmement diversifiées.
Bref, il nous paraît évident que, dans l’esprit de la tendance intermédiale « à réfléchir les ressemblances comme autant de mises en relation[33] », il serait opportun d’ajouter l’écologie des médias à l’arbre « généa(na)logique » déjà fort touffu de l’intermédialité. On pourrait même être tenté de la greffer sur une branche voisine de cette dernière vu leur croissance quasi simultanée et leurs nombreuses similitudes d’ordres génétique, épistémique et méthodologique.
Cela dit, toute ressemblance familiale sous-entend aussi des différences — et de potentiels différends —, comme le rappelle fort justement Éric Méchoulan à la fin de son article déjà évoqué[34].
Cartographie « idéologique »
En effet, des différences tout de même significatives apparaissent lorsqu’on se met à regarder de plus près les définitions qu’on a données de l’écologie des médias (qui, soit dit en passant, semble éprouver autant de difficulté et mettre autant d’efforts — toujours renouvelés ! — que l’intermédialité à se « définir »), mais aussi les sources intellectuelles de ce courant de pensée qui témoignent, comme on le verra tout de suite, d’une généalogie géographiquement, intellectuellement, voire idéologiquement distincte.
Prenons par exemple l’overview, volontairement large, que propose Lance Strate pour décrire l’écologie des médias sur le site Web de l’association MEA :
It is a study of media environments, the idea that technology and techniques, modes of information and codes of communication play a leading role in human affairs. Media ecology is the Toronto School, and the New York School. It is technological determinism, hard and soft, and technological evolution. It is media logic, medium theory, mediology. It is McLuhan Studies, orality–literacy studies, American cultural studies. It is grammar and rhetoric, semiotics and systems theory, the history and the philosophy of technology. It is the postindustrial and the postmodern, and the preliterate and prehistoric[35].
Bien que, par son extension théorique et historique, cette « définition » fort éclectique ne soit pas sans évoquer la généa(na)logie d’Éric Méchoulan, on notera des différences avec l’intermédialité au regard, en premier lieu, de l’équilibre géographique des sources intellectuelles, qui paraît nettement plus nord-américain qu’européen. Ce déséquilibre transatlantique peut d’ailleurs être confirmé par une tentative récente d’un écologiste des médias italien, Paolo Granata, de « géolocaliser » les principales sources intellectuelles de l’écologie des médias. Sa cartographie intellectuelle, remise en cause par certains (au regard notamment de son incomplétude, de sa « virilité » excessive, mais aussi de sa classification géographique borgésienne des sources qui inclut cinq villes, un pays, trois institutions universitaires et une région de l’Europe !), possède tout de même le mérite de rendre manifestes les fondements majoritairement nord-américains de l’écologie des médias[36] :

Une étude comparative des principales sources citées dans la revue montréalaise Intermédialités et la revue de l’association MEA, Explorations in Media Ecology, vient d'ailleurs confirmer le déséquilibre transatlantique qui distingue les deux courants, et ce, tout en ouvrant la voie à une appréhension plus précise de ce qui les différencie[37] :

On voit que la liste des quatre intellectuels les plus cités dans chaque revue — un Allemand[38] et trois Français pour Intermédialités; deux Canadiens et deux Américains pour EME — atteste de nouveau, si besoin est, des origines continentales opposées des deux approches, liées bien sûr à leur lieu d’émergence, mais aussi à l’« origine » nationale ou au lieu de l’affiliation institutionnelle de leurs membres[39].
On note toutefois d’autres disparités qui paraissent plus significatives. On constate notamment que certaines sources très importantes dans une revue sont parfois quasi, voire totalement absentes de l’autre. On peut comprendre évidemment que des penseurs français relativement peu connus ou traduits dans le monde anglophone, tels Rancière et Déotte, ou encore des théoriciens liés davantage aux études littéraires et à l’intertextualité, tels Kristeva et Bakhtine, soient absents d’Explorations in Media Ecology. Il était sans doute prévisible aussi que des chercheurs liés à la branche américaine des sciences de la communication, tel James Carey (peu connu dans les milieux de la recherche francophone[40]), ne soient pas cités dans Intermédialités. Cependant, d’autres différences paraissent plus spectaculaires : notamment le fait que le fondateur de l’écologie des médias, Neil Postman (qui arrive en deuxième place des citations dans EME), mais surtout Jacques Ellul (qui y figure en cinquième place) ou encore Lewis Mumford (qu’on retrouve en sixième) ne soient pas même cités une seule fois dans Intermédialités. Et il ne s’agit pas ici que d’une question de langue ou de culture intellectuelle car, si on peut alléguer que Postman demeure très américain et souvent trop « grand public » dans ses écrits (qui ne sont pas d’une grande profondeur théorique[41]), Ellul, lui, est français, tandis que l’historien, sociologue et urbaniste Mumford est certainement un penseur important de la technologie traduit dans de nombreuses langues, incluant le français.
Ces trois figures intellectuelles ont toutefois un trait en commun qui pourrait expliquer à la fois leur absence de la revue Intermédialités et leur importance pour un certain nombre d’adeptes de l’écologie des médias : Postman, Ellul et Mumford se sont tous trois attaqués au mythe du progrès technologique et en ont ouvertement dénoncé les effets délétères. Ils ont, chacun à sa manière, adopté des positions « morales » ou idéologiques très fortes contre les médias, la « technique » ou les technologies modernes[42], des positions qu’on retrouve aussi dans une proportion non négligeable des communications et des publications des écologistes des médias.
Cette perspective morale a d’ailleurs été adoptée dès le commencement par le fondateur du premier programme d’écologie des médias : « From the beginning, we were a group of moralists. It was our idea to have an academic department that would focus its attention on the media environment, with a particular interest in understanding how and if our media ecology was making us better or worse[43]. »
Pourtant, comme l’admet Postman lui-même, cette position allait à l’encontre des principes de celui-là même qui avait inspiré l’écologie des médias :
Not everyone thought that this was a good idea — Marshall McLuhan, for one. Although McLuhan had suggested that we start such a department at NYU, he did not have in mind that we ought to interest ourselves in whether or not new media, especially electronic media, would make us better or worse. [...] No room for moralists there. McLuhan claimed that we ought to take the [following] point of view in thinking about modern media: that they are neither blessed nor cursed, only that they are here. He thought that this moral neutrality would give the best opportunity to learn exactly how new media do their stuff. If one spent too much time on the question of whether or not that stuff was good, one would be distracted from truly understanding media. As a consequence, although I believe McLuhan liked me, I feel sure he would not have much liked my books, which he would have thought too moralistic, rabbinical or, if not that, certainly too judgmental[44].
Postman en rajoute ensuite en disant qu’en ce qui le concerne, il ne voit pas même l’intérêt d’étudier les médias et les technologies en dehors d’un contexte éthique et il se justifie en soulignant qu’il n’est pas le seul à penser ainsi, citant en exemple Ellul et Mumford qui, ajoute-t-il, ne pouvaient écrire un mot sur la technologie sans évoquer ses « conséquences humanistes ou antihumanistes[45] ».
Il ne s’agit évidemment pas là d’une position adoptée par tous les écologistes des médias, loin de là. Plusieurs restent fidèles à une neutralité toute mcluhanienne, à l’érudition scientifique plus prudente d’un Ong ou à des perspectives intellectuelles critiques de l’humanisme traditionnel qui sont assez proches de celles que l’on trouve chez les intermédialistes : il suffit, pour s’en convaincre, de considérer l’importance tout de même non négligeable de penseurs comme Heidegger, Benjamin, Foucault, Deleuze, etc., dans les sources évoquées dans la revue EME.
Il reste que la présence significative d’une morale humaniste relativement traditionnelle, parfois essentialiste, conservatrice et même ouvertement religieuse constitue un trait distinctif qui paraît typique d’une sous-catégorie appréciable des adeptes de l’écologie des médias, ce qui — au-delà de l’importance du trio des moralistes « antitechnologiques » Postman-Ellul-Mumford — pourrait être attribuable aussi au fait que les trois figures les plus importantes qui forment ce qu’on pourrait appeler la « sainte trinité » de l’écologie des médias[46] sont, outre Postman (un intellectuel new-yorkais qui, bien qu’il ne fut pas pratiquant, se réclamait d’un humanisme des Lumières inspiré par le judaïsme[47]), deux penseurs ouvertement catholiques : le méthodiste converti au catholicisme McLuhan[48] et le jésuite Ong. On se trouve là loin de l’intermédialité, qui, si elle peut aussi adopter une perspective critique à l’égard de la technologie, le fait le plus souvent à partir de positions inspirées par une philosophie continentale moins traditionnelle : théorie critique, phénoménologie, poststructuralisme, etc.
Cartographie (inter)disciplinaire
Les orientations intellectuelles et idéologiques dominantes de ces deux courants sont en partie attribuables à l’origine nationale et continentale de leurs adeptes, mais aussi à la formation disciplinaire de leurs « disciples ». Les intermédialistes proviennent dans une large proportion des domaines liés aux arts et aux lettres (études cinématographiques, études littéraires, histoire de l’art, études théâtrales, musicologie, architecture, etc.), domaines auxquels on pourrait sans doute ajouter — entre autres[49], bien que dans une moindre mesure — la communication, l’anthropologie et l’histoire des sciences et des technologies, tandis que les écologistes des médias proviennent d’abord et avant tout de programmes liés aux sciences de la communication (ou aux media studies)[50], ensuite à la philosophie, puis aux sciences sociales, aux lettres, à la pédagogie, voire à la théologie [51].
Une telle répartition des origines disciplinaires affecte évidemment aussi le champ et les objets d’études privilégiés par ces deux approches. Ainsi, au risque de généraliser, on observe que, même si l’intermédialité peut à bon droit se vanter de couvrir un vaste territoire historique, géographique et disciplinaire dans le choix de ses objets d’étude, ce territoire reste un peu plus délimité que celui de l’écologie des médias. Un autre coup d’oeil aux tables des matières des revues Intermédialités et Explorations in Media Ecology vient confirmer cette impression. Si l’on excepte les articles de nature plus théorique qu’on retrouve dans des proportions assez significatives et équivalentes dans les deux cas, on constate qu’il y a dans la revue intermédiale montréalaise une vaste majorité de travaux portant sur le cinéma, les arts visuels, le théâtre, la musique ou la littérature, tandis que ces objets sont presque totalement absents (sauf pour la musique populaire et le cinéma hollywoodien) des publications scientifiques de l’écologie des médias, qui fait, en revanche, une place plus grande aux études sur l’oralité, l’écriture et l’imprimé, ainsi que sur les médias de masse (télévision, radio, journalisme), la culture populaire et les nouveaux médias (Internet, jeux vidéo, téléphones cellulaires, réalité virtuelle, réseaux sociaux...)[52]. De plus, comme on le constatera à la lecture des statistiques données dans la note précédente, on trouve aussi une proportion importante d’articles et de communications qui abordent trois domaines quasi, voire totalement absents de l’intermédialité : les enjeux et effets psychologiques, sociaux ou éthiques de diverses technologies de communication, leurs enjeux pédagogiques[53] (la revue EME comporte même une section « Pedagogy ») et, enfin, les enjeux de ces mêmes technologies pour la religion ou la spiritualité[54].
Toutefois, si ces différences dans le choix des champs d’études qui sont attribuables aux généalogies multidisciplinaires distinctes de nos deux courants de pensée paraissent notables, il n’en demeure pas moins que les deux approches retrouvent un air de parenté si l’on observe les relations complexes et changeantes qu’elles entretiennent avec les territoires disciplinaires qu’elles occupent, fréquentent ou traversent. Toutes deux se caractérisent en effet par une incontestable hybridité disciplinaire, qui s’accompagne simultanément d’une certaine fragilité institutionnelle.
Comme l’intermédialité, en effet, l’écologie des médias a constitué un assez vaste réseau international de chercheurs (l’association compte un peu plus de 600 membres à cette date). Toutefois, à l’exception du programme fondateur à la NYU (qui a été offert pendant plus de 30 ans, mais qui n’existe plus sous ce nom), elle n’a pas donné naissance à d’autres programmes universitaires complets, et ce, même si des « options » ou des cours axés en tout ou en partie sur l’écologie des médias sont offerts dans divers programmes de communication aux États-Unis[55]. Ainsi, en dehors des espaces qu’elle a elle-même créés (l’association MEA, son congrès annuel, la revue EME, ainsi qu’une collection de livres d’abord chez Hampton Press, puis chez l’éditeur Peter Lang), l’écologie des médias n’occupe le plus souvent qu’une place assez modeste dans quelques « séances spéciales » des gros congrès annuels des grandes associations de communication et d’étude des médias (comme celui de la NCA, la National Communication Association des États-Unis, qui accueille plus de 5000 participants et 34 autres associations affiliées)[56]. Cette relative fragilité institutionnelle de l’écologie des médias a sans doute partie liée avec son ambiguïté disciplinaire, qui n’est pas sans rappeler celle de l’intermédialité, même si on note encore là quelques différences significatives[57].
Dès les premières années du développement de l’écologie des médias, Christine Nystrom, par exemple, a tenté de définir celle-ci comme une « métadiscipline » apparue dans le sillage de ce que Kenneth Boulding a appelé la grande transition « postcivilisationnelle[58] » du 20e siècle :
One of the consequences of the change to which Boulding and others refer, or, better perhaps, one of its hallmarks, is a movement away from the rigidly compartmentalized, uncoordinated specialization in scientific inquiry which characterized the Newtonian world, and a movement toward increasing integration of both the physical and the social sciences. One of the symptoms of this trend is the proliferation, in recent years, of “compound” disciplines such as mathematical biochemistry, psychobiology, linguistic anthropology, psycholinguistics, and so on. Another is the emergence of new fields of inquiry so broad in their scope that the word “discipline,” suggesting as it does some well-bounded area of specialization, scarcely applies to them at all. Rather, they are perspectives, moving perhaps in the direction of metadisciplines. One such perspective, or emerging metadiscipline, is media ecology — broadly defined as the study of complex communication systems as environments[59].
Plusieurs années plus tard, dans leur introduction au premier numéro de la revue Explorations in Media Ecology, Lance Strate et Judith Yaross Lee parlent plutôt en termes de trans-, de multi- et d’interdisciplinarité :
EME brings together a diverse group of writers: historians of literature, electronic media, rhetoric, and the arts; critics of popular culture and social practices; researchers and theorists of communication, technologization, and information; educators in many fields; contemporary prophets. [...] We welcome scholarship and commentary rooted in the arts, humanities, sciences, and social sciences, and respect all relevant methodologies. As a journal, EME can be understood to be cross-disciplinary, multidisciplinary, or interdisciplinary, but it should not be thought undisciplined[60].
Plus récemment, dans un article de 2011 qui tentait de déterminer si l’écologie des médias constituait une « discipline », Dennis D. Cali en vient à conclure qu’elle reste une discipline « émergente[61] » et attribue l’ambiguïté de son statut disciplinaire au contexte prétendument « postmoderne » de son émergence :
Perhaps the most plausible explanation for the ambiguity in the disciplinary status of media ecology rests in the postmodernist context out of which it has originated. Postmodernism rebukes such totalizing and “closed” systems as “disciplines” that seek cohesiveness and instead celebrates “disruption, tension, and the withholding of closure” (Bloland, 1995, p. 529). Conceiving of a “discipline” not as a community of scholars but as sites, systems, or networks in which power contests are waged (p. 531), postmodernism heralds, in fact, the collapse of boundaries. “The boundaries of the disciplines,” writes Bloland (2005), borrowing the language of Baudrillard, “are imploding” (p. 135). Within such a context, a discipline might be viewed as a “community of dissensus,” conceptualized “without recourse to notions of unity, consensus, and communication” (Readings, 1996, p. 20, cited in Bloland, 2005, p. 144[62])
Cali conclut en décrivant l’écologie des médias comme une communauté et un champ d’études « rhizomatiques » qui produisent une carte toujours en construction, détachable, connectable, réversible, modifiable, etc.[63] On notera d’ailleurs que l’appel à contributions du présent numéro de la revue Intermédialités faisait référence au même concept deleuzien pour décrire une des deux « manières d’envisager » l’intermédialité dont les frontières et territoires disciplinaires demeurent tout aussi mobiles et en perpétuelle (re)négociation[64]. La « première manière » d’envisager l’intermédialité concernait cependant la vocation interdisciplinaire de ses principaux centres de recherche à travers le monde[65]. Et c’est à cette notion d’interdisciplinarité que nous souhaitons consacrer la dernière partie de nos réflexions sur ce qui établit un lien entre intermédialité et écologie des médias. Car ce n’est sans doute pas un hasard si nos deux « interdisciplines » plongent leurs racines dans les années 1960–1970 — au moment où les appels à l’interdisciplinarité se multiplient de toutes parts[66] — et qu’elles s’inspirent toutes deux de la pensée de McLuhan, qui a joué un rôle de pionnier dans le développement des recherches interdisciplinaires en sciences humaines, que ce soit, dès les années 1950, par son séminaire hautement interdisciplinaire Culture and Communications dans la revue Explorations in Media Ecology, qui est issue de ce même séminaire[67], ou encore dans les activités du Centre for Culture and Technology, créé pour lui par l’université de Toronto en 1963[68].
Et s’il semble pertinent de parler d’interdisciplinarité pour décrire les pratiques de recherche de l’écologie des médias (qui reprend d’ailleurs pour sa revue le titre de l’emblématique revue interdisciplinaire Explorations), cela paraît d’autant plus légitime pour l’intermédialité [69] : non seulement celle-ci partage-t-elle le même préfixe (suivi de l’emblématique suffixe doublement « inter-médiaire ») que l’interdisciplinarité, mais on la situe aussi souvent dans le sillage de l’intertextualité, de l’interdiscursivité ou de l’interartialité[70], sans compter qu’elle se réclame elle-même fréquemment de l’« entre-deux » et de l’interstitiel[71].
Cela dit, la notion d’interdisciplinarité demeure contestée. On souligne régulièrement, par exemple, le caractère assez rare des recherches véritablement interdisciplinaires [72]. D’autres, comme Jean-Marc Larrue, affirment qu’une approche comme l’intermédialité va en fait au-delà de la simple interdisciplinarité — « Intermediality is not the offspring of intertextuality — it is not another way of saying interdisciplinarity; rather, as an approach, it constitutes a real paradigmatic and epistemic break[73] » —, du fait notamment qu’elle se défait des oppositions binaires préalables à l’« inter » pour se concentrer sur l’« entre[74] » en lui-même. Enfin, d’autres encore, comme Jürgen Müller reprenant une hypothèse de James Cisneros (lui-même inspiré par Bill Readings), ont été jusqu’à voir dans une prétendue « stratégie » interdisciplinaire de l’intermédialité un « réflexe de survie » de l’université :
On pourrait voir, dans l’avènement du concept d’intermédialité, une stratégie institutionnelle et territoriale : l’intermédialité serait le produit d’un réflexe de survie des institutions universitaires qui ne peuvent plus bâtir leur légitimité scientifique sur un partage disciplinaire strict du savoir. Dans ce sens, la notion d’intermédialité serait [...] à la fois un indice du déclin ou de la fin de l’institution de l’Université occidentale et un point de départ pour le développement de moyens de recherche qui nous permettraient de nous regarder comme des chercheurs faisant de la recherche. Faut-il alors considérer l’histoire du concept d’intermédialité comme un symptôme de la fin de l’Université[75] ?
Müller, par l’entremise de James Cisneros, reprenait ici simplement — en les déformant quelque peu — les mises en garde formulées, dès le milieu des années 1990, par Bill Readings contre les périls de l’interdisciplinarité dans son livre posthume, The University in Ruins :
One form of such market expansion is the development of interdisciplinarity programs, which often appear as the point around which radicals and conservatives can make common cause in University reform. This is partly because interdisciplinarity has no inherent political content, as the example of the Chicago School shows. It is also because the increased flexibility they offer is often attractive to administrators as a way of overcoming entrenched practices of demarcation, ancient privilege, and fiefdoms in the structure of universities. The benefits of interdisciplinarity openness are numerous — as someone who works in an interdisciplinarity department I am particularly aware of them — but they should not blind us to the institutional stakes that they involve. At present interdisciplinarity programs tend to supplement existing disciplines; the time is not far off when they will be installed in order to replace clusters of disciplines [76].
Ces mises en garde de Bill Readings — qui, fortement inspiré par la pensée de Jean-François Lyotard, demeure méfiant envers les appels à l’« unité » et à la « synthèse » qui sous-tendent généralement le recours à la notion d’interdisciplinarité[77] — paraissent aujourd’hui prophétiques : plusieurs universités ont effectivement regroupé (et parfois coupé par la suite) des unités disciplinaires dans des métastructures[78] plus ou moins « interdisciplinaires », et ce, particulièrement dans le domaine des arts, des lettres et des sciences humaines[79].
James Cisneros avait, quant à lui, repris les hypothèses de Readings pour comprendre les enjeux foncièrement paradoxaux de l’émergence de cette interdiscipline[80] qu’est l’intermédialité :
To consider the history and geography of the concept, then, we should revise it both as a symptom of changes in its institutional setting and as a tool created with the present socio-historical juncture in mind, one that can help explain and partially mould the shifting cultural field. If my initial question asked whether intermediality was a symptom or an explanation of a historical juncture, and if I am correct in saying it is both, we now find ourselves before a second, more pressing question: how can we use intermediality to think through and to explain a situation of which it is a symptom?; or how can intermediality explain itself as a symptom at the same time that it explains the situation of which it is a sign[81]?
Mais s’il était encore possible de craindre, au moment où Cisneros réfléchissait sur l’avenir de l’intermédialité, que cette dernière puisse, en tant que « symptôme », être instrumentalisée à des fins économiques par des administrations universitaires machiavéliques[82], il paraît plus difficile d’envisager aujourd’hui qu’elle puisse être utilisée pour « avaler » les disciplines qui lui contribuent. Et on pourrait en dire tout autant, comme on l’a vu plus tôt, de l’écologie des médias. En toute honnêteté, il faut bien admettre que ces deux interdisciplines ne constituent pas de grandes réussites d’un point de vue purement administratif et économique car, bien que l’intermédialité et l’écologie des médias continuent de connaître un succès international certain, qu’elles attirent même de nouvelles générations de chercheurs, qu’elles possèdent des associations scientifiques apparemment solides et des publications savantes plus que respectables, elles conservent un statut institutionnel tout de même assez précaire si on les compare aux grandes disciplines traditionnelles.
Cependant, ces « échecs » institutionnels de l’intermédialité et de l’écologie des médias leur offrent peut-être aussi une véritable occasion de succès. En survivant ainsi tant bien que mal dans les interstices disciplinaires des nouvelles universités corporatives, en lien continuel avec plusieurs disciplines[83] et en restant attentives à la matérialité des technologies du passé et du présent, aux pratiques changeantes de la médialité et des institutions, ainsi qu’au complexe tissu de relations entre les arts, les lettres, les techniques et la société, ces deux interdisciplines soeurs ont su rester intellectuellement dynamiques et ne semblent pas avoir perdu leur pertinence plus de trois décennies après leur émergence. Chacune à sa manière, elles offrent peut-être même la possibilité de jeter un peu de lumière sur le crépuscule de l’université de la « culture » (soi-disant « postlittéraire », « postnationale », « postdisciplinaire », « posthistorique »...) dans le contexte de l’accélération technologique actuelle, du moins si, comme le proposait Cisneros à la suite de Readings, elles préservent la « réflexivité de leur réflexion » sur les techniques, les institutions... et sur elles-mêmes, afin de faire de leur (inter)disciplinarité une « question permanente[84] », comme le propose fort justement le présent numéro de la revue Intermédialités.
Parties annexes
Note biographique
Jean-François Vallée est professeur au département de lettres, d’arts et d’histoire de l’art du Collège de Maisonneuve et chercheur au CRIalt et au CRINH, à l’Université de Montréal. ll a coédité un ouvrage collectif sur le dialogue à la Renaissance, Printed Voices. The Renaissance Culture of Dialogue (University of Toronto Press, 2004), ainsi qu’un volume sur la littérature comparée contemporaine, Transmédiations. Traversées culturelles de la modernité tardive (Presses de l’Université de Montréal, 2013). Il a en outre publié des articles et des chapitres de livres portant sur des auteurs, des éditeurs et des imprimeurs de la Renaissance et de la modernité, ainsi que sur l’école de Toronto (McLuhan), l’écologie des médias et divers enjeux théoriques de la culture de l’imprimé et des médias numériques. Il travaille en ce moment à une édition numérique polymorphe d’un dialogue satirique de la Renaissance, le Cymbalum mundi (Projet CRSH La Cymbale du monde numérique).
Notes
-
[1]
Cet article est issu de travaux dont le premier volet a pris la forme d’une communication intitulée « The Interplay of Media Ecology and Intermediality », présentant l’intermédialité aux participants du congrès annuel de la Media Ecology Association à Bologne en juin 2016, et dont le deuxième volet, « Authentic Affinity: Intermediality and Media Ecology », présentait l’écologie des médias aux participants de la conférence Authentic Artifice de l’International Society for Intermedial Studies à Montréal en mai 2017.
-
[2]
Éric Méchoulan, « Intermédialité : ressemblances de famille », Intermédialités, no 16 « Rythmer / Rhythmize », automne 2010, p. 234.
-
[3]
Méchoulan, 2010, p. 235-259.
-
[4]
Étant donné que cet article vise d’abord à faire connaître l’écologie des médias aux « intermédialistes », nous ne nous ne pencherons pas en détail sur la généalogie et les différentes écoles de pensée liées à l’intermédialité. L’école montréalaise, avec laquelle nous sommes plus familier, nous servira d’exemple et de principale source de comparaison. Même si elles sont manifestement liées aux réflexions théoriques, nous ne nous attarderons pas non plus aux pratiques intermédiales qui ont vu le jour dans divers départements d’arts visuels ou de communication, pratiques qui se sont développées dans le sillage du travail initial de l’artiste Dick Higgins et qu’on retrouve maintenant dans des programmes universitaires homologués (tels que le Bachelor of Fine Arts in Intermedia à l’université York, http://vaah.ampd.yorku.ca/programs/intermedia/, ou les Bachelor of Fine Arts et Master of Fine Arts in Intermedia à Concordia, https://www.concordia.ca/finearts/studio-arts/programs/graduate/intermedia.html, pour ne donner que deux exemples canadiens).
-
[5]
Bill Readings, The University in Ruins, Cambridge, MA, Londres, Harvard University Press, 1995.
-
[6]
Du moins, si on l’excepte l’emploi précoce du terme intermedium par Samuel Taylor Coleridge dès le début du 19e siècle pour évoquer le lien entre personne et personnification dans l’allégorie chez Edmund Spenser. Sur l’emploi (en fait plus complexe) de ce terme chez Coleridge, ses liens avec la chimie et avec la notion d’intermedia chez Dick Higgins, voir Julainne S. Sumich, « Conceptual Fusion Coleridge, Higgins, and the Intermedium », 2007, publié sur Scribd en janvier 2016, https://fr.scribd.com/document/295966387/Conceptual-Fusion-Coleridge-Higgins-And-the-Intermedium (consultation le 21 juin 2017). Higgins lui-même évoque, en 1981, l’emploi du terme intermedium chez Coleridge dans la version augmentée de son article « Intermedia », paru pour la première fois en 1966. Dick Higgins, « Intermedia », in The Something Else Newsletter, vol. I, n° 1, février 1966; Dick Higgins, The Poetics and Theory of the Intermedia, Carbondale et Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1984, p. 23.
-
[7]
Le terme fut employé par Postman pour la première fois le 29 novembre 1968, lors d’une présentation intitulée « Growing Up Relevant » à l’occasion de la 58th Annual Convention of the National Council of Teachers of English, à Milwaukee dans le Wisconsin. Lance Strate, « Media Ecology », Wiley Online Library, the International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 23 octobre 2016, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118766804.wbiect137/full (consultation le 17 février 2018).
-
[8]
Le passage de l’intermédialité artistique d’un Higgins aux réflexions théoriques sur l’intermédialité en Allemagne dans les années 1980 mériterait de faire l’objet de recherches additionnelles. Il n’en demeure pas moins que, si l’on se fie à Jürgen E. Müller lui-même, la première a certainement inspiré les secondes : « Au cours des dernières années, la communauté des chercheurs a reconnu l'importance de l'axe de pertinence de l'intermédialité. En Allemagne, ce sont surtout les travaux de Franz-Josef Albersmeier, Volker Roloff, Joachim Paech, Yvonne Spielmann — et aussi les miens — qui, s'inspirant des propos de Higgins, Aumont (1989), Bellour, Jost, etc., ont mis en place des cadres théoriques pour des recherches intermédiatiques. » Jürgen E. Müller, « L’intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l’exemple de la vision de la télévision », in Cinémas 10, n° 2–3, printemps, 2000, p. 106. Pour compléter le propos de Müller, mentionnons aussi la publication, au cours des années 1990, des travaux des autrichiens Jorg Helbig, du côté de la narratologie, et Werner Wolf à l’intersection de la littérature et de la musique.
-
[9]
McLuhan a notamment été choisi comme « saint patron » par la revue Wired, le périodique le plus en vue de la nouvelle élite californienne des digerati de la Silicon Valley. Les publications au sujet de McLuhan se sont aussi multipliées à partir du début des années 1990.
-
[10]
https://lnu.se/en/research/searchresearch/isis/ (consultation le 17 février 2018).
-
[11]
http://www.media-ecology.org/ (consultation le 17 février 2018).
-
[12]
En Allemagne, il n’y a pas de périodique qui inclut le terme Intermedialität dans son titre, mais diverses revues savantes, telle la Zeitschrift für Medienwissenschaft, accueillent les études inspirées par l’approche intermédiale.
-
[13]
Il suffit, pour en avoir une idée, d’entrer les termes « intermediality » et « media ecology » dans l’application Ngram de Google (qui comptabilise les occurrences de mots dans tous les livres, publiés en anglais dans ce cas-ci), pour voir combien les courbes de croissance sont similaires entre les années 1990 et 2010.
-
[14]
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2015/06/23/the-17th-annual-convention-of-the-media-ecology-association-call-for-papers-university-of-bologna-june-23-26-2016/ (consultation le 17 février 2018).
-
[15]
http://isis2017.digitaltextualities.ca/fr/ (consultation le 17 février 2018).
-
[16]
Irina O. Rajewsky, entre autres, note aussi cette conscience aiguë de la matérialité des pratiques artistiques et culturelles : « [...] a heightened awareness of the materiality and mediality of artistic practices and of cultural practices in general. » Irina O. Rajewsky, « Intermediality, Intertextuality, and Remediation: a Literary Perspective on Intermediality », Intermédialités, no 6 « Remédier / Remediation », automne 2005, p. 44.
-
[17]
Il faut en effet préciser que McLuhan avait déjà utilisé cette formule oralement quelques années auparavant dans un autre contexte, soit lors d’une conférence en 1958 devant les diffuseurs de l’industrie de la radio à Vancouver. À ce sujet, voir l’entrée de blogue du petit-fils de McLuhan, Andrew McLuhan, « The Medium is the Message », Inscriptorium, 20 mai 2011, https://inscriptorium.wordpress.com/2011/05/20/the-medium-is-the-message/ (consultation le 12 juin 2017).
-
[18]
Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, trad. Jean Paré, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2001 [1966], p. 44-45.
-
[19]
Le fait que McLuhan évoque souvent les « effets » des médias et des technologies lui a fréquemment valu des accusations de « déterminisme », mais il faut savoir que la conception de la causalité chez McLuhan est beaucoup plus complexe et va au-delà de cette notion linéaire de la causalité « efficiente » au profit plutôt de la notion aristotélicienne de causalité « formelle ». À ce sujet, voir notamment Corey Anton, Robert K. Logan et Lance Strate (dir.), Taking Up McLuhan's Cause. Perspectives on Media and Formal Causality, Chicago, University of Chicago Press, 2017.
-
[20]
À propos de ce tournant dans les recherches sur les médias, voir notamment Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski et Kirsten A. Foot (dir.), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, MIT Press, 2014 (et surtout l’article de Jonathan Sterne : « “What Do We Want?” “Materiality!” “When Do We Want It?” “Now!” »), ainsi que Bernd Herzogenrath (dir.), Media Matter. The Materiality of Media, Matter as Medium, New York, Londres, New Delhi et Sydney, Bloomsburry, 2015.
-
[21]
« [...] the isolating tendencies of media theories and histories ». Jens Schröter, « Four models of intermediality », Travels in intermedia[lity]. ReBlurring the boundaries, Bernd Herzogenrath (dir.), Hanover, New Hampshire, Dartmouth College Press, p. 15.
-
[22]
« [...] the intricate and complex processes of media interactions or media encounters ». Ibid.
-
[23]
« [...] the “content” of any medium is always another medium. The content of writing is speech, just as the written word is the content of print, and print is the content of the telegraph. » Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man , W. Terrence Gordon, Corte Madera (ed.), CA, Gingko Press, 2003 [1964], p. 19.
-
[24]
Pour un excellent résumé de l’évolution des théories intermédiales, voir l’article de Jean-Marc Larrue, « The "in-between" of what? Intermedial perspectives on the concept of borders/boundaries », Geoffrey Rockwell et Michael Sinatra (dir.), Actes du congrès Digital Humanities without Borders organisé à St. Catharines (Ontario), 24–30 mai 2014, Digital Studies / Le champ numérique, vol. 5, 2014–2015, https://www.digitalstudies.org/articles/10.16995/dscn.33/ (consultation le 18 février 2018).
-
[25]
Marshall McLuhan, « Living at the Speed of Light », conférence donnée le 25 février 1974 à l’université de South Florida, dans Understanding Me. Lectures and Interviews, Stephanie McLuhan et David Staines (dir.), Toronto, McLelland & Stewart, 2003, p. 241-242.
-
[26]
« Media ecology is concerned with the study of both media as environments and environments as media. » Lance Strate et Judith Yaross Lee, « Beginnings », Explorations in Media Ecology, vol. 1, no 1, avril 2002, p. 2.
-
[27]
« Le CRIalt est l’héritier du Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI) qui a été le premier centre de recherche (1997) au Québec et au Canada sur les rapports intermédiatiques et leurs implications historiques, sociologiques, culturelles et politiques. » Site Web du Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, section « À propos », http://crialt-intermediality.org/fr/pages7/ (consultation le 18 février 2018).
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Andrew McLuhan, « The Meaning of ‘Medium’ is the Message », freeCodeCamp, 11 septembre 2016, https://medium.freecodecamp.org/the-meaning-of-medium-is-the-message-9bbe732869a7 (consultation le 18 juin 2017).
-
[30]
Dans la conférence précitée de McLuhan, peu après son développement sur l’automobile, il lie l’apparition de l’écologie à la mise en orbite du premier satellite, puis évoque la nécessité de développer une écologie des médias eux-mêmes : « Ecology became the name of the game from the moment of Sputnik. Nature ended. The planet became an art form inside a manned capsule, and life will never be the same on this planet again. Nature ended and art took over. Ecology is art. We now have to confront the need for an ecology of media themselves. » McLuhan, 2003, p. 242. Il va de soi que cette notion d’« écologie » connaît une fortune immense non seulement dans les milieux scientifiques, mais aussi, tout particulièrement à partir des années 1960–1970, dans les sciences humaines et sociales (« écologie humaine », « écologie sociale », « écologie politique », etc.). Il serait impossible ici d’en prendre toute la mesure.
-
[31]
« Enjeux scientifiques du CRI », document interne, 2009. Les quatre autres aspects sont les suivants : « Théorie et histoire des médias », « Épistémologie intermédiale », « La question de l’art » et « L’interdisciplinarité ».
-
[32]
Milad Doueihi, La grande conversion numérique, trad. Paul Chemla, Paris, Seuil, 2008.
-
[33]
Ibid., p. 259.
-
[34]
« L’important, comme dans toute réunion de famille, est que ça se passe mal, mais qu’on se retrouve l’année suivante. » Méchoulan, 2010, p. 259.
-
[35]
Lance Strate, « An Overview of Media Ecology », site Web de la Media Ecology Association, http://www.media-ecology.org/about-us/ (consultation le 2 juillet 2017.) Strate vient tout juste de publier un ouvrage complet consacré à l’écologie des médias (Lance Strate, Media Ecology: An Approach to Understanding the Human Condition, New York, Peter Lang, 2017) que nous n’avons malheureusement pu prendre en compte pour cette étude.
-
[36]
Cette image est reproduite avec la permission de Paolo Granata, que nous tenons à remercier.
-
[37]
Cette étude comparative a été faite en juillet 2017 en consultant les outils de recherche des bases de données des deux revues, accessibles sur Intellect pour Explorations in Media Ecology (https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=214) et sur Érudit (https://www.erudit.org/fr/revues/im/) pour Intermédialités. Tel qu’indiqué dans le tableau, à cette date, Intermédialités avait 27 numéros publiés accessibles en ligne, alors que EME en avait 43.
-
[38]
Les publications allemandes sur l’Intermedialität feraient sans aucun doute une place plus grande aux sources allemandes, mais cela n’altérerait pas et risquerait même de renforcer la polarisation Europe-Amérique du Nord qui caractérise les sources intellectuelles de ces branches mcluhanniennes de la pensée des médias, comme en témoigne « géographiquement » le fait qu’avant 2016, toutes les conférences annuelles des associations ISIS et MEA avaient été tenues sur leur continent d’origine.
-
[39]
L’analyse d’un échantillon de 200 des 610 membres de l’association Media Ecology dans le bottin de la MEA nous a permis d’estimer que plus de 80 pour cent des membres (82,5 pour cent de cet échantillon) vivaient en Amérique du Nord (incluant 59,5 pour cent d’Américains et 22,5 pour cent de Canadiens), tandis que seulement 6 pour cent des membres vivaient dans un pays européen, les autres se trouvant en Asie et en Océanie (5 pour cent), en Amérique du Sud (4 pour cent) ou au Moyen-Orient (2,5 pour cent). Les chiffres de l’ISIS n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de cet article, mais une comptabilisation rapide non pas de l’origine nationale, mais de l’affiliation institutionnelle des participants aux colloques des deux associations nous donne une bonne idée du partage transatlantique : plus de 80 pour cent des participants des colloques ISIS de 2013 à Cluj-Napoca (80,1 pour cent) et de 2015 à Utrecht (83,1 pour cent) étaient affiliés à des institutions européennes, tandis qu’une proportion de plus de 85 pour cent des participants au colloque MEA de Denver en 2012 et de 71 pour cent à celui de New York en 2015 était affiliée à des institutions nord-américaines (précisons que ce pourcentage plus faible de Nord-Américains au colloque de New York s’explique par la présence d’un fort contingent sud-américain, brésilien surtout : les participants attachés à des universités européennes ont donné moins de 9 pour cent des communications de ce colloque). Nous avons choisi de ne pas prendre en compte le colloque 2016 du MEA à Bologne et le colloque 2017 d’ISIS à Montréal étant donné que leur situation sur le continent « opposé » a eu un effet important de distorsion sur la nature des participants (étant donné la participation fortement réduite des membres habituels de ces associations qui n’ont pu traverser l’Atlantique et la participation inhabituellement élevée des habitants des pays hôtes).
-
[40]
Dans un hommage à Carey rédigé une année après son décès, Pascal Froissart confirme en effet que « James Carey est mal connu en France, alors que son rayonnement dans le monde anglo-saxon est important. » Pascal Froissart, « L’approche rituelle de la communication Hommage à James Carey », Médiamorphoses, no 19, [s.d.], p. 37.
-
[41]
Neil Postman, en effet, n’est pas connu pour son travail scientifique, mais pour des ouvrages de vulgarisation et de critique culturelle dont certains ont connu un grand succès, à l’instar d’Amusing Ourselves to Death surtout, qui, publié en 1985 durant l’ère Reagan, connaît un regain de popularité depuis l’élection de Donald Trump. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, New York, Penguin, 1985. Son ouvrage intitulé Technopoly est une dénonciation plus générale de l’emprise de la technologie sur les sociétés contemporaines : Technopoly: the Surrender of Culture to Technology, New York, Vintage Books, 1993.
-
[42]
Nous n’avons pas été surpris de retrouver récemment Ellul et Mumford dans le panthéon des 50 penseurs qui ont inspiré la pensée de la « décroissance » : Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset (dir.), Aux origines de la décroissance : cinquante penseurs, Paris, Montréal et Vierzon, L’Échappée/Écosociété/Le Pas de côté, 2017.
-
[43]
Neil Postman, « The Humanism of Media Ecology », Janet Sternberg et Mark Lipton (dir.), Actes du congrès annuel de la Media Ecology Association organisé à New York, 16–17 juin 2000, vol. 1, 2000, http://media-ecology.org/publications/MEA_proceedings/v1/index.html (consultation le 15 juin 2017).
-
[44]
Ibid.
-
[45]
« To be quite honest about it, I don’t see any point in studying media unless one does so within a moral or ethical context. I am not alone in believing this. Some of the most important media scholars — Lewis Mumford and Jacques Ellul, for example — could scarcely write a word about technology without conveying a sense of either its humanistic or anti-humanistic consequences. » Ibid.
-
[46]
Lance Strate confirme le caractère central de ces trois figures : « media ecology can be understood as an intellectual network in which McLuhan, Ong, and Postman constitute the prime nodes (corresponding geographically to Toronto, St. Louis, and New York City) ». Lance Strate, Echoes and Reflections: on Media Ecology as a Field of Study, Cresskill, NJ, Hampton Press, p. 12.
-
[47]
À ce sujet, voir Gregory Reynolds, The World is Worth a Thousand Pictures: Preaching in the Electronic Age, Eugene, Oregon, Wipf & Stock, 2001, p. 171.
-
[48]
Sur les fondements religieux de la pensée de McLuhan, rarement évoqués dans ses écrits les plus diffusés, voir Marshall McLuhan, The Medium and the Light: Reflections on Religion, Eric McLuhan et Jacek Szklarek (ed.), Toronto, Stoddart, 1999, ainsi que le numéro spécial de la revue Renascence consacré à son catholicisme, vol. 64, no 1, automne 2011.
-
[49]
L’appel à contributions du présent numéro dressait une liste plus détaillée des disciplines dans lesquelles l’intermédialité « apparaît plus ou moins incidemment (comme dans les études littéraires, l’histoire de l’art, les études de cinéma, les études de théâtre, la musicologie, l’anthropologie, la théorie de l’architecture, les études urbaines, les études de la communication, les cultural studies, les sound studies, les translation studies, les performance studies, les (video)game studies, les porn studies, etc.) ». « Appel à contributions : Cartographier (l’intermédialité) / Mapping (intermediality) », Intermédialités, no 29, printemps 2017.
-
[50]
La Media Ecology Association est affiliée à quatre organisations, toutes quatre dans le domaine des communications : la National Communication Association, l’Eastern Communication Association, l’International Communication Association et la New York State Communication Association.
-
[51]
À un sondage informel réalisé auprès du groupe Facebook « Media Ecology », 15 personnes ont répondu qu’elles avaient une formation en communication ou en media studies, 6 en philosophie, 4 en lettres (English), 4 en littérature comparée, 3 en éducation, 2 en histoire des sciences et de la technologie, 2 en théâtre et 1 dans chacun des domaines suivants : cultural studies, informatique, psychologie, sociologie et théologie. Il y a aussi un certain nombre de chercheurs « indépendants », d’artistes, voire d’entrepreneurs qui prennent part aux activités de la MEA.
-
[52]
Un survol (non scientifique) des titres et abstracts des articles dans les numéros des dix premières années de la revue Explorations in Media Ecology, par exemple, nous a permis d’identifier 38 articles théoriques, 16 articles sur les enjeux pédagogiques des médias, 14 articles sur des « effets » psychologiques ou sociologiques des médias, 10 articles sur des questions liées à la religion ou à la spiritualité en relation avec la technologie, 8 articles sur le journalisme, mais seulement 3 articles sur le cinéma, 3 articles sur la musique, 1 article sur les arts visuels et aucun sur la littérature. En revanche, un survol (moins approfondi étant donné que les tendances paraissaient déjà suffisamment évidentes) des numéros des premières années d’Intermédialités a permis d’identifier 15 articles théoriques, 18 articles sur le cinéma, 16 articles sur les arts visuels, 11 articles sur la littérature, 4 sur la photo, 3 sur les jeux vidéo, 3 sur la musique, 1 sur la religion et 1 seul portant sur l’éducation ou la pédagogie : Laura U. Marks, « In the University's Ruins, Some Audiovisual Thoughts », Intermédialités, n° 5 « Transmettre / Transmitting », printemps 2005.
-
[53]
La recherche des mots « éducation / education » dans les deux revues a donné 138 résultats dans EME contre 31 dans Intermédialités.
-
[54]
La recherche des mots « spiritualité / spirituality » dans les deux revues a donné 38 résultats dans EME contre 2 dans Intermédialités.
-
[55]
En plus de la NYU, l’université Fordham, aussi à New York, est connue pour son fort noyau d’écologistes des médias, mais, sinon, les cours d’écologie des médias semblent « saupoudrés » un peu partout dans divers programmes et universités : « The field of media ecology, as taught in college curricula, rests virtually camouflaged among adjacent disciplines — such as media criticism; media, culture, and society; media effects; and semantics — yet does not appear to concern itself with distinguishing its project from those of the kindred disciplines. » Dennis D. Cali, « On Disciplining Media Ecology », Explorations in Media Ecology, vol. 10, nos 3-4, 2011, p. 343.
-
[56]
Casey Lum témoigne éloquemment de l’ « attention polie » accordée à l’écologie des médias dans ces congrès : « The term’s very ambiguity invariably fueled comment and discussion from outsiders, bringing into the circle people who thought they knew something about communication but were struck — and intrigued on just what was this thing called media ecology. But even after three decades of evolution since the coinage of the phrase late in the 1960s, media ecology still draws polite curiosity at communication conferences whereby, for better or for worse, it still works pretty well as an ice-breaker at the bar. » Casey Man Kong Lum (dir.), Perspectives on Culture, Technology and Communication: the Media Ecology Tradition, Cresskill, NJ, Hampton Press, p. 3. Cela n’est pas sans évoquer les réactions face à des références à l’« intermédialité » dans certains milieux disciplinaires plus traditionnels.
-
[57]
L’intermédialité peut à tout le moins se vanter d’avoir des centres de recherche établis à travers le monde (Toulouse, Sarrebruck, Graz, Montréal, etc.), sauf que le fait que le CRIalt n’ait pas obtenu de financement d’organismes de recherche depuis maintenant plusieurs années témoigne de la fragilité de cette « interdiscipline ».
-
[58]
« The twentieth century marks the middle period of a great transition in the state of the human race. It may properly be called the second great transition in the history of mankind. The first transition was that from precivilized to civilized society which began to take place about five (or ten) thousand years ago [...] Even as the first great transition is approaching completion, however, a second great transition is treading on its heels. It may be called the transition from civilized to postcivilized society. » Kenneth E. Boulding, The Meaning of the 20th Century: the Great Transition, New York, Harper & Row, 1964, p. 2.
-
[59]
Christine Nystrom, Towards a Science of Media Ecology: the Formulation of Integrated Conceptual Paradigms for the Study of Human Communication Systems, thèse de doctorat, New York University, 1973. Extrait publié sur le site Web de la Media Ecology Association, http://www.media-ecology.org/about-us/ (consultation le 1er juillet 2017).
-
[60]
Strate et Yaross Lee, 2002, p. 2.
-
[61]
« [...] media ecology is an emerging discipline not yet a fully realized one. » Cali, 2011, p. 344.
-
[62]
Ibid. Le texte de Bloland cité par Cali est le suivant : H.G. Bloland, « Postmodernism and higher education », The Journal of Higher Education, vol. 66, no 5, p. 521-559. Le livre de Bill Readings, cité par Bloland, lui-même cité par Cali, est The University in Ruins, Cambridge, MA et Londres, Harvard University Press, 1996.
-
[63]
« Drawing on Deleuze and Guattari (1987), Courmier taps another metaphor familiar to media ecologists to elaborate: “the rhizome” pertains to a map that must be produced, constructed, a map that is always detachable, connectible, reversible, modifiable, and has multiple entryways and its own lines of flight (p. 21, italics added). Perhaps to describe the enterprise of media ecology as a rhizomatic community and field of study best captures its current nature and scope. » Cali, 2011, p. 345. La référence à Deleuze et Guattari concerne la traduction anglaise de Mille Plateaux, capitalisme et schizophrénie : Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia, trad. Brian Massumi, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.
-
[64]
« […] l’intermédialité voyage, se propage de plus en plus rapidement et de façon rhizomique, créant un réseau sans centre précis, mais où différentes interprétations de la médialité et différentes applications de la “méthode intermédiale” foisonnent. » « Appel à contributions : Cartographier (l’intermédialité) / Mapping (Intermediality) », https://t.co/m9ZaAZW4Gm (consultation le 18 février 2018).
-
[65]
« On peut distinguer deux manières d’envisager l’intermédialité : d’un côté, elle est visée comme telle par des centres à vocation interdisciplinaire (à Montréal, à Toulouse, à Sarrebruck, à Graz, notamment) qui dégagent les aspects « médiatiques » de leurs objets d’études [...]. » Ibid.
-
[66]
Si la pratique de l’interdisciplinarité émerge dès le début du 20e siècle et si le terme apparaît dès les années 1930, c’est vraiment à partir des années 1960 que la pression se fait plus grande pour développer des approches interdisciplinaires de l’enseignement et de la recherche. À ce sujet, voir notamment Harvey J. Graff, Undisciplining Knowledge: Interdisciplinarity in the Twentieth Century, Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University Press, 2015; David L. Sills, « A Note on the Origin of “Interdisciplinary” », Items, vol. 40, no 1, 1986, p. 17-18; et Yves Lenoir, « L’interdisciplinarité : aperçu historique de la genèse d’un concept », Cahiers de la recherche en éducation, vol. 2, no 2, 1995, p. 227-265.
-
[67]
Le Culture and Communications Seminar, financé par la fondation Ford, s’est tenu à l’Université de Toronto entre 1953 et 1955. Organisé par McLuhan et l’anthropologue Edmund Carpenter, ce séminaire hebdomadaire réunissait aussi une spécialiste de l’urbanisme, Jaqueline Tyrwhitt, un économiste politique, Thomas Easterbrook, et un psychologue, D. Carleton Williams. Inspiré notamment par les recherches du professeur d’économie politique Harold Innis sur les « biais » des technologies de communication, le projet a donné naissance à la revue interdisciplinaire devenue mythique Explorations, qui a publié neuf numéros entre 1953 et 1959.
-
[68]
Sur les apports de McLuhan au développement de l’interdisciplinarité, voir notamment Twyla Gibson, « Double Vision: McLuhan's Contributions to Media as an Interdisciplinary Approach to Communication, Culture, and Technology », MediaTropes, 2008, vol. 1, no 1, p. 143-166; Oumar Kane, « Marshall McLuhan et la théorie médiatique : genèse, pertinence et limites d’une contribution contestée », Tic & Société, vol. 10, n° 1, 1er semestre 2016, http://journals.openedition.org/ticetsociete/2043#bodyftn24) (consultation le 18 février 2018); et Gary Genosko, Marshall McLuhan: Critical Evaluations In Cultural Theory, vol. 3, Renaissance for a wired world, London, Routledge, 2005.
-
[69]
Voir notamment Jürgen E. Müller, 2000, p. 105-134. On pourrait aussi citer à nouveau le document « Enjeux scientifiques du CRI » qui, en 2009, identifiait l’interdisciplinarité parmi les cinq « aspects » des « contributions du Centre à l’avancement des connaissances » : « Le CRI a mis au point une pratique d’interdisciplinarité solide et réelle entre plusieurs domaines traditionnellement séparés. Cette pratique s’incarne de façon exemplaire dans sa revue. Il est devenu nécessaire de ne pas oeuvrer en vase clos, de prendre en compte les approches et les avancées accomplies dans des disciplines connexes, de réfléchir aux présupposés techniques, technologiques ou institutionnels qui fondent l’efficacité et le sens des productions artistiques ou des manifestations discursives les plus diverses. » Enjeux scientifiques du CRI, document interne, 2009.
-
[70]
À ce sujet, voir notamment Éric Méchoulan, « Intermédialités : le temps des illusions perdues », Intermédialités, n° 1 « Naître », printemps 2003, p. 9-27 et Walter Moser, « L’interartialité : pour une archéologie de l’intermédialité », Marion Froger, Jürgen E. Müller (dir.), Intermédialité et socialité. Histoire et géographie d’un concept, Münster, Nodus Publikationen, coll. « Film und Medien in der Diskussion », vol. 14, 2007, p. 69-92.
-
[71]
La réflexion la plus complète sur le caractère central (et complexe) de l’« entre-deux » et de l’inter-esse pour l’intermédialité est sans doute celle d’Henk Oosterling : « Sens(a)ble Intermediality and Interesse: Towards an Ontology of the In-Between », Intermédialités, n° 1 « Naître », printemps 2003, p. 29-46. En ce qui concerne l’« entre-deux », voir aussi les travaux du philosophe Peter Zhang sur la notion d’« interalité », notamment dans le numéro spécial « Studies on Interality » du Canadian Journal of Communication, vol. 4, no 3, 2016, ainsi que mon article pour ce même numéro, Jean-François Vallée, « A Dialogue between Dialogism and Interality », p. 469-486.
-
[72]
Comme le fait justement Yoni Van Den Eede à propos de l’écologie des médias (et de la philosophie de la technologie) : « Notwithstanding much feverish talk about inter- and multi-disciplinarity, real and substantial dealings between disciplines remain hard to come by. Paradoxically, that even counts for disciplines that are in themselves eclectic and composed of elements hailing from many different domains. Such is, to a large extent, the case for Media Ecology (ME) and Philosophy of Technology (PhilTech). » Yoni Van Den Eede, « Blindness and ambivalence: the meeting of Media Ecology and Philosophy of Technology », Explorations in Media Ecology, vol. 15, no 2, 2016, p. 103.
-
[73]
Jean-Marc Larrue, 2014.
-
[74]
« This is because the progressive elimination of the system of binary opposites ended up eliminating the in-between or, at least, the "two" prior entities that supposedly circumscribe this "between" and from which they originate. The between remains – and there is only that, and intermediality deals only with it. » Ibid.
-
[75]
Jürgen E. Müller, « Vers l’intermédialité. Histoires, positions et options d’un axe de pertinence», Médiamorphoses, no 16, 2006, p. 99-100.
-
[76]
Bill Readings, The University in Ruins, Cambridge, MA, Londres, Harvard University Press, 1995, p. 39.
-
[77]
Voir Readings, 1995, p. 201, note 23.
-
[78]
Pour donner un exemple « local » récent, on pourrait citer la création à l’Université de Montréal du « Département de littératures et de langues du monde » (sic) qui a résulté de la fusion des départements de littérature comparée (où enseignait justement Bill Readings), d’études hispaniques, d’études allemandes, d’études anglaises et de langues modernes (incluant les études arabes, italiennes, russes, lusophones, néo-helléniques et catalanes). À une échelle plus vaste, dans le milieu universitaire américain par exemple, le blogueur Byron Alexander fait un suivi de ce qu’il appelle les « sacrifices de la reine » (Queen sacrifices) dans les collèges et universités qui procèdent à un nombre croissant de « restructurations » et de coupures ou de fermetures complètes de programmes (et ce, presque systématiquement dans les domaines « non-STEM » des arts, des lettres, des humanités et des sciences humaines ou sociales) : https://bryanalexander.org/tag/queensacrifice/, (consultation le 18 février 2018).
-
[79]
À ce sujet (et sur le danger de voir ces nouveaux programmes « interdisciplinaires » devenir de nouvelles formes de « disciplines » en soi), voir notamment le texte d’Ethan Kleinberg : « Interdisciplinary Studies at a Crossroad », Liberal Education, 2008, p. 6-11.
-
[80]
« If the new inter-disciplines are a symptom of the end of a model whose organising principle was a national literature that produced subjects for the nation-state, it is also, according to some, the form of knowledge that ideally projects the new forms of economic domination. » James Cisneros, « Remains to be Seen: Intermediality, Ekphrasis and Institution », Leena Eilittä, Liliane Louvel et Sabine Kim (dir.), Intermedial Arts: Disrupting, Remembering, and Transforming Media, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 198. Une première version de ce texte était parue en 2007 dans Marion Froger et Jürgen E. Müller (dir.), 2007, p. 15-28.
-
[81]
Ibid., p. 187.
-
[82]
À Montréal à tout le moins, l’avenir de l’intermédialité s’annonçait alors assez prometteur de ce point de vue : « The concept of intermediality surfaces at this institutional juncture. Placed at the crossroads of information, media and technology, it deploys to advantage the transnational networks’ fundamental elements and interests. Research of the concept, at least in Montreal, has resulted in considerable funding from the government as it invests in the information superhighway and from corporate foundations as they patronize related activities with financial or in-kind support. » Cisneros, 2012 [2007], p. 185-186.
-
[83]
Bill Readings suggérait une alternance rythmée entre « attachement » et « détachement » disciplinaires : « What I am calling for, then, is not a generalized interdisciplinary space but a certain rhythm of disciplinary attachment and detachment which is designed so as not to let the question of disciplinarity disappear, sink into routine. ». Readings, 1996, p. 176.
-
[84]
« In the context of our discussion, intermediality’s reflexivity and focus on technology can help us to see the university’s ruins, yet only if we turn it towards its institutional origins and, inevitably, towards ourselves. If we translate this circling back into Readings’s terms, it means installing “disciplinarity as a permanent question” (Readings 1996: 177). » Cisneros, 2012 [2007], p. 188.