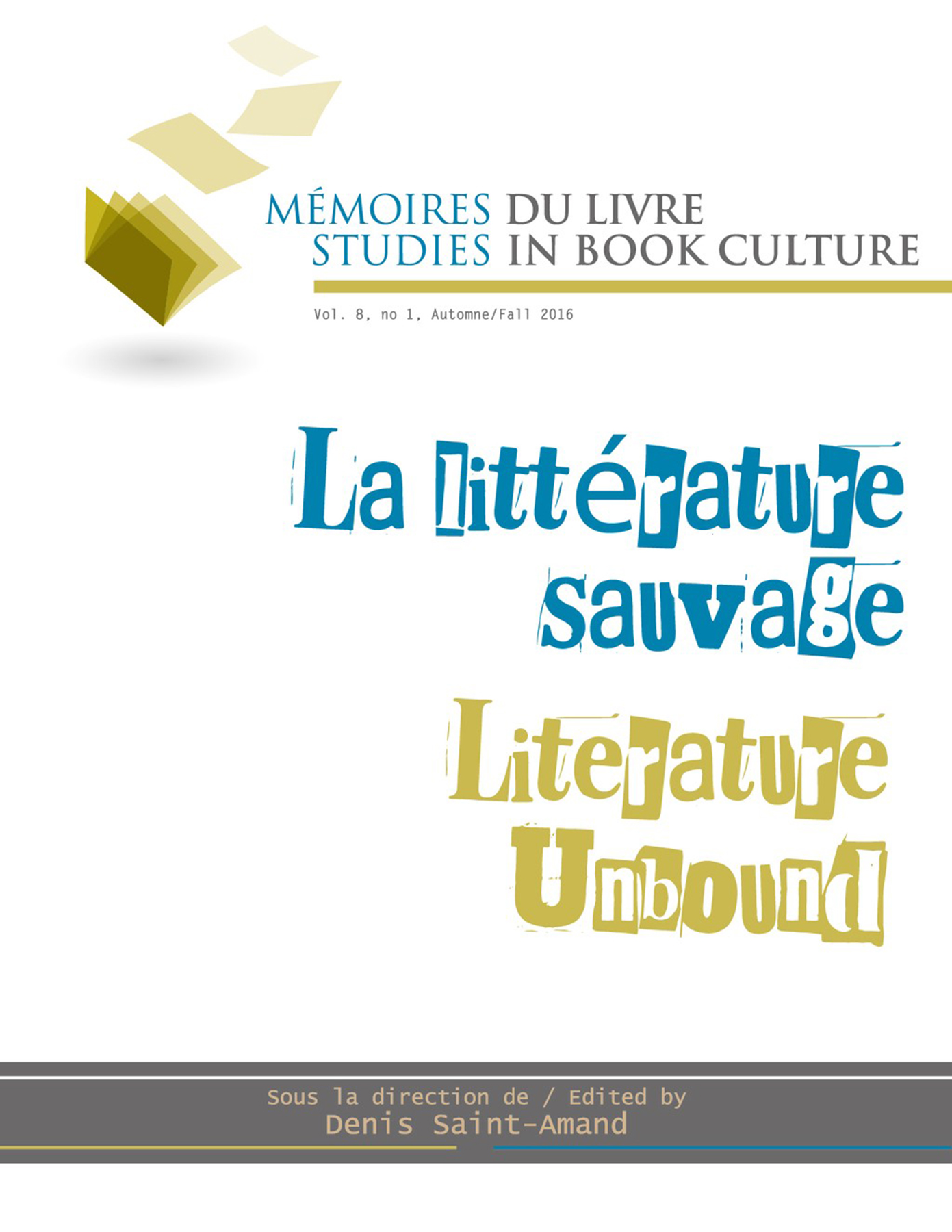Résumés
Résumé
Cet article s’attache au Collège de sociologie (porté par Bataille, Caillois et Leiris, de 1937 à 1939), et plus particulièrement à son statut de collectif de recherche « sauvage ». Il montre que l’ambition de créer une « communauté morale » qui l’anime prend le relais d’expériences plus formelles (propres à la revue Documents, par exemple) et que ce dispositif complexifie sa réception. Il considère également le travail éditorial mené par Denis Hollier, en mettant en lumière les impasses qu’il déjoue : quand le devenir-livre signifie le plus souvent consécration, l'existence livresque du Collège de sociologie n’a pas stabilisé sa réception, parce que son édition parvient à le faire apparaître à la fois puissamment subversif et historiquement situé. L’enjeu est donc d’interroger les modalités du partage de l’autorité (celle qui est propre à tout collectif, mais aussi celle qui procède du travail de l'éditeur) et la dimension axiologique de l’histoire littéraire, que le choix des supports contribue à façonner.
Abstract
This article focuses on the Collège de sociologie (led by Bataille, Caillois and Leiris, from 1937 to 1939), more specifically on its status as an “unbound” collective research project. It shows that its ambition to make up a “moral community” takes over from more formal experiments (by comparison, for instance, with the review Documents) and that this approach makes its reception rather complex. It also pays particular attention to the editing process conducted by Denis Hollier, to shed light on the deadlocks that it resolves: while making a book out of an off-track experiment usually implies its consecration, the life of the Collège de sociologie as a material object did not bring about a stable reception, because his editor managed to make it appear both powerfully subversive and historically situated. The hope is to achieve a better understanding of co-authorship (which belongs to any collective movement, but which can also involve the editor) and of the axiological dimension of literary history, which is partly shaped by its media.
Corps de l’article
« Parallèle et sauvage[1] », le Collège de sociologie, porté par Georges Bataille, Roger Caillois et Michel Leiris, de juillet 1937 à juillet 1939, l’est à plus d'un titre : né à l’écart des institutions de savoir comme de l'espace du livre, il constitue un projet fondamentalement rétif aux idées et aux médiums autorisés, aimanté par le goût de l’hétérogène et l’hétérodoxe. À la différence des projets antérieurs de Bataille[2], le format retenu n’est pas, cette fois, celui de la revue, mais celui du collectif, dont les productions sont publiées sporadiquement. « Collège », donc, parce que les pairs qui le composent se proposent de dispenser « un enseignement théorique sous forme de conférences hebdomadaires[3] »; de « sociologie », parce que ce savoir représente, sur fond d’impasses des avant-gardes et de crise des démocraties occidentales, l’espoir de dépasser les démêlés de la politique et de l'art, pour mettre au jour et régénérer ce qui fait lien entre les individus. Au cours de sa brève existence, l’expérience sera animée par une tension insidieuse entre désir de rationalité et attraction pour ce qui la met en échec, suivant un dosage subtil d’audace et d’équivoque.
Si, appliqués à la littérature, les adjectifs « parallèle » et « sauvage » évoquent des pratiques transgressives, qui parasitent ou éludent les règles du jeu littéraire, le second, qualifiant l'état de ce qui ne se distingue pas de la nature, peut aussi renvoyer au fantasme d’une littérature qui, vierge de tout conditionnement, existerait indépendamment des représentations sociales propres à l’institution qu’elle est : écrits ordinaires, formes « brutes » ou indisciplinées, qui seraient par là même des clés pour sa compréhension – la littérature mise à nu, autrement dit. Le Collège de sociologie n’est pas sauvage en ce sens : par sa conscience aiguisée des faits sociaux, et particulièrement du caractère institutionnel du fait littéraire, il ne peut être en-deçà du littéraire, mais cherche à se situer au-delà. Sauvage, il l’est surtout, peut-être, par les ruses qu’il oppose à nos efforts pour le domestiquer – le rendre inoffensif, cohérent, utilisable.
C’est à Denis Hollier qu’on doit d’avoir donné la tridimensionnalité d’un livre à ce dossier complexe, dont les événements furent oraux et les restes éparpillés. Son édition critique, Le Collège de Sociologie (Gallimard, coll. « Idées », 1979; rééditée en « Folio essais », 1995), collige les traces qu’il a laissées. Après 40 ans de somnolence (ou de purgatoire?), et depuis près de 40 ans à présent, l’existence du Collège est donc passée du mode de la réunion informelle au format livresque, sans pour autant perdre de sa puissance d’inconfort. Ce devenir-livre d’un collectif aux contours instables et sans opus magnum est resté jusqu’à présent inquestionné. Aussi s’agira-t-il ici d’interroger ce que ce nouveau support fait à notre compréhension de l’aventure. Il soulève la question du partage de l’autorité (authorship), celle qui est propre à tout collectif, mais aussi celle qui procède du travail de l’éditeur « inventeur », comme on peut l’être d’un trésor ou d’une archive.
Nous reviendrons d’abord sur le projet initial de ce collectif, afin de caractériser ses pratiques et sa pensée (en creux) du médium, pour nous attacher ensuite au geste éditorial de « l’apprenti sourcier » (CS, p. 15), selon l’expression de Denis Hollier lui-même. Nous verrons ainsi que, si le devenir-livre du Collège de sociologie n’a pas désamorcé sa charge subversive, il révèle néanmoins l’effet du travail de l’historien de la littérature sur la valeur de ses matériaux et le rôle que jouent les supports dans ce processus de valorisation.
Un lieu de savoir évanescent
Il nous faut repartir de l’étrangeté de cette institution officieuse, que l’on ne peut assigner ni à un médium ni à une doctrine arrêtée. La manière la plus efficace de situer le Collège de sociologie reste celle de Denis Hollier : ultime avant-garde de l’entre-deux-guerres, qui veut sortir de la littérature par la science et penser collectivement le collectif (CS, pp. 19-23). Pointant les insuffisances des études sociologiques académiques, ses membres prennent leurs libertés avec les limites disciplinaires et les principes scientifiques, en revendiquant sans détour un horizon activiste.
Le projet s’inscrit dans le sillage du surréalisme et de sa dissidence, dont l’organe est la revue, et tout particulièrement de Documents. Si les deux expériences ont en commun l’esprit ethnographique, les fins comme les moyens diffèrent de l’une à l'autre. Il s’agissait, à l’époque de Documents, de retrouver sous une « manière de voir savante » une « manière de voir enfantine ou sauvage[4] »; l’enjeu sera au Collège de les faire coexister. La revue donnait à cette recherche une forme éminemment visuelle, mettant en oeuvre une pensée du montage[5]; l’existence du Collège de sociologie, en revanche, sera essentiellement d’ordre événementiel : c’est par son activité qu’il se définit, non par ses productions imprimées. En deux ans, ses membres ne publient que trois fois en son nom[6]. C'est là la partie émergée de l’aventure : le cours régulier de ses activités consiste en exposés et discussions. Le Collège prend donc corps comme un lieu, lieu de sociabilité et lieu de savoir[7] : ses membres tiennent leurs réunions bimensuelles dans l’arrière-boutique d’une librairie[8] de la rue Gay-Lussac, dans le cinquième arrondissement parisien – on peut d’ailleurs trouver piquant qu’une expérience qui court-circuite l’ordre du livre ait lieu depuis « Les Galeries du livre », dans une rue nommée d’après un savant connu pour ses travaux sur la physique des gaz. L’entrée, contre une somme modique, est ouverte à tous, et l’adhésion annuelle, suggérée.
Il importe au demeurant de considérer ce dispositif comme un choix formel à part entière. Le collectif n’est pas à l’écart des circuits éditoriaux : certes, aucun de ses trois principaux animateurs n’a alors fait paraître de livre qui lui assure une notoriété certaine (sauf Leiris, avec L'Afrique fantôme), mais il compte parmi ses sympathisants actifs (et conférenciers) Jean Paulhan, alors directeur de la N.R.F., qui donne tribune à deux reprises au Collège, publie les annonces des conférences et des comptes rendus de séance – ce qui témoigne de l’ancrage du Collège du côté de la littérature, mais d’une littérature qui commence à s’intéresser activement aux sciences humaines. Ce n’est donc pas faute d’opportunité éditoriale que l’organisation s’écarte des sentiers de la publication. De fait, le choix du format que le Collège se donne est, comme dans le cas de Documents, homologue au projet intellectuel qu’il se fixe. Par sa pratique décapante du montage, Documents entendait agir sur les hiérarchies culturelles en vigueur; par la fondation d’une « communauté morale », posée en principe de l’organisation (CS, p. 27), le Collège cherche à agir sur les ressorts de l’ordre social. Le propos des membres est en effet la recherche du principe « communiel » (CS, p. 36) des institutions sociales, ce qui fait qu’elles prennent ou qu’elles tiennent; leur horizon, la réinvention des « liens nécessaires à l’action en commun » (CS, p. 27). Attentifs aux rapports du sacré au profane, tenants d’une « sociologie “active” », ils entendent réinjecter dans les sociétés modernes l’équivalent du sacré propre aux « sociétés dites primitives », pour régénérer le sens du collectif. D’abord défini comme « un organisme de recherches et d’études », le Collège affirmera ainsi, dans la « Déclaration du Collège de sociologie sur la crise internationale », qu’il a aussi vocation à être « un foyer d’énergie » :
C’est pourquoi il convie ceux à qui l’angoisse a révélé comme unique issue la création d’un lien vital entre les hommes, à se joindre à lui, en dehors de toute détermination que la prise de conscience de l’absolu mensonge des formes politiques actuelles et la nécessité de reconstituer par le principe un mode d’existence collective qui ne tienne compte d’aucune limitation géographique ou sociale et qui permette d’avoir un peu de tenue quand la mort menace[9].
Si l’on suit Caillois, rédacteur de cette déclaration, le projet « communiel », qui prend sens sur fond de désorientation politique, ne doit donc pas rester purement spéculatif, mais bel et bien prendre corps.
D’autres hypothèses pour expliquer le choix de ce format peuvent être cherchées dans les rapports qu’entretient le Collège aux sciences sociales. Son statut hybride, à mi-chemin entre séminaire universitaire et société secrète, conditionne son mode d’existence publique : le versant séminaire universitaire (dont une version académique serait à chercher du côté du Centre de documentation sociale, créé en 1921 par Célestin Bouglé à l’École Normale Supérieure, à quelques rues de distance[10]) appelle la publication; le versant société secrète (Acéphale) s’y refuse. Ne pas destiner les conférences du Collège à la publication systématique permet d’abord de se prémunir contre les réserves et critiques des sociologues autorisés. Les animateurs du Collège peuvent en effet se montrer « sauvages » dans leur usage des notions et principes de l’école de sociologie française, par eux mêlés de biologie et de psychanalyse, ou infléchis dans un sens sacramentel. Une telle démarche, irrévérencieuse, interdisciplinaire avant la lettre, a toutes les chances de se voir disqualifiée par la communauté savante. Mais ce choix est aussi positif. Dans l’entre-deux-guerres, la sociologie et l’ethnologie sont profondément marquées par la figure de Marcel Mauss, dont l’aura procède surtout de son enseignement, suivi par plusieurs des animateurs du Collège[11]. Par la forme autant que par le contenu de cet enseignement, ceux-ci ont donc conscience de l’efficacité d’un rite pour fédérer une communauté[12]. Tandis que le passage par l’écrit, qui à la fois divulgue et consacre, irait à l’encontre de l’imaginaire initiatique qui anime l’organisation, tout en limitant les possibilités de recherche expérimentale sur ce qui fonde un collectif, la réunion, en revanche, par sa dimension rituelle et émotionnelle, permet de donner lieu à ce « principe communiel » dont les membres sont en quête, en contribuant à la production d’un lien informel.
Le fonctionnement du collectif soulève également la question du partage de l'autorité : le Collège est-il à la hauteur de son ambition collégiale? Les textes publiés comptent certes plusieurs signataires, mais les conférences sont préparées individuellement – quoique Bataille soit contraint à plusieurs reprises d’assurer la séance à partir des notes de Caillois. Si les exposés de ces deux derniers n’occupent pas moins de 15 séances sur les 24 tenues, on comptera au total une dizaine d’orateurs d’horizons très différents, aux objets et aux vues distinctes – tels, au cours de la seconde année, Denis de Rougemont sur les « Arts d'aimer et arts militaires », Anatole Lewitsky sur le chamanisme, Jean Paulhan sur les proverbes malgaches... Aussi est-il toujours approximatif d’attribuer un énoncé au « Collège de sociologie » comme instance unifiée. La position, intenable, de Bataille, est celle de cerveau d’une société qui se veut elle aussi acéphale. Malgré l’énergie qu’il déploie pour faire advenir un « nous », il se trouvera finalement seul à parler lors de la dernière séance, après le départ précipité de Caillois pour l’Argentine et le retrait in extremis de Leiris. La dissolution du Collège ne fait d'ailleurs que précipiter les dissensions latentes, la « lézarde dans l’édifice » (CS, p. 799). Ses insuffisances, scientifiques et littéraires, peuvent être inférées des critiques émises lors de ce retrait par Leiris, celui des trois principaux animateurs qui a été le moins impliqué. Réticences littéraires : les derniers mots du bilan qu’il devait dresser lors de la dernière séance de la seconde année, et qu’il ne prononcera pas, attiraient l’attention sur la place du littéraire et les « moyens d'action » (CS, p. 816) du Collège, auxquels il n’aurait pas accordé suffisamment d’attention. Leiris semble en somme lui reprocher un certain défaut de conscience réflexive, vis-à-vis de son discours comme de sa portée. Insuffisances scientifiques : dans une lettre à Bataille, il exprimera également la gêne qu’éveillent en lui les manquements du groupe à la méthode sociologique (CS, pp. 818-821). Le Collège se trouve ballotté, on le voit, entre plusieurs paires d’injonctions contradictoires.
Le dispositif propre au Collège de sociologie peut ainsi être considéré comme la traduction concrète du désir de restaurer une forme de communion sociale perdue, par le sacré et par le mythe (dont la littérature, par sa dimension individualiste, apparaît comme une version dégradée), ou, à l’inverse, comme l’indice de son incapacité à diffuser hors de ses adeptes des représentations collectives qui assureraient une cohésion autour de valeurs et d’actions communes. Ce lieu de savoir sans oeuvre ni doctrine peut aussi bien apparaître comme un non-lieu, fabrique d’un non-savoir – qui est « expérience de la négation d’un savoir communicable par la raison (scientifique, linguistique) au profit d’un savoir communicable par l’émotion[13] ». Ce collectif « sauvage » incarne en ce sens le paradoxe mis au jour par les pensées de la communauté, de Maurice Blanchot à Giorgio Agamben : le désir d’activer ce qui relie sans figer le lien[14].
Colliger le Collège
Comment une telle entreprise passe-t-elle de l’arrière-boutique d’un libraire aux rayonnages de ses successeurs? Que peut faire l’historien pour ne pas réifier (lisser, figer) cette expérience éphémère, instable, protéiforme? C’est le travail éditorial de Denis Hollier que nous nous proposons à présent de considérer, à partir de l’observation du livre qui en est le produit, afin de caractériser la manière de ce geste éditorial[15].
« Apprenti sourcier » (CS, p. 15), Denis Hollier ne l’est déjà plus tout à fait en 1979, quoi qu’il en dise. Il a soutenu en 1973 une thèse sur « Bataille entre deux guerres », sous la direction de Gaëtan Picon, dont il tire, en 1974, La Prise de la Concorde : essais sur Georges Bataille; participé à l'édition des Oeuvres complètes de ce dernier, entre autres. « Apprenti sorcier », il l’est peut-être, en revanche, en tant qu’auteur du « processus de transsubstantiation symbolique du texte en livre dont tout éditeur est responsable[16] ». Notons d’abord que l’ancrage disciplinaire du chercheur, quel que soit son degré de détachement à l’égard des codes qu’il implique, n’est pas sans incidence sur le rapport qu’il entretient à son objet. Il est évident que, si l’édition princeps avait été réalisée par un historien des sciences, l’inscription du Collège dans le champ intellectuel et disciplinaire aurait été quelque peu différente[17]. Les appartenances multiples du Collège de sociologie, qui tient à la fois du discours para-scientifique, de l’expérimentation méta-littéraire et du projet politique, recouvrent de fait un rapport complexe à l’institution littéraire. Cette dernière fonctionne comme repère de façon surtout négative : la « littérature » est constituée en horizon non pas d’attente mais de rupture et, dans une certaine mesure, de désaveu. Le Collège de sociologie manifeste donc d’abord l’intérêt que peut avoir le chercheur à compter parmi ses objets d’attention les projets qui se sont définis contre celle-ci, tout en l’engageant à interroger les frontières entre science, littérature et document.
« On trouvera dans ce volume – authentically restored, comme disent les Américains – les restes pieusement colligés de ce dernier groupe d’avant-garde d’avant-guerre », annonce Denis Hollier (CS, p. 14). Le volume rassemble en effet des « restes » disparates : ceux qui furent publiés comme émanant du Collège de sociologie et ceux parus ultérieurement sous d’autres formes, mais aussi des notes inédites, les résultats d’une enquête, des lettres, des extraits d’articles..., dont la mise au jour a requis un important travail d’archives[18]. Ils sont accompagnés de précieux parerga qui donnent à ces matériaux hétérogènes la liaison attendue d’un livre[19]. En éclaireur, Denis Hollier donne ainsi à voir conjointement le Collège de sociologie et la lecture qu’il en fait. Pour mesurer véritablement la marque de l’éditeur sur le produit final, il faudrait bien sûr pouvoir partir à nouveaux frais en quête de ces restes (autant réécrire le Quichotte), disposer d’une édition en fac-simile ou établie par un autre éditeur. Le volume est toutefois paru sous deux éditions, en 1979 et en 1995. Se livrer au jeu des différences entre ces deux moutures, leur paratexte et leur conception, peut déjà être révélateur.
Les changements de collection et de couverture n’ont rien de décisif[20]. Celui du sous-titre l’est davantage. Quand l’édition originale portait le sous-titre « Texte de Bataille, Caillois, Guastalla, Klossowski, Kojève, Leiris, Lewitzky, Mayer, Paulhan, Wahl, etc. » (où le singulier de « texte » est d’autant plus singulier que la liste de noms s’achève sur un « etc. »), c’est le seul nom de l’éditeur qui figure sur la couverture de la seconde édition; le sous-titre précise cette fois les dates d’existence du Collège, « 1937-1939 ». Ce choix peut générer une incertitude sur l’autorité productrice du livre, en rendant ambiguës les limites entre sources primaires et secondarité critique. Il invite du moins à interroger la représentation traditionnelle de l’éditeur comme auteur sans oeuvre, contribuant à un livre qu’il ne signe pas. D’une édition à l’autre, l’appareil critique (initialement entre crochets, signalant son statut auxiliaire; en italiques dans les deux cas) s’est considérablement étoffé, de sorte qu’on peut effectivement se demander s’il est d’ordre paratextuel ou textuel[21]; autrement dit, si l’intervention de Denis Hollier est d’ordre éditorial ou auctorial. Par ailleurs, l’ordre adopté pour la présentation des textes diffère sensiblement d’une édition à l’autre. Dans la première édition, ils étaient répartis selon leur forme originale, publication ou conférence; dans la seconde, ils sont ordonnés suivant la seule chronologie. Si le premier agencement rend mieux compte du mode d’existence du Collège, de sa visibilité médiatique pour ses contemporains, le second invite à suivre son développement, à percevoir sa dynamique interne comme la pression des événements externes. Il faut en outre noter l’ajout de pièces manquantes retrouvées entre-temps[22], la mise au point d’un « Épilogue », et l’ampleur prise par les « Appendices ».
C’est que cette édition critique est aussi devenue une histoire. Les textes d’accompagnement tiennent ensemble contextualisation historique et acuité sensible, expertise et ferveur. Expertise : le propos consiste à situer l’entreprise dans le champ des possibles, à donner la mesure de sa puissance de négation, à transmettre une approche critique du matériau. Ferveur : il s’agit aussi de faire feu de toutes les ressources de l’empathie (on ne s’estime pas « apprenti sourcier » sans le ressort de l’identification), pour « comprendre l’intrigue » du Collège, en faire un « roman vrai[23] », rendre sensibles simultanément l’intérêt intellectuel et la valeur existentielle de l’entreprise. Ce rapport aux sources à la fois immédiat et à distance, l’adhésion à la fois jouissive et aguerrie à la matière, permettent de mesurer la ténuité de la frontière entre l’historien qui édite des archives et l’écrivain qui restitue une enquête (le geste d’écriture de Denis Hollier est d’ailleurs manifeste dans l’entrée en matière, avec ses variations stylistiques pour évoquer l’aventure – « style Balzac après Nietzsche » (CS, p. 8) –, ou dans la reconstitution de l’« épilogue »). Le volume invite donc à concevoir un acte auctorial partagé entre auteurs et éditeur scientifique (et il faudrait peut-être ajouter l’éditeur « général ») : en interrogeant les limites habituelles entre oeuvres littéraires et discours d’accompagnement, il met en évidence la réalité polyphonique du texte mis en livre.
Polyphonique, le volume est aussi polyscopique. L’entreprise éditoriale intègre en effet des matériaux témoignant de la réception du Collège de sociologie avant sa publication en volume : les « Appendices » donnent les réactions de satellites du Collège et les jugements a posteriori de ses acteurs. Bataille, dans le premier numéro de Critique, en juin 1946, perçoit déjà le Collège à distance, comme un phénomène générationnel, dont les domaines d’intérêt ont mis au jour des « malaises significatifs[24] ». Quant à Caillois, qui concevait initialement l’activité intellectuelle hors de l'écrit comme seul horizon valable, (« vous savez, écrivait-il à Paulhan en novembre 1937, je ne suis pas écrivain, il m’intéresse seulement d’avoir une action[25] »), il constate après coup la difficulté à être à la hauteur de cette ambition : « nous aurons été des orateurs »; « ces creuses ambitions restèrent lettre morte », écrit-il en 1940, et en 1963[26]. Le bilan est mitigé, sinon amer : l’aspiration à la parole efficace est désormais considérée avec détachement ou dérision[27]. Comme expérience littéraire, on peut d’ailleurs estimer qu’à court terme, le Collège a été éclipsé par les volumes indirectement issus de l’expérience, publiés par ses fondateurs : Le Mythe et l'homme et L’Homme et le sacré, parus en 1938 et 1939, pour Caillois; L’Expérience intérieure, pour Bataille, qui paraît en 1943, premier volet de La Somme athéologique; Biffures, en 1948, premier volume de La Règle du jeu, pour Leiris. Les conférences données pour le Collège apparaissent à certains égards comme le laboratoire d’oeuvres parallèles ou à venir.
Côté sociologie, la réception est également ambiguë : elle oscille entre soupçon d’amateurisme inspiré, savonneux par ses implications idéologiques, et reconnaissance d’une portée puissamment subversive. Parmi les contemporains, on connaît notamment les réactions de Mauss, exprimées dans une lettre à Caillois du 22 juin 1938, qui voit dans le Collège l’effet d’un « déraillement général[28] », ou de Lévi-Strauss, pour qui, à l’inverse, « l’entreprise réussit[29] ». Ce qui pose bien sûr problème, c’est la pente idéologique du Collège : parce qu'il fait l’apologie de la fonction sociale du mythe, à l’heure où celui-ci est aussi le fondement du système de propagande fasciste, il est soupçonné de lui préparer le terrain[30] – notre propos n’est pas ici de statuer à ce sujet. Mais on a aussi pu signaler, après son édition cette fois[31], son rôle de précurseur, par les retours, vers le proche et sur soi-même, qu’il inaugure : le Collège amorce en effet le versant « endotique » de l’ethnologie, puisqu’il se donne pour objet non plus les « sociétés dites primitives », mais des institutions des sociétés modernes, et exalte l’exigence de réflexivité de la discipline, puisqu’il postule que l’expérience de sujet social de l’observateur doit elle-même être analysée. Dans son étude sur la réception historique du Collège, Stephan Moebius estime pour sa part que sa réception est encore à venir : il reste selon lui à prendre acte au présent de ses intuitions, à les trahir fidèlement[32]. Avant comme après sa récollection, le Collège de sociologie reste donc placé sous le signe de l’ambiguïté, que celle-ci désigne des apports ou des apories[33], recouvre un malaise ou le sentiment d’une productivité encore inaboutie.
Instabilités des valeurs, valeur de l’instable
La question de la réception est également essentielle dans la mesure où elle constitue le point de départ de la fabrique du mémorable à laquelle travaille l’histoire littéraire. Ce processus passe presque immanquablement par le livre, forme élémentaire d’accomplissement en ce domaine. Ce devenir-livre, pour une entreprise tentée hors des sentiers institutionnels, engage-t-il nécessairement une « récupération », ou du moins une neutralisation de l’expérience?
Le problème de la « littérature sauvage » est bien celui de sa transmission[34]; si sa spécificité est d’avoir été conçue, par nécessité ou par choix, à l’écart des canaux de diffusion mainstream, il faut pourtant qu’elle soit portée à notre connaissance, sous des formes qui risquent alors de la trahir, tout au moins d’influer sur sa visibilité et donc sur sa valeur. Comme le rappelle Brigitte Ouvry-Vial, il faut « tenir compte du fait qu’un livre, qui transforme le texte par une suite d’opérations techniques et intellectuelles d’édition, d’impression et de diffusion est, un peu comme la monnaie, moins un bien réel – l’objet manufacturé n’est pas très coûteux en soi – qu’une valeur fiduciaire qui doit son existence à la réalité, difficilement quantifiable, des biens et des services qui le font naître, comme de ceux qu’il fait circuler[35] ». Il faudrait alors, par parenthèse, distinguer, dans le champ de connaissance de la littérature, entre le travail de l’éditeur « inventeur » et celui de l’historien qui vient après coup. Si le travail de l’historien de la littérature relève de ce que Paul Veyne appelle « histoire axiologique », soit un discours qui peut se contenter de reconduire des valeurs en vigueur, requérant avant tout une « faculté mimétique[36] », le travail d’éditeur se situerait en amont de celui-ci : exigeant une évaluation préalable, qui suppose de ne pas se contenter de cette « faculté mimétique », il lance le cours d’une valeur littéraire et conditionne la pratique ultérieure de l’« histoire axiologique ». Par la qualité de sa démarche éditoriale, il agit donc à même les reliefs du paysage littéraire. Cette distinction entre évaluation, geste initial d’engagement axiologique, et valorisation, adaptation plus ou moins opportuniste aux modes intellectuelles, demande néanmoins à être nuancée, puisque le travail de l’historien suppose aussi de « redécouvrir » et donc de remettre en jeu la valeur, tandis que le travail de l’éditeur, qui ne se fait jamais ex nihilo, peut avoir été conditionné par des jugements antérieurs.
En dotant le Collège du medium attitré de l’oeuvre littéraire, Denis Hollier a bien évidemment conscience de transformer son objet, de s’exposer à la fois à le trahir et à le consacrer – « on ne refait pas un mythe avec un livre », a écrit René Guastalla, un des conférenciers du Collège[37], et rien n’inspire plus de méfiance à Bataille que l’ambition de complétude, le fixe et le défini. Ce processus est très explicitement formulé par Denis Hollier dans la préface qu’il donne par ailleurs, en 1991, à la réimpression de Documents : « le reprint récupère, contre son gré, quelque chose qui n’avait pas voulu de survie », il en fait un « phénix malgré lui, quelque chose de même nature que par exemple la transformation d’abattoirs en parcs naturels[38] ». Pour le Collège de sociologie, on pourrait également avancer que l’objet livre fausse la donne : il fait aboutir l’expérience plus qu’elle n’a abouti, lui donne une fixité qu’elle s’était refusée. Dans l’édition de 1995, Denis Hollier note en passant que son travail a pu « monumentalis[er] » l’aventure (CS, p.15). L’objet livre n’a guère d’autre possibilité, à l’évidence, que d’altérer le mode du potentiel et du prospectif, dimension pourtant constitutive de tout acte de création. La difficulté de cette entreprise éditoriale est donc précisément d’enclencher un processus de transmission, tout en donnant à comprendre l’expérience comme une aventure sans mode d’emploi. Un de ses enjeux, autrement dit, est de contrer le pouvoir naturalisant du livre, afin qu’il ne semble pas simplement mettre les documents en oeuvre. Or il est clair que ce qui peut faire de textes une « oeuvre » ou un « monument » tient à la lecture et à l’usage qu’on en fait plus qu’au texte lui-même. Aussi n’est-il pas évident qu’en stabilisant ses matériaux, le volume ait du même coup fait rentrer l’expérience dans le rang de l’institution.
« Stabiliser », au demeurant, est le préalable du geste scientifique. Avant le travail d’édition, le Collège de sociologie bénéficiait selon toute apparence de l’aura sulfureuse de son fondateur et du mystère qui entoure Acéphale, tout en étant soupçonné d’avoir joué le jeu du fascisme. Le mérite du geste éditorial est donc aussi de transformer la rumeur en teneur, de rendre plus net le halo dont tend à s’entourer tout projet antirationaliste, d’enrayer la fabrique du mythe. Un des risques dans l’approche du Collège de sociologie aurait été de reconduire mimétiquement cette quête d’aura (qui peut être un des traits des exégètes batailliens). Stabiliser, en ce sens, n’est pas appauvrir la connaissance, c’est résister à la fascination, en délimiter l’empire. En même temps, la force du volume est aussi de donner la mesure de l’inachèvement du projet, de son excès ou de son échec : de le restituer comme chantier vif, non tant parce que ses thèses nous sembleraient encore explosives aujourd’hui (elles nous semblent singulièrement situées, dans l’histoire des rapports entre avant-garde et politique, entre sciences humaines et littérature au xxe), mais parce que l’expérience faisait de la pensée une prise de risque, sans souci d’unité ni de postérité. La gageure éditoriale était donc d’acter un projet sans actualisation, de le faire avenir à l’existence livresque en préservant sa qualité d’événement équivoque[39], qui reste le ressort de l’intérêt qu’il suscite.
Plus encore pour les questions qu’il pose que pour les réponses qu’il offre, Le Collège de sociologie de Denis Hollier est un objet qui est « bon à penser », « bon à penser » tout court, mais aussi « bon à penser » le lieu de la littérature. D’abord, parce qu’il fait exister le texte littéraire comme entité fondamentalement instable. Le Collège est autre après l’édition de ses traces en volume, sa réédition le transforme, pièces et témoignages exhumés l’infléchissent à nouveau[40] – où se confirme le principe borgésien selon lequel toute apparition d’un texte en fait un objet neuf, invitant à se détacher résolument d’une conception fixiste du littéraire. En termes batailliens : « Toute la vérité que reconnaît l’homme est nécessairement liée à l’erreur que représente le “sol immobile”[41] ». Ensuite, parce qu’il éclaire la façon dont la littérature prend place dans la topographie des savoirs. Le Collège de sociologie reposait sur une idée de littérature comme dépassement de la littérature, par le détournement de la science. Aujourd’hui, cette conception éveille à la fois des résistances (on connaît le saut qui existe de l’une à l’autre, on se les figure moins dans un rapport de dépassement de l’une par l'autre que comme des régimes de connaissance distincts), et des tentations (on n’en finit pas d’explorer les porosités de ces deux pratiques, dans leur portée sociale et cognitive). L’existence livresque du Collège de sociologie, expérience transgressive s’il en fut, a le mérite de le faire apparaître à la fois comme subversif et comme daté : en situant l’idée de littérature qu’il engageait, elle contribue aussi à nous situer[42]. Telle pourrait finalement être une des leçons de l’expérience : un projet qui prend forme aux confins de plusieurs communautés, se dérobe aux mailles de la publication comme aux règles du savoir, a toutes les chances d’y faire scrupule. Ce qui lui vaut aussi de rester un espace critique.
Parties annexes
Note biographique
Éléonore Devevey est ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon et agrégée de lettres modernes. Elle prépare actuellement une thèse en études littéraires, qui porte sur les pratiques d’écriture des anthropologues et la réception du savoir anthropologique par les écrivains dans la seconde moitié du xxe siècle.
Notes
-
[1]
Nous empruntons à notre tour l’expression de Jacques Dubois, L'Institution de la littérature, Bruxelles, Labor, coll. « Dossiers média »; rééd. Bruxelles, Espace Nord/Références, 2005, p. 192.
-
[2]
À l’occasion du cinquantenaire de la disparition de l’écrivain, la revue Critique a consacré un numéro au Collège de sociologie, qui mettait utilement à jour les connaissances sur le sujet : Philippe Roger (dir.), Critique, « Georges Bataille. D’un monde l’autre » (dossier), n° 788-789, janvier-février 2013.
-
[3]
Le Collège de sociologie, [1979], édition de Denis Hollier, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1995, p. 17; par la suite, abrégé CS.
-
[4]
Georges Bataille, « Cheminées d’usine », Documents I, préface de Denis Hollier, Paris, Jean-Michel Place, 1991, p. 332. C’est Bataille qui souligne.
-
[5]
Georges Didi-Huberman, La Ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, coll. « Vues », 1995.
-
[6]
Soit une « Note relative à la fondation d’un “Collège de sociologie” » parue en juillet 1937 dans Acéphale; les textes-programmes du dossier « Pour un Collège de Sociologie » paru en juillet 1938 dans la N.R.F., n° 298 (qui compte « L’apprenti sorcier », de Bataille, « Le sacré dans la vie quotidienne », de Leiris, « Le vent d'hiver », de Caillois); une « Déclaration du Collège de sociologie sur la crise internationale », parue le 1er novembre 1938, à nouveau dans la N.R.F., en réaction à la signature des accords de Munich. Née de la dissolution de Contre-attaque, qui rassemble temporairement Breton et Bataille, Acéphale est à la fois une revue et une « société secrète »; la fondation du Collège provoque la suspension de la revue, mais non celle de la société secrète. Voir à ce sujet Yves Hersant, « Intellectuels contre intelligentsia : la revue Acéphale », dans Jacques Le Goff et Béla Köpeczi (dir.), Intellectuels français et intellectuels hongrois, xiiie-xxe siècles, Akadémiai Kiadó / Paris, CNRS, 1985, pp. 255-259.
-
[7]
J’emprunte bien sûr cette notion à Christian Jacob; voir tout particulièrement « Qu’est-ce qu’un lieu de savoir? », OpenEdition Press, 2014, http://books.openedition.org/oep/650 (21 mars 2016).
-
[8]
Le témoignage d’Édith Boissonnas donne le cadre : « […] la salle est charmante, tapissée de livres, dans le fond de belles reliures, des rayons où se balancent quelques livres plus rares. J’ai les coudes dans les livres. On fume à sa guise; des gens feuillettent même des ouvrages […] », extrait du Journal pour moi seule, 21 février 1939, cité par Philippe Roger dans « Edith Boissonnas au Collège de sociologie », Critique, « Georges Bataille. D’un monde l’autre », n° 788-789, janvier-février 2013, pp. 110-123; p. 111.
-
[9]
« Déclaration du Collège de sociologie sur la crise internationale », 7 octobre 1938, signée Bataille, Caillois, Leiris, CS, pp. 362-363.
-
[10]
Comme le note Claude Imbert, « on y débattait des mêmes livres […]. On y discutait de la possibilité, et nécessité, des sciences humaines. »; Claude Imbert, Lévi-Strauss ou le passage du Nord-Ouest, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « Carnets », 2008, p. 71.
-
[11]
Caillois, Leiris et Monnerot ont suivi ses cours à l’École pratique des Hautes Études dans les années 1930. Caillois écrira en 1963 : « […] je distinguais à peine l’enseignement que j’allais recevoir, à l’École pratique des Hautes Études, de Marcel Mauss et de Georges Dumézil de celui qu’avec Georges Bataille et Michel Leiris je me hasardais à proposer dans la modeste salle du Collège de Sociologie, que nous venions de fonder ensemble » (CS, p. 882). Quant à Bataille, il a découvert ses travaux par le biais d’Alfred Métraux, son condisciple à l’École des Chartes qui fut aussi l’élève de Mauss dans les années 1920 (voir CS, p. 877). Dans L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss (Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1997, p. 377), Bruno Karsenti voit dans le Collège de sociologie une « institution étrange, résolument en marge des formes classiques d’enseignement et de diffusion du savoir ».
-
[12]
C’est toutefois dans le cadre d’Acéphale que les rites (initiation pour les adeptes, projet de sacrifice) auraient eu toute leur place.
-
[13]
C’est, on le sait, la spécificité de l’écriture littéraire selon Bataille, définie dans L'Expérience intérieure (1943). Muriel Pic, « Georges Bataille. Lisibilité du non savoir », dans Muriel Pic, Barbara Selmeci Castioni et Jean Pierre van Elslande (dir.), La Pensée sans abri. Non-savoir et littérature, Nantes, Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2012, pp. 101-119, p. 116.
-
[14]
À cet égard, le livre de Denis Hollier représente sans doute une étape dans la constitution d’une communauté de pensée sur la communauté, communauté faite de livres, revenant sans cesse aux livres, et qui tente de penser le caractère « sauvage », inassignable, de la « vraie » communauté.
-
[15]
Nous faisons nôtre la remarque de Brigitte Ouvry-Vial, qui invite à « considérer l’acte éditorial comme une situation d’énonciation, non pas dissociée mais intégrée au texte et qui se traduit autant dans et par la matérialité du livre que dans les opérations intellectuelles de son établissement et les éléments paratextuels qui l’accompagnent »; Brigitte Ouvry-Vial, « L’acte éditorial : vers une théorie du geste », Communication et langages, « L’énonciation éditoriale en question », n° 154, 2007, pp. 67-82, pp. 77-78.
-
[16]
Brigitte Ouvry-Vial, « L’acte éditorial : vers une théorie du geste », Communication et langages, « L’énonciation éditoriale en question », n° 154, 2007, p. 78. L’expression de « transsubstantiation symbolique » appliquée à ce contexte est de Pascal Durand et Anthony Glinoer, dans Naissance de l'éditeur, l'édition à l'âge romantique, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2005, p. 182.
-
[17]
Voir Jean Jamin, « Un sacré collège, ou les apprentis sorciers de la sociologie », Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 68, janvier-juin 1980, pp. 5-30. Les travaux de Stephan Moebius, dont l’approche relève de l’histoire des sciences, montrent que le changement de contexte national peut entraîner un déplacement des coordonnées disciplinaires de l’objet et de sa critique.
-
[18]
Si les sources sont toujours précisées, les fonds consultés ne sont toutefois pas explicitement listés.
-
[19]
Le terme « anthologie », parfois utilisé pour désigner le volume, est impropre, puisque la démarche n’entend ni sélectionner ni stabiliser.
-
[20]
La collection « Idées » (la première collection d'essais et de documents au format de poche de Gallimard, lancée par François Erval en 1962) dans laquelle le volume paraît en 1979, a pris fin en 1985; en 1995, il reparaît donc en « Folio essais » (la collection « Folio », née en 1972, est déclinée en différentes séries en 1985). La couverture de la seconde édition est plus sobre que la première : à une illustration de Jean-Michel Nicollet (une figure de penseur (position à la Rodin), qui se détache sur le ciel rougeoyant au-dessus de la place de la Concorde), succède « Le Piège à soleil », tableau d’André Masson, peintre historiquement lié à l’aventure, auquel Acéphale doit son iconographie.
-
[21]
L’ouvrage collectif Ma(r)king the Text relevait déjà de cette conception théorique de l’acte éditorial selon laquelle « to mark a text is to make it »; Joe Bray, Miriam Handley et Anne C. Henry (dir.), Ma(r)king the Text. The presentation of meaning on the literary page, Ashgate, 2000, p. XVII. Il s’intéressait à « this fringe between text and paratext, questioning the terms of this opposition » (p. XIX).
-
[22]
Des pièces sont réapparues à la faveur de la première édition. Mentionnons également les éditions anglaise (1988), italienne (1991) et allemande (2012) du volume.
-
[23]
C’est le propos de l’historien selon Paul Veyne, dans Comment on écrit l’histoire [1971], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1978.
-
[24]
« Ces jeunes écrivains, plus ou moins nettement, sentaient que la société avait perdu le secret de sa cohésion et que c’était là justement ce que visaient les efforts obscurs, malaisés et stériles de la fièvre poétique. Il arrivait parfois qu’ils ne désespèrent plus et ne tiennent plus pour absurde la possibilité de le retrouver. » Mais à propos de l’ambition de recherche « sociologique », il estime « douteux que, sur le plan limité de la connaissance scientifique, de grandes conséquences en résultent » (« Le sens moral de la sociologie », repris dans CS, p. 878).
-
[25]
Roger Caillois, lettre à Jean Paulhan, 5 novembre 1937, citée dans CS, p. 696.
-
[26]
« Seres del anochecer », cité dans CS, p. 866; « Préface à la troisième édition » de L’Homme et le sacré, cité dans CS, p. 882.
-
[27]
Le Collège de sociologie a laissé peu de traces dans le Journal de Leiris (Journal 1922-1989, édition de Jean Jamin, Paris, Gallimard, 1992), sinon indirectement ou au moment de l’édition de ses traces par Denis Hollier (voir pp. 721-722). Leiris est le seul des trois principaux animateurs encore vivant à sa parution; Bataille est mort en juillet 1962, Caillois meurt en décembre 1978.
-
[28]
Il y voit l’empire de l’« irrationalisme absolu », « sous l’influence de Heidegger, bergsonien attardé dans l’hitlérisme, légitimant l’hitlérisme entaché d’irrationalisme »; Marcel Mauss, « Une lettre inédite de Marcel Mauss à Roger Caillois du 22 juin 1938 », éditée par Marcel Fournier, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 84, septembre 1990, p. 87. Curieusement, cette lettre n’est pas reprise dans le volume.
-
[29]
Ce jugement est difficile à interpréter; le texte, extrait d’un chapitre sur « La sociologie française », est écrit depuis New York, pour un volume dirigé par Georges Gurvitch. Lévi-Strauss côtoie alors d’anciens membres du Collège; voir CS, pp. 842-844. Voir également les analyses de Vincent Debaene dans le chapitre intitulé « Une exception française », tout particulièrement pp. 95-103, de L’Adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2010.
-
[30]
C’est la réaction de Walter Benjamin au dossier de la N.R.F, et tout particulièrement à la contribution de Caillois. Voir à ce sujet Muriel Pic, « Penser au moment du danger. Le Collège et l’Institut de recherche sociale de Francfort », Critique, « Georges Bataille. D’un monde l’autre », n° 788-789, janvier-février 2013, pp. 81-95.
-
[31]
Voir Jean Jamin, « Un sacré collège, ou les apprentis sorciers de la sociologie », Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 68, janvier-juin 1980, pp. 5-30.
-
[32]
Stephan Moebius, Die Zauberlehringe. Soziologiegeschichte des Collège de Sociologie (1937-1939), Konstanz, UVK Verlaggesellschaft mbH, 2006. Dans sa dernière phrase, Stephan Moebius adresse cette exhortation à qui veut l’entendre : « Hier gilt es fortzufahren... » (« C’est à partir d’ici qu’il faut poursuivre... »; nous traduisons), p. 503.
-
[33]
Clément Poutot, « Sacré Collège! », Anamnèse, n° 8, « Le Collège de sociologie », Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 7-11.
-
[34]
Voir dans cette perspective Maureen Bell, Shirley Chew, Simon Eliot, et alii (dir.), Re-constructing the book, Literary texts in transmission, Aldershot, Ashgate, 2000.
-
[35]
Brigitte Ouvry-Vial, « Médiation éditoriale, quatrièmes de couverture et valeur minimum du texte », dans Vincent Jouve (dir.), La valeur littéraire en question, Paris, Éditions de l’Improviste, 2010, pp. 57-87; p. 57.
-
[36]
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire [1971], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1978, p. 98. Avec un sens certain de la provocation, Paul Veyne poursuit : « Puis donc que, passé l’évaluation axiologique préliminaire, l’histoire axiologique ressemble tout à fait à de l’histoire, on comprend que les historiens de la littérature n’aient pas éprouvé le besoin de faire certaines distinctions et de tirer au clair les postulats implicites de leur travail. On comprend aussi quelle est leur faculté maîtresse : non pas le goût et la sympathie, mais une faculté mimétique qui permet d’apercevoir les valeurs, sans les juger du point de vue de l’absolu […]. », p. 99.
-
[37]
René Guastalla, Le Mythe et le livre, Paris, Gallimard, 1940, p. 212. Il avait donné le 10 janvier 1939 une conférence au Collège de sociologie, intitulée « Naissance de la littérature », voir CS, pp. 460-493.
-
[38]
Denis Hollier, « La valeur d’usage de l’impossible », préface à la réimpression de Documents, Paris, Jean-Michel Place, 1991; repris dans Les Dépossédés, Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1993, pp. 153-178; p. 178.
-
[39]
Voir à cet égard l’introduction de Denis Hollier à l’édition italienne du recueil, « De l’équivoque entre littérature et politique », reprise dans Les Dépossédés, Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1993, pp. 109-130.
-
[40]
Voir les témoignages de Walter Benjamin et Édith Boissonnas, « Walter Benjamin et le Collège de sociologie », « Édith Boissonnas au Collège de sociologie », dans Critique, « Georges Bataille. D’un monde l’autre », n° 788-789, janvier-février 2013, pp. 97-109; pp. 110-123.
-
[41]
Georges Bataille, « Corps célestes », cité dans CS, p. 34.
-
[42]
Comme l’a fait remarquer Guillaume Bridet dans « Roger Caillois dans les impasses du Collège de Sociologie », Littérature, 2007, vol. 2, n° 146, pp. 90-103; p. 103.
Bibliographie
- Le Collège de sociologie [1979], édition de Denis Hollier, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1995.
- Documents, préface de Denis Hollier, Paris, Jean-Michel Place, 1991.
- Maureen Bell, Shirley Chew, Simon Eliot, et alii (dir.), Re-constructing the book, Literary texts in transmission, Aldershot, Ashgate, 2000.
- Joe Bray, Miriam Handley et Anne C. Henry (dir.), Ma(r)king the Text. The Presentation of Meaning on the Literary Page, Aldershot, Ashgate, 2000.
- Guillaume Bridet, « Roger Caillois dans les impasses du Collège de Sociologie », Littérature, 2007, vol. 2, n° 146, pp. 90-103.
- Vincent Debaene, « Le point de vue de l’indigène, ou Comment on écrit l’histoire de la littérature », Romanic review “Literary Histories of Literatures”, n° 100, 1-2, printemps-été 2009, pp. 16-27.
- Vincent Debaene, L’Adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2010.
- Georges Didi-Huberman, La Ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, coll. « Vues », 1995.
- Jacques Dubois, L'Institution de la littérature, Bruxelles, Labor, coll. « Dossiers média »; rééd. Bruxelles, Espace Nord/Références, 2005.
- Pascal Durand et Anthony Glinoer, Naissance de l'éditeur, l'édition à l'âge romantique, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2005.
- Yves Hersant, « Intellectuels contre intelligentsia : la revue Acéphale », dans Jacques Le Goff et Béla Köpeczi (dir.), Intellectuels français et intellectuels hongrois, xiiie-xxe siècles, Akadémiai Kiadó / Paris, CNRS, 1985, pp. 255-259.
- Denis Hollier, Les Dépossédés, Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1993.
- Claude Imbert, Lévi-Strauss ou le passage du Nord-Ouest, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « Carnets », 2008.
- Christian Jacob, « Qu'est-ce qu'un lieu de savoir? », OpenEdition Press, 2014, http://books.openedition.org/oep/650 (21 mars 2016).
- Jean Jamin, « Un sacré collège, ou les apprentis sorciers de la sociologie », Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 68, janvier-juin 1980, pp. 5-30.
- Bruno Karsenti, L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1997.
- Michel Leiris, Journal 1922-1989, édition de Jean Jamin, Paris, Gallimard, 1992.
- Marcel Mauss, « Une lettre inédite de Marcel Mauss à Roger Caillois du 22 juin 1938 », éditée par Marcel Fournier, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 84, septembre 1990, p. 87.
- Stephan Moebius, Die Zauberlehringe. Soziologiegeschichte des Collège de Sociologie (1937-1939), Konstanz, UVK Verlaggesellschaft mbH, 2006.
- Brigitte Ouvry-Vial, « L’acte éditorial : vers une théorie du geste », Communication et langages, « L’énonciation éditoriale en question », n° 154, 2007, pp. 67-82.
- Brigitte Ouvry-Vial, « Médiation éditoriale, quatrièmes de couverture et valeur minimum du texte », dans Vincent Jouve (dir.), La valeur littéraire en question, Paris, Éditions de l’Improviste, 2010, pp. 57-87.
- Muriel Pic, « Georges Bataille. Lisibilité du non savoir », dans Muriel Pic, Barbara Selmeci Castioni et Jean Pierre van Elslande (dir.), La Pensée sans abri. Non-savoir et littérature, Nantes, Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2012, pp. 101-119.
- Clément Poutot, « Sacré Collège! », Anamnèse, n° 8, « Le Collège de sociologie », Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 7-11.
- Philippe Roger (dir.), Critique, « Georges Bataille. D’un monde l’autre » (dossier), n° 788-789, janvier-février 2013.
- Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire [1971], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1978.