Corps de l’article
L’origine militante de la perspective intersectionnelle est désormais connue (Bilge, 2010 : 47 ; Jaunait et Chauvin, 2013 : 286) et c’est au courant le plus radical du féminisme africain américain de la fin des années 1970 (Dorlin, 2012 : 13) que l’on doit d’avoir impulsé une véritable rupture au sein de la théorie critique en mettant en exergue « l’imbrication » des différents systèmes d’oppression (Combahee River Collective, 2000). Si celle-ci était déjà au coeur des revendications des militantes abolitionnistes du milieu du dix-neuvième siècle, en témoigne le fameux discours de Sojourner Truth[2], ce n’est qu’à partir des années 1980 que la nécessité de penser cette « imbrication » parvient à s’imposer dans le milieu universitaire. Les pionnières (Rich, 1979 ; Davis, 1981 ; hooks, 1981 ; Hull et al., 1982) soulignent alors notamment le dilemme politique auquel les féministes noires se trouvent de facto confrontées en raison de la tendance prédominante à la mise en concurrence des luttes féministes et antiracistes, tout en pointant le racisme des unes et le sexisme des autres. Concrètement, et pour le dire comme bell hooks[3],
Lorsqu’on parle des personnes noires, le sexisme a un effet négatif sur la reconnaissance des intérêts des femmes noires ; lorsqu’on parle des femmes, le racisme a un effet négatif sur la reconnaissance des intérêts des femmes noires. Lorsqu’on parle des Noirs, le regard a tendance à être tourné vers les hommes noirs ; et lorsque l’on parle des femmes, le regard a tendance à être tourné vers les femmes blanches.
1981 : 7
De manière parallèle, des juristes – telle Kimberle Crenshaw (1989, 1991) qui passe pour être la première à avoir parlé d’« intersectionnalité » – font des constats semblables dans le cadre d’analyses critiques du droit ; par exemple, pour prouver qu’une femme noire a été victime de discrimination, il lui faut démontrer qu’elle en a été victime soit en tant que femme, soit en tant que Noire, mais que les traitements discriminatoires attribuables à la cumulation de ces deux caractéristiques (de Noire et de femme) ont tendance à se « faufiler entre les mailles du filet ». En d’autres termes, ce concept d’intersectionnalité s’est présenté d’emblée comme une critique des catégories essentialistes et homogénéisantes qui sont celles-là même de la domination – « les Noirs », « les femmes » (Yuval-Davis, 2006 : 199) – et s’oppose de manière conséquente à la tendance à uniformiser indûment les expériences vécues de celles-ci (Grillo, 1995 : 19 et suiv. ; Hancock, 2007 : 65).
Ce numéro spécial fait suite au colloque organisé par le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM) les 17 et 18 mai 2012 sur le thème « L’intersectionnalité et les études internationales » et regroupe certains des textes des présentations qui y ont cherché à donner des clés pour interpréter l’articulation des différents systèmes de rapport de pouvoir dans la société internationale ou transnationale. Plus particulièrement, une question centrale, dans au moins trois de ces textes, concerne le lien entre, d’une part, les différents rapports sociaux de subordination et les catégories d’analyse permettant de décrire la place des individus dans ceux-ci et, d’autre part, l’identification des subjectivités ainsi que l’utilisation de l’agentivité qui sont essentielles à la mise en place de stratégies de résistance.
Retour sur quelques enjeux relatifs à l’intersectionnalité
Devenu un véritable paradigme (Bilge, 2010 : 60), le concept d’intersectionnalité s’est érigé en concept clé dans tous les débats qui traversent la réflexion sur l’oppression et les conditions d’émancipation. En vertu de son propre flou théorique (Peñafiel, dans ce numéro), le concept d’intersectionnalité recouvre cependant des tensions, sinon des analyses conflictuelles de la dynamique des rapports de pouvoir ou des systèmes d’oppression, d’où les débats qui se poursuivent et se renouvellent sous ce thème.
Un premier débat, ontologique, concerne la nature de l’objet d’étude. Plus précisément, de quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’intersectionnalité ? Sirma Bilge précise ainsi les enjeux de la discussion :
Si l’interaction des catégories de différence constitue un point de consensus dans la littérature intersectionnelle – en témoigne l’utilisation répandue de termes faisant allusion aux catégories/identités/processus « mutuellement constitutifs » –, la question ontologique (qu’est-ce que c’est) et la question épistémologique (comment on la regarde) sont sujettes à controverses. Un certain flou entoure en effet ce « mutuellement constitutif » : Qu’est-ce qui est censé être mutuellement constitutif ? S’agit-il des catégories de différence/identité ou des processus qui les sous-tendent ?
2009 : 77
Pour certaines (dans les premiers articles de Crenshaw par exemple), l’exercice consiste essentiellement à mettre en relation des catégories renvoyant à une identité (être femme ; être Noire) dont il s’agit de faire une « cartographie » afin de montrer que le fait d’être à l’« intersection » de ces deux groupes apporte des effets discriminatoires plus grands que la somme de celles provenant du racisme et du sexisme (Crenshaw, 1989 : 140). Cette perspective a toutefois fait l’objet de critiques, notamment de la part de féministes françaises, pour qui il importe d’éviter le piège d’une analyse catégorielle consistant à séparer, pour ne pas dire à séquencer les rapports sociaux et à percevoir ceux-ci de manière statique, afin de les comprendre plutôt comme étant dynamiques et co-constitutifs. Pour Elsa Dorlin,
La critique que l’on peut adresser au raisonnement de Crenshaw vise sa définition des rapports sociaux en termes de secteurs d’intervention, définition qui implique que celles d’entre nous qui subissent plusieurs discriminations se retrouvent dans des secteurs isolés. Or, cette définition non seulement isole, mais uniformise des positions socialement antagoniques et tend à confondre les identités stigmatisées, imposées et les identités politiques des groupes minorisés. Le concept d’intersectionnalité et, plus généralement, l’idée d’intersection peinent à penser un rapport de domination mouvant et historique, difficilement formalisable […] En d’autres termes, l’intersectionnalité est un outil d’analyse qui stabilise des relations en des positions fixes, qui sectorise les mobilisations, exactement de la même façon que le discours dominant naturalise et enferme les sujets dans des identités altérisées toujours déjà-là.
2005 : 92-93
Pour le dire comme Danièle Kergoat cette fois, « la multiplicité des catégories masque les rapports sociaux. Or, on ne peut dissocier les catégories sociales des rapports sociaux à l’intérieur desquelles elles ont été construites » (2009 : 117). Ainsi, avec les concepts de « consubstantialité » et de « coextensivité » des rapports sociaux (p. 112), elle propose de placer la focale sur les rapports sociaux[4] plutôt que de partir de catégories, mais surtout de voir ceux-ci comme un « noeud » ; « en se déployant, […] [ils] se reproduisent et se co-produisent mutuellement » (p. 112).
Nous reviendrons sur cette idée, mais soulignons pour le moment que tout en ne niant évidemment pas l’importance d’étudier les rapports sociaux, d’autres auteures ont récemment fait remarquer qu’il demeurait pertinent d’étudier d’autres aspects (dont les catégories) sociopolitiques de la vie. C’est, par exemple, le point de vue de Rita Kaur Dhamoon qui stipule que quatre de ces éléments méritent d’être étudiés, à savoir les identités assignées à un individu (la femme noire), les catégories de différence (la « race » et le genre), le processus de différenciation (la racialisation et le « genrage » [gendering]) et les systèmes de domination (le racisme et le patriarcat), tout en concluant que les deux derniers « sont les plus efficaces dans une analyse des dynamiques complexes du pouvoir » (2011 : 232-235). D’autres ensuite, tout en gardant un vocabulaire qui tend à les rapprocher d’une analyse catégorielle et en parlant d’« emplacement social » (social location), vont faire valoir que cet emplacement est déterminé par la façon dont le pouvoir est exercé (Ken, 2007). En d’autres termes, c’est parce qu’il existe des systèmes de domination et d’exploitation qui sont déterminants dans la configuration des rapports sociaux qu’il existe des « emplacements sociaux » (qui eux-mêmes déterminent les « catégories » et les « identités individuelles », pour reprendre l’analyse de Dhamoon). Par ailleurs, il est essentiel pour certaines de penser non seulement les rapports sociaux à partir du positionnement de ceux et celles qui sont désavantagés par ceux-ci, mais aussi du point de vue de ceux et celles qui en profitent (Walby et al., 2012 : 230) afin, et comme le font remarquer d’autres auteures dans un contexte différent (Marks, 2009), de mettre de l’avant le fait que les systèmes de subordination n’existent que parce que des individus et des groupes en sont bénéficiaires. Une telle prise en compte permet notamment de faire ressortir que les stratégies de résistance et d’émancipation devront généralement signifier que des avantages devront être sacrifiés par les dominants, pour ne pas dire leur être arrachés.
Un deuxième débat porte sur l’identification des rapports de pouvoir qui doivent être étudiés dans la recherche intersectionnelle. Aux États-Unis, et par la double conséquence de l’importance historique de la question raciale (Jaunait et Chauvin, 2013 : 289) et de l’absence d’une tradition marxiste forte, c’est d’abord (et principalement) avec la « race » que le genre a été croisé, ce qui n’a pas empêché la classe sociale d’être éventuellement perçue comme troisième élément à étudier (Anthias, 2012). Il reste que même si l’on parle ouvertement du patriarcat (ou du sexisme) et du racisme comme systèmes de subordination, on observe une grande frilosité à parler et à dénoncer ouvertement le capitalisme pour ses effets sur les classes sociales. Du côté français maintenant, c’est plutôt le croisement entre le genre et la classe qui a été priorisé au détriment de la « race ». Il faut dire que c’est d’abord pour l’analyse de l’exploitation particulière et des pratiques combatives des ouvrières que la nécessité de penser les relations qu’entretiennent les différents rapports de pouvoir a progressivement été formalisée sous le concept de consubstantialité des rapports sociaux (Kergoat 1982 ; 2012). Cette théorisation s’inscrit par ailleurs dans le droit fil des théorisations féministes matérialistes qui accordent une importance centrale au travail et à l’exploitation (Falquet, 2009 ; Kergoat, 2009), alors que l’on parle plus souvent de « discrimination » aux États-Unis.
Cela dit, il aura fallu un certain temps[5] et l’arrivée de féministes dites « postcoloniales » pour qu’un quatrième système (en plus du racisme, du patriarcat et du capitalisme) entre en ligne de compte, à savoir le rapport postcolonial, aussi appelé (comme dans le cas de l’appel à communications du colloque du CÉDIM) le rapport Occident-Tiers-monde[6], et que nous nommerons, en tant que système de domination, l’impérialisme. Tout en étant loin d’être intégré par la plupart des analyses (ce commentaire vise particulièrement les études faites aux États-Unis, situation qui n’est, au demeurant, pas surprenante compte tenu de la quasi-inexistence d’analyses anti-impérialistes radicales dans ce pays), ce système de subordination nous semble incontournable parce qu’il est indéniablement partie prenante de la complexité des rapports de pouvoir qui traversent la planète entière. En effet, non seulement est-il central pour comprendre les rapports politiques, économiques, culturels et sociaux dans le Tiers-monde, mais il nous permet également de mieux comprendre des enjeux internes aux sociétés occidentales qui touchent particulièrement les populations migrantes venant de sociétés postcoloniales (Mohanty, 2003 ; Maillé, 2007, et dans ce numéro).
Un troisième débat porte cette fois sur la manière d’envisager la façon dont les systèmes de subordination interagissent entre eux. Nira Yuval-Davis (2006), par exemple, avance qu’il est important de se rappeler que
[L]a base ontologique de chacune de ces divisions est autonome et chacune priorise une sphère différente des relations sociales […] Par exemple, les divisions de classes sont enchâssées dans les processus économiques de production et de consommation ; le genre devrait être compris non pas en tant que « véritable » différence sociale entre l’homme et la femme, mais comme un mode discursif qui est relié aux groupes de sujets dont les rôles sociaux sont définis par leur différence sexuelle/biologique, alors que la sexualité est encore un autre discours associé à la construction du corps, au plaisir sexuel et aux relations sexuelles. Les divisions ethniques et raciales sont associées aux discours sur les collectivités élaborés autour de frontières de l’exclusion/inclusion […] qui peuvent, dans une certaine mesure, être construits comme étant perméables et muables et qui divisent les gens entre le « nous » et le « eux ».
2006 : 200-201
Ce passage mérite plusieurs commentaires. Premièrement, il est en effet possible d’admettre que la base ontologique de chaque système de subordination est différente du fait qu’ils articulent des rapports sociaux entre différents groupes d’individus (nos « catégories d’analyse » : « race », classes, genre, Occident/Tiers-monde) qui sont eux-mêmes différents, mais à condition, et pour des raisons qui seront développées plus bas, de reconnaître que ces systèmes ont aussi des effets sur des catégories autres que celles sur lesquelles leurs effets sont les plus déterminants. Ainsi, le capitalisme produit des effets qui influencent les rapports de genre ou de « race ». Deuxièmement, il est par contre plus difficile d’admettre que ces systèmes « priorisent différentes sphères de relations sociales », c’est-à-dire qu’ils créent des effets sur des sphères qui sont différentes. En effet, et si l’on accepte la définition que proposait Albert Memmi du racisme, à savoir « la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression » (1994 : 14), on doit admettre que « l’agression » dont profite « l’accusateur » peut prendre forme dans différentes « sphères des relations sociales » et que cette agression prend le genre, la « race », la classe ou même l’opposition Occident/Tiers-monde comme fondement. Pour le dire autrement, le racisme peut bien être la base idéologique (la « justification ») de l’esclavage, il peut également être utilisé pour « légitimer » (ou tenter de le faire !) une exploitation capitaliste, donc économique (par exemple, le cas des travailleuses domestiques immigrantes), ou encore sexuelle (la traite des Est-Européennes à des fins de prostitution). De manière similaire, une analyse qui ne verrait pas les implications des rapports de genre dans la sphère économique serait extrêmement lacunaire du fait qu’une dimension centrale des rapports de genre concerne justement l’exploitation et l’appropriation du « travail considéré comme féminin » (Falquet, 2009 : 78-80). Ainsi, et dès lors que l’on partage cette conclusion, on doit refuser toute analyse qui ferait une relation directe et une division stricte entre un système de domination et une « sphère des relations sociales ».
Troisièmement, même en estimant que « la base ontologique de chacune de ces divisions soit autonome », Yuval-Davis, s’oppose néanmoins à la conception selon laquelle la situation vécue par l’ouvrière noire vienne du fait qu’elle vit une « triple oppression », à savoir celles qui découlent de sa position racialisée, de son genre et de sa classe. Au contraire de cette analyse, elle estime plutôt – avec raison à notre avis – que « dans l’expérience concrète de l’oppression, être opprimé, par exemple en tant que ‘personne noire’, est toujours construit et interrelié [intermeshed] avec d’autres divisions sociales (par exemple, le genre, la classe sociale, le statut d’invalidité, la sexualité, l’âge, la nationalité, le statut migratoire, la géographie, etc.) » (2006 : 195). On l’a vu, c’est par ailleurs dans un tel état d’esprit que Danièle Kergoat propose d’analyser les rapports sociaux comme étant consubstantiels, c’est-à-dire tout à la fois irréductibles les uns aux autres et entretenant des relations de co-construction puisqu’ils « se reproduisent et co-produisent mutuellement » (2009 : 112). La même analyse sous-tend la conceptualisation en termes de co-formation (Falquet, 2009). Plus encore, pouvons-nous préciser que ce n’est pas qu’au strict point de vue du positionnement individuel que ces entrecroisements doivent être imaginés, mais également (et peut-être plus encore) au niveau des systèmes, c’est-à-dire que la relation entre ceux-ci en est une de « dépendance » et de constitution mutuelle en ce sens que le capitalisme, par exemple, va exercer des effets renforcés sur l’ouvrière noire en raison de la vulnérabilité de cette dernière qui est dérivée du sexisme, puis du racisme (Hancock, 2007 ; Ken, 2007 : 9-12 ; Walby, 2007 ; Ken, 2008 ; Bilge, 2009 ; Conaghan, 2009 ; Falquet, 2009 ; Kergoat, 2009). On voit ainsi l’utilité de la définition que donnait Memmi du racisme qui permet de montrer comment on utilise une valorisation de différences (réelles ou imaginaires) pour justifier une agression ou un rapport de subordination dont l’origine peut être le capitalisme ou le sexisme. En résumé, le concept de « matrice de domination » de Patricia Hill Collins est peut-être celui qui est le plus approprié pour bien interpréter la relation entre ces différents systèmes de domination. Ce concept, qui « réfère à la façon dont ces oppressions intersectorielles sont concrètement organisées » (2009 : 21), permet en effet de bien saisir la nature historiquement, culturellement et socialement contingente de l’organisation des différents systèmes d’oppression afin de bien faire ressortir comment chacun d’eux influence et est influencé, voire utilise et est utilisé par les autres. Il permet aussi de montrer que cette organisation est instable temporellement et diffère d’une (micro) société à l’autre, même d’un contexte à l’autre. À tout le moins, pour un centre de recherche comme le CÉDIM qui s’intéresse aux études internationales et au droit international, un tel concept et la grille d’interprétation qu’il induit permettent de questionner comment la globalisation des rapports sociaux de toute nature (économique, politique, sociale, etc.) et, incidemment, le droit international, influencent les matrices de domination aux échelles nationales et locales.
Penser la résistance et l’émancipation à partir de l’intersectionnalité : une nécessaire réflexion sur la subjectivation et la reconnaissance
Les débats qui viennent d’être évoqués renvoient tous à la même question qui relève de la compréhension ou de l’interprétation des structures sociales et des systèmes de domination. Ces débats ne lèvent toutefois pas le voile sur l’importante question de la subjectivité individuelle qui régit le rapport à eux. Cette question est toutefois essentielle si l’on cherche à réfléchir sur la résistance, c’est-à-dire sur les raisons qui poussent les individus, soit à soutenir (activement ou passivement) les structures qui les oppriment, soit à s’organiser pour les combattre. Bref, s’ils s’attardent à la question du rapport social en soi, ces débats sont généralement silencieux sur le rapport pour soi. Ce silence est particulièrement étonnant si l’on considère que cette question est centrale à la réflexion de certains des plus grands auteurs marxistes du début du vingtième siècle, tels que Gramsci ou Lukacs. Quoi qu’il en soit, c’est précisément sur ce sujet que porte le texte de Ricardo Peñafiel qui fait « ‘voyager’ la problématique de l’intersectionnalité […] pour l’introduire dans le domaine de l’étude de l’action collective en Amérique latine ». En prenant appui sur quelques-uns des soulèvements populaires qui agitent l’Amérique latine depuis les « émeutes de l’austérité », celui-ci propose de réexaminer la tension entre la nécessité stratégique d’une certaine unité de la lutte pour l’émancipation et la diversité des « laissés pour compte ». Il s’intéresse plus précisément à la production d’articulations politiques et de « subjectivités intersectionnelles », qu’il cherche à saisir par l’intermédiaire de l’analyse de « récits d’actions directes spontanées ». Son article se présente alors comme un plaidoyer pour une démarche de recherche qui consiste à « induire des positions de sujets silenciées » comme les « systèmes de domination qu’elles dévoilent », plutôt que de les déduire des structures de domination. Cette démarche serait à même sinon de dépasser, du moins de contourner « l’aporie du sujet et de la structure » qui continue de traverser la réflexion sur l’émancipation, y compris intersectionnelle. C’est donc à la création de nouvelles perspectives susceptibles d’éclairer les processus de subjectivation que Ricardo Peñafiel entend contribuer en adoptant une méthode d’analyse de discours appliquée aux récits des protagonistes anonymes d’actions directes spontanées.
Ce décalage entre les rapports sociaux comme tels et l’interaction des individus avec eux, et plus précisément le fait que, bien souvent, la résistance subalterne est (en partie du moins) menée par des individus qui ne se retrouvent pas dans une situation subalterne face aux rapports sociaux sur lesquels ils interviennent, ouvrent la question de savoir qui peut parler pour qui ? Cette question, qui a notamment été posée par le féminisme tiers-mondiste (Spivak, 2009), est abordée d’une façon ou d’une autre dans les textes de Chantal Maillé et de Diane Lamoureux. La contribution de la première vient prolonger la réflexion qu’elle avait amorcée dans La réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois (2007) où elle s’efforçait de mettre à nu les logiques susceptibles d’éclairer le retard d’une telle réception. Elle pointait alors une forme de repli identitaire attaché à « l’héritage de la question nationale » québécoise. Ici, Chantal Maillé poursuit l’analyse tout en déplaçant le questionnement sur les résistances « au sein des féminismes de la francophonie à l’endroit d’une analyse décentrée d’un sujet-femme universel ». Elle propose plus précisément d’interroger la « francophonie » en tant qu’« objet postcolonial », en l’envisageant comme un espace politique marqué par les rapports de colonialité – et sous-problématisé comme tel –, pour mieux situer les silences du féminisme québécois majoritaire sur la question des contradictions (de « race » et de colonialité) entre femmes. Ce silence serait notamment attribuable à « l’hégémonie de la théorie féministe française, elle-même imprégnée d’une culture politique française allergique au multiculturalisme à l’américaine et résistante à l’idée de nommer les différences, particulièrement celles liées à la race, qu’elle met toujours entre guillemets ». Cette contribution ouvre finalement sur les conditions dans lesquelles une « mue postcoloniale » du projet féministe pourrait s’inventer au Québec. Elle supposerait d’engager une double rupture : 1) avec la tendance des féministes majoritaires à puiser leurs ressources critiques et analytiques dans un féminisme français alors même que celui-ci tait son propre colonialisme, y compris vis-à-vis de la société québécoise ; 2) avec le « récit des deux peuples fondateurs, duquel est occultée toute référence à l’idée de conquête, de génocide ou d’esclavage ».
La contribution de Diane Lamoureux cherche pour sa part à « déterminer » les implications politiques des perspectives intersectionnelles et postcoloniales pour lesquelles les différents rapports de pouvoir sont tout à la fois co-constitués et irréductibles les uns aux autres. Cette irréductibilité suppose bien sûr de rompre avec le schéma de la lutte principale mais, surtout, elle permet d’envisager « les dynamiques contradictoires qui peuvent exister » entre les rapports de classe, de race et de sexe, qu’il y a donc « (fort heureusement !) peu de situations de domination totale, ce qui laisse aux divers sujets sociaux une marge d’agentivité à partir de laquelle contester les rapports de pouvoir ». C’est précisément cette agentivité, saisie à partir du problème de la subjectivation des subalternes, qui est au centre de son article. Pour s’en emparer, à l’instar de Ricardo Peñafiel, Diane Lamoureux propose de raisonner non pas à partir des identités ou des « places » occupées dans les hiérarchies sociales toujours socialement constituées, ce qui reviendrait à les réifier, mais plutôt des zones de conflictualité. Ce pas de côté permettrait notamment de voir émerger de « nouvelles grammaires de l’injustice » et simultanément « de nouvelles subjectivités politiques qui […] se construisent dans la contestation même du processus d’assignation des places et des catégorisations dans la société (Rancière, 1998) et instituent de ce fait une dissonance dans l’assignation identitaire ». Or ces dissonances sont fondamentales pour Lamoureux qui voit dans l’assignation identitaire le principe même du « tort » – ou de la souffrance – susceptible de révéler l’injustice et, partant, de nourrir la contestation. On comprend que celle dont il est question ici est l’injustice de l’altérisation, de la naturalisation et de la hiérarchisation. Partant de cette définition, Lamoureux propose de réinterpréter les luttes sociales réputées « identitaires », « trop hâtivement qualifiées de luttes pour la reconnaissance », selon elle. Elle reprend alors la discussion initiée par Nancy Fraser (2004 : 152-153) sur la question de savoir « [q]ue faire du nouvel imaginaire politique articulé autour de l’‘identité’, de la ‘différence’, de la ‘domination culturelle’ et de la ‘reconnaissance’ ? ». Pour Diane Lamoureux, les luttes soi-disant identitaires qui se sont développées dans la période récente peuvent au contraire se lire « comme des luttes pour la justice et pour une autre distribution non seulement de la richesse, mais également du pouvoir ». Si ce sont des luttes « de reconnaissance », c’est qu’elles visent à faire « reconnaître le tort » et non pas l’identité assignée, comme peuvent le laisser penser les lectures trop rapides. Certes, elles « partent de l’expérience de rapports de domination et de l’existence de groupes situés en position subalterne dans ces rapports de domination », mais il reste que « dans le processus de contestation de la domination, les groupes dominés sont engagés à la fois dans une démarche de mise en évidence de la domination, de ‘positivation’ des subalternes et de recomposition plus égalitaire des rapports sociaux ». Il s’agit donc bien de pratiques émancipatoires vis-à-vis de l’assignation identitaire et non pas de luttes partant d’une identité assignée réifiée. Finalement, ce texte s’inscrit de plain-pied dans les débats qui marquent les théories critiques du moment sur le caractère irréductiblement pluriel du sujet et des chemins de l’émancipation. Diane Lamoureux prend ici parti pour les tenants de la pluralité contre une vision par trop unifiante du sujet et appuie son plaidoyer sur les Indignés, Occupy, et le mouvement étudiant du Printempsérable, mobilisations collectives qui seraient significatives de l’émergence de nouvelles subjectivités politiques attentives à leur propre pluralité.
Enfin, le texte de Vincent Chapaux aborde une problématique différente, mais qui nous ramène néanmoins d’une certaine façon à la façon dont la subjectivité des « preneurs de décisions » au sein des organisations internationales et non-gouvernementales est construite, mais également à l’identification de ces preneurs de décisions. Son analyse s’appuie sur deux types de raisonnement avancés par Pierre Bourdieu, à savoir un raisonnement structurel qui cherche à montrer que « [l]’espace social est […] envisagé comme un champ, c’est-à-dire un espace au sein duquel les individus ont une place qui correspond à la configuration précise de capital (culturel, économique, social) dont ils disposent » ; puis un raisonnement individuel qui s’intéresse plutôt aux stratégies que les individus adoptent pour acquérir ce capital. Ainsi, et en rappelant que les universités occidentales possèdent une quantité de capital symbolique largement supérieure à celui des universités non occidentales, ce dont témoignent les « classements » faits par diverses institutions, il met en relief le fait que « près de 90 % des dirigeants des 25 fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies disposent d’un diplôme occidental » et que cette situation est semblable dans les grandes organisations non gouvernementales qu’il a étudiées. Bien qu’il évite de spéculer sur des relations de cause à effet (en affirmant, par exemple, que c’est à cause de ces diplômes qu’ils ont été recrutés), Vincent Chapaux laisse néanmoins entendre que cet état de fait, cette préférence oserions-nous dire, pour les diplômés occidentaux a l’effet de favoriser certains individus au profit des autres : les Occidentaux, premièrement, qui sont les principaux titulaires de diplômes des universités détentrices de ce capital symbolique ; puis, et compte tenu du coût des études universitaires occidentales, les non-Occidentaux qui disposeront « d’un capital économique démesuré au regard du revenu moyen de leur pays ». Derrière ce capital symbolique se cacherait donc un important enjeu de capital économique directement relié à l’intersectionnalité.
Parties annexes
Note biographique
Rémi Bachand est professeur de droit international et directeur du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM), Université du Québec à Montréal.
Notes
-
[1]
Je tiens à remercier Elsa Galerand pour ses nombreux commentaires sur la version préliminaire de cette introduction.
-
[2]
Voir notamment sur ce point Poiret (2005) qui montre en quoi ce discours fait coup double en mettant en cause une version non seulement patriarcale mais aussi éminemment raciste de la féminité blanche au nom de laquelle les femmes se voient contesté le droit de vote.
-
[3]
Toutes les citations tirées de publications anglaises sont des traductions libres.
-
[4]
Rapports sociaux que Kergoat théorise en tant que « relation[s] antagonique[s] entre deux groupes sociaux, établie[s] autour d’un enjeu » (2009 : 112).
-
[5]
Parmi les exceptions notoires : Mohanty, 1984.
-
[6]
Pour une justification du concept de Tiers-monde, voir Mutua, 2000 : 35.
Bibliographie
- Anthias, Floya, 2012, « Hierarchies of Social Location, Class and Intersectionality : Towards a Translocational Frame », International Sociology, vol. 28, no 1, p. 121-138.
- Bilge, Sirma, 2009, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, no 225, p. 70-88.
- Bilge, Sirma, 2010, « De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale et l’inégalité complexe », L’homme et la société, nos 176-177, p. 43-64.
- Crenshaw, Kimberle, 1989, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, p. 139-167.
- Crenshaw, Kimberle, 1991, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, no 6, p. 1241-1299.
- Collins, Patricia Hill, 2009 [2000], Black Feminist Thought, New York, Routledge.
- Combahee River Collective, 2000 [1977], « The Combahee River Collective Statement », dans Barbara Smith (sous la dir. de), Home Girls : A Black Feminist Anthology, New Jersey, Rutgers University Press, p. 264-274. [Trad. fr. par Jules Falquet, 2006, « Déclaration du Combahee River Collective », Cahiers du CEDREF, p. 53-67.]
- Conaghan, Joanne, 2009, « Intersectionality and the Feminist Project in Law », dans Emily Graham, Davina Cooper, Jane Krishnadas et Didi Herman (sous la dir. de), Intersectionality and Beyond : Law, Power and the Politics of Location, Abingdon, Routledge-Cavendish, p. 21-48.
- Davis, Angela, 1981, Women, Race and Class, New York, Random House.
- Dhamoon, Rita Kaur, 2011, « Considerations on Mainstreaming Intersectionality », Political Research Quarterly, vol. 64, no 1, p. 230-243.
- Dorlin Elsa, 2005, « De l’usage épistémologique et politique des catégories de ‘sexe’ et de ‘race’ dans les études sur le genre », Cahiers du Genre, vol. 2 no 39, p. 83-105.
- Dorlin, Elsa, 2012, « L’Atlantique féministe. L’intersectionnalité en débat », Papeles del CEIC [Centro de Estudios sobre la Identidad], no 83, p. 1-16.
- Falquet, Jules, 2009, « La règle du jeu : Repenser la co-formation des rapports sociaux de sexe, de classe et de ‘race’ dans la mondialisation néolibérale », dans Elsa Dorlin (sous la dir. de), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France, p. 71-90.
- Fraser, Nancy, 2004, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du MAUSS, vol. 1, no 23, p. 152-164.
- Grillo, Trina, 1995, « Anti-essentialism and Intersectionality : Tools to Dismantle the Master’s House », Berkeley Women’s Law Journal, vol. 10, no 1, p. 16-30.
- Hancock, Ange-Marie, 2007, « When Multiplication Doesn’t Equate Quick Addition : Examining Intersectionality as a Research Paradigm », Perspectives on Politics, vol. 5, no 1, p. 63-79.
- hooks, bell, 1981, Ain’t I a Woman : Black Women and Feminism, Boston, South End Press.
- Hull, Gloria, Patricia Bell Scott et Barbara Smith (sous la dir. de), 1982, All the Women are White, all the Blacks are Men, but Some of Us Are Brave : Black Women’s Studies, Old Westbury (NY), Feminist Press.
- Jaunait, Alexandre et Sébastien Chauvin, 2013, « Intersectionnalité », dans Catherine Achin et Laure Bereni (sous la dir. de), Dictionnaire Genre et Science politique : Concepts, objets, problèmes, Paris, Presses de Sciences Po, p. 286-298.
- Ken, Ivy, 2007, « Race-Class-Gender Theory : An Image(ry) Problem », Gender Issues, vol. 24, p. 1-20.
- Ken, Ivy, 2008, « Beyond the Intersection : A New Culinary Metaphor for Race-Class-Gender Studies », Sociological Theory, no 26, vol. 2, p. 152-172.
- Kergoat, Danièle, 1982, Les ouvrières, Paris, Le Sycomore.
- Kergoat, Danièle, 2009, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Elsa Dorlin (sous la dir. de), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France, p. 111-125.
- Kergoat, Danièle, 2012, Se battre, disent-elles, Paris, La Dispute, coll. « Le genre du monde ».
- Maillé, Chantal, 2007, « La réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois », Recherches féministes, vol. 20, no 2, p. 91-111.
- Marks, Suzan, 2009, « Exploitation as an International Legal Concept », dans Suzan Marks (sous la dir. de), International Law on the Left : Re-examining Marxist Legacy, Cambridge, Cambridge University Press, p. 281-307.
- Memmi, Albert, 1994, Le racisme, Paris, Gallimard.
- Mohanty, Chandra Talpade, 1984, « Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discourses », Boundary 2, vol. 3, nos 12/13, p. 301-319.
- Mohanty, Chandra Talpade, 2003, Feminism Without Borders : Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Durham, Duke University Press.
- Mutua, Makau, 2000, « What is TWAIL ? », American Society of International Law Proceedings, vol. 94, p. 31-38.
- Poiret, Christian, 2005, « Articuler les rapports de sexe, de classe et interethniques », Revue européenne des migrations internationales, vol. 1, no 21, p. 195-226.
- Rancière, Jacques, 1998, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique.
- Rich, Adrienne, 1979, « Disloyal to Civilization : Feminism, Racism, Gynephobia », dans On Lies, Secrets and Silence : Selected Prose 1966-1978, New York, W.W. Norton, p. 275-310.
- Spivak, Gayatri Chakravorty, 2009, Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, Amsterdam.
- Yuval-Davis, Nira, 2006, « Intersectionality and Feminist Politics », European Journal of Women’s Studies, vol. 13, no 3, p. 193-209.
- Walby, Sylvia, 2007, « Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities », Philosophy of the Social Sciences, vol. 4, no 37, p. 449-470.
- Walby, Sylvia, Jo Armstrong et Sofia Strid, 2012, « Intersectionality : Multiple Inequalities in Social Theory », Sociology, vol. 2, no 46, p. 224-240.

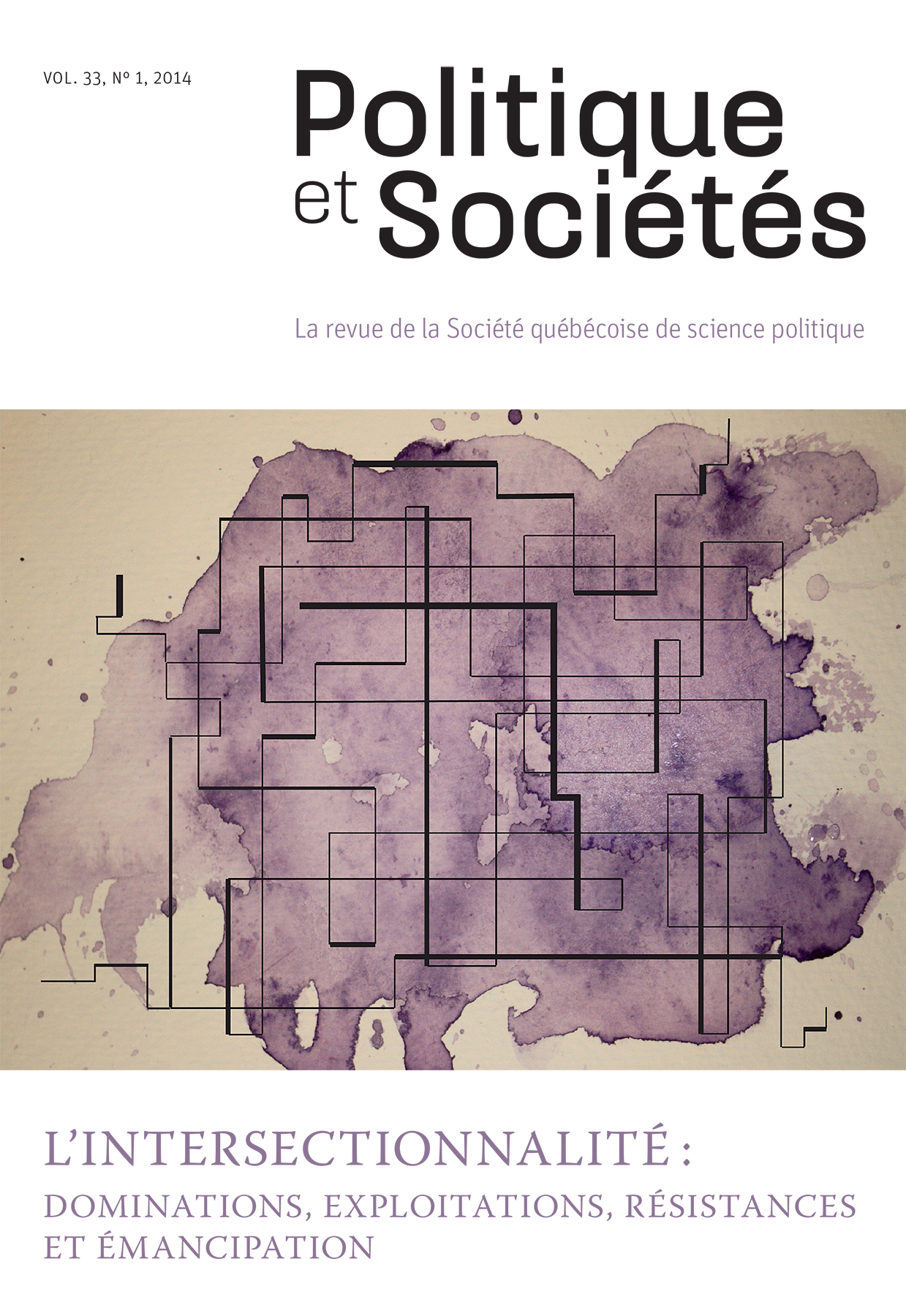
 10.7202/017607ar
10.7202/017607ar