Résumés
Résumé
Cet article s’intéresse à la construction contingente de subjectivations politiques situées à l’intersection de diverses formes de domination ainsi que de diverses pratiques sociales émancipatrices. Cherchant à dépasser une aporie constitutive du champ de l’intersectionnalité oscillant entre sujet et structure, le texte cherche à aborder des positions de sujet généralement « invisibilisées », sans les « déduire » directement des structures de la domination, mais aussi sans les individualiser ou les diluer dans un cumul désordonné de particularismes. En se basant sur un corpus de récits d’actions directes spontanées ayant eu lieu en Amérique latine au cours des deux dernières décennies, l’article cherche à montrer comment ces actions contestataires transgressives sont porteuses de subjectivations politiques intersectionnelles transversales permettant la convergence stratégique de positions divergentes ainsi que l’expression publique de positions invisibles et inaudibles jusqu’alors. L’analyse de ces positions permet non seulement de mieux comprendre les actions collectives et les motivations de leurs participants, mais également d’entreprendre, à partir de cette perspective épistémologique de la marge, une analyse intersectionnelle des structures de la domination.
Abstract
This article focuses on the contingent construction of political subjectivations located at the intersection of various forms of domination as well as various emancipatory social practices. Seeking to overcome a constitutive aporia of intersectionality, between subject and structure, the text seeks to address “invisibilized” subject’s positions without inferring them directly from structures of domination, and without individualizing them or diluting them in a disordered accumulation of specificities. Based on a corpus of narratives from spontaneous direct actions that took place in Latin America over the past two decades, the article tries to show how these transgressive protest actions can be interpreted as transversal intersectional political subjectivations enabling the strategic convergence of divergent positions and the public expression of positions, which were invisible and inaudible until the protests. The analysis of these positions not only gives a better understanding of collective actions and participants’ motivations, it also leads to undertake an intersectional analysis of the structures of domination from the epistemological perspective of the margins.
Corps de l’article
Depuis son apparition au sein du féminisme « noir » (Black feminism) étasunien des années 1980, le concept de l’intersectionnalité (Crenshaw, 1989) s’est propagé dans d’autres espaces disciplinaires[1] au profit d’un décentrement de la conception du rapport entre « sujet » (acteur, agent, identité) et « structure ». Indépendamment des tendances – allant de perspectives qualifiées de « postmodernes », « poststructuralistes » ou « subjectivistes », à d’autres insistant davantage sur les structures de la domination –, la perspective générale de l’intersectionnalité questionne tout autant les analyses centrées exclusivement sur les relations de genre que celles qui s’intéressent de manière unidimensionnelle aux relations de classe, de race ou d’identité.
Posant les principes de la multiplicité et de la fluidité des « identités » de même que de l’interaction entre divers systèmes d’oppression ou de (sur)détermination sociale, le paradigme de l’intersectionnalité déborde de la triade « classe-genre-race » pour embrasser potentiellement toutes les « subjectivations » conflictuelles, situées aux intersections de diverses et complexes formes de domination (homosexualité, âge, handicap, capacités, postcolonialité, etc.). Cet élargissement de la problématique et cette diffusion du concept s’expliquent, selon plusieurs (Knapp, 2005 ; Davis, 2008, entre autres), en fonction d’un « flou » théorique qui affaiblirait la cohérence et la profondeur de la perspective intersectionnelle, se transformant en une simple « formule » rituelle (buzzword) qu’il convient d’évoquer dans l’économie politique des « théories voyageuses » (Knapp, 2005)[2] sans nécessairement l’utiliser.
Pourtant, cette ambigüité théorique peut également être vue comme une tension dynamique, constitutive du champ de l’intersectionnalité (Bilge, 2009), au sein duquel un pôle « subjectiviste » questionne la « dépendance excessive » vis-à-vis des « structures » (Staunaes, 2003) chez certaines théories « normatives » de l’intersectionnalité, tandis que l’autre pôle, insistant sur la nécessité d’analyser de manière intégrée les « structures » générales ou sociétales de la domination et du pouvoir, prévient contre le cumul désordonné de particularismes apolitiques, psychologisants et individualisés du côté des « postmodernes » (Crenshaw, 1991 ; Collins, 2000a [1990] ; Yuval-Davis, 2006).
Dans cet article je vais, moi aussi, faire « voyager » la problématique de l’intersectionnalité. La faire sortir du domaine du féminisme et des « politiques de l’identité » (identity politics) pour l’introduire dans le domaine de l’étude de l’action collective en Amérique latine. Ce faisant, j’espère ne pas tomber dans un usage purement rhétorique de ce concept « valise » (voyageuse), mais contribuer au dépassement de l’aporie se situant entre sujet et structure en présentant une perspective théorique et méthodologique qui cherche à induire les positions de sujet à partir d’une analyse discursive de récits d’actions collectives[3] en fonction desquels peut s’effectuer une interprétation des axes spécifiques de la domination, tels que dévoilés par les sujets collectifs concrets qui s’y opposent. Pour le dire autrement, et de manière plus « polémique », plutôt que de déduire les positions intersectionnelles en fonction de multiples systèmes de domination, je propose d’induire ces positions, ainsi que les systèmes de domination qu’elles dévoilent, à partir des récits d’actions contestataires transgressives recueillis auprès de leurs protagonistes anonymes. Je démontrerai ainsi comment ces positions de sujets ne correspondent pas à des « identités » individuelles ou particularistes, mais à des articulations (Laclau et Mouffe, 1985 ; Hall, 2010) permettant la convergence d’une série de positions partielles derrière une subjectivation politique intersectionnelle « transversale » (Yuval-Davis, 1997 : 116 et suiv.).
Pour illustrer cette démarche, j’appuierai ma démonstration sur une série de « récits d’actions directes spontanées[4] » recueillis dans sept pays d’Amérique latine dans le cadre d’une recherche collective que j’ai codirigée au sein du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)[5] et d’autres recherches personnelles développées au Chili[6]. Ces actions contestataires transgressives (McAdam et al., 2001) vont de l’occupation de terres agricoles ou urbaines (Brésil, Venezuela) aux soulèvements populaires (Oaxaca, Mexique), en passant par des barrages de routes (Équateur, Pérou) et des manifestations de masse (Bolivie, Chili) se transformant souvent en de véritables crises sociales du fait de leur non-reconnaissance par les gouvernements.
L’étude comparative de ces différents cas (que je ne peux malheureusement pas détailler ici) a été réalisée grâce à l’élaboration d’un protocole d’entretien ouvert[7], de type récit de vie (Bertaux, 2010), appliqué par un groupe de chercheurs du GRIPAL à des protagonistes anonymes d’actions directes spontanées ayant eu cours dans les pays évoqués plus haut. Par protagonistes « anonymes », on entend les personnes qui ont participé à des actions collectives sans faire partie des porte-paroles ou de la direction des organisations qui les ont convoquées (lorsqu’elles sont convoquées). Il ne s’agit pas non plus de « la base », dans la mesure où la plupart de ces participants n’ont pas de militance préalable. En effet, les actions contestataires transgressives, comme les soulèvements populaires ou d’autres actions directes spontanées, se caractérisent par la participation de personnes généralement « exclues » des systèmes de représentation politique : non seulement des partis politiques, mais également des organisations sociales ou communautaires. La méthode ethnosociologique de terrain appliquée pour parvenir à recueillir ces récits de vie consistait à se rendre sur les lieux où avaient eu lieu des actions directes spontanées et à s’entretenir avec les populations locales jusqu’à l’obtention d’une trentaine de récits d’actions par pays ou par cas. Ces récits recueillis entre l’été 2009 et l’été 2010[8] ont ensuite fait l’objet d’analyses spécifiques, cas par cas, mais également d’analyses transversales et comparatives visant à tirer des conclusions relatives au phénomène dans son ensemble.
L’augmentation et l’intensification d’actions collectives « transgressives » (débordant des cadres institutionnalisés de représentation politique) au tournant du vingt et unième siècle (Seoane, 2006 ; Seoane et al., 2006 ; Goirand, 2010), non seulement en Amérique latine mais ailleurs dans le monde (Indignados, Occupy, Printemps des peuples, etc.), rend d’autant plus important le développement d’outils conceptuels et méthodologiques pour aborder ce type d’action qui, parce que faiblement institutionnalisé, se prête mal aux analyses classiques des mouvements sociaux et de l’action collective[9]. L’approche intersectionnelle peut servir à aborder ce phénomène qui, lui-même, permet de tester les limites de l’intersectionnalité et de pousser plus loin cette perspective.
L’aporie du sujet et de la structure dans le paradigme de l’intersectionnalité
Dès ses premières formulations, la problématique de l’intersectionnalité visait à dépasser une double invisibilisation[10] des formes spécifiques de domination des femmes noires aux États-Unis, dans le contexte des « politiques de l’identité ». Les sévices subis par les femmes afro-étasuniennes (ou par d’autres minorités paupérisées issues de l’immigration) ne trouvaient pas d’expression adéquate ni du côté du féminisme (« hégémonisé » par la perspective des femmes blanches de classe moyenne) ni du côté du mouvement noir (dominé par une perspective masculine). Plus qu’une simple inadéquation, Kimberle W. Crenshaw parle d’un « effacement de la présence des femmes de couleur dans la contestation politique de la hiérarchie raciale par l’antiracisme, ou du patriarcat par le féminisme » (2005 [1991] : 63). Bien qu’en partie inconsciente ou involontaire, cette invisibilisation de la perspective des femmes noires paupérisées au sein même des mouvements noirs et féministes n’est pas moins lourde de conséquences pratiques et théoriques. Cette subordination interne aux groupes d’« appartenance » n’affecte pas seulement la vie concrète des femmes noires, elle empêche la théorie et la praxis, noires et féministes, de saisir pleinement la réalité sur laquelle elles prétendent agir. La perspective des femmes noires devient alors une position épistémologique à partir de laquelle on peut (et, sur un plan normatif, on « doit ») saisir l’ensemble (Collins, 2000a [1990] ; 2000b).
Comme je l’ai mentionné plus haut, en devenant une « rapide théorie voyageuse » (fast travelling theory) (Knapp, 2005), le paradigme de l’intersectionnalité a perdu en cohérence ce qu’il gagnait en expansion. L’intersectionnalité rassemble autant qu’elle cumule en son sein des contradictions, qui se trouvaient sans doute à l’origine même du concept, mais qui sont amplifiées du fait de leur « importation » décontextualisée dans des domaines et des pays au sein desquels les postulats du féminisme noir et des politiques de l’identité n’ont pas d’équivalents (Weber, 1998 ; Knapp, 2005). Ce n’est pas ici l’espace pour commenter en détail les débats et les défis du champ de l’intersectionnalité. D’autres, qui avaient beaucoup plus de compétences que moi à cet égard, l’ont déjà fait avec sagacité (voir, par exemple, Weber, 1998 ; Knapp, 2005 ; Yuval-Davis, 2006 ; Davis, 2008 ; Bilge, 2009). Je voudrais ici concentrer l’attention sur l’un des problèmes qui subsistent malgré le dépassement des approches monistes de la domination sociale, soit l’aporie du sujet et de la structure, aporie qui se décline dans une série de tensions entre les niveaux micro et macro-social (Bilge, 2009), de même qu’entre « postmodernes » et « structuralistes » ou entre symbolique et matériel (Yuval-Davis, 2006). Gudrun-Axeli Knapp l’exprime ainsi : « The aporia lies in the simultaneous indispensability and impossibility of a foundational reference to an epistemic or political subject » (2005 : 253). Autrement dit, la nécessaire référence à un « sujet » positivement identifié – tant pour des raisons scientifiques que politiques – ne peut se faire qu’au détriment de la diversité de l’expérience qui n’entrera jamais dans les catégories unifiées de la science et de l’action politique. Le champ de l’intersectionnalité s’est constitué sur diverses tentatives pour dépasser cette aporie qui, en tant qu’aporie, n’est peut-être pas « dépassable », mais qui, par le fait même, s’avère le principe dynamique poussant à la création de nouvelles approches des « sujets ».
Les récits d’action directe comme approche des subjectivations politiques et des structures de la domination
Le problème, d’ailleurs, n’est pas exclusif à l’intersectionnalité. Au contraire, issue d’une inhabituelle convergence de courants opposés (rassemblés autour du féminisme), l’intersectionnalité a le mérite de rendre explicite une tension généralement subsumée par des communautés épistémiques relativement monolithiques. Sans prétendre trancher cette question indécidable, je propose ici une méthode d’analyse qui, comme l’intersectionnalité, adopte la perspective épistémologique de la marge (Collins, 2000a [1990]) – de ceux et celles qui ne comptent pour rien dans l’élaboration du savoir et des pratiques sociales –, mais, plutôt que de postuler ou d’attribuer de manière positive une « référence fondationnelle » au « sujet épistémique » de cette négativité[11], je chercherai à induire les positions de sujet « silenciées » à partir d’une analyse discursive[12] de récits de vie de ces « laissés-pour-compte » (Rancière, 1995). Plus spécifiquement, pour illustrer cette approche, je mobiliserai des exemples issus d’analyses de récits d’actions contestataires transgressives ayant eu lieu en Amérique latine au cours de la dernière décennie, recueillis auprès de leurs protagonistes anonymes.
Bien que fondée sur des récits ou des narrations (narratives) (voir à ce sujet Polletta, 2006), cette perspective analytique ne cherche pas à déterminer l’identité ou la subjectivité des individus qu’elle interroge. Et bien qu’il soit toujours possible de mobiliser le matériel d’entrevue derrière des hypothèses cherchant ces identités et ces subjectivités, cela présenterait le risque de conforter une conception subjectiviste des identités collectives ou de ne servir qu’à étayer des catégories identitaires préexistantes (femmes, autochtones, populaires, etc.) sans nécessairement les questionner. À l’inverse, la perspective adoptée ici ne cherche pas à rendre compte de l’identité d’un individu ou d’un groupe social prédéfini, mais cherche plutôt à voir s’il existe des formes communes de représentation ou de mise en discours caractérisant les récits d’actions directes spontanées d’Amérique latine. Plutôt que de parler d’identité, je parlerai de subjectivations politiques, surgies dans et par l’action, impliquant la convergence stratégique de positions[13] divergentes.
Cette démarche requiert également de ne pas « postuler » les raisons qui ont poussé ces populations à participer à ces actions, comme ont tendance à le faire les écrits sur l’intensification de l’action contestataire transgressive en Amérique latine. Comme je l’ai montré ailleurs,
[l]orsqu’on ne déplore pas leur manque d’organisation et l’absence d’une définition claire de leurs intérêts[14], ces actions transgressives sont interprétées, soit comme des nouveaux mouvements sociaux marqués par la prépondérance des dimensions identitaires, ethniques ou culturelles[15], soit comme un « élargissement des répertoires d’action collective » qui ne change pas les « intérêts » et les « demandes » des « groupes sociaux »[16], soit comme des symptômes d’une crise de la représentation et du néolibéralisme[17], ouvrant la voie aux virages à gauche[18].
Peñafiel, 2012b : 73-74
Dans tous les cas, on tend à interpréter des formes « transgressives » d’action politique en fonction de facteurs externes (néolibéralisme, structure d’opportunités), stables et unifiés (identités, culture, intérêts) et relativement institutionnalisés ou ritualisés (mouvements sociaux), alors que ces actions directes spontanées se caractérisent par leur hétérogénéité et leur imprévisible irruption, en dehors des mécanismes institutionnalisés ou « maîtrisés » (contained) de l’action collective ou des mouvements sociaux (McAdam et al., 2001).
Cette hétérogénéité spécifique des actions directes spontanées ne signifie pas que ces dernières soient « étrangères » aux formes davantage institutionnalisées d’action sociale et politique. Seulement, en subordonnant l’analyse d’actions « transgressives » à ses dimensions « maîtrisées », on tend à « silencier » les positions « absentes » de l’espace public qui avaient trouvé dans ces actions une surface d’inscription. De la même manière que l’intersectionnalité a montré comment la position des femmes noires (et d’autres groupes marginalisés) pouvait être invisibilisée, non seulement par les structures de domination mais au sein même des mouvements prétendant les « libérer », je chercherai à rendre compte de la perspective « épistémologique » exprimée dans les récits d’action directe, pour procéder à l’identification de structures de domination se trouvant non seulement dans la violence structurelle du néolibéralisme, mais également dans une violence symbolique dissimulée dans des pratiques se présentant comme des espaces démocratiques (Peñafiel, 2014).
Cette approche pose plusieurs défis méthodologiques, à commencer par une nouvelle question aporétique : comment élaborer un corpus de récits significatifs d’une position dont on ignore jusqu’à l’existence (puisque invisibilisée) ? La manière proposée ici (mais il y en a beaucoup d’autres[19]) consiste à étudier des actions collectives transgressives (qui sortent du cadre institutionnalisé de représentation d’intérêts) en demandant à leurs protagonistes anonymes de raconter leurs expériences. En demandant à ces protagonistes anonymes non pas d’expliquer pourquoi ils ont participé, mais simplement de raconter comment cela s’est passé, on cherche à dépasser un postulat utilitariste ou instrumental (voyant l’action exclusivement comme un moyen en vue d’une fin) et à rendre possible l’apparition d’éléments d’interprétation qui ne soient pas donnés d’avance par la question ou par le cadre théorique et normatif en amont de la recherche. Ce qui intéresse l’analyse n’est donc pas la dimension biographique, mais le système de sens (de valeurs, de légitimation, de jugement, etc.) utilisé par les répondants. En ne posant pas directement les questions relatives aux réponses que l’on cherche, on vise à éviter d’induire un biais systématique à travers la question. Pourtant, cela requiert par la suite d’analyser ces énoncés sans les réintroduire immédiatement dans des catégories préexistantes d’une quelconque théorie générale.
C’est à ce niveau qu’intervient l’analyse du discours comme méthode d’interprétation de « textes » ou d’énoncés assurant une certaine objectivité dans l’identification des mécanismes et des unités de sens qui forment les systèmes de signification (c.-à-d. discours) analysés. C’est cette « objectivité » ou plutôt cette rigueur dans l’identification des éléments signifiants qui a poussé l’analyse du discours[20] à privilégier les acquis méthodologiques de la linguistique pour les appliquer à des énoncés « en contexte ». En appliquant le « principe d’immanence[21] » à l’interprétation des récits d’action directe, on cherche à interpréter la parole de ces locuteurs non autorisés de la langue politique (Joignant, 2007 ; Peñafiel, 2008) en fonction de leurs propres critères de véracité et de légitimité, plutôt qu’en fonction d’un principe externe donné par une théorie générale et préalable du social.
Pourtant, l’analyse du discours n’est pas une analyse strictement linguistique. Elle cherche le « lieu où viennent s’articuler un fonctionnement discursif et son inscription historique » (Maingueneau, 1984 : 7). L’analyse du fonctionnement interne des « systèmes de sens » en fonction desquels les participants anonymes d’actions directes spontanées représentent leurs propres actions ne sera pas complète si elle n’est pas articulée, de manière « dialogique » (Todorov, 1981 ; Maingueneau, 1984), aux autres discours vis-à-vis desquels cette parole se positionne.
Le principe dialogique a été développé par le linguiste russe Mikhaïl Bakhtine pour rendre compte du fait qu’en sciences humaines nous n’avons pas affaire à des « objets », mais à des sujets qui ne peuvent être « objectivés », car ils se situent au sein d’interrelations humaines sur lesquelles ils (inter)agissent. Ce principe dialogique englobe jusqu’au chercheur qui participe, lui aussi, aux interactions sociales constitutives de son « sujet » d’étude. En analyse du discours, le principe dialogique s’est opérationnalisé dans une série de concepts traitant, notamment, de l’intertextualité, de l’interdiscours, de l’inter-incompréhension ou de l’hétérogénéité constitutive des discours[22]. Chacun à leur manière, ces concepts soutiennent l’idée qu’il est impossible d’interpréter un « texte », un discours ou une pratique sociale sans les référer aux autres textes, situations (d’énonciation), pratiques ou discours antérieurs ou concomitants sur lesquels ils prennent appui ou encore qu’ils récusent ou subvertissent.
Ainsi, plutôt que de postuler (objectiver) la valeur et la position ou l’identité des groupes « invisibilisés », le principe dialogique invite à prendre au sérieux la parole ou la compétence énonciative des sans-voix, exprimée dans le parler ordinaire (Labov, 1993 [1978]) ou dans des actions « transgressives », pour tenter d’élaborer une sociologie politique et historique de leurs positions (sociales autant qu’énonciatives) en fonction de la représentation qu’ils et elles expriment d’eux-mêmes, de leurs contextes et de leurs relations à la structure.
Les fonctions fondamentales des récits d’action directe en Amérique latine
Je ne pourrai malheureusement pas aborder le détail des différents récits d’actions contestataires transgressives ayant servi à l’établissement des conclusions exposées ici[23], une telle entreprise débordant du cadre d’un seul article. Au-delà du détail de chacun des conflits étudiés – et des renseignements que l’analyse séparée de chaque corpus de récits d’actions donne pour l’interprétation de chaque cas et contexte particuliers –, il se dégage de l’ensemble de ces cas certains éléments généraux qui peuvent contribuer à la réflexion théorique, épistémologique et méthodologique qui se développe autour de l’intersectionnalité.
Ainsi, après avoir montré comment les récits d’action directe n’expriment pas « une » identité spécifique mais articulent une série de positions autour de subjectivations politiques exigeant leur « reconnaissance[24] », je tâcherai de montrer comment cette subjectivation politique repose sur l’expression publique d’un tort fondamental vérifiant un postulat d’égalité (Rancière, 1995). Exprimant leur « exclusion » commune, les participantes et les participants des actions directes spontanées ne demandent pourtant pas à être « intégrés », du moins pas dans les mêmes rapports d’« intégration excluante » (Simmel, 1998 [1908]). Au contraire, face aux tentatives de représentation politique, d’intégration sociale ou de négociation « en leur nom », les récits des protagonistes anonymes dénoncent la « trahison » du mouvement par ses « leaders », dévoilant ainsi une forme de domination rarement abordée au moment d’analyser ce type de mouvements, c’est-à-dire la violence symbolique ou le fétichisme politique (Bourdieu, 1977 ; 1984), en fonction duquel le porte-parole se substitue aux « sans-voix » au nom desquels il prétend parler.
Les actions directes spontanées en Amérique latine depuis 1989
Comme je le mentionnais plus haut, les actions contestataires transgressives ont connu en Amérique latine, au cours du dernier quart de siècle, une intensification et une croissance spectaculaires (Seoane, 2006). Depuis le Caracazo (1989) et les émeutes de la faim ou de l’austérité à la fin des années 1980 (Walton et Seddon, 1994) jusqu’aux mouvements de protestation populaire – comme ceux du Brésil contre la hausse des prix du transport en commun et le faste des célébrations de la Coupe des confédérations en juin-juillet 2013 ou en soutien aux professeurs en grève en octobre de la même année –, les actions directes spontanées ne cessent d’augmenter et de se répercuter les unes sur les autres. Ainsi, au début des années 1990, on voit apparaître les grandes marches « indiennes » et les barrages routiers en Équateur et en Bolivie. Ces actions vont rapidement « voyager » vers l’Argentine, où des chômeurs et des employés de l’État « sans solde » depuis des mois vont s’approprier ce « répertoire d’action » (Tilly, 1986) pour donner naissance à la pratique des piquetes [barrages routiers] en fonction de laquelle on nommera, de manière métonymique, un nouveau mouvement social hétéroclite : les piqueteros. Plusieurs de ces piquetes et autres actions contestataires transgressives se sont transformées en de véritables soulèvements populaires, comme le Santiagazo en 1993, ceux de Cutral-co et de Plaza Huincul en 1996 ou El estallido (l’explosion [sociale]) de décembre 2001 en Argentine (Auyero, 2001 ; 2002 ; 2003).
Cette dernière crise sociale va conduire à la destitution du président de l’époque, Fernando de la Rúa, comme avant et après lui tomberont une série de présidents sous la pression de la rue. De Fernando Collor de Mello au Brésil en 1992, tombé sous la pression du mouvement de protestation des Caras-Pintadas initié par des manifestations étudiantes, au renversement de trois présidents d’affilé en Équateur par différents mouvements de protestation (Abdalá Bucaram en 1997, Yamil Mahuad en 2000, puis Lucio Gutiérrez en 2005), en passant par la destitution de deux présidents boliviens (Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 et Carlos Mesa en 2005), par les deux « guerres du gaz », pas moins de quatorze présidents ont été destitués par la rue depuis le retour des gouvernements représentatifs dans la région.
Ce n’est pourtant là que la pointe de l’iceberg. Innombrables sont les actions directes spontanées qui, sans entraîner la destitution de présidents, n’ont pas moins permis d’infléchir le devenir politique de l’Amérique latine. Les constantes explosions ou « crises sociales », signifiées en espagnol par le suffixe « azo » (coup/explosion), comme le Caracazo, l’Arequipazo, le Santiagazo, le Baguazo, de même qu’une recrudescence de grèves générales, de longues marches, de blocages de route, de manifestations de masse et d’une série d’autres actions de moindre envergure (comme l’occupation de terrains agricoles ou urbains), sont le signe d’une forme spécifique d’action collective qui semble caractériser la politique contemporaine latino-américaine.
En parlant d’actions directes « spontanées » pour caractériser ces mouvements, il ne faudrait pas entendre que ces actions n’ont aucune cause ou condition de possibilité, comme si elles surgissaient de nulle part et qu’il n’y avait aucun moyen d’en faire l’analyse. Au contraire, le caractère « spontané » de ces actions réfère au concept du « spontanéisme des masses » élaboré par Rosa Luxembourg (1969 [1906]) pour rendre compte du fait que les masses « non conscientisées » (externes aux organisations politiques de la classe ouvrière) pouvaient acquérir, par des actions directes et des luttes autonomes « spontanées », une « conscience de classe » bien plus radicale que celle de « dirigeants conscientisés » de la classe ouvrière. Le déplacement du concept de spontanéisme, pour rendre compte des spécificités de la vague d’actions contestataires transgressives qui caractérise l’action collective contemporaine de l’Amérique latine, vise à rendre compte du débordement des cadres institués de l’action ainsi que des « demandes » sectorielles de départ (servant de détonateur). En effet, alors que certaines actions (comme les explosions sociales) surgissent sans convocation apparente d’une quelconque organisation politique ou sociale, d’autres, bien que convoquées par des acteurs politiques ou sociaux, se transforment en des mouvements beaucoup plus larges ne reflétant que de manière indirecte les objectifs spécifiques de ces convocations.
La constitution d’un corpus d’entrevues pour aborder des actions directes spontanées
J’ai affirmé plus haut que ces actions se répercutaient les unes sur les autres, tel un répertoire d’actions collectives (Tilly, 1986) qui se diffuseraient de manière « généalogique ». Pourtant, cet « air de famille » ou cette influence « superficielle » ne renseigne pas sur les « motivations » des personnes qui y ont pris part. Comme le note Charles Tilly lui-même dans un article récent (2010), il ne suffit pas de « décrire et mesurer » (quantifier) le conflit, il faut encore « l’expliquer » et, pour cela, il plaide en faveur d’une méthode « ethnographique », venant en renfort aux traditionnels « catalogues d’événements » utilisés par la sociologie de l’action collective.
Sans reprendre la méthode utilisée par Javier Auyero (2001 ; 2002 ; 2003)[25], la démarche utilisée ici s’en approche en plusieurs points, notamment en ce qui a trait à l’usage de récits d’actions pour interpréter l’ensemble du phénomène dans ses relations à la structure « globale ». Cette approche est qualifiée de « glocale[26] » par Auyero (modifiant le concept de Robertson, 1995), qui souligne le fait que bien que les émeutes et les soulèvements populaires puissent avoir des « causes » globales (comme les politiques d’austérité), celles-ci n’ont pas les mêmes effets partout. Il est donc nécessaire d’interpréter les articulations locales qui reconfigurent radicalement les contextes globaux pour produire des actions, mais aussi des effets sur la structure globale.
L’étude comparative présentée ici a impliqué une douzaine de chercheurs travaillant sur sept pays différents (Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, Mexique, Pérou et Venezuela). Aux fins de comparaison, tous les chercheurs ont appliqué un même protocole d’entrevue élaboré collectivement au cours de l’année précédant les départs sur le terrain. Recueillant une trentaine d’entrevues par conflit analysé, le corpus total comprend plus de 300 entrevues semi-dirigées qui, après transcription, ont été analysées pays par pays, mais également de manière transversale et comparative à partir de méthodes qualitatives et quantitatives d’analyse du discours[27].
Pour illustrer les résultats de cette recherche collective, je mobiliserai ici des extraits d’entrevues concernant principalement des cas du Pérou (Baguazo), du Mexique (la Commune d’Oaxaca), de l’Équateur (communautés autochtones en lutte contre des compagnies « extractivistes »), du Venezuela (Caracazo, manifestations de rejet ou d’appui à Hugo Chávez et prises de terrains agricoles et urbains) et du Chili (mouvement de contestation sociale issu d’une grève étudiante de six mois en 2011). Puisque les conclusions cherchent à caractériser l’ensemble, la mise en contexte de ces actions sera présentée en notes de bas de page au moment d’aborder des extraits.
Identités ou subjectivation politique ? L’exigence de reconnaissance
Au-delà d’une identité commune, les récits d’actions directes que nous avons analysés expriment une subjectivation politique, négativement constituée, exigeant la reconnaissance d’une série de positions qui ne sont pas liées entre elles de manière « positive » ou « identitaire », mais en fonction d’un « mépris social » (Honneth, 2006) ou d’une « négation » commune par un ordre symbolique (Laclau et Mouffe, 1985) dans lequel elles n’existaient pas. Comme l’exprime Wari[28], un autochtone qui a participé au tragique barrage d’une route à Bagua dans l’Amazonie péruvienne en juin 2009[29], « Sans [cette action] nous n’allions jamais être reconnus en tant que peuples indigènes, nous allions toujours occuper un lieu vide de notre non-existence. Alors que nous en tant que peuples indigènes nous sommes aussi égaux, en tant qu’êtres humains que, que les hispanophones. » En apparence, cet énoncé s’inscrirait dans la catégorie des récits identitaires indigènes (en tant que peuples indigènes). Pourtant, cette exigence de reconnaissance se fait sur un postulat d’égalité (nous sommes aussi égaux, en tant qu’êtres humains) qui permet à cette action – tout comme à toutes les autres actions directes spontanées analysées ici – de déborder de la position « identitaire » (ou sectorielle) de départ pour embrasser un ensemble beaucoup plus large, négativement constitué, s’étendant même au-delà des frontières nationales.
Dans le cas de Bagua – ou d’autres actions menées par des « autochtones » d’Équateur (Corten, 2012) ou de Bolivie (Beaucage et al., 2012) –, il s’agit de la catégorie d’indigènes qui en vient à s’articuler à d’autres, comme celles des paysans, des métis, des pauvres, des femmes, des travailleurs, des persécutés politiques, etc., de même qu’à d’autres positions « sans-nom ». Ailleurs, comme au Chili en 2011[30], c’est autour d’un conflit étudiant que des centaines de milliers de personnes ont pris la rue pendant six mois, pas seulement en fonction d’un droit nié à l’éducation, mais, de manière beaucoup plus large, en fonction d’un principe d’égalité et d’isonomie (égale capacité de tous à statuer sur la norme constitutive du social) bafoué par une forme « décisionniste » et procédurale de légitimité politique caractéristique de la « démocratie de basse intensité » chilienne (Gills et Rocamora, 1992 ; Moulian, 1997) et, plus largement, des démocraties autoritaires contemporaines (Dabène et al., 2008 ; Peñafiel, 2014).
Ailleurs, comme dans le cas de la Commune d’Oaxaca et de l’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (APPO) au Mexique en 2006[31], il s’agit d’un conflit de travail on ne peut plus institutionnalisé – voire ritualisé – entre le syndicat des enseignants et le gouvernement de l’État qui se transforme en symbole ou signifiant vide (Laclau, 2000) de tous les torts subis par l’ensemble « des peuples d’Oaxaca », en fonction de la répression des enseignants et du déni de leur statut d’interlocuteur légitime. Ailleurs, encore, ce sera le « pillage » d’une région par des compagnies extractives (ou traitant des ressources renouvelables de manière « extractiviste ») qui engendrera la révolte populaire (Seoane, 2006). Dans d’autres cas – comme ceux du Caracazo au Venezuela en 1989 (Coronil et Skurski, 2006 ; Peñafiel, 2012a), de la révolte des Forajidos [hors-la-loi] en Équateur en 2005, du conflit du TIPNIS (Territoire indigène et parc national Isiboro-Secure), ou du Gazolinazo en Bolivie depuis 2010 –, c’est en fonction d’une loi ou d’une décision gouvernementale que des positions divergentes convergent autour de l’expression publique de l’« indignation » devant l’inacceptable.
Souffrance sociale et expression publique d’un tort fondamental
Indépendamment des raisons spécifiques et conjoncturelles de chacun des conflits analysés, une caractéristique se détache de l’ensemble, permettant d’avancer l’hypothèse d’une expression publique de la souffrance (Peñafiel, 2012d). En effet, de manière surprenante, et sans aucune sollicitation[32], l’ensemble des répondants racontaient les processus qui les avaient conduits à prendre la rue en fonction d’une inacceptable souffrance protéiforme. Pablo, par exemple, un habitant d’Oaxaca qui a participé aux actions de l’APPO, raconte :
Les gens qui participent […] ou bien ils ont vu la souffrance du peuple ou ils ont souffert dans leur propre chair… les représailles […] les injustices, le manque de liberté, de droits […] Oaxaca est un état où il y a beaucoup de politisation. Pas parce qu’on aurait étudié mais à cause de la souffrance des gens. Alors, quand tu vois tout ça, tu dois entrer dans la lutte, pour défendre les droits[33].
Dans cet extrait, on peut voir comment la souffrance en question n’est pas seulement physique (représailles) ou individuelle (dans leur propre chair), mais d’abord et avant tout collective[34] (souffrance du peuple), morale et politique (les injustices, le manque de liberté, de droits). Loin d’être victimaire, cette souffrance n’appelle pas une aide, mais sert de « garant[35] » à l’action (tu dois entrer dans la lutte). La souffrance ne vient pas seulement cautionner ex post une action ; modalisée de manière déontique[36] (tu dois), la figure de la souffrance se présente comme si elle « exigeait » des actions, ex ante.
La souffrance dans les récits d’actions directes ne fait pas que légitimer (se porter garante) des actions contestataires transgressives qu’elle « exige » (modalisation déontique), elle engendre, dans le même mouvement, le « sujet » de ces actions. Comme le notait Güaïna, un nativo (autochtone) de Bagua qui a également pris part au barrage de la route transamazonienne en juin 2009, « Je crois que, comme conséquence de [la répression sanglante], comme conséquence des actes de discrimination qui existent et de l’abandon dans lequel se retrouvent les communautés indigènes, cela va prendre corps. » Cet énoncé exprime explicitement un des principes fondamentaux des théories de l’énonciation sur lesquelles se développe la tradition française d’analyse du discours, à savoir que les déictiques (repères) de temps, d’espace et de personnes ou la scénographie (Maingueneau, 1999) d’un discours ne font pas que « décrire » ou situer l’énoncé par rapport à une situation d’énonciation « extra-discursive ». En valorisant le contexte d’une certaine manière, le discours engendre une sorte de matérialité. Il institue, notamment, des communautés discursives qui « prennent corps » en fonction du fait qu’elles partagent une série de critères de véracité ou de légitimité. Dans ce cas, l’action – qu’on peut interpréter en tant que telle comme un acte significatif (sémantique de l’action : Ricoeur, 1977) – engendre une unité (un corps social) qui n’existait pas avant. Cette communauté imaginaire n’est pas constituée seulement des diverses nations autochtones de la région, n’ayant entre elles aucune unité ethnique ou linguistique préalable[37], mais également des « frères métis » qui se reconnaissent dans la lutte de leurs « frères nativos » en fonction de leur exclusion commune (Giménez Micó, 2012).
La répression et le déni d’un statut d’interlocuteur (ex post) se présentent dans les récits d’action directe comme la confirmation d’une négation généralisée (ex ante). Dans les mots de Kuña, une autochtone de Bagua, « Chaque jour qui passait, pour nous, c’était une preuve que nous ne servions pas pour eux. Pour eux, nous n’avions pas la moindre importance. » Et elle conclut, plus tard : « nous continuons à être maltraités, l’abus de nos droits… ». Dans l’ensemble des récits du corpus, on retrouve, avec une étonnante régularité, une scénographie valorisant (modalisant) le temps, l’espace et les personnes en fonction d’une souffrance et d’une violence généralisées, qui semblent être là partout (Oaxaca est rempli de tout ça) « depuis toujours » (Toute ma vie j’ai vu les injustices…) et pour toujours (nous continuons à être maltraités). Une violence exercée non seulement par les forces répressives mais par les compagnies (privées comme publiques, étrangères ou nationales) qui « prétendent apporter le progrès » mais « pillent les forêts », « polluent les rivières », « violent nos filles »[38]. Une violence qui, en plus d’être physique, politique, économique et structurelle (Farmer, 2003), s’énonce comme le refus d’une violence symbolique (Bourdieu, 1977) qui voudrait que les dominés assument eux-mêmes les places de leur domination.
Le refus de la violence symbolique
Les actions directes spontanées ont ainsi comme condition de possibilité un refus des « positions de sujet » offertes aux populations par les appareils idéologiques d’État afin d’en obtenir un assujettissement volontaire à l’idéologie qui les interpelle en tant que sujets libres (Althusser, 1976 ; Bourdin, 2008). Comme l’exprime Arturo, jeune homme d’une communauté autochtone de l’Amazonie équatorienne, « Les gouvernants ne nous écoutent pas. Ils font à leur tête. Alors, le peuple indigène n’entre pas [no se acopla] dans l’idée qu’ils se font de nous ». Refusant leur position dans la « démocratie participative » de la « révolution citoyenne » mise de l’avant par le gouvernement (du virage à gauche) de Rafael Correa, les communautés autochtones de l’Équateur dévoilent les limites de cette « révolution démocratique ».
Ce refus de la violence symbolique et de l’assujettissement des sujets s’exprime également par la dénonciation de leur non-reconnaissance (ici, il n’y a personne ; nous n’existons pas pour eux ; le lieu vide de notre non-existence ; etc.) ainsi que de leur « fausse représentation ». Une « fausse représentation » qui est autant le fait des « riches » que des « puissants » ou du « centre » – qui « nous voient comme des communistes », des « terroristes », de la « racaille », du « lumpen » – que des politiciens, de gauche comme de droite, qui « nous utilisent simplement pour arriver au pouvoir et après ils nous disent : ‘vous êtes des déchets’, ‘vous ne valez rien’ ». Une violence qui vient également des institutions – censées « défendre les droits du peuple mais qui se mettent du côté des puissants » –, des médias – qui « mentent » et « feraient mieux de se taire » plutôt que de pervertir « la réalité » – ou même des leaders de l’action ou de dirigeants locaux – qui « trahissent » en cherchant leurs intérêts personnels ou ceux d’un parti politique[39] ou qui « se trompent » en cherchant des gains matériels pour le groupe, mais qui conduisent à la réinsertion de celui-ci dans les mêmes institutions inacceptables dénoncées par l’action[40].
Subjectivations politiques intersectionnelles transversales négativement constituées
Les récits d’actions directes de notre corpus établissent ainsi d’immenses chaînes d’équivalence entre diverses formes de violence (physique, structurelle, symbolique, conservatrice, fondatrice, etc.) qui tendent à décrire une sorte de position intersectionnelle qui, plutôt que d’établir des distinctions ou des spécificités entre diverses formes de discrimination, les articulent, autour de certains signifiants vides[41], créant de nouvelles positions transversales négativement constituées. Pour le dire dans les mots de Lupita, une femme qui a participé aux luttes de l’APPO, « une assemblée populaire où tous peuvent aller, les commerçants, les paysans, les agriculteurs, les indigènes, les femmes au foyer… Et on s’agglutine dans l’APPO […] pour pouvoir ‘faire’ et faire entendre notre voix ».
Cette indistinction ou ce cumul de positions « disparates » n’est pas le signe d’une incapacité à comprendre les articulations spécifiques de la structure d’oppression, mais la condition de possibilité d’une subjectivation transversale qui englobe en son sein tous ceux qui sont « exclus » d’un système de représentation, social et politique. En d’autres termes, c’est parce que les participants d’actions directes spontanées ne cherchent pas tant à adresser des demandes – à un système qui ne les prend pas en considération –, mais à exprimer publiquement une souffrance protéiforme ou à mettre en commun un tort fondamental, que celles-ci permettent la convergence d’une série de positions et, surtout, de positions « absentes » (invisibilisées, silenciées, marginalisées) de l’espace public.
La trahison des représentants et le postulat d’égalité
C’est ainsi que s’explique la « trahison des représentants », dont la principale faute consiste à chercher à instrumentaliser ces actions dans une série de demandes visant l’intégration sociale des participants, mais qui se traduit, dans les récits d’actions directes, comme une nouvelle violence symbolique cherchant à les réintégrer au sein des mêmes structures qui les excluent et reproduisent les hiérarchies sociales naturalisées, dénoncées par les actions. Privilégier une fin (partielle) au détriment des autres éléments constitutifs de la chaîne d’équivalences construite autour de l’expression publique de la souffrance en vient à recréer de nouveaux privilèges qui excluent ceux qui avaient enfin trouvé un espace pour exprimer leur « inexistence » en fonction de laquelle ils exigent de se faire compter. Carmen, une femme qui a participé à la récupération d’une terre agricole dans la région de Yaracuy au Venezuela, l’exprime ainsi :
[Le problème c’est qu’il] existe encore des privilèges [divinidades] au sein même des coopératives agricoles [fundos] et des organisations, produits d’une bureaucratie profondément ancrée dans tout le gouvernement et qui ne veut pas qu’ici on fasse la révolution. Mais alors je dis que la révolution se fait tout de même, parce que la révolution c’est nous qui la faisons, les paysans, les ouvriers et les étudiants ; c’est aussi facile que ça ; c’est ainsi et c’est ainsi.
De même, Rosita, une « combattante [luchadora] populaire [sic] » qui a occupé des édifices à Caracas, se confrontant à la répression physique autant qu’à l’intimidation symbolique d’un gouvernement « révolutionnaire » traitant d’envahisseurs [invasores] les personnes qui luttent pour le droit au logement en dehors des structures « participatives » (c.-à-d. bureaucratisées) « d’accès » au logement : « Pour l’instant, nous nous taisons, mais lorsque les cerros[42] sortiront, […] là je t’assure que ça va changer, parce que c’est le peuple qui va parler. Pas les ministres, ni les députés, ni le foutu parti, nous allons sortir ceux qui souffrent réellement[43]. »
Les subjectivations politiques intersectionnelles transversales et les structures de la domination
Les récits des protagonistes anonymes d’actions directes spontanées expriment ainsi une position intersectionnelle transversale (bâtie autour de l’expression publique de la souffrance) « masquée » tout autant par les structures de la domination qui l’« invisibilisent » que par les catégories « identitaires » spécifiques (femmes, autochtones, paysans, ouvriers, étudiants, etc.) qui tendent à surdéterminer le sens des groupes ainsi « identifiés » à leurs positions sociales instituées. La subjectivation politique qui traverse ces récits n’est pas déductible de la structure de la domination dans la mesure où elle est issue de processus contingents qui réarticulent ces identités ou ces « positions différentielles » (Laclau et Mouffe, 1985) spécifiques dans de nouvelles positions transversales « inexistantes » auparavant.
Pourtant, ces nouvelles positions de sujet ne sont pas autoréférentielles. Elles se relient de manière dialogique et négative à la structure et offrent une clé d’interprétation permettant précisément d’identifier des articulations invisibilisées par la naturalisation ou l’objectivation de celle-ci. La première ou la plus fondamentale de ces articulations de la domination dévoilées par les récits d’actions directes est justement l’objectivation même de la structure de la domination autant que des identités ou des positions de sujet articulées en son sein. En effet, en surgissant par effraction dans un espace public où ils « n’existaient pas », en exigeant de s’y faire compter (Rancière, 1995), les laissés-pour-compte dévoilent le caractère mensonger de l’unité du social et rendent ainsi inopérant l’ensemble des positions de la structure de la domination qui, pour se reproduire, requerrait leur « négation » et leur « assujettissement volontaire ».
En refusant de se « tenir à leur place » (dans le lieu vide de leur non-existence), en refusant cette violence symbolique qui les contraindrait à assumer le caractère inéluctable de la domination, les protagonistes des actions directes spontanées affirment l’égale capacité de tous à statuer sur la norme constitutive du social (isonomie). Ce faisant, ces actions ne questionnent pas seulement les formes les plus évidentes de la domination, déjà mises en cause par les catégories instituées de l’action politique et sociale[44]. De manière beaucoup plus radicale, ces actions remettent en question le fondement même de la représentation politique, en « manifestant » l’existence de ce qui était invisibilisé et silencié par et dans les formes mêmes de la contestation « maîtrisée ». Finalement, les actions directes spontanées problématisent les catégories sociales identitaires et appellent de nouvelles manières de rendre compte de la structure et des sujets qui la créent, la reproduisent ou la subvertissent.
Parties annexes
Note biographique
Ricardo Peñafiel est professeur associé au Département de science politique de l’Université du Québec de Montréal (UQAM) où il enseigne l’analyse du discours, la théorie politique et les systèmes politiques de l’Amérique latine. Il est également chercheur au GRIPAL (Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine) et chercheur associé au CPDS (Centre de recherche sur les politiques et le développement social / Université de Montréal). Ses recherches portent sur les mouvements sociaux, les actions directes spontanées et les actions contestataires transgressives en Amérique latine, dans leurs relations aux processus démocratiques, aux changements sociaux et au questionnement des systèmes politiques institués. Combinant l’analyse des discours politiques à une socio-ethnographie discursive de récits de vie, il développe des études socio-historiques comparatives des scènes politiques du continent, cherchant à incorporer la perspective des groupes marginalisés ou invisibilisés.
Notes
-
[1]
Comme l’illustre le présent numéro de la revue portant sur « l’intersectionnalité dans les études internationales ».
-
[2]
Knapp reprend ici le fameux concept de Travelling Theory de Saïd, 1983.
-
[3]
Qui, comme nous le verrons, expriment moins des « identités » sociales ou des « identifications » individuelles que des « subjectivations politiques » imprévues (non déductibles d’une préconception du social ou du politique).
-
[4]
Le caractère spontané de ces actions ne signifie pas que celles-ci soient dépourvues de causes ou d’intentions. Leur spontanéité réfère au fait qu’elles ne suivent pas les canaux institués d’acheminement de demandes ou d’expression d’« intérêts ». Au sujet du spontanéisme, voir notamment Luxembourg, 1969 [1906].
-
[5]
Les pays en question sont : le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, le Mexique et le Venezuela. Pour le détail de cette recherche subventionnée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), voir Corten et al., 2012. Pour la présente démonstration, je m’attarderai plus spécifiquement aux cas de l’Équateur, du Mexique, du Pérou et du Venezuela, de même que du Chili, incorporé en fonction d’une recherche individuelle ultérieure.
-
[6]
J’en profite pour remercier le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS) et le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) de leur appui à mes recherches de terrain au Chili en décembre 2011 et janvier 2012. Certains des résultats de cette recherche se trouvent par ailleurs dans Peñafiel, 2012c. Je remercie également le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), le CRSH ainsi que le GRIPAL de leur appui à l’ensemble de mes recherches.
-
[7]
Ce protocole consiste en une série d’orientations thématiques communes visant à susciter des récits plutôt que des réactions à des questions précises pouvant induire des réponses orientées. Je reviendrai plus bas sur ces questions épistémologiques autant que méthodologiques.
-
[8]
Ces dates concernent la recherche collective GRIPAL. Pour la recherche individuelle au Chili, les récits ont été recueillis entre décembre 2011 et janvier 2012.
-
[9]
Pour plus de détails, voir Peñafiel, 2012b et 2012c.
-
[10]
Au sujet du concept d’invisibilisation, voir, par exemple, Magendzo, 1997, ou Winter, 1997.
-
[11]
C’est-à-dire aux populations qui se trouvent oubliées ou invisibilisées, tout autant par le savoir que par le pouvoir, comme pouvaient l’être les femmes noires paupérisées mises en lumière par l’intersectionnalité. Pour plus de détails au sujet de la négativité, voir Peñafiel, 2008.
-
[12]
Pour une introduction à cette perspective, voir notamment Maingueneau, 1991 ; Mazière, 2005 ; et Sarfati, 2005. Pour un dictionnaire encyclopédique sur le sujet, voir Charaudeau et Maingueneau, 2002. Et pour une application de la perspective discursive à une étude de l’action collective, voir Rennes, 2011.
-
[13]
Positions sociales, politiques, identitaires, énonciatives, etc. Cette manière de rendre compte du phénomène est inspirée de la conceptualisation des formations discursives par Foucault, 1969.
-
[14]
Voir, par exemple, Arditi, 2008 ; Oxhorn, 2011.
-
[15]
Tant dans une perspective tourainienne (Garretón, 2002) que dans une approche culturaliste, relative aux Cultural Studies (Escobar et al., 2001).
-
[16]
Wickham-Crowley et Eckstein, 2010.
-
[17]
Paramio, 2002.
-
[18]
Cameron et Hershberg, 2010.
-
[19]
Voir Peñafiel (2013) pour une application de l’analyse du discours à l’étude des pensées politiques incorporant la perspective du parler ordinaire dans les corpus classiques de grands penseurs (au masculin, bien entendu, puisque les femmes, comme les subalternes, ne peuvent ni parler ni penser).
-
[20]
Tant l’analyse du discours de tradition française (Maingueneau, 1991 ; Mazière, 2005 ; Sarfati, 2005) qu’anglo-saxonne, comme la Critical Discourse Analysis (Van Dijk, 1985 ; Fairclough, 1992 ; Wodak et Mayer, 2001). Pour une analyse de l’ensemble du champ des analyses du discours dans les sciences sociales, voir notamment Bonnafous et Temmar, 2007.
-
[21]
Le principe d’immanence a été élaboré par Saussure (1982 [1915]) pour fonder la linguistique moderne. Ce principe postule que les systèmes de sens que constituent les langues (ou les discours) ne s’expliquent pas en fonction d’un principe externe, mais par rapport aux relations de différence existant entre les éléments des systèmes eux-mêmes. Pour plus de détails sur le principe d’immanence et l’analyse du discours appliqués aux sciences sociales, voir Peñafiel, 2013.
-
[22]
Au sujet de ces notions, voir notamment Tel Quel, 1968 ; Maingueneau, 1984 ; 1991 ; Paveau, 2010.
-
[23]
Les analyses plus détaillées se trouvent dans Corten et al., 2012, de même que dans Peñafiel, 2012b et 2012c.
-
[24]
Sans s’inscrire entièrement dans la théorie de la reconnaissance de Honneth, les réflexions induites par cette exigence de reconnaissance viennent l’alimenter et la problématiser. Au sujet de la théorie de la reconnaissance, voir notamment Honneth, 2000 et 2006, ou encore Fraser et Honneth, 2003.
-
[25]
Qui sert d’exemple paradigmatique au plaidoyer de Tilly en faveur d’une approche ethnographique.
-
[26]
Néologisme obtenu par la contraction de global et de local (Auyero, 2001).
-
[27]
Pour les analyses spécifiques à chaque pays, voir les différents chapitres de Corten et al., 2012 ; pour une analyse comparative quantitative, voir Longtin, 2012 ; pour une analyse comparative qualitative, voir Peñafiel, 2013.
-
[28]
Afin de préserver l’anonymat des répondants sans enlever trop de vie aux récits, tous les noms utilisés dans cet article sont des pseudonymes. Aussi, pour ne pas alourdir le texte, les extraits d’entrevues ne sont transcrits que dans leur traduction libre.
-
[29]
Cette action concerne une série de nations d’autochtones de l’Amazonie (désignés comme des nativos [natifs / autochtones]), de même que des habitants « métis » (non-autochtones) des villes avoisinantes qui se sont portés à la défense de leurs « frères nativos ». Cette action survient après plusieurs mois de luttes (marches, grèves de la faim, occupations de routes, d’édifices publics, de stations-service, délégations à Lima, etc.) pour résister à un ensemble de lois visant à permettre l’exploitation intensive de l’Amazonie, dans le cadre des accords de libre-échange entre le Pérou et les États-Unis. Refusant de reconnaître la légitimité du mouvement, le gouvernement péruvien envoie, le 5 juin 2009, les forces antiterroristes de la Division nationale des opérations spéciales (DINOES) pour démanteler un barrage routier. S’ensuit une violente confrontation qui se solde par la mort de 23 policiers, la mort et la disparition de dizaines de manifestants, ainsi que des centaines de blessés du côté de ces derniers. Malgré ce funeste dénouement, l’action a tout de même servi à publiciser le conflit et à forcer les autorités à négocier. Mais le plus précieux acquis, selon les protagonistes de l’action, est d’avoir permis l’apparition d’une « communauté du litige » et d’une réalité niée. Pour plus de détails, voir Giménez Micó, 2012.
-
[30]
Ce conflit qui en avril 2011 ne concernait qu’une seule université où les étudiants dénonçaient la génération de profits par une institution censée être « sans but lucratif » va s’étendre à l’ensemble des universités, puis aux collèges (d’enseignement secondaire) en opposition à l’ensemble de la Loi organique constitutionnelle de l’enseignement (LOCE) dénoncée comme autoritaire, mercantile et « ségrégationniste » (aggravant la ségrégation sociale). Avec l’appui des syndicats et de divers mouvements sociaux, ce mouvement de protestation se généralise à l’ensemble du social, engendrant des manifestations hebdomadaires de centaines de milliers de personnes, des grèves générales de 24 heures, des grèves locales solidaires, des manifestations éclairs (flashmobs), des concerts de casseroles (caceroleos), des occupations de lieux publics autant que d’édifices gouvernementaux, de partis politiques de même que d’institutions d’enseignement, etc. Pour une analyse plus détaillée, voir Peñafiel, 2012c. Pour une analyse comparée de ce mouvement avec le Printemps érable et d’autres mouvements de protestation issus de conflits étudiants, voir Peñafiel, 2014.
-
[31]
La Commune d’Oaxaca fait référence à une série d’actions (marches, occupations du Zócalo [place centrale], de l’université, de radios, etc.) déclenchées à partir du mois de mai 2006, après le déni de négociation et la répression des grévistes de la Section 22 du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE). Ces actions, qui mobilisent des centaines de milliers de personnes autour, notamment, de l’exigence de destitution du gouverneur de l’État d’Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, conduisent par ailleurs à la création de l’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (APPO), regroupant plus de 300 organisations sociales (syndicales, populaires, autochtones, de femmes, culturelles, etc.). Pour plus de détails, voir Huart, 2012.
-
[32]
La recherche ne portait pas sur la souffrance mais sur l’action directe spontanée. Dans aucun des thèmes du protocole d’entrevue il n’était question de souffrance.
-
[33]
Pour une analyse plus détenue de cet extrait ainsi que de l’ensemble du corpus des récits d’actions directes, voir Corten et al., 2012. Pour une analyse spécifique du cas d’Oaxaca, voir Huart, 2012.
-
[34]
Il est à noter que même dans l’énoncé « individualisant » la souffrance (ilsont souffert dans leur propre chair), celle-ci est énoncée au pluriel et se trouve connectée à l’énoncé antérieur sur la souffrance du peuple. Ainsi, même lorsque vécue individuellement, il s’agit toujours d’une « souffrance partagée ».
-
[35]
Au sujet de la fonction énonciative de garant, voir notamment Maingueneau, 1999.
-
[36]
La modalisation déontique d’un énoncé montre une relation entre le locuteur et autrui, sous le mode de la permission, de l’obligation ou de l’interdiction. Voir à ce sujet Maingueneau, 1991 : 122 ; et Kerbrat-Orecchioni, 2006.
-
[37]
Parmi les nations qui ont pris part aux événements de Bagua, on retrouve des Achuar, des Asháninkas, des Machiguenga, des Arabela, des Witoto, des Awajún et des Quichuas… (Wiesse, 2009 ; et Montoya Rojas, 2009).
-
[38]
Extraits d’entrevues dans des communautés autochtones en Équateur. Au-delà d’un conflit particulier, ces entrevues concernent différents conflits locaux dont le dénominateur commun est l’opposition aux politiques de développement « extractif » ou intensif par des compagnies minières pétrolières ou forestières. Pour le détail de ces entrevues, voir Corten, 2012. Pour une analyse comparée, voir Longtin, 2012 et Peñafiel, 2013.
-
[39]
Comme l’exprime Pablo à Oaxaca : « Leader sans vergogne […] Ils l’ont attrapé, l’ont mis en prison quelques mois et, après, plus rien. Il se met à faire des affaires avec le gouvernement ». Notons que les « affaires » en question consistent à avoir négocié avec le gouvernement au nom du mouvement et à s’être fait élire député grâce au prestige acquis lors de l’action. De même, Rosita à Caracas : « Ils ne parlent que de leurs intérêts communs, de défendre leurs partis et non pas les droits de ceux qui en ont besoin. Ils sont tous pareils, rouges ou blancs… » ; ou encore en Équateur : « …quand ils [les dirigeants locaux] ont commencé à faire de la politique, le niveau [de mobilisation] a commencé à diminuer. »
-
[40]
Par exemple dans une communauté de l’Amazonie équatorienne : « Aujourd’hui, la direction sortante a dit qu’ils se rendent compte qu’ils ont causé un tort [d’avoir laissé entrer la compagnie pétrolière, en pensant que ça apporterait le progrès]. »
-
[41]
Signifiants vides qui peuvent être les nativos [autochtones], les travailleurs, les étudiants, les professeurs, les foragidos [hors-la-loi], les casseroles, les citoyens, etc. Étant négativement constitués, ces « signifiants » peuvent aussi être négatifs, comme la privatisation de l’eau ou du gaz en Bolivie, une loi spéciale (d’exception), une dérèglementation ou l’arrêt d’une subvention, etc.
-
[42]
Les cerros [collines] font référence ici, de manière métonymique, aux habitants des quartiers populaires qui ont déferlé en 1989 (Caracazo), mais aussi en 1992 (pour appuyer la tentative de coup d’État de Chávez) et en 2002 pour s’opposer au coup d’État contre le gouvernement chaviste.
-
[43]
L’analyse détaillée des deux derniers extraits se trouve dans Peñafiel, 2012a.
-
[44]
Comme pouvait le faire le mouvement Black ou féministe par rapport à la domination intersectionnelle des femmes noires des classes populaires.
Bibliographie
- Althusser, Louis, 1976, « Idéologie et appareils idéologiques d’État », dans Louis Althusser (sous la dir. de), Positions (1964-1975), Paris, Les Éditions sociales, p. 67-125.
- Arditi, Benjamin, 2008, « Arguments About the Left Turns in Latin America : A Post-Liberal Politics ? », Latin American Research Review, vol. 43, no 3, p. 59-81.
- Auyero, Javier, 2001, « Glocal Riots », International Sociology, vol. 16, no 1, p. 33-53.
- Auyero, Javier, 2002, « Fuego y barricadas. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática » [Feu et barricades. Récits de la belligérance populaire dans l’Argentine démocratique], Nueva Sociedad [Nouvelle société], no 179, p. 144-162.
- Auyero, Javier, 2003, « The Geography of Popular Contention : An Urban Protest in Argentina », Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, vol. 28, nos 55-56, p. 37-70.
- Beaucage, Pierre, Manuel de la Fuente et Jesus Carballo, 2012, « Langage commun et pluralité des voix. Perceptions et participation à des actions directes à Cochabamba et à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 119-144.
- Bertaux, Daniel, 2010, Le récit de vie. L’enquête et ses méthodes, Paris, Armand Colin.
- Bilge, Sirma, 2009, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, no 225, p. 70-88.
- Bonnafous, Simone et Malika Temmar (sous la dir. de), 2007, Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Paris, Ophrys.
- Bourdieu, Pierre, 1977, « Sur le pouvoir symbolique », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 32, no 3, p. 405-411.
- Bourdieu, Pierre, 1984, « La délégation et le fétichisme politique », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 52-53, p. 49-55.
- Bourdin Jean-Claude (sous la dir. de), 2008, Althusser, une lecture de Marx, Paris, Presses universitaires de France.
- Cameron, Maxwell A. et Eric Hershberg (sous la dir. de), 2010, Latin America’s Left Turns. Politics, Policies, and Trajectories of Change, Boulder, Lynne Rienner.
- Charaudeau, Patrick et Dominique Maingueneau (sous la dir. de), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil.
- Collins, Patricia H., 2000a [1990], Feminist Thought : Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York, Routledge.
- Collins, Patricia H., 2000b, « Gender, Black Feminism, and Black Political Economy », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, no 568, p. 41-53.
- Coronil, Fernando et Julie Skurski, 2006, « Dismembering and Remembering the Nation : The Semantics of Political Violence in Venezuela », dans Fernando Coronil et Julie Skurski (sous la dir. de), States of Violence, Ann Arbor, University of Michigan Press, p. 83-151.
- Corten, André, 2012, « Équateur : actions directes à courant et à contre-courant », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 67-92.
- Corten, André, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), 2012, L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/ Presses de l’Université du Québec.
- Crenshaw, Kimberle W., 1989, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : a Black Feminist Critique of Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Practice », University of Chicago Legal Forum, p. 139-167.
- Crenshaw, Kimberle W., 1991, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, no 6, p. 1241-1299.
- Crenshaw, Kimberle W., 2005 [1991], « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, vol. 2, no 39, p. 51-82.
- Dabène, Olivier, Vincent Geisser et Gilles Massardier (sous la dir. de), 2008, Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires au XXIe siècle. Convergences Nord-Sud, Paris, La Découverte.
- Davis, Katy, 2008, « Intersectionality as Buzzword : A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful », FeministTheory, vol. 9, no 1, p. 67-85.
- Escobar, Arturo, Sonia E. Álvarez et Evelina Dagnino, 2001, Política cultural y cultura política : una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos [Politique et culture : un nouveau regard sur les mouvements sociaux latino-américains], Bogota, Taurus, ICANH [Institut colombien d’anthropologie et d’histoire].
- Fairclough, Normand, 1992, Discourse and Social Change, Cambridge, Polity Press.
- Farmer, Paul, 2003, Pathologies of Power, Berkeley, University of California Press.
- Foucault, Michel, 1969, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
- Fraser, Nancy et Axel Honneth, 2003, Redistribution or Recognition ? A Political-Philosophical Debate, Londres et New York, Verso.
- Garretón, Manuel Antonio, 2002, « La transformación de la acción colectiva en América Latina » [La transformation de l’action collective en Amérique latine], Revista de la CEPAL [Revue de la Commission économique pour l’Amérique latine], no 76, p. 7-24
- Gills, Barry et Joel Rocamora, 1992, « Low Intensity Democracy », Third World Quarterly, vol. 13, no 3, p. 501-523.
- Giménez Micó, José Antonio, 2012, « Bagua (Pérou, 2009). Des ‘victimes’ résolues à ne plus l’être », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 223-239.
- Goirand, Camille, 2010, « Mobilisations et répertoires d’action collective en Amérique latine », Revue internationale de politique comparée, vol. 17, no 2, p. 7-27.
- Hall, Stuart, 2010, Sin garantías : Trayectorias y problemáticas en estudios culturales [Sans garantie : trajectoires et problématiques dans les études culturelles], Popayán (Colombie), Envión.
- Honneth, Axel, 2000, La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf.
- Honneth, Axel, 2006, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La Découverte.
- Huart, Catherine, 2012, « L’irreprésentable plèbe. Le cas des batailles de l’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (Mexique) », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 185-204.
- Joignant, Alfredo, 2007, « Compétence politique et bricolage. Les formes profanes du rapport au politique », Revue française de science politique, vol. 57, no 6, p. 799-817.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine, 2006, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin.
- Knapp, Gudrun-Axeli, 2005, « Race, Class, Gender : Reclaiming Baggage in Fast Travelling Theories », European Journal of Women’s Studies, vol. 12, no 3, p. 249-265.
- Labov, William, 1993 [1978], Le parler ordinaire. La langue dans les ghettos noirs des États-Unis, Paris, Minuit.
- Laclau, Ernesto, 2000, « De l’importance des signifiants vides en politique », La guerre des identités, grammaire de l’émancipation, Paris, La Découverte/MAUSS [Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales], p. 93-105.
- Laclau, Ernesto et Chantal Mouffe, 1985, Hegemony and Socialist Strategy, Towards a Radical Democratic Politics, Londres, Verso.
- Longtin, David, 2012, « Actions directes en Amérique latine. Entre violence et solidarité (Pérou, Mexique, Équateur) », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 257-295.
- Luxembourg, Rosa, 1969 [1906], Oeuvre I. Grève de masse, parti et syndicats, Paris, Maspero.
- Magendzo, Abraham, 1997, « La reconnaissance de l’autre, condition essentielle de la citoyenneté moderne et de l’éducation aux droits humains », Revue des sciences de l’éducation, vol. 23, no 1, p. 133-143.
- Maingueneau, Dominique, 1984, Genèses du discours, Liège, Mardaga.
- Maingueneau, Dominique, 1991, L’analyse du discours : Introduction aux lectures de l’archive, Paris, Hachette.
- Maingueneau, Dominique, 1999, « Ethos, scénographie et incorporation », dans Ruth Amossy (sous la dir. de), Images de soi dans le discours, La construction de l’éthos, Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. 75-100.
- Mazière, Francine, 2005, L’analyse du discours, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? ».
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow et Charles Tilly, 2001, Dynamics of Contention, Cambridge, Cambridge University Press.
- Montoya Rojas, Rodrigo, 2009, Con los rostros pintados. Tercera rebelión Amazónica en Perú (agosto 2008-junio 2009) [Avec les visages peints. Troisième rébellion amazonienne au Pérou (août 2008-juin 2009)], consulté sur Internet (http://ibcperu.org/doc/isis/10938.pdf ) le 14 avril 2014.
- Moulian, Tomás, 1997, Chile actual : Anatomía de un mito [Chili actuel : Anatomie d’un mythe], Santiago, ARCIS [Université des arts et sciences sociales].
- Oxhorn, Philip, 2011, Sustaining Civil Society : Economic Change, Democracy and the Social Construction of Citizenship in Latin America, University Park, The Pennsylvania State University Press.
- Paramio, Ludolfo, 2002, « La crisis de la política en América latina » [La crise de la politique en Amérique latine], América Latina Hoy [L’Amérique latine aujourd’hui], no 32, p. 15-28.
- Paveau, Marie-Anne, 2010, « Interdiscours et intertexte. Généalogie scientifique d’une paire de faux jumeaux », dans Driss Ablali et Margareta Kastberg Sjöblom (sous la dir. de), Linguistique et littérature : Cluny, 40 ans après, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 93-105.
- Peñafiel, Ricardo, 2008, « Le rôle politique des imaginaires sociaux. Quelques enjeux théoriques autour de leur conceptualisation », Politique et sociétés, vol. 27, no 1, 2008, p. 99-128.
- Peñafiel, Ricardo, 2012a, « Venezuela. L’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de l’action contingente de la plèbe par le discours sur le ‘protagonisme populaire’ », dans André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel (sous la dir. de), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/Presses de l’Université du Québec, p. 93-118.
- Peñafiel, Ricardo, 2012b, « Luttes sociales et subjectivations politiques en Amérique latine : Expropriations, récupérations et réinventions des savoirs sur ‘soi’ », Mouvements, no 72, p. 69-78.
- Peñafiel, Ricardo, 2012c, « Le ‘printemps chilien’ et la radicalisation de l’action collective contestataire en Amérique latine », Lien social et Politiques, no 68, p. 121-140.
- Peñafiel, Ricardo, 2012d, « Expression publique de la souffrance, excès de sens et remise en question de l’inacceptable », Cahiers des imaginaires, no 10, p. 55-85.
- Peñafiel, Ricardo, 2013, « Les pensées politiques en tant que discours », dans Dalie Giroux et Dimitri Karmis (sous la dir. de), Ceci n’est pas une idée politique : Réflexions sur les approches à l’étude des idées politiques, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 181-200.
- Peñafiel, Ricardo, 2014 [à paraître], « Les mouvements étudiants des Amériques et la transgression des limites autoritaires de la représentation politique (Chili, Colombie, Québec, Mexique) », dans Florence Piron (sous la dir. de), Le patrimoine collectif de la démocratie participative, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Polletta, Francesca, 2006, It Was Like a Fever : Storytelling in Protest and Politics, Chicago et Londres, The University of Chicago Press.
- Rancière Jacques, 1995, La Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée.
- Rennes, Juliette, 2011, « Les formes de la contestation. Sociologie des mobilisations et théories de l’argumentation », A contrario, no 16, p. 151-173.
- Ricoeur, Paul, 1977, La sémantique de l’action, Paris, Éditions du CNRS [Centre national de la recherche scientifique].
- Robertson, Roland, 1995, « Glocalization : Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity », dans Mike Featherstone, Scott Lash et Roland Robertson (sous la dir. de), Global Modernities, Londres, Sage, p. 25-44.
- Saïd, Edward, 1983, « Traveling Theory », dans Edward Saïd (sous la dir. de), The World, the Text, and the Critic, Cambridge (MA), Harvard University Press, p. 226-247.
- Sarfati, George-Élia, 2005, Éléments d’analyse du discours, Paris, Armand Colin.
- Saussure (de), Ferdinand, 1982 [1915], Cours de linguistique générale, Paris, Payot.
- Seoane, José, 2006, « Movimientos sociales y recursos naturales en América latina. Resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas » [Mouvements sociaux et ressources naturelles en Amérique latine. Résistances au néolibéralisme, configuration de solutions de rechange], Sociedade e Estado [Société et État], vol. 21, no 1, p. 85-107.
- Seoane, José, Emilio Taddei et Clara Algranati, 2006, « Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina » [Les nouvelles configurations des mouvements sociaux populaires en Amérique latine], dans Atilio A. Boron et Gladys Lechini (sous la dir. de), Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina [Politique et mouvements sociaux dans un monde hégémonique. Leçons d’Afrique d’Asie et d’Amérique latine], Buenos Aires, CLACSO [Conseil latino-américain de sciences sociales], p. 227-250.
- Simmel, Georg, 1998 [1908], Les pauvres, Paris, Presses universitaires de France.
- Staunaes, Dorthe, 2003, « Where Have All the Subjects Gone ? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and Subjectification », NORA. Nordic Journal of Women’s Studies, vol. 11, no 2, p. 101-110.
- Tel Quel, 1968, Théorie d’ensemble, Paris, Seuil.
- Tilly, Charles, 1986, La France conteste : de 1600 à nos jours, Paris, Fayard.
- Tilly, Charles, 2010, « Décrire, mesurer et expliquer le conflit », Revue internationale de politique comparée, vol. 17, no 2, p. 187-205.
- Todorov, Tzvetan, 1981, Mikhaïl Bakhtine : Le principe dialogique, Paris, Seuil.
- Van Dijk, Teun A., 1985, Handbook of Discourse Analysis (4 vol.), Londres, Academic Press.
- Walton, John et David Seddon (sous la dir. de), 1994, Free Markets and Food Riots : The Politics of Global Adjustment, Oxford, Blackwell.
- Weber, Lynn, 1998, « A Conceptual Framework for Understanding Race, Class, Gender, and Sexuality », Psychology of Women Quarterly, vol. 22 no 1, p. 13-32.
- Wickham-Crowley, Timothy et Susan Eckstein, 2010, « Économie et sociologie politiques du militantisme et des répertoires des mouvements sociaux récents en Amérique latine », Revue internationale de politique comparée, vol. 17, no 2, p. 29-52.
- Wiesse, Patricia, 2009, « El rugido de la serpiente de agua » [Le rugissement du serpent des eaux], Ideele, Revista del Instituto de Defensa Legal (Lima) [Revue de l’Institut de défense légale], nº 194, consulté sur Internet (http://www.elbuho.com.pe/anteriores/web377/politica9.htm) le 24 avril 2014.
- Winter, Bronwyn, 1997, « L’essentialisation de l’altérité et l’invisibilisation de l’oppression : l’histoire bizarre mais vraie de la déformation d’un concept », Nouvelles questions féministes, vol. 20, no 4, p. 75-102.
- Wodak, Ruth et Michael Meyer, 2001, Methods of Critical Discourse Analysis, Londres, Sage.
- Yuval-Davis, Nira, 1997, Gender and Nation, Londres, Sage.
- Yuval-Davis, Nira, 2006, « Intersectionality and Feminist Politics », European Journal of Women’s Studies, vol. 13, no 3, p. 193-209.

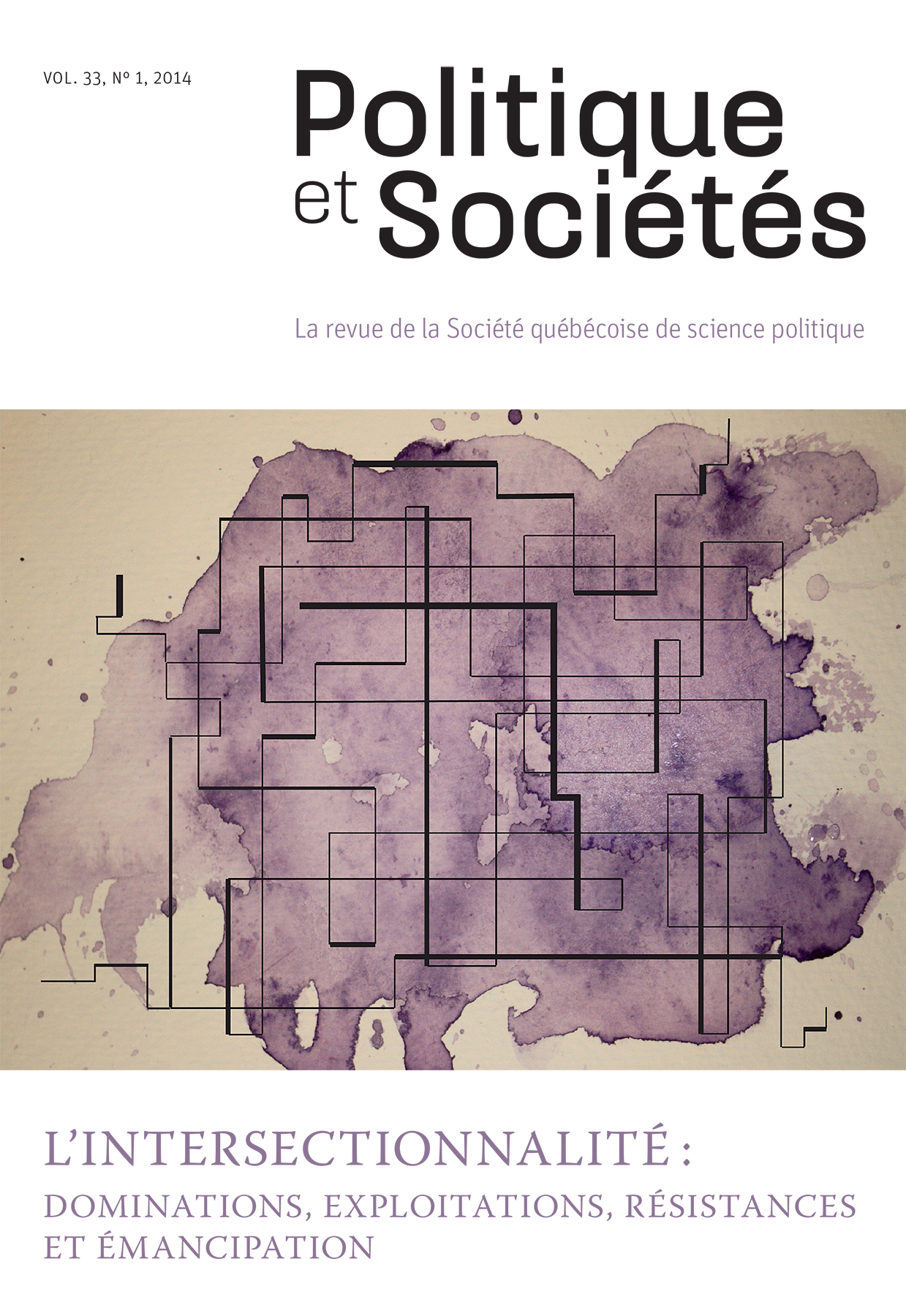
 10.7202/031908ar
10.7202/031908ar