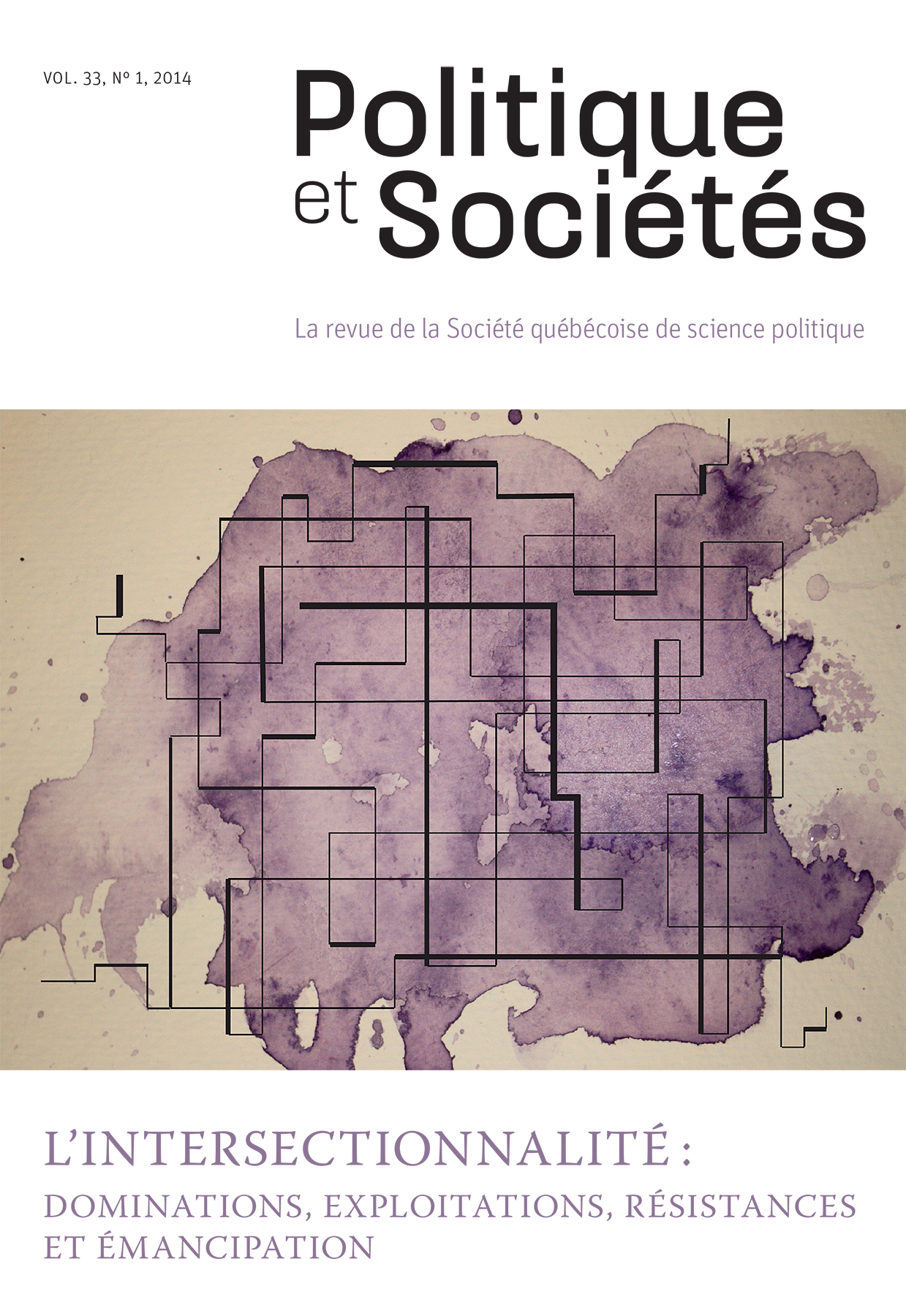Résumés
Résumé
En prenant appui sur les théories de l’intersectionnalité et postcoloniales, cet article se propose d’explorer les nouvelles grammaires de l’injustice sociale lorsqu’on prend au sérieux le caractère coextensif du capitalisme, du sexisme et du racisme conçus comme systèmes sociaux globaux et de dégager la signification des luttes sociales qui se développent contre ces injustices. Dans la première partie, en prenant appui sur les analyses de Young concernant les diverses facettes de l’injustice et sur celles de Renault qui propose une problématisation théorique de l’injustice, il est fait mention des procédés de domination/assujettissement qui confortent ces injustices. La deuxième partie s’appuie sur la notion de subjectivation politique développée par Rancière pour soutenir que les mouvements de luttes contre l’injustice ne peuvent se réduire à des mouvements identitaires, même s’ils sont susceptibles de recourir à ce que Spivak qualifie « d’essentialisme stratégique », et relèvent plutôt d’une volonté de rendre le monde véritablement commun. C’est d’ailleurs ce qui explique le recours au langage des droits pour construire ce monde commun en tentant d’échapper aux logiques de la domination.
Abstract
Building on intersectionality and postcolonial theories, this paper attempts to develop a vision of social injustices that takes into account the intersection of comprehensive social systems such as capitalism, sexism and racism and to characterize social struggles against those injustices. The first part, bringing together Young’s analysis of the various faces of injustice and Renault’s theoretical investigation of injustice in contemporary societies, seeks ways to evaluate processes of domination that reinforce those injustices. The second part, using Rancière’s idea of political subjectivation, argues that social movements struggling against those injustices cannot be labeled merely as identity politics, even if they can develop some kind of “strategic essentialism.” This research views them rather as ways to make the world truly common, that is, shared by everyone on the basis of equality. In conclusion, the article highlights the potential of appealing to rights in building this common world and trying to avoid dominations.
Corps de l’article
Il est de mise, dans les réflexions postcoloniales, de faire une opposition entre hégémonie et subalternes (Spivak, 1988 ; Bhabha, 1994). Cela permet de rendre visibles les rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés. L’intersectionnalité, et plus encore la perspective postcoloniale, permet de saisir la conjoncture politique à partir d’une double compréhension : d’abord, nous vivons dans des sociétés structurées par des rapports de classe, de sexe et de race ; ensuite, ces rapports ne sont pas que sectoriels mais constituent des systèmes sociaux globaux qui se renforcent le plus souvent et sont d’une certaine manière co-constitués (Dorlin, 2009). Reste maintenant à en déterminer les conséquences sur le plan politique.
Parler de systèmes globaux, c’est parler de systèmes qui structurent plusieurs aspects de la vie sociale. Dans ce sens, il est possible de soutenir que le capitalisme, le sexisme et le racisme sont des systèmes globaux de domination qui affectent l’ensemble des domaines de la vie sociale. Que doit-on voir là-dedans ? D’abord et avant tout que le capitalisme ne se limite pas à l’économie (surtout à l’ère néolibérale où l’on assiste à un processus d’« économicisation » du monde), que le sexisme est loin de se limiter à la famille et à la sexualité et que le racisme n’est pas uniquement une affaire de culture ou d’idéologie.
Parler de systèmes non réductibles les uns aux autres, c’est refuser de se laisser enfermer dans la logique des contradictions principales et secondaires. Comprendre la configuration concrète des rapports de pouvoir, c’est analyser la position (et les dynamiques de conflictualité sociale) des divers acteurs sociaux dans chacun de ces rapports, mais aussi les dynamiques contradictoires qui peuvent exister entre ceux-ci. C’est surtout éviter de se dédouaner de sa posture dominante dans certains rapports de pouvoir en invoquant sa position dominée dans d’autres. C’est également saisir qu’il y a (fort heureusement !) peu de situations de domination totale, ce qui laisse aux divers sujets sociaux une marge d’agentivité à partir de laquelle contester les rapports de pouvoir.
Enfin, parler de systèmes imbriqués, c’est prendre acte du fait que, même s’ils sont non réductibles les uns aux autres, ces divers systèmes de domination sont à l’oeuvre dans le même espace social et configurent simultanément chacun des sujets sociaux. Cela ne veut pas dire qu’ils soient toujours convergents, mais ils sont toujours en interaction et ce sont leurs effets inégaux et combinés dont il importe de tenir compte pour comprendre les dynamiques et les conflictualités sociales.
Évidemment, nous avons affaire à des catégories sociales qui sont toutes construites. Pas plus le sexe que la race ou la classe ne relèvent de la naturalité humaine, mais constituent des rapports sociaux. Si l’on se situe sur un plan politique, c’est-à-dire si l’on tient compte non pas des places occupées par les unes et les autres dans la gestion du social, ce qui relève de la « police » (Rancière, 1995) ou de la gouvernementalité (Foucault, 2004), ce qu’on voit émerger à l’intersection de ces rapports sociaux, ce sont des zones de conflictualité sociale qui dessinent une grammaire de l’injustice (Renault, 2004 ; Honneth, 2006) et qui permettent l’émergence de nouvelles subjectivités politiques qui ne constituent pas de nouvelles identités sociales, mais se construisent dans la contestation même du processus d’assignation des places et des catégorisations dans la société (Rancière, 1998) et instituent de ce fait une dissonance dans l’assignation identitaire.
Dans cette perspective, je me propose de centrer ma réflexion sur deux aspects : les nouvelles grammaires de l’injustice sociale qui apparaissent lorsqu’on prend au sérieux la coextensivité (Kergoat, 2009) des rapports de classe, de sexe et de race, dans un premier temps, et la contestation de l’assignation sociale que recèlent les luttes contre l’injustice, dans un deuxième temps. Je conclurai par quelques considérations sur le rôle des droits humains dans une tentative de reproblématisation des rapports de pouvoir.
Grammaire des luttes contre l’injustice et la souffrance sociale
Dans cette première partie, je voudrais traiter à la fois des formes que prend l’injustice dans les sociétés contemporaines et des résistances que cette injustice suscite. On peut, grosso modo, identifier cinq grandes formes, qui se recoupent souvent mais qu’il importe de distinguer, à tout le moins sur un plan heuristique, de l’injustice : l’exploitation, la marginalisation, l’impuissance, l’impérialisme culturel et la violence (Young, 1990).
L’exploitation est certainement la notion la plus facile à saisir. Le marxisme nous a donné une analyse du salariat comme système d’exploitation fondé sur une égalité formelle des parties contractantes qui masque un processus d’extorsion de la plus-value lié à la nature même du rapport salarial. Mais l’exploitation prend également d’autres formes que le salariat, par exemple quand, au nom de l’amour (Vandelac, 1985), on force les femmes au travail domestique qui ne comprend pas que le ménage et les repas mais inclut aussi le soutien affectif, les services sexuels, les soins à diverses catégories de personnes (autant les personnes dépendantes en raison de leur âge, de leur handicap physique ou mental, d’une maladie, qu’aux hommes parfaitement valides) (Delphy, 2001).
La marginalisation prend plusieurs formes également. Dans notre ère qui valorise la performance et l’efficience, des pans entiers de la société deviennent « superflus » en regard de l’insertion dans l’économie formelle du salariat (Castel, 1995). Ces groupes marginalisés comportent très souvent des dimensions raciales comme les populations afro-descendantes aux États-Unis, les populations postcoloniales en Grande-Bretagne et en France, les Roms en Europe, les populations autochtones dans l’ensemble des Amériques. La marginalisation les condamne souvent à la pauvreté et à l’illégalité et les expose à diverses formes de violence pouvant aller jusqu’à l’extermination.
L’impuissance est l’expérience d’un nombre croissant de personnes, y compris dans les sociétés formellement démocratiques qui ont tendance à réduire la démocratie à la tenue régulière d’élections compétitives. C’est l’impression d’être sans voix face aux décisions qui nous concernent. Malgré l’injonction néolibérale à être « l’entrepreneur de soi-même », soit à se fabriquer comme on fabriquerait un objet (Ehrenberg, 1998, 2008 ; Dardot et Laval, 2009), l’expérience concrète des « 99 % » c’est l’impuissance, que ce soit par rapport au pouvoir politique, au milieu de travail ou au style de vie de plus en plus dicté par le consumérisme. Cette impuissance donne l’impression de ne plus avoir de contrôle sur sa propre existence et encore moins sur le monde dans lequel on évolue.
L’impérialisme culturel est loin de se réduire à l’hégémonie étasunienne sur la « culture mondialisée ». C’est l’expérience de ne pas avoir d’histoire ni d’existence parce que notre marginalisation tend à nous écarter de toute possibilité narrative et rend inaudible aux oreilles des groupes dominants le récit de notre expérience. « Pas d’histoire les femmes », disait-on à une certaine époque, et on pourrait dire la même chose des Autochtones ou de la classe ouvrière. Gloria Anzaldua et Cherrie Moraga (1981) ont parlé de l’effacement de l’expérience des Chicanos et surtout des Chicanas aux États-Unis. Les mouvements d’égalité civique et les féministes noires (hooks, 1984 ; Hill Collins, 1991) ont mis en évidence le processus de survisibilisation/invisibilisation des populations noires aux États-Unis. Cet impérialisme culturel donne le sentiment de vivre simultanément dans deux mondes et de n’être pleinement soi nulle part. Il peut aussi revêtir l’aspect du mépris (Honneth, 2006) : dévalorisation de certaines catégories sociales, de minorités ethniques, religieuses, culturelles ou sexuelles.
Quant à la violence, elle est omniprésente. Forces répressives qui sont souvent les seules institutions étatiques présentes dans certaines zones. C’est aussi cette guerre d’usure de tous les jours, moins spectaculaire, que représentent les violences sexistes et racistes au quotidien, des petites remarques anodines et perfides à la violence masculine envers les femmes ou au viol, aux ratonnades diverses ou aux meurtres haineux d’homosexuels ou encore au viol collectif de lesbiennes pour les remettre dans le droit chemin de l’hétérosexualité. C’est en outre la criminalisation de la contestation politique, y compris dans les pays de vieille tradition démocratique ou même les arrestations de masse préventives.
Ces injustices ne sont pas toujours le résultat d’un dysfonctionnement social ; le plus souvent, elles relèvent du fonctionnement même des institutions sociales. Comme le précise Emmanuel Renault, « les expériences de l’injustice ne doivent pas être comprises comme les lésions de présuppositions normatives de la vie sociale que comme la non-satisfaction d’attentes normatives fondamentales » (2004 : 55). C’est pourquoi la lutte contre l’injustice peut prendre autant la forme d’extension à des catégories sociales auxquelles ils sont déniés de principes normatifs (le droit de vote qui s’universalise, par exemple) que d’une refonte des institutions sociales pour qu’elles puissent s’ouvrir à des réalités et des savoirs qu’elles négligent, par exemple la dénonciation féministe de la démocratie libérale comme « fratriarchie » (Pateman 1988).
Si je me situe globalement dans la même perspective que Renault lorsqu’il parle des expériences de l’injustice, je m’en sépare partiellement lorsqu’il souligne que les luttes contre l’injustice sont essentiellement portées par des mouvements identitaires. Il me semble que le travail des groupes sociaux constitués par l’existence d’injustices sociales est plus complexe, comme je le montrerai dans la prochaine section. À ce stade de mon analyse, il me semble qu’il faille plutôt mettre l’accent sur le tort qui sert de révélateur à l’injustice et sur le savoir qui en émerge et qui permet d’articuler autrement notre compréhension du social et de subvertir le cadre normatif dominant (Renault, 2004 : 29).
L’existence de telles injustices sociales engendre non seulement des inégalités sociales, mais également un monde où prévalent des dynamiques de domination et d’assujettissement. Même si les systèmes de domination sont distincts, il n’en reste pas moins que trois grands procédés sont perceptibles dans la dynamique de construction de l’hégémonie et des subalternes (Delphy, 2008) : l’altérisation, la naturalisation et la hiérarchisation. Ces procédés constituent en eux-mêmes une technologie du pouvoir.
L’altérisation consiste à transformer tous les subalternes en « autres » par rapport à une norme qui n’a pas à se définir puisqu’elle sert de référence. Ce procédé met en demeure les subalternes de se définir, d’expliquer qui ils/elles sont (Spivak, 1988). Ce processus de définition de soi sert ensuite à enfermer les subalternes dans un particularisme et à taxer les mouvements de subalternes de « politiques identitaires ». Ce processus d’altérisation a bien été mis en lumière par Simone de Beauvoir (1949), puis par les féministes radicales en ce qui concerne les femmes (Mathieu, 1991 ; Guillaumin, 1992 ; Delphy, 2001). Les analyses de Colette Guillaumin (1972) sur la racialisation vont également dans le même sens.
La naturalisation dépend largement de l’altérisation. Elle correspond à deux démarches. Premièrement, il s’agit de fixer les traits identitaires liés à l’altérisation pour les transformer en « nature ». Les analyses de Guillaumin ([1978] repris dans 1992) sur le « sexage » sont assez éloquentes. On peut aussi mentionner celles des féministes noires étasuniennes comme Patricia Hill Collins (1991) ou bell hooks (1984). Deuxièmement, cette nature, conformément au particularisme qui accompagne l’altérisation, n’est pas considérée comme pleinement humaine, ce qui fait qu’elle sert à disqualifier des droits humains puisque l’humanité des personnes altérisées est usuellement perçue sous la forme du défaut, du manque ou de l’incomplétude.
Enfin, le processus n’est pas un processus égalitaire, mais hiérarchique. Les identités assignées aux subalternes sont porteuses de stigmates plus ou moins importants que plusieurs ont associés à la méconnaissance ou à l’absence de reconnaissance (Fraser et Honneth, 2003), mais aussi, l’assignation identitaire est un processus de catégorisation hiérarchique (Foucault, 2004). Classer, c’est confirmer les « autres » dans la position subalterne et dominée et conforter une posture de domination.
Soulignons par ailleurs que ces processus induisent une division parmi les subalternes, division qui sert évidemment les groupes dominants dans les divers rapports de pouvoir. Il n’existe de solidarité mécanique ni entre les personnes dominées d’un même groupe ni entre les divers groupes soumis à une forme ou l’autre de domination (Collin, 1983 ; Dean, 1996 ; Young, 1997). De plus, faire l’expérience de la domination dans un des systèmes de pouvoir n’empêche pas que dans d’autres rapports de pouvoir on puisse se retrouver en position dominante.
Luttes contre l’injustice et émergence de nouvelles subjectivations politiques
C’est en regard d’une telle compréhension de l’injustice qu’il importe d’examiner les luttes sociales qui se sont développées pour y résister que l’on a un peu trop hâtivement qualifiées de luttes pour la reconnaissance au point que bon nombre d’analystes politiques aient pu craindre qu’elles ne remplacent les luttes pour la redistribution qui avaient dominé le paysage des luttes sociales à l’ère de l’État providence (Fraser, 1997, 2005 ; Fraser et Honneth, 2003). Il me semblerait plus exact d’interpréter les diverses luttes émancipatrices (femmes, colonisées, minorités ethnoculturelles ou racisées, sexualités, etc.) qui se sont développées dans la période récente comme des luttes pour la justice et pour une autre distribution non seulement de la richesse, mais également du pouvoir. Leur fonction est donc de faire reconnaître le tort, l’injustice, et pas nécessairement le groupe social victime de ce tort. Pour ce faire, comme les dynamiques sociales ne sont pas des processus sans sujets concrets, il est souvent nécessaire que ces groupes se constituent politiquement.
Car ces luttes sociales contre la domination se sont situées à la fois sur le terrain de la reconnaissance et sur celui de la redistribution des « parts sociales », pour emprunter l’expression de Jacques Rancière qui parle de transformation « des identités définies dans l’ordre naturel de la répartition des fonctions et des places en instances d’expérience d’un litige » (1995 : 60). Ce qui revient à dire que ces pratiques émancipatoires partent de l’expérience de rapports de domination et de l’existence de groupes situés en position subalterne dans ces rapports de domination ; dans le processus de contestation de la domination, les groupes dominés sont engagés à la fois dans une démarche de mise en évidence de la domination, de « positivation » des subalternes et de recomposition plus égalitaire des rapports sociaux.
Cela dépasse largement la simple reconnaissance, puisqu’on est loin de la reproduction à l’identique d’une identité préexistante ou de la greffe d’une dimension politique sur une identité sociologique.
Le processus de l’émancipation est la vérification de l’égalité de n’importe quel être parlant avec n’importe quel autre. Il est toujours mis en oeuvre au nom de la catégorie à laquelle on dénie le principe de cette égalité ou sa conséquence – travailleurs, femmes, noirs ou autres. Mais la mise en oeuvre de l’égalité n’est pas pour autant la manifestation du propre ou des attributs de la catégorie en question.
Rancière, 1998 : 85
Il s’agit donc d’une reformulation substantielle de la nature du « groupe », puisque son identité est elle-même tributaire d’un rapport de pouvoir et de la lutte contre ce rapport. La possibilité de déprise des personnes qui le composent de l’assignation identitaire qui leur est imposée implique de la réinvestir pour pouvoir en contester les termes et s’affirmer comme sujets politiques. C’est ce qui explique, selon Françoise Collin, que les membres des groupes opprimés sont « souvent les derniers croyants de l’humanisme identitaire, les derniers croyants de la libération de soi avec soi […] Il faut lutter contre l’assujettissement sans nourrir le mythe du sujet » (1992 : 134-135).
Ainsi, la reconnaissance n’est pas l’enjeu de la subjectivation politique, mais un de ses moyens. Il ne s’agit pas tant de faire reconnaître une identité que d’acquérir une « autorisation de parole » sur le monde commun pour des personnes et des groupes qui avaient été refoulés aux marges de ce monde commun ou qui en étaient devenus les objets en raison des politiques publiques[1]. Ce qui est en jeu, ce n’est pas une « identité » plus ou moins « authentique », mais sa capacité de parler et d’être écouté sur le sort du monde, bref, d’énoncer un tort et de tenter d’y trouver une solution à partir d’une perspective de responsabilité pour le monde (Arendt, 2009).
C’est pourquoi, au lieu de produire de l’identité, l’émancipation engendre de la pluralité, ce qui amène Rancière à définir la logique de l’émancipation comme hétérologie. La victime d’un tort est le nom de l’anonyme, de n’importe qui, et « [q]uand des groupes victimes d’une injustice entrent dans le traitement d’un tort, ils se réfèrent à l’humanité et à ses droits » (1998 : 86). Cette production de la pluralité par la subjectivation politique prend trois formes principalement : d’abord, le refus d’une assignation identitaire ; ensuite, la démonstration d’un tort qui présuppose un « autre » auquel on s’adresse et un lieu commun polémique pour signifier le tort ; enfin, une identification impossible, qui peut parfois prendre des formes ironiques ou manifestement contrefactuelles, comme le « nous sommes tous des étudiants », titre du Manifeste des profs contre la hausse[2].
Le refus de l’assignation identitaire, comme la parole de cette femme qui refusait de se laisser enfermer dans le rôle de « b.s.[3] », se vit d’abord sur le plan individuel, mais demande également une mobilisation collective pour construire le rapport de force permettant de transformer la situation. Ainsi, pour lutter contre la pauvreté, il faut que des « pauvres » se mobilisent et, par le geste même de leur mobilisation, refusent la situation qui est faite aux « pauvres » dans notre société, situation de disqualification sociale et politique, comme en témoignent les pouvoirs exorbitants de l’administration à leur encontre. Ce faisant, les « pauvres » dérogent à leur rôle social qui est celui de subir en silence, en échange d’une « aumône » privée ou publique de plus en plus aléatoire, mais qui ne leur permet jamais de sortir de la situation sociale de pauvreté.
Il faut ensuite signifier le tort, c’est-à-dire montrer d’abord que la pauvreté n’est pas un « état » ou une « condition », mais le produit d’une certaine organisation sociale qui distribue très inégalement richesses et emplois (Simmel, 1998). Il est en outre essentiel de montrer que cette organisation sociale n’a rien d’inéluctable et qu’elle résulte d’une construction sociale qui, tout comme elle a été construite socialement, est susceptible de déconstruction sociale. D’où la revendication, par exemple, d’un « Québec sans pauvreté ».
Enfin, il s’agit de créer une identification improbable (b.s. = citoyenne siégeant dans un parlement, même « de la rue »), ce qui montre clairement que ce qui est revendiqué, ce n’est pas un « privilège » pour les personnes marginalisées, mais le fait d’être soumises au régime commun dans lequel toutes et tous jouissent de la citoyenneté et, partant, du droit de se prononcer sur les affaires publiques. Ainsi, il y a une forme de déprise identitaire, un refus des luttes « en silo » et d’intégration dans la logique de compétition entre les intérêts catégoriels qu’est devenu le politique pour se situer d’emblée sur le terrain de l’intérêt public. « Un sujet politique, ce n’est pas un groupe qui ‘prend conscience’ de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société. C’est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration de l’expérience donnée. » (Rancière, 1995 : 65)
Il serait donc fallacieux d’y voir essentiellement une source de fragmentation et de perte de sens commun ; il y aurait plutôt lieu d’y voir « une manière d’introduire la politique par de la différence » (Brugère, 2012 : 100). La difficulté de faire accepter comme allant de soi des identités englobantes ne relève pas d’un glissement du politique vers l’éthique, mais de nouvelles exigences d’inclusion sociale qui essaient d’éviter les pièges de la domination et de l’oppression et qui postulent que « l’auto-anéantissement constitue une condition déraisonnable et injuste de la citoyenneté » (Young, 1990 : 179 [traduction libre]). En outre, l’apparence de fragmentation sociale qui semble résulter de la diffusion de la « reconnaissance » n’est pas un état permanent, mais peut aussi constituer une étape essentielle vers une inclusion plus égalitaire.
Pour ce faire, il est essentiel de rompre avec l’idée que les groupes sociaux formeraient des identités sociales ou politiques de type essentialiste. Il faut plutôt entendre ces identités sociales comme un processus mouvant et surtout comme un rapport social. L’argument le plus souvent amené pour discréditer l’action politique de ces groupes dits « identitaires », c’est qu’ils seraient porteurs de revendications « spécifiques » plutôt que d’un projet valant pour l’ensemble de la société. En fait, « la multiplicité des catégories masque les rapports sociaux » (Kergoat, 2009 : 117).
Ainsi, il y a un acte de pouvoir inhérent au fait de catégoriser certaines revendications comme « spécifiques » alors que d’autres sont d’emblée reconnues comme génériques. Car une conséquence usuelle du privilège social, c’est la capacité d’un groupe de transformer sa propre perspective en savoir faisant autorité (Hill Collins, 1991) sans pouvoir être contredit par ceux et celles qui ont des raisons de voir les choses différemment. Une telle dynamique contribue de façon majeure à ce que l’inégalité politique reproduise l’inégalité sociale et économique, y compris dans des processus formellement démocratiques (Young, 2000 : 108).
L’agir politique nécessite donc de se départir du mépris (Honneth, 2006) qui condamne certains – et surtout certaines – à mener une vie qui peut soit être jugée indigne d’être vécue et, par conséquent, exposer leur titulaire à toutes sortes d’exactions pouvant aller jusqu’à leur anéantissement pur et simple, soit être assortie d’humiliations telles qu’elles ne correspond pas aux critères minimaux de la dignité humaine. C’est ainsi que Judith Butler souligne la tendance à priver certaines vies de visage, au sens lévinasien du terme, ce qui « nous autorise à devenir insensibles face à ces vies que nous avons annihilées et dont le droit au deuil est constamment reporté » (2005 : 21), disait-elle en faisant référence à ces morts déshumanisées sous le vocable de « dommages collatéraux » durant les guerres d’Afghanistan et d’Irak.
Pour lutter contre ce mépris, surtout s’il est institué politiquement et socialement, il ne suffit pas, comme le faisait remarquer Hannah Arendt (2002) dans son analyse de la crise des droits humains, de proclamer son humanité et de valoriser sa zoê ou encore d’affirmer, comme c’était le cas des Noirs lors du mouvement des droits civiques aux États-Unis, « I am a man », il faut également disposer des moyens politiques de faire reconnaître son existence comme digne d’être vécue et par conséquent de pouvoir nommer les injustices qui en font l’indignité et obtenir des formes de réparation. Il faut par ailleurs penser en termes d’action politique dont la caractéristique est de partir du « refus de certaines situations sociales » pour ensuite se développer « dans une lutte contre les groupes sociaux intéressés à la préservation d’une telle situation » tout en visant « une situation sociale plus égalitaire » (Renault, 2004 : 46).
La perspective dans laquelle je me situe est celle de la construction de solidarités et de luttes contre les divers visages de la domination, « une vraie mobilisation des subjectivités contre un universel qui fonctionne par décret, ne sait inclure qu’en domestiquant et en subordonnant les mouvements sociaux » (Brugère, 2012 : 101). L’existence de ces solidarités nécessite des capacités d’altération qui découlent d’une véritable ouverture aux différences et de déplacement des positions et des localisations. « Il ne s’agit pas de postuler l’absence de place, mais de se livrer au déplacement. Il ne s’agit pas de dénier la réalité d’un chez soi, mais de rendre ce chez soi poreux, voire nomade » (Collin, 2003 : 53). Cependant, on ne peut faire abstraction du fait que les solidarités n’émergent pas automatiquement des situations sociales (Dean, 1996). Elles ne sont pas le produit des identités, tout aussi complexes et narratives qu’elles soient, mais d’une politisation des enjeux. La solidarité n’est possible que si l’enjeu est le monde, c’est-à-dire dans le domaine politique en politisant les localisations sociales, non pas pour en faire émerger les identités mais pour identifier et combattre les diverses figures de l’injustice. Ainsi, cela permet de « créer un monde commun avec d’autres qui sont dans une forme d’altérité par rapport à soi » (Brugère, 2012 : 103).
En même temps, il faut voir que si elles sont difficiles, ces solidarités sont nécessaires puisque la domination se nourrit de ses déplacements entre les divers systèmes de conflictualité sociale et que la lutte contre les rapports sociaux de domination doit être généralisée pour porter fruit. Cependant, cette montée en généralité passe par la prise en compte des divers aspects de la domination et de l’ensemble des systèmes sociaux. Il ne saurait être question de demander à certaines de se nier ou de secondariser leur lutte sous prétexte d’une nécessaire unité stratégique. Cela prépare toujours des lendemains qui déchantent. À la volonté d’unification par l’autorité politique répond « une politique des capacités, des relations, des coalitions, des politiques participatives et des nouveaux mouvements sociaux qui ne veulent plus représenter un ‘nous’ identifié et fixé devant un gouvernement » (Brugère, 2012 : 137).
Cette non-hiérarchisation des enjeux permet aussi d’éviter de reproduire les structures de domination au sein même des mouvements d’émancipation. Lorsque seuls certains aspects des rapports sociaux sont pris en compte dans les mouvements d’émancipation, ils tendent à reconduire des positions hégémoniques et des positions subalternes, même si leur configuration peut se transformer.
Sans avoir la prétention de répondre à la question classique de Gayatri Spivak (1988) tout en me situant dans sa logique, j’aurais tendance à soutenir que les subalternes peuvent parler, qu’ils et elles peuvent passer du phonos au logos, de la plainte ou du cri à une parole articulée et raisonnée. Mais, comme le souligne Spivak, cette parole est le plus souvent ignorée, brouillée, représentée plutôt qu’entendue ; elle doit donc de surcroît créer les conditions de son audibilité. De plus, comme tous les subalternes n’occupent pas les mêmes localisations sociales, leur parole sera nécessairement plurielle, faisant naître le dissensus qui est l’instrument le plus efficace d’une politique démocratique d’inclusion. Elle sera aussi de l’ordre du « trouble », introduisant de l’indétermination là où les pouvoirs préfèrent les classements et les assignations.
Pour saisir les modalités de création des conditions d’audibilité, il me semble intéressant de jeter un coup d’oeil sur les luttes sociales qui se sont développées récemment, comme les Indignés en Grèce et en Espagne, le mouvement Occupy Wall Street ! en Amérique du Nord ou encore la lutte du mouvement étudiant au Québec connue sous le vocable Printempsérable. Je me propose d’en examiner certaines caractéristiques.
Premièrement, ce sont des mouvements de repolitisation des lieux publics et de transformation de ceux-ci en espaces publics politiques. Il est symptomatique qu’ils sont issus du rassemblement, dans un lieu public et ouvert, de personnes contactées principalement par l’intermédiaire des réseaux sociaux. « L’occupation des espaces publics, les défilés sans permis et le trouble quotidien dans le Financial District, eux, ont provoqué la rébellion populaire qui manquait aux tentatives précédentes » (Vitale, 2012 : 119). Alors que les lieux publics ont été soit marchandisés (commerces divers, centres commerciaux) soit transformés en espaces de loisir (là aussi plus ou moins monétarisés, comme le quartier des festivals à Montréal), choisir d’occuper des lieux publics pose la question du sens des places publiques dans nos villes. Cela témoigne également d’une volonté d’inclusion, même si tous les mouvements qui se sont installés dans la durée ont eu de la difficulté à « cohabiter » avec les personnes itinérantes avec lesquelles ils devaient partager les lieux. Ce sont aussi des mouvements qui regroupent des individus sur la base d’une protestation commune, plutôt que des catégories sociales particulières.
Deuxièmement, ce sont des mouvements très critiques de la réduction de la démocratie à la démocratie représentative. D’une certaine façon, ils font écho au cri du coeur de la population argentine au moment de la crise de 2002, ¡ que se vayan todos ! (qu’ils partent tous !). Cela est particulièrement important dans le mouvement des indignad@s d’Espagne qui, sous le slogan ¡ democracia real ya ! (démocratie véritable, maintenant !), cherche à développer de nouvelles formes d’inclusion démocratique. Ces mouvements ne se reconnaissent ni dans la réduction de la démocratie aux élections périodiques avec un nombre limité de choix politiques, ni dans ceux et celles qui prétendent les représenter. Ce rejet de la réduction de la démocratie à sa version représentative est également à mettre en rapport avec la dénonciation de la corruption des gouvernants et leur collusion avec les milieux d’affaires responsables de la crise économico-financière.
Troisièmement, ce sont des mouvements qui ont mis la délibération au coeur du processus politique et du processus de politisation des personnes qui y ont participé. Si les personnes impliquées savaient ce qu’elles rejetaient, elles n’avaient pas nécessairement une idée précise de cet autre monde possible et ne croyaient pas au « sauveur suprême » ni aux solutions simplistes et « mur-à-mur ». La délibération permet de rechercher ces voies alternatives en commun tout en respectant l’individualité et l’apport de chaque personne. Elle permet également de donner chair aux valeurs des mouvements : inclusion, écoute/respect, solidarité, égalité, liberté.
Quatrièmement, ce sont des mouvements horizontaux par rapport à la verticalité du pouvoir et des tours de la finance mondiale. Ce ras-du-sol c’est aussi la pratique des réseaux plutôt que la délégation du pouvoir et la pyramide qu’elle suppose. C’est une forme d’étalement du mouvement, sur le mode de la capillarité ou des rhizomes. C’est l’insistance sur le lien de concitoyenneté (pouvoir de et avec) en essayant de minimiser le lien de domination (pouvoir sur).
Cinquièmement, ce sont des mouvements qui se sont constitués au nom de l’intérêt public. On peut prendre l’exemple du mouvement étudiant québécois de 2012. Commençant par dénoncer la hausse des droits de scolarité, mais s’alliant dès le début (blocage de la tour de la bourse le 16 février 2012) à la Coalition opposée à la hausse des tarifs, il en est rapidement venu à demander la gratuité scolaire et à mettre en question le crédo néolibéral de l’utilisateur/payeur dont le champ d’application dépasse largement la question des frais de scolarité. Puis, la lutte aidant, il en est venu à s’interroger sur les finalités de l’éducation dans la société et sur la marchandisation de celle-ci à laquelle nous assistons depuis plusieurs années.
Ces mouvements nous renseignent sur ce que signifie devenir un sujet politique, passer du statut de l’invisibilité, de l’inaudibilité et de l’anonymat à celui de « quelqu’un » qui n’est pas l’auteur de ses actions, mais, parce qu’il ou elle prend la parole et agit, enclenche une dynamique de politisation, c’est-à-dire de subversion des hiérarchies sociales organisées et cherche à instaurer une autre dynamique, imprévisible.
Ce que les luttes contemporaines font émerger, c’est, d’une part, l’énorme potentiel d’inclusion que revêt la notion d’égalité et, d’autre part, le fait qu’il est inapproprié de poser plusieurs enjeux politiques contemporains en termes d’une opposition entre particularismes et universalité. Ces luttes montrent aussi l’importance du recours aux droits afin d’unifier des collectivités disparates, hétérogènes et potentiellement conflictuelles.
Conclusion
Cette référence au droit constitue une critique implicite du concept de pouvoir qui est entendu largement dans nos sociétés sur le mode de la domination et remet en cause le principe de maîtrise qui est si souvent associé au pouvoir. Comme le soulignait la poétesse Audre Lorde (2007 [1984]), jamais les outils du maître ne détruiront la maison du maître. On peut ainsi estimer que les luttes pour les droits ne visent ni la conquête du pouvoir (que ce soit par les voies électorale ou armée) ni la destruction du pouvoir existant, mais plutôt à énoncer de nouvelles normes de justice (Lefort, 1981). La revendication de droits questionne le fondement du juste et de l’injuste dans une société et oblige le pouvoir à rendre des comptes et à justifier ses actions. On peut ainsi dire que ceux et celles qui revendiquent des droits agissent politiquement en posant la question des fondements et de la légitimité du pouvoir dans une collectivité et que, dans ce sens, ils et elles constituent des sujets politiques.
La revendication de droits induit donc un nouveau type de luttes sociales et reconfigure le rapport entre le social et le politique. Ces luttes présentent deux traits centraux : elles ne visent pas le pouvoir comme objet appropriable ; elles inscrivent les minorités comme porteuses d’une critique du « peuple-Un » et elles montrent la fausse unanimité des majorités silencieuses (ou réduites au silence). En posant la question du pouvoir non pas sur le mode d’un objet dont on peut s’emparer, mais plutôt sur celui de ce qui circule entre les citoyennes et les citoyens et alimente le lien politique, la revendication de droits met au centre du politique la dimension de l’agir concerté plutôt que celle de la domination (Arendt, 1958). Elle contribue également à maintenir ouvert l’écart entre le savoir, le pouvoir et la loi que la domination cherche à colmater. Dans ce sens, elle revêt un fort potentiel d’égalité, de liberté et de solidarité.
Ce qui est à la base de la revendication de droits, c’est le principe d’égalité qui est un des fondements de nos sociétés modernes et qui demande, comme les droits, à être mis en pratique pour ne pas tomber en déshérence. L’égalité agit dans ce sens comme principe opérateur du politique et revêt une fonction émancipatoire qui crée le politique là où ne se donnait à voir que de la gouvernance. L’égalité est rendue nécessaire parce que les différences existent. La revendication de droits est aussi une revendication de liberté, non pas uniquement la liberté individuelle, quoique celle-ci soit essentielle, mais aussi la liberté publique des citoyennes et des citoyens face au pouvoir et à la domination.
Enfin, revendiquer des droits rend possible la solidarité à deux titres. D’abord, cela permet de « s’affirmer comme co-partageant le monde commun » (Rancière, 1998 : 67). Dans cette optique, les droits induisent une politique qui vise le monde et non le Bien, même commun. C’est parce qu’ils prennent le monde pour objet qu’ils construisent une conflictualité autour des notions de liberté, d’égalité, de solidarité et de justice, notions dont le sens est constamment différé, qui feront toujours l’objet d’interprétations différentes. Ensuite, cela permet de maintenir la pluralité du monde à deux titres. D’une part, la distinction entre les individus qui ne sont pas des copies conformes, réductibles les uns aux autres. D’autre part, en estimant que l’égalité est essentielle parce que nous sommes différents, et qu’elle est nécessaire justement pour préserver cette différence. Mais, dans la mesure où la visée est celle du monde commun, ces différences commandent des solidarités qui ne tentent pas d’homogénéiser, de créer du « un » à partir du plusieurs, mais plutôt d’amplifier les possibilités de pluralisation non égocentriques. Le « peuple » demeure bariolé mais peut également agir en commun. C’est là un des sens possibles du « nous sommes les 99 % ».
Cette volonté de commun nous éloigne du particularisme ou de la revendication d’une identité particulière. Elle s’oppose à l’assignation identitaire du pouvoir et à sa volonté de classification hiérarchique. Mais elle n’obéit pas à la logique du consensus et vise, au contraire, à articuler le dissensus. C’est dans ce sens que les voix qui clament leur volonté de justice introduisent une dissonance identitaire dans la mécanique de la domination sociale.
Parties annexes
Note biographique
Diane Lamoureux est professeure de philosophie politique au Département de science politique de l’Université Laval. Elle a publié récemment Le trésor perdu de la politique (Montréal, Écosociété, 2013) et Pensées rebelles. Autour de Rosa Luxemburg, Hannah Arendt et Françoise Collin (Montréal, Remue-ménage, 2010). Elle a beaucoup travaillé sur les théories féministes et l’analyse des mouvements féministes contemporains. Son cycle actuel de recherche porte sur la citoyenneté et la démocratie et plus particulièrement sur les pratiques sociales de subjectivation et de contestation politiques à l’ère néolibérale.
Notes
-
[1]
Ce processus est illustré par l’intervention d’une participante au « parlement de la rue » mis en place par le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui disait « enlever son chapeau de ‘b.s.’ pour mettre son chapeau de citoyenne ». Cet exemple est tiré de Lamoureux (2008 : 230).
-
[2]
Disponible sur le site (www.profscontrelahausse.org), consulté en avril 2014.
-
[3]
« b.s. » est parfois utilisé au Québec pour désigner familièrement les personnes bénéficiaires de l’aide sociale.
Bibliographie
- Anzaldua, Gloria et Cherrie Moraga (sous la dir. de), 1981, This Bridge Called My Back, Watertown (MA), Persephone Press.
- Arendt, Hannah, 1958, Human Condition, Chicago, University of Chicago Press.
- Arendt, Hannah, 2002, L’impérialisme, Paris, Seuil.
- Arendt, Hannah, 2009, Responsabilité et jugement, Paris, Payot.
- Bhabha, Homi, 1994, The Location of Culture, Cambridge, Cambridge University Press.
- Brugère, Fabienne, 2012, Faut-il se révolter ?, Paris, Bayard.
- Butler, Judith, 2005, Vies précaires, Paris, Amsterdam.
- Castel, Robert, 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard.
- Collin, Françoise, 1983, « La même et les différences », Cahiers du GRIF (Groupe de recherche et d’information féministe), no 28, p. 7-19.
- Collin, Françoise, 1992, « Praxis de la différence », Cahiers du GRIF, no 46, p. 125-141.
- Collin, Françoise, 2003, « Déconstruction ou destruction de la différence des sexes », Contretemps, no 7, p. 46-57.
- Dardot, Pierre et Christian Laval, 2009, La nouvelle raison du monde, Paris, La Découverte.
- Dean, Jodi, 1996, Solidarity of Strangers, Berkeley, University of California Press.
- de Beauvoir, Simone, 1949, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard.
- Delphy, Christine, 2001, L’ennemi principal, tome 1, Paris, Syllepses.
- Delphy, Christine, 2008, Classer/dominer, Paris, La Fabrique
- Dorlin, Elsa (sous la dir. de), 2009, Sexe, race et classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France.
- Ehrenberg, Alain, 1998, La fatigue d’être soi, Paris, Odile Jacob.
- Ehrenberg, Alain, 2008, Le culte de la performance, Paris, Hachette.
- Foucault, Michel, 2004, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard.
- Fraser, Nancy, 1997, Justice Interruptus, New York, Routledge.
- Fraser, Nancy, 2005, Qu’est-ce que la justice sociale ?, Paris, La Découverte.
- Fraser, Nancy et Axel Honneth, 2003, Redistribution or Recognition ?, Londres, Verso.
- Guillaumin, Colette, 1972, L’idéologie raciste, Paris, Mouton.
- Guillaumin, Colette, 1992, Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris, Côté-femmes.
- Hill Collins, Patricia, 1991, Black Feminist Thought, New York, Routledge.
- Honneth, Axel, 2006, La société du mépris, Paris, La Découverte.
- hooks, bell, 1984, From Margins to Center, Boston, South End Press.
- Kergoat, Danièle, 2009, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Elsa Dorlin (sous la dir. de), Sexe, race et classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France, p. 111-125.
- Lamoureux, Jocelyne, 2008, « Paroles dérangeantes, scènes inédites, subversion égalitaire », dans Louise Blais (sous la dir. de), Vivre à la marge, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Lefort, Claude, 1981, L’invention démocratique, Paris, Fayard.
- Lorde, Audre, 2007 [1984], Sister Outsider : Essays and Speeches, Darlinghurst (Australie), The Crossing Press.
- Mathieu, Nicole-Claude, 1991, L’anatomie politique, Paris, Côté-femmes.
- Pateman, Carole, 1988, The Sexual Contract, Stanford, Stanford University Press.
- Rancière, Jacques, 1995, La mésentente, Paris, Galilée.
- Rancière, Jacques, 1998, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique.
- Renault, Emmanuel, 2004, L’expérience de l’injustice, Paris, La Découverte.
- Simmel, Georg, 1998, Les pauvres, Paris, Presses universitaires de France.
- Spivak, Gayatri, 1988 « Can the Subaltern Speak », dans Cary Nelson et Laurence Grossberg (sous la dir. de), Marxism and the Interpretation of Culture, Londres, Macmillan, p. 271-313.
- Vandelac, Louise, 1985, Du travail et de l’amour, Montréal, Saint-Martin.
- Vitale, Alex, 2012, « NYPD ET OWS, deux styles qui s’opposent », dans Jade Lindgaard (sous la dir. de), Occupy Wall Street !, Paris, Les Arènes, p. 112-121.
- Young, Iris Marion, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press.
- Young, Iris Marion 1997, « Gender as Seriality », Intersecting Voices, Princeton, Princeton University Press, p. 12-37.
- Young, Iris Marion, 2000, Inclusion and Democracy, Londres, Oxford University Press.