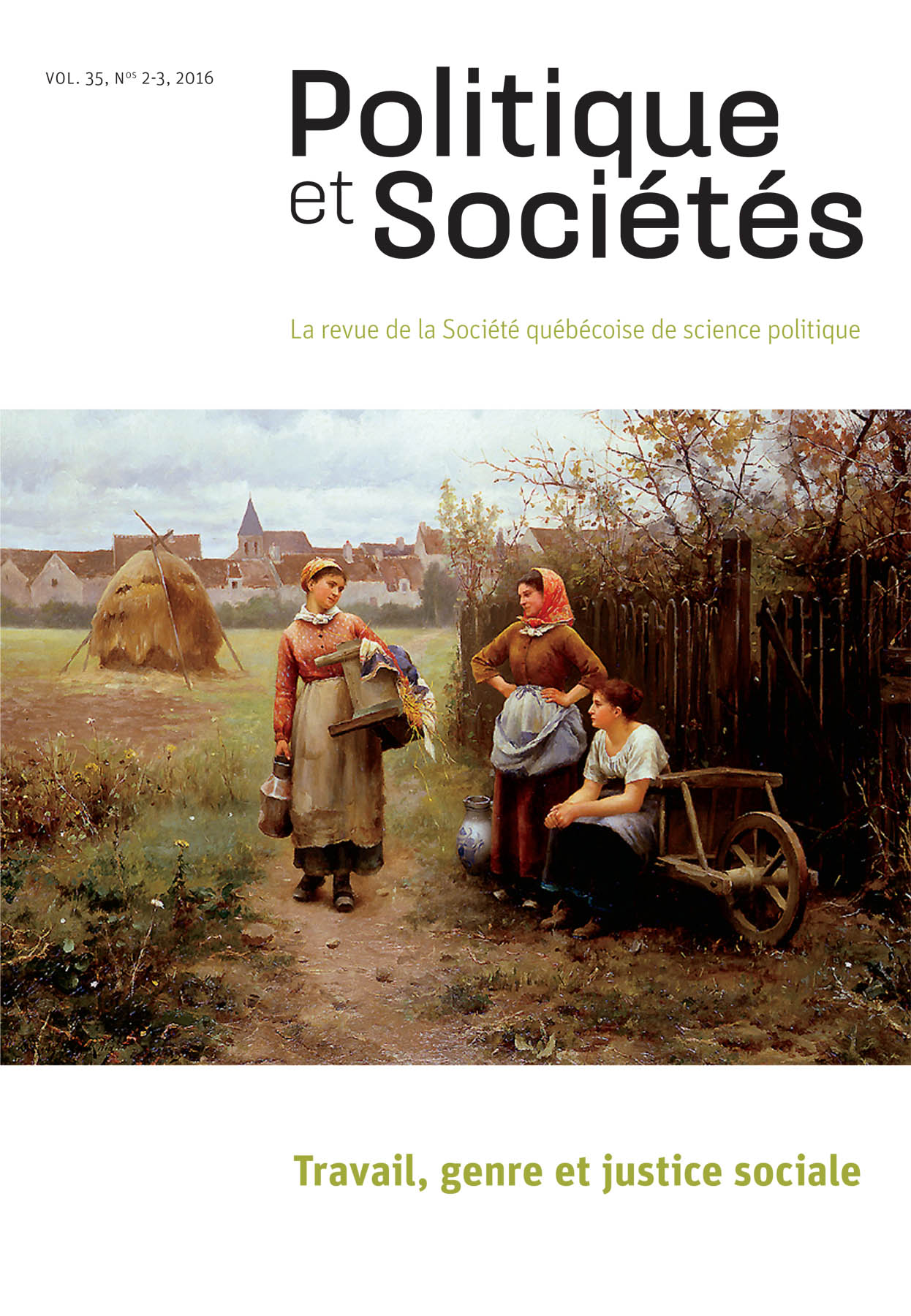Résumés
Résumé
Dans cet article, je soutiens que les « marchés où le gagnant rafle la mise », c’est-à-dire des marchés où de légères différences de performance se traduisent par de gigantesques différences de revenu, ne respectent pas le principe libertarien selon lequel les individus ont droit aux fruits de leur travail. Si les revenus doivent refléter les fruits du travail et que ces derniers doivent être mesurés selon la performance, alors les revenus sont en effet, dans ces marchés, fortement supérieurs aux fruits du travail, ce qui rend légitime, en vertu de ce principe, l’adoption d’un régime fiscal fortement progressif.
Mots-clés :
- justice distributive,
- libertarianisme,
- travail
Abstract
In this article I contend that “winner-take-all markets” (i.e., those where slight differences in performance mean huge differences in income) do not respect the libertarian principle that individuals are entitled to the fruits of their labour. If income must reflect the fruits of one’s labour (which must itself be measured by performance), then income in these markets is much higher than the fruits of the labour – which, on this principle, justifies the adoption of a very progressive tax system.
Keywords:
- distributive justice,
- libertarianism,
- labor
Corps de l’article
Dans son ouvrage, La course au luxe, l’économiste Robert H. Frank soutient que « l’accroissement récent de la disparité des revenus provient en grande partie de l’importance accrue [des] “marchés où le gagnant rafle la mise” – c’est-à-dire ceux où des écarts de performance minimes se traduisent souvent par des différences monumentales en termes de récompenses économiques » (2010 : 69)[2]. En effet, comme on le sait, les inégalités économiques se sont profondément accrues au cours des dernières décennies. Or, une des mesures possibles pour réduire ces inégalités pourrait consister à augmenter fortement la progressivité fiscale, c’est-à-dire à élever considérablement le taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu. Toutefois, les libertariens s’opposent à une telle mesure en vertu de trois principes qui ont un caractère transitoire. Selon eux, tout individu est propriétaire de sa propre personne et de son travail, ce qui entraîne un droit de propriété sur les fruits de son travail, puis sur les revenus de son travail. Ainsi, selon eux, l’impôt progressif sur le revenu est injuste, puisqu’en prélevant les revenus du travail des individus, il prélève du même coup les fruits de leur travail, ce qui viole le principe sous-jacent de la propriété de soi.
Cependant, la théorie des marchés où le gagnant rafle la mise (après : MGRM) permet de contester la validité d’une telle objection. Dans la mesure en effet où les MGRM peuvent être définis comme des marchés où de légères différences de performance au travail se traduisent par de gigantesques différences de revenus, les très hauts revenus obtenus au sein de ce type de marché ne semblent pas refléter les fruits du travail des individus, du moins lorsque ces derniers sont mesurés selon la performance. Alors que les libertariens insistent trop souvent sur les situations où le principe de la propriété de soi est violé par défaut, c’est-à-dire où un individu obtient des revenus inférieurs aux fruits de son travail, les MGRM montrent que ce principe peut aussi être violé par excès, c’est-à-dire lorsqu’un individu bénéficie de revenus supérieurs aux fruits de son travail.
Certes, la justice distributive ne se réduit pas à la théorie libertarienne et cette dernière ne se réduit pas non plus au principe de la propriété de soi. Par conséquent, on pourrait considérer, en vertu d’autres théories, qu’il est juste qu’une personne accumule des revenus supérieurs aux fruits de son travail. Par surcroît, on pourrait considérer que la performance n’est pas un critère approprié pour mesurer les fruits du travail d’un individu. Néanmoins, si l’on adhère à ce principe et que l’on considère que la performance est un critère approprié[3], les MGRM montrent qu’il est possible d’adopter la théorie libertarienne tout en étant favorable à une réduction des inégalités économiques au moyen d’un impôt sur le revenu fortement progressif. En effet, dans un tel cas, augmenter le taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu consisterait à prélever non pas le fruit du travail des individus, mais plutôt la différence excessive entre leurs revenus et les fruits de leur travail mesurés selon leur performance.
Ainsi, dans cet article, je soutiendrai qu’il est possible de réduire les inégalités économiques causées par les MGRM en augmentant fortement le taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu sans violer les principes libertariens de la propriété de soi et du droit aux fruits de son travail. Pour ce faire, je présenterai d’abord les principales caractéristiques qui définissent les MGRM, puis je préciserai pourquoi j’ai choisi d’aborder cette problématique d’un point de vue libertarien. Je montrerai ensuite que les MGRM sont, en premier lieu, un système de production qui s’enracine dans la division du travail, ce qui permet aux gagnants d’obtenir des fruits du travail supérieurs à leur performance individuelle ; et qu’ils sont, en second lieu, un système de distribution des revenus qui, par leur fonctionnement même, permettent à ces mêmes gagnants d’empocher des revenus supérieurs aux fruits de leur travail individuel. Enfin, je soutiendrai que la meilleure manière de réguler les MGRM consiste à adopter un régime fiscal fortement progressif et qu’une telle mesure demeure compatible avec le principe le plus important de la théorie libertarienne, à savoir la propriété de soi.
Les « marchés où le gagnant rafle la mise »
Dans son ouvrage La course au luxe, Frank propose un exemple qui permet d’illustrer les principales caractéristiques des MGRM :
Au début du [vingtième] siècle, quand l’État de l’Iowa comptait à lui seul plus de 1300 opéras, des milliers de ténors gagnaient modestement mais correctement leur vie en se produisant en public. Maintenant que nous écoutons le plus souvent de la musique enregistrée, le meilleur ténor du monde peut littéralement être présent partout à la fois. Comme il ne coûte pas plus cher de produire des disques compacts à partir d’un enregistrement de Luciano Pavarotti que d’un autre ténor moins célèbre, la plupart d’entre nous écoutent aujourd’hui Pavarotti. Nous sommes des millions à accepter de payer un peu plus pour écouter Luciano Pavarotti et non d’autres ténors très légèrement moins capables ou moins réputés ; voilà pourquoi Pavarotti gagne plusieurs millions de dollars chaque année, alors que la plupart des autres ténors, souvent presque aussi talentueux, survivent avec difficulté.
2010 : 70
Par cet exemple tiré du monde de l’opéra, Frank résume une théorie développée dans un autre ouvrage rédigé avec Philip J. Cook[4], The Winner-Take-All Society (1995), qu’ils appellent des « marchés où le gagnant rafle la mise » (winner-take-all markets), c’est-à-dire des marchés où « des différences mineures en termes de performances se traduisent par des différences gigantesques en termes de revenus » (Frank, 2010 : 71). Selon Frank, les MGRM n’ont rien de nouveau, mais il remarque qu’ils ont pris, au cours des dernières décennies, une ampleur jamais connue auparavant[5] : « ce type de marché existe depuis longtemps dans le monde du spectacle, des sports et des arts, mais il pénètre toujours davantage dans la comptabilité, le droit, le journalisme, le conseil, la médecine, la banque d’investissement, la gestion de société, l’édition, le design, la mode et toute une foule de professions » (ibid. : 69). Ainsi, ce type de marché est, selon Frank et Cook, en voie de transformer en profondeur notre société et d’en faire, conformément au titre de leur ouvrage, non simplement un « marché où le gagnant rafle la mise » (winner-take-all markets), mais une « société où le gagnant rafle la mise » (winner-take-all society).
Les MGRM se distinguent de ce que les auteurs appellent des « marchés traditionnels » (traditional markets) (Frank et Cook, 1995 : 8-9, 21) selon certaines caractéristiques relatives à l’offre et à la demande. Du côté de l’offre, le principal facteur à l’origine de tels marchés est la capacité de reproduire à l’infini et à un faible coût le service de la personne qui offre la meilleure performance (ibid. : 32-33). Le progrès technique joue, à cet égard, un rôle déterminant. Par exemple, comme il a été mentionné auparavant, « il ne coûte pas plus cher de produire des disques compacts à partir d’un enregistrement de Luciano Pavarotti que d’un autre ténor moins célèbre » (Frank, 2010 : 70). Puis, il faut que les récompenses économiques soient déterminées non par des performances absolues, mais plutôt – ou davantage – par des performances relatives. On sait, par exemple, que lors de l’épreuve du 100 mètres en athlétisme aux jeux olympiques d’été, la différence entre celui qui remporte la médaille d’or et la médaille d’argent se mesure le plus souvent en millièmes de seconde[6]. Cet exemple permet de mettre en évidence une autre caractéristique des MGRM relative à l’offre, à savoir que les récompenses économiques doivent être fortement concentrées entre les mains du gagnant. En effet, alors que celui qui a remporté la médaille d’argent est le plus souvent complètement oublié, celui qui a remporté la médaille d’or peut s’attendre à récolter presque la totalité des revenus grâce à la célébrité que lui procurera sa victoire et qui lui permettra notamment d’attirer sur lui l’attention des publicitaires.
Du côté de la demande, les MGRM peuvent ensuite se présenter sous deux formes différentes, à savoir des « marchés de masse où le gagnant rafle la mise » (mass winner-take-all markets) et des « marchés de poche profonde où le gagnant rafle la mise » (deep-pocket winner-take-all markets) (Frank et Cook, 1995 : 26). S’agissant des marchés de masse, ceux-ci peuvent être définis comme étant des marchés où il existe une multitude d’acheteurs potentiels qui ont tous un intérêt minime dans la performance du gagnant. Par exemple, le marché de la boxe représente un marché de masse plus important que celui du handball, puisqu’il existe une masse critique plus importante d’amateurs de boxe que d’amateurs de handball[7]. En ce sens, un champion de boxe peut s’attendre à toucher des revenus nettement supérieurs à ceux d’un champion de handball, puisqu’il existe un nombre plus important d’amateurs de boxe prêts à payer pour assister à un match de boxe, que ce soit en personne ou à la télévision. Cela dit, cette masse critique peut aussi être concentrée entre les mains d’un nombre réduit d’individus, mais très riches. C’est ce que les auteurs appellent des « marchés de poche profonde où le gagnant rafle la mise », c’est-à-dire des marchés où il existe un petit nombre d’acheteurs potentiels, mais qui ont tous un très grand intérêt dans la performance du gagnant. Ces marchés sont notamment ceux des plus grands peintres, sculpteurs, avocats, ainsi que des géologues qui ont développé une aptitude particulière à trouver du pétrole (ibid. : 26).
Ainsi, comme on le voit, c’est essentiellement en raison des multiples progrès techniques et technologiques des dernières décennies que les MGRM ont pris une telle importance. De tels progrès permettent en effet, du côté de l’offre, de cloner le travail de la personne qui offre la meilleure performance ou, du moins, qui suscite la plus forte demande. Puis, ces mêmes progrès permettent aussi à cette personne d’avoir accès à une multitude d’acheteurs potentiels dans le cadre des marchés de masse où le gagnant rafle la mise. Ainsi, lorsque ces différentes caractéristiques relatives à l’offre et à la demande sont combinées, elles donnent lieu à une forte augmentation des inégalités économiques. Certes, dans les marchés dits traditionnels, les revenus ne reflètent pas nécessairement la performance au travail des individus, mais les MGRM contribuent à accentuer, voire à dissocier complètement ces deux manières de mesurer le travail.
Il semble donc que notre rapport séculaire au travail doive être repensé aujourd’hui à la lumière des MGRM. Dominique Méda remarque d’ailleurs que « nous vivons aujourd’hui avec un concept du travail qui est un conglomérat, le produit de la juxtaposition et de l’assemblage non repensés de ces trois dimensions du travail : le travail comme facteur de production, comme essence de l’homme et comme système de distribution des revenus, des droits et des protections » (2010 : 23-24). Or, les MGRM bouleversent surtout deux de ces trois dimensions du travail, à savoir comme « facteur de production » et comme « système de distribution des revenus, des droits et des protections ». Par surcroît, ces deux dimensions trouvent une certaine cohérence au sein de la théorie libertarienne qui défend, d’une part, l’idée que les individus ont droit aux fruits de leur travail (facteur de production) et, d’autre part, qu’un « libre marché » s’avère à même de distribuer ces fruits du travail de manière juste (système de distribution des revenus). Pour repenser la juxtaposition et l’assemblage de ces deux dimensions du travail à la lumière des MGRM, il nous faut donc examiner de quelle manière ils bouleversent la théorie libertarienne.
Nous sommes tous libertariens
Dans leur ouvrage The Myth of Ownership, Liam B. Murphy et Thomas Nagel remarquent que le libertarisme se présente sous deux principales formes : un libertarisme fondé sur les droits (rights-based) et un autre fondé sur le mérite (desert-based) (2002 : 31-32). Alors que la première forme de libertarisme repose principalement sur le droit qu’ont les individus d’accumuler et d’échanger librement ce sur quoi ils ont un droit de propriété, le libertarisme fondé sur le mérite repose, quant à lui, sur l’idée qu’un libre marché est une institution qui permet d’accorder à chacun les ressources selon son mérite respectif. Ces deux formes de libertarisme impliquent toutefois, selon les auteurs, deux problèmes importants. Le libertarisme fondé sur les droits conduit les individus à croire qu’ils ont un droit de propriété légitime sur leurs revenus avant impôt : lorsqu’un gouvernement prélève des recettes fiscales quelconques, c’est leur argent sur lequel ils ont déjà un droit de propriété qu’ils acceptent de donner au gouvernement afin que celui-ci puisse offrir divers services aux citoyens (ibid. : 175-176). Ensuite, le libertarisme fondé sur le mérite conduit les individus à croire que le marché est fondamentalement juste : puisqu’il permet de récompenser chacun selon son propre mérite, toute distorsion de cette distribution initiale doit être justifiée et soumise à la critique (ibid. : 31-32).
Or, ces deux idées – que les individus ont un droit de propriété légitime sur leurs revenus avant impôt et que le marché est fondamentalement juste – ne résistent pas, selon Murphy et Nagel, à une analyse critique. D’abord, s’agissant du premier problème, les auteurs remarquent que le droit de propriété lui-même ne saurait exister sans État et que l’État ne saurait exister sans fiscalité[8]. Par conséquent, les individus ont tort de croire qu’ils ont un quelconque droit de propriété légitime sur leurs revenus avant impôt (ibid. : 8). Ensuite, de la même manière, le marché non plus ne saurait exister sans État et l’État, sans fiscalité. Ainsi, l’idée d’un « libre marché » complètement détaché de l’intervention de l’État qui permettrait de distribuer les revenus selon le mérite de chacun est un mythe qui ne résiste pas, lui non plus, à une analyse critique (ibid. : 32).
Toutefois, selon Murphy et Nagel, ce ne sont pas seulement les libertariens qui adhèrent à ces deux mythes, mais bien la majorité des citoyens. Il existe en effet ce qu’ils appellent un « libertarisme courant » (everyday libertarianism) (ibid. : 35) qui peut être défini comme la croyance, partagée non seulement par les libertariens, mais aussi par les égalitaristes, dans le fait que les individus ont un droit de propriété légitime sur leurs revenus avant impôt et que le marché accorde à chacun ce qu’il mérite. Par exemple, lorsque les égalitaristes considèrent que les plus riches devraient contribuer davantage au « fardeau fiscal » et que leur rhétorique repose sur l’idée que ces derniers devraient faire un plus grand « sacrifice », ils adhèrent implicitement à ce libertarisme courant, puisqu’ils reconnaissent non seulement un droit de propriété légitime aux très hauts revenus avant impôt des plus riches, mais aussi que ces revenus correspondent grosso modo à ce qu’ils méritent.
S’agissant du libertarisme fondé sur les droits, cette forme de libertarisme, on le sait, s’inspire largement de la philosophie de John Locke. C’est dans Le second traité du gouvernement (1994) que les libertariens trouvent le principe selon lequel chacun a droit aux fruits de son travail (Menger, 1899 ; Becker, 1976 ; Steiner, 1992 ; Michael, 1997). Locke écrit : « Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne […] Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains […] lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu’il fait sortir de l’état dans lequel la nature l’a fourni et laissé, et il y joint quelque chose qui est sien ; par là il en fait sa propriété » (1994 : 22, §27). On trouve ici trois principes – la propriété de soi, la propriété de son travail et la propriété des fruits de son travail – qui ont un caractère transitoire : la propriété de soi entraîne un droit de propriété sur son travail qui entraîne lui-même un droit de propriété sur les fruits de son travail. Pour reprendre une métaphore proposée par James W. Harris, on pourrait comparer cette transitivité à un arbre dont le tronc représente le corps d’un individu, les branches, le travail de son corps et les fruits, la richesse produite par ce travail[9].
Or, on a souvent tendance aujourd’hui à assimiler les fruits du travail d’un individu à ses revenus. Mais peut-on pousser aussi loin cette transitivité ? S’il est vrai que la propriété de soi entraîne d’abord un droit de propriété sur son travail, puis sur les fruits de son travail, ce droit aux fruits de son travail entraîne-t-il aussi un droit de propriété sur les revenus de son travail ? Autrement dit, les revenus d’un individu, dans une économie moderne, correspondent-ils aujourd’hui aux fruits de son travail ? La théorie libertarienne semble en effet ajouter une troisième étape à cette transitivité :
Propriété de soi ➔ propriété de son travail ;
Propriété de son travail ➔ propriété des fruits de son travail ;
Propriété des fruits de son travail ➔ propriété des revenus de son travail.
On le voit, la deuxième étape correspond au travail comme facteur de production et la troisième étape, au travail comme système de distribution des revenus[10]. Or, ce sont ces deux étapes dont le caractère transitoire est bouleversé par les MGRM. Je montrerai donc, à la section suivante, que la division du travail permet d’accroître la productivité individuelle, ce qui bouleverse le caractère transitoire de la deuxième étape voulant que la propriété de son travail entraîne la propriété des fruits de son travail.
Le travail comme facteur de production
Dans son article « L’interprétation du principe de la propriété de soi au sein du libertarisme de gauche », Peter Dietsch écrit : « la notion de propriété de soi n’a pas de sens concret avant qu’on règle la question de la propriété du monde extérieur […] Poussée à l’extrême, cette position irait jusqu’à m’interdire d’utiliser mes poumons si je n’ai pas le droit de respirer l’air autour de moi » (2008b : 66). Bien que les libertariens adoptent tous le principe de la propriété de soi, ceux-ci en effet ne s’entendent toutefois pas sur le règlement des ressources externes qu’ils divisent généralement en deux grandes catégories, soit les ressources naturelles et les artéfacts[11]. S’agissant des ressources naturelles, les libertariens de gauche considèrent qu’elles devraient être distribuées d’une manière égalitaire (Vallentyne, 1999), puisqu’on peut considérer avec Locke que « la terre […] appartien[t] en commun à tous les hommes » (1994 : 22, §27). Les libertariens de droite, quant à eux, considèrent que les individus ont le droit de s’approprier les ressources naturelles dans la mesure toutefois où ils respectent la clause lockéenne (proviso) qui stipule qu’un individu peut s’approprier les ressources naturelles « du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d’aussi bonne qualité » (Locke, 1994 : 22, §27). Enfin, les libertariens d’extrême-droite (Vallentyne, 2012 : 4), comme Murray Newton Rothbard (1978 ; 1991) ou Jan Narveson (1999 ; 2001), refusent cette clause lockéenne et considèrent que les individus ont le droit de s’approprier les ressources naturelles selon le principe « premier arrivé, premier servi ».
Mais qu’en est-il des artéfacts ? Malheureusement, le libertarisme accorde moins d’importance à cette question et propose peu de réponses[12]. Cela s’explique sans doute par le fait que les artéfacts, dans la mesure où ils peuvent être définis comme les produits du travail humain, sont considérés par les libertariens comme étant toujours déjà la propriété d’un individu. Il existe toutefois un phénomène qui vient bouleverser cette conception des artéfacts par les libertariens. Il s’agit du problème de la division du travail. En effet, en situation d’autarcie, il ne fait nul doute que le produit du travail d’un individu appartient à cet individu. Mais dans le contexte de la division du travail, comment déterminer à qui appartient le produit d’un travail collectif ? Le problème, en l’occurrence, c’est que c’est précisément ce phénomène de la division du travail qui, en premier lieu, est à l’origine de l’émergence des MGRM (Frank et Cook, 1995 : 54). La division du travail a en effet une influence déterminante sur la première des deux manières de mesurer le travail au sein des MGRM, à savoir la performance. Comme on le sait, les MGRM se définissent comme des marchés où de légères différences de performance se traduisent par de gigantesques différences de revenu, mais cette performance elle-même ne pourrait être aussi élevée sans la division du travail, c’est-à-dire si chacun ne pouvait se concentrer sur les tâches où il excelle.
Toutefois, la performance au travail peut être entendue de deux manières, soit selon l’effort, c’est-à-dire les moyens mis en oeuvre dans le cadre de cette performance, soit selon la contribution, c’est-à-dire les résultats obtenus grâce à cette performance (Lamont, 1995). Manifestement, lorsqu’on réfère aux artéfacts ou aux « fruits du travail » d’un individu, on ne tient compte en l’occurrence que de sa contribution, c’est-à-dire des résultats obtenus ou de sa « productivité ». Ainsi, on observe que la productivité individuelle s’est profondément accrue au fil des siècles. Thomas Piketty remarque à ce propos : « En Europe occidentale, en Amérique du Nord ou au Japon, le revenu moyen est passé d’à peine plus de 100 euros par mois et par habitant en 1700 à plus de 2500 euros par mois en 2012, soit une multiplication par plus de vingt. » (2013 : 145) Cette multiplication de la productivité individuelle entre 1700 et 2012 par un facteur de vingt serait même une estimation prudente, puisqu’elle ne tient pas compte du nombre d’heures travaillées qui, lui, a considérablement diminué. Piketty ajoute en effet : « En réalité, la progression de la productivité, c’est-à-dire de la production par heure travaillée, a été plus élevée encore, car la durée moyenne du travail par habitant a beaucoup diminué : toutes les sociétés développées ont fait le choix, au fur et à mesure de leur enrichissement, de travailler moins longtemps, afin de disposer de plus de temps libre (journées de travail plus courtes, vacances plus longues, etc.). » (ibid. : 145-146)
Dès lors, s’il est vrai que cet accroissement de la productivité individuelle s’explique en grande partie par le phénomène de la division du travail, quelles conséquences normatives peut-on en tirer ? Pour répondre à cette question, il y a lieu tout d’abord de préciser que la division du travail peut prendre deux formes différentes : une division intra-temporelle et inter-temporelle du travail (Dietsch, 2008a : 101). Par division intra-temporelle du travail, j’entends le travail qu’un certain nombre d’individus se partagent en même temps et, par division inter-temporelle, le capital social issu du travail des générations antérieures sur lequel repose le travail aujourd’hui. Car sans un certain capital social qui prend généralement la forme de connaissances accumulées au fil des siècles, de techniques et d’artéfacts produits par les générations antérieures, il y a tout lieu de croire que la productivité individuelle résultant de la division intra-temporelle du travail serait beaucoup plus basse qu’elle ne l’est à l’heure actuelle. Comme nous le verrons, ces deux facteurs que sont la division intra-temporelle et inter-temporelle du travail jouent un rôle majeur au sein des MGRM.
Bien que la problématique de la division du travail ait une longue histoire (Sun, 2012), l’auteur qui a sans doute le mieux analysé cette question d’un point de vue économique est bien sûr Adam Smith. Dans La Richesse des nations (1991), Smith a bien montré en effet comment la séparation des tâches permet un accroissement de la productivité individuelle. Puis, sans les nommer explicitement, Smith en appelle non seulement à la division intra-temporelle, mais aussi à la division inter-temporelle du travail. Dans son célèbre exemple de l’usine d’épingles, il montre en effet comment une dizaine d’ouvriers, en se séparant les tâches nécessaires à la production d’épingles, peuvent produire 48 000 épingles en une journée. Est-ce à dire qu’un seul ouvrier, sans la division du travail, aurait pu produire 4800 épingles ? Nullement, répond Smith, puisque selon lui, « s’ils [les ouvriers] avaient tous travaillé à part et indépendamment les uns des autres, et s’ils n’avaient pas été façonnés à cette besogne particulière, chacun d’eux assurément n’eût pas fait vingt épingles, peut-être pas une seule, dans sa journée » (1991 : vol. I, livre I : 72). Selon Smith, cette augmentation de la productivité est due à trois facteurs : « premièrement, à un accroissement d’habileté chez chaque ouvrier individuellement ; – deuxièmement, à l’épargne du temps qui se perd ordinairement quand on passe d’une espèce d’ouvrage à une autre ; – et troisièmement enfin, à l’invention d’un grand nombre de machines qui facilitent et abrègent le travail, et qui permettent à un homme de remplir la tâche de plusieurs » (ibid. : 74-75).
Comme on le voit, les deux premiers facteurs (l’accroissement d’habileté et l’épargne du temps) correspondent à la division intra-temporelle du travail et le troisième (l’invention d’un grand nombre de machines) correspond plutôt à la division inter-temporelle du travail. D’ailleurs, il y a lieu de remarquer que ce dernier facteur, ou ce que l’on pourrait appeler le progrès technique, a pris aujourd’hui une importance bien plus considérable que celle qu’il avait au dix-huitième siècle. L’économiste Gaël Giraud et la philosophe Cécile Renouard remarquent à ce propos :
La Révolution industrielle a consisté essentiellement en une succession de procédures toutes fondées sur le même principe : substituer l’énergie naturelle […] au travail humain […] Un homme peut fournir, au maximum, 150 kWh au cours d’une année en utilisant ses membres. Le pétrole, le gaz et le charbon nous ont permis de multiplier par plusieurs centaines notre action sur l’environnement, en ordre de grandeur et en moyenne […] Dit autrement, ce qui fait fonctionner la machine industrielle mondiale, c’est avant tout l’énergie, et non le travail des hommes […] du coup cela signifie que l’énergie est le véritable moteur des économies contemporaines.
2012 : 85-86
S’il est vrai que ce n’est pas le travail humain, mais l’énergie naturelle qui, aujourd’hui, est le véritable moteur des économiques contemporaines, dès lors, à qui appartient cette énergie ou, plus généralement, ce capital social issu de la division inter-temporelle du travail ? Pour reprendre l’exemple de Pavarotti, nous avons vu en effet que ce sont les progrès techniques, c’est-à-dire la capacité d’enregistrer la musique, qui, essentiellement, lui permettent de cloner son travail autant de fois que l’exige la demande et ainsi de gagner des millions. Toutefois, puisque Pavarotti ne peut s’attribuer l’invention de ces progrès techniques, il est permis de se demander si, en lui permettant de faire fortune, on ne lui permet pas du même coup de s’approprier une part trop importante du capital social issu des générations antérieures.
D’ailleurs, Pavarotti ne pourrait non plus vendre ses disques à une multitude d’acheteurs sans l’aide de nombreux collaborateurs comme les techniciens qui fabriquent les disques, les manoeuvres qui s’occupent de leur distribution, etc. Ainsi, pourquoi les revenus de Pavarotti sont-ils si élevés, alors que ceux des autres, peut-on présumer, sont-ils si faibles ? Une telle question met en lumière non plus la problématique de la division inter-temporelle, mais celle de la division intra-temporelle du travail. Dans une économie moderne, les fruits du travail ne sont jamais produits de manière autarcique, mais sont plutôt le résultat d’une coopération entre les individus, ce qui permet d’accroître considérablement la productivité individuelle. Cette différence de productivité entre ce qu’un individu peut produire par son seul travail et ce qu’il peut produire en collaboration avec les autres est ce que Dietsch appelle le « surplus coopératif ». Il explique :
Dans tout système de coopération basé sur une division des tâches se produit un surplus coopératif. Je le définis comme le différentiel de production entre le monde actuel et un monde contrefactuel où les individus doivent mener une vie autarcique. Si j’avais à produire et à fournir tous les biens et services que je consomme moi-même, ma productivité dans ces activités diverses serait beaucoup plus basse que celle des producteurs spécialisés dans ces tâches. La somme de ces différentiels de productivité constitue le surplus coopératif. Ces différentiels ne représentent pas les fruits du travail des individus, mais les fruits de leur coopération.
Dietsch, 2008b : 68
S’il est vrai, comme le soutient Dietsch, que la division intra-temporelle du travail produit un « surplus coopératif » qui ne représente pas « les fruits du travail des individus, mais les fruits de leur coopération », comment doit-on distribuer ce « surplus coopératif » ? Il répond à cela qu’il y a lieu de le distribuer selon un « principe de surplus égal » (ibid. : 68) (Equal Surplus Principle), c’est-à-dire distribuer le surplus coopératif également à condition que les individus y consacrent un nombre égal d’heures. Si cette dernière condition n’est pas remplie, alors la part de chaque individu devrait être proportionnelle au nombre d’heures travaillées (Dietsch, 2008a : 104-112). Certes, pour revenir à l’exemple de Pavarotti, cela ne signifie pas pour autant que les revenus de ce dernier ne devraient pas être supérieurs à ceux des autres travailleurs qui collaborent à ses enregistrements. Cela signifie seulement qu’il y a lieu de tenir compte de ce facteur qu’est le surplus coopératif issu de la division intra-temporelle du travail lorsqu’on évalue le caractère juste ou non des très hauts revenus de Pavarotti. Et, lorsqu’on tient compte de ce facteur, les très fortes inégalités qu’on peut observer au sein des MGRM paraissent manifestement excessives.
D’ailleurs, un exemple contemporain, proposé ces dernières années par Thomas Thwaites (2011) et repris par David Robichaud et Patrick Turmel dans leur ouvrage La juste part (2012), montre bien à quel point les divisions inter-temporelle et intra-temporelle du travail permettent d’augmenter la productivité individuelle. Thwaites a eu en effet l’idée un peu farfelue de fabriquer lui-même un grille-pain. Robichaud et Turmel racontent :
Thwaites a […] découvert que ce banal objet, disponible en grande surface pour environ 10 $, est un véritable casse-tête composé de 404 pièces faites des matériaux les plus variés : acier, cuivre, nickel, plastique, etc. Comment fait-on du plastique, au juste ? Et de l’acier ? Avec du fer, pour lequel il faut creuser, et encore là au bon endroit. Pas une mince tâche. Même chose pour le nickel et le cuivre. Mais Thomas Thwaites a relevé le défi et a fabriqué la chose. Son grille-pain a, pendant quelques secondes, réchauffé (plutôt que grillé) une tranche de pain, avant que les pièces ne commencent à fondre. Il lui a couté 250 fois le prix du modèle de départ, sans compter l’effort, le temps et les milliers de kilomètres parcourus pour trouver les matériaux nécessaires.
2012 : 13-14
Ce que montre cet exemple, c’est que la tentative de fabriquer un simple grille-pain en situation d’autarcie, c’est-à-dire en ignorant à la fois la division inter et intra-temporelle du travail, est vouée à l’échec. Robichaud et Turmel précisent d’ailleurs que « Thwaites n’a pas lui-même conçu le grille-pain : il ne s’intéressait qu’à sa fabrication, en calquant un travail d’ingénierie et de design déjà fait » (ibid. : 14). Par conséquent, même en s’appuyant sur la division inter-temporelle du travail, il semble impossible de fabriquer un objet aussi simple sans faire appel à la division intra-temporelle du travail. La leçon que l’on peut en tirer, c’est donc, comme l’écrivent Robichaud et Turmel, que « la valeur marchande de tous biens, services ou idées dans les sociétés modernes avancées a une dimension radicalement collective, et ne peut jamais être entièrement attribuée au mérite, aux talents ou aux efforts d’un individu » (2012 : 14).
Ainsi, toutes ces observations illustrent le fait que les fruits du travail collectif, c’est-à-dire qui sont le résultat de la division inter et intra-temporelle du travail, sont très largement supérieurs aux fruits du travail individuel, c’est-à-dire en situation d’autarcie. Par conséquent, la performance d’un individu au sein des MGRM doit beaucoup à ces deux dimensions de la division du travail et serait évidemment moindre en leur absence. Si l’on considère que c’est la performance qui constitue la mesure appropriée des fruits du travail, il semble donc peu plausible que les fruits du travail d’un individu soient très largement supérieurs à ceux d’un autre. Ainsi, le principe libertarien qui stipule que la propriété du travail d’un individu entraîne un droit de propriété sur les fruits de son travail peut certes sembler juste, mais ne conduit certainement pas à des inégalités aussi excessives que celles qu’on observe au sein des MGRM. Par contre, s’il est vrai que les fruits du travail d’un individu doivent refléter le mieux possible sa performance au travail, les revenus eux-mêmes doivent-ils refléter les fruits du travail des individus ? C’est cette question que j’examinerai maintenant.
Le travail comme système de distribution des revenus
Le travail ne doit pas seulement être compris comme facteur de production, mais aussi comme système de distribution des revenus. À ce titre, ce ne sont plus seulement les progrès techniques qui jouent un rôle déterminant, mais aussi le marché lui-même. Or, comme on le sait, les libertariens accordent une grande importance à cette institution qu’est le marché. Dans la perspective du libertarisme fondé sur les droits, le marché permet en effet d’échanger librement ce sur quoi les individus ont un droit de propriété légitime et, dans la perspective du libertarisme fondé sur le mérite, il permet de distribuer les revenus selon le mérite de chacun. Bien que certains libertariens n’accordent que peu d’importance à la problématique du mérite[13], il demeure néanmoins que tous les libertariens, sans exception, s’accordent sur le fait que le travail, tout comme les biens matériels légitimement acquis, peut être échangé librement sur le marché. C’est le cas, par exemple, d’un libertarien de droite comme Robert Nozick qui écrit, dans Anarchie, État et Utopie : « Les gens transfèrent leurs possessions ou leur travail sur des marchés libres avec des taux d’échange (des prix) déterminés de la façon habituelle. La théorie de la productivité marginale est raisonnablement adéquate. Les gens recevront dans ces transferts de possessions grosso modo leurs produits marginaux. » (2012 : 233)
Discuter de l’exactitude de la théorie de la productivité marginale m’entraînerait hors de mon propos. Ce que je voudrais démontrer, en revanche, c’est le fait que, dans les MGRM, les individus y gagnent des revenus fortement supérieurs à ceux qu’ils peuvent recevoir au sein des marchés traditionnels, et ce, en raison même du fonctionnement de ce type de marché. Pour ce faire, je montrerai que l’analyse que fait Nozick du caractère juste du marché repose en réalité sur un marché traditionnel et que cette analyse ne tient plus lorsqu’il s’agit de MGRM. La principale différence en effet entre un marché traditionnel et un MGRM réside dans le fait que, dans un MGRM, le travail de la personne qui offre la meilleure performance peut être cloné autant de fois qu’il est nécessaire, alors que dans un marché traditionnel, cette reproduction de l’offre à l’infini et à faibles coûts n’est pas possible. Comme nous le verrons maintenant, cette caractéristique des MGRM permet à la demande, qu’elle provienne d’un marché de poche profonde ou d’un marché de masse, de converger entièrement vers la meilleure offre ou, du moins, vers celle qui suscite la plus forte demande.
Dans Anarchie, État et Utopie, Nozick propose une métaphore du marché du travail qu’il compare à des hommes et des femmes désireux de se marier (2012 : 321-324). Il nous demande en effet d’imaginer la situation suivante. Prenons 26 femmes et 26 hommes désireux de s’unir et classons-les en termes de désirabilité, c’est-à-dire en ordre préférentiel décroissant. Nous aurons alors, chez les femmes, un classement de A à Z et, chez les hommes, un classement de A' à Z' où A et A' représentent les personnes les plus désirables et Z et Z', les personnes les moins désirables. Évidemment, la femme A choisira d’abord de se marier avec l’homme A'. Ce premier mariage réduit ensuite l’éventail de choix de la femme B. Celle-ci aurait sans doute choisi de se marier avec A', mais puisque cela n’est plus possible, ce choix devient plus limité et son éventail de choix se réduit alors à devoir choisir un partenaire de B' à Z'. La femme B choisira donc en toute logique de se marier avec l’homme B'. Il en va de même jusqu’au bas du classement de telle manière que la femme Z a le choix soit de se marier avec Z', soit de rester célibataire.
Imaginons maintenant que les femmes de A' à Z' représentent le côté « demande » du marché du travail, c’est-à-dire les employeurs ou les détenteurs de capitaux et que les hommes de A à Z représentent le côté « offre » du marché du travail, c’est-à-dire les travailleurs. Que se passera-t-il ? Tout comme dans l’exemple précédent du mariage, l’employeur A' choisira le travailleur A et ce contrat de travail représente la meilleure situation possible, c’est-à-dire celle où l’offre et la demande de travail sont les plus désirables. On y trouve en effet, du côté de la demande, les meilleurs salaires et les meilleures conditions de travail et, du côté de l’offre, le travailleur le plus performant. Certes, le travailleur B aurait souhaité obtenir l’emploi offert par A' et l’employeur B' aurait aussi souhaité engager le travailleur A, mais puisque cela n’est plus possible, B et B' devront se résoudre à signer un contrat de travail. Il en va de même jusqu’au bas du classement où, selon Nozick, « Z a deux solutions : soit travailler, soit mourir de faim » (2012 : 322). Toutefois, selon lui, une telle situation n’est pas injuste, puisque, écrit-il, « le choix d’une personne confrontée à différents degrés de solutions désagréables n’est pas rendu non volontaire par le fait que les autres ont choisi volontairement et ont agi selon leurs droits » (ibid. : 323).
L’exemple que propose Nozick est toutefois basé sur un marché du travail traditionnel où plusieurs employeurs ne peuvent choisir le même travailleur. Cependant, dans un MGRM, l’offre de travail d’un individu peut être clonée autant de fois qu’il est nécessaire, et ce, à faibles coûts. Les MGRM peuvent donc se présenter de deux manières. Dans un marché de poche profonde où le gagnant rafle la mise, du côté de la demande, un détenteur de capital A' très riche peut choisir, du côté de l’offre, un seul travailleur, soit le meilleur A. Et dans un marché de masse où le gagnant rafle la mise, du côté de la demande, les détenteurs de capitaux de A' à Z', riches ou non, peuvent tous choisir, du côté de l’offre, un seul travailleur, soit le meilleur A. Mais dans tous les cas, les travailleurs de B à Z sont exclus de ce marché, puisqu’il est possible à un seul travailleur de satisfaire la demande, qu’elle provienne d’un seul détenteur de capital (marché de poche profonde où le gagnant rafle la mise) ou de plusieurs (marché de masse où le gagnant rafle la mise).
La principale conséquence qui en découle est que ce n’est plus seulement le travailleur Z qui a deux solutions (accepter un travail moins valorisant ou mourir de faim), mais les 25 travailleurs de B à Z. Les MGRM ont donc pour effet d’exclure un très grand nombre de personnes de ce type de marché. Certes, cette conséquence paraît exagérée, puisque l’alternative qui se présente à ces 25 travailleurs n’est pas de travailler ou mourir de faim, mais plutôt de mourir de faim dans ce marché ou travailler dans un autre marché. Mais il demeure néanmoins que, puisque les MGRM sont actuellement en expansion et qu’ils accaparent une part croissante de la richesse collective, la solution qui s’offre à ceux qui sont exclus de ce type de marché se caractérise par des conditions de travail et des rémunérations peu intéressantes.
Un MGRM peut-il donc être considéré comme étant un marché du travail qui permet de distribuer la richesse selon le fruit du travail de chacun ? Il y a lieu d’en douter. Mais il s’agit là pourtant d’un principe de justice distributive défendu non seulement par un libertarien de droite comme Nozick, mais aussi par les socialistes et les marxistes (Cohen, 1990). Nozick affirme : « L’une des opinions traditionnelles socialistes est que les travailleurs ont droit au produit et aux fruits complets de leur travail. Ils l’ont gagné ; une distribution est injuste si elle ne donne pas aux travailleurs ce à quoi ils ont droit. » (2012 : 211) Selon la théorie marxiste en effet, le capitalisme est injuste parce que les détenteurs de capitaux (demande) volent aux travailleurs le fruit de leur travail (offre) représenté par la plus-value. Dans un tel cas, les travailleurs reçoivent moins que le fruit de leur travail. Mais les MGRM offrent une situation nouvelle et inattendue, à savoir un type de marché où ce ne sont pas les détenteurs de capitaux qui reçoivent davantage que le fruit de leur travail, mais le travailleur le plus performant. En effet, si l’on suppose qu’il existe de légères différences de performance entre les travailleurs de A à Z et que les fruits du travail reflètent cette performance, tous les revenus offerts par les employeurs pourront converger vers le travailleur A. Ainsi, ce dernier accumulera des revenus fortement supérieurs aux fruits de son travail, alors que les travailleurs B à Z percevront des revenus inférieurs aux fruits de leur travail.
Certes, la justice distributive ne se réduit pas à la position libertarienne et ce ne sont pas toutes les théories qui imposent que les revenus du travail reflètent les fruits du travail mesurés selon la performance. Par surcroît, un marché traditionnel ne permet pas non plus d’offrir à chacun des revenus qui reflètent parfaitement les fruits de son travail. Mais il demeure néanmoins que les MGRM créent un conflit au sein de la position libertarienne entre le principe selon lequel chacun a droit aux fruits de son travail et le principe selon lequel le marché permet de distribuer les revenus de manière proportionnelle aux fruits du travail des individus. La critique des libertariens envers la redistribution forcée de la richesse au moyen de la fiscalité repose d’ailleurs, en grande partie, sur l’idée que les travailleurs ont droit aux fruits complets de leur travail. Par exemple, Nozick va même jusqu’à affirmer : « L’imposition sur les biens provenant du travail se retrouve sur un pied d’égalité avec les travaux forcés […] le fait de prendre les gains de n heures de travail revient à prendre n heures de cette personne ; c’est comme si l’on forçait cette personne à travailler n heures pour quelqu’un d’autre » (2012 : 211).
Une telle affirmation demeure-t-elle valable dans un MGRM ? On peut penser que non, puisque le rapport entre le nombre n d’heures qu’un individu consacre à son travail dans un MGRM ne correspond pas aux gains obtenus grâce à ce nombre n d’heures. Par conséquent, il serait justifié de réguler davantage les MGRM sans violer le principe de la propriété de soi. D’ailleurs, Mark A. Michael propose un argument qui va dans le même sens. Ayant reconnu d’abord que Nozick adopte un principe qu’il appelle P3 qui stipule que personne ne devrait être forcé de donner ou de transférer une part du fruit de son travail[14], il observe ensuite :
Nozick’s argument applies to those cases in which the redistributive tax expropriates the fruit of one’s labour. But might not some of the wages which a person receives as a result of her work represent more than the fruit of her labour, a condition we might think of as a person’s being overpaid ? Since self-ownership requires only that the fruit of a person’s labour not be expropriated, and makes no claims about what may be done with any overpayment a person may receive as part of her wages, it appears that this excess could be expropriated as part of a redistributive tax without violating (P3).
Michael, 1997 : 138
Or, les MGRM représentent justement un exemple concret de marché où les individus qui offrent la meilleure performance sont surpayés. Encore une fois, on ne peut considérer que ces derniers sont surpayés qu’en vertu du principe selon lequel les revenus doivent refléter les fruits du travail mesurés selon la performance. Il demeure néanmoins, si l’on adopte une position libertarienne, qu’imposer ces revenus ne peut être considéré comme une violation de la propriété de soi et ne s’apparente certainement pas non plus, comme le soutient Nozick, à du travail forcé. Ainsi, il semble qu’une meilleure régulation des MGRM demeure compatible avec les principes fondamentaux du libertarisme. Mais de quelle manière réguler ce type de marché ? C’est à cette question que je consacrerai la dernière partie de cet article.
La nécessité d’un régime fiscal fortement progressif
Dans leur article « Winner-Take-All Markets : Easing the Case for Progressive Taxation », Martin McMahon et Alice G. Abreu écrivent :
The existence of winner-take-all markets presents a serious challenge to the classical argument that progressive taxation is inefficient because it distorts the decision to create additional income or to consume at the margin, and so entails trading efficiency for equity. In a winner-take-all market, progressive taxation may be not only efficient, it may be nearly optimal ; it may raise revenue from people whose incentive to make more money is nearly unaffected by the existence of the tax.
1998 : 10
L’adoption d’un régime fiscal fortement progressif pourrait en effet représenter une solution permettant de faire en sorte que les revenus reflètent le mieux possible les fruits du travail des individus. Rappelons d’abord qu’il existe trois principales formes d’impôt sur le revenu : un impôt sur le revenu est dit progressif quand le taux d’imposition s’élève progressivement lorsque le revenu augmente ; il est dit régressif quand, au contraire, le taux est progressivement abaissé lorsque le revenu augmente ; puis il est dit proportionnel ou flat tax lorsque le taux demeure le même, peu importe le revenu. S’agissant du taux lui-même, notons que celui-ci peut être moyen, c’est-à-dire s’appliquer à l’ensemble du revenu, ou marginal, c’est-à-dire ne s’appliquer qu’à une tranche de ce revenu.
Ainsi, je soutiens que la meilleure manière de réguler les MGRM consiste à adopter un régime fiscal fortement progressif dont le taux marginal supérieur est beaucoup plus élevé qu’il ne l’est présentement. Toutefois, la réinstauration d’un impôt marginal fortement progressif se heurte pour l’instant, particulièrement aux États-Unis, à la théorie du ruissellement (trickle-down theory). Présentée brièvement, cette théorie stipule qu’un allègement des impôts des plus riches entraîne une plus forte croissance qui « s’écoulera » (trickle down) vers les plus pauvres et contribuera à améliorer leur situation. Selon Frank, cette théorie représente sans doute, aux États-Unis, l’obstacle le plus important qui empêche l’adoption de la mesure qu’il préconise pour réguler les MGRM, à savoir l’impôt progressif sur la consommation :
Croire qu’augmenter l’imposition des riches paralysera l’économie est le principe fondateur de la théorie du ruissellement. L’adhésion généralisée à ce principe constitue également un obstacle majeur à l’introduction d’un impôt fortement progressif sur la consommation. Si le principe était juste, il expliquerait également pourquoi nous ne devrions pas avoir cet impôt. Or les meilleures preuves démontrent que, loin de paralyser l’économie, un impôt fortement progressif sur la consommation contribuerait à son essor.
2010 : 318
Bien qu’un impôt fortement progressif sur la consommation soit certainement une mesure qui mérite d’être envisagée et étudiée davantage (ibid. : 298-318), il ne faut pas oublier que nous avons déjà, à notre disposition, un outil qui nous est familier, l’impôt sur le revenu.
Contrairement à ce que suppose la théorie du ruissellement, on remarque en effet que l’abaissement progressif du taux supérieur de l’impôt sur le revenu depuis la fin des années 1970 n’a nullement profité aux plus pauvres ou à la classe moyenne. Pour le démontrer, prenons par exemple le cas des États-Unis. Contrairement à une idée reçue, le taux supérieur de l’impôt sur le revenu, dans ce pays, a été très élevé, et ce, durant plusieurs décennies (Piketty, 2013 : 805, graph. 14.1). En 1944 et 1945, ce taux supérieur était de 94 %, puis il a oscillé entre 91 % et 92 % de 1951 à 1963. À partir du début des années 1980, il a toutefois commencé à décroître progressivement. De 1964 à 1981, il oscille encore entre 69 % et 77 %, mais il chute à 50 % durant les années 1982 à 1986, puis à 28 % durant les années 1988 à 1990 pour se stabiliser enfin entre 35 % et 40 % de 1993 à 2013. Le cas des États-Unis ne fait d’ailleurs pas exception, puisqu’on constate des variations similaires, durant la même période, dans des pays comme le Royaume-Uni[15], l’Allemagne ou la France.
Comme on le voit, c’est durant les trente glorieuses que le taux supérieur de l’impôt sur le revenu, aux États-Unis, a été le plus élevé. Or, si la théorie du ruissellement était juste, on constaterait une certaine amélioration de la situation des plus pauvres ou de la classe moyenne à compter du moment où ce taux a commencé à diminuer, c’est-à-dire durant la période qui va de la fin des années 1970 à aujourd’hui. Toutefois, durant cette période, la croissance qui devait, en vertu de la théorie du ruissellement, profiter aux plus pauvres ou à la classe moyenne a été presque entièrement captée par les plus riches[16]. Piketty observe à ce propos : « Concrètement, si l’on cumule la croissance totale de l’économie américaine au cours des trente années précédant la crise, c’est-à-dire de 1977 à 2007, alors on constate que les 10 % les plus riches se sont approprié les trois quarts de cette croissance ; à eux seuls, les 1 % les plus riches ont absorbé près de 60 % de la croissance totale du revenu national américain sur cette période ; pour les 90 % restants, le taux de croissance du revenu moyen a été ainsi réduit à moins de 0,5 % par an » (2013 : 469-470). Par surcroît, il semble que la situation ne se soit nullement améliorée depuis la crise financière de 2008, puisque, dans un document publié récemment par Oxfam, il est estimé qu’aux États-Unis, « les 1 % les plus riches ont confisqué 95 % de la croissance post-crise financière depuis 2009, tandis que les 90 % les moins riches se sont appauvris » (Fuentes-Nieva et Galasso, 2014 : 3).
Ainsi, les États-Unis sont devenus aujourd’hui un des pays où les inégalités sont les plus fortes. Par exemple, en 2014, la part des revenus détenue par les 1 % les plus riches aux États-Unis s’élevait à 17,85 % et celle détenue par les 10 % les plus riches, à 47,19 % (Alvaredo et al., 2016). Par conséquent, 10 % de la population aux États-Unis se partageait en 2014 presque la moitié des revenus et 90 %, un peu plus de l’autre moitié. Ainsi, il semble clair que la théorie du ruissellement, qui a motivé l’abaissement du taux supérieur de l’impôt sur le revenu au cours des dernières décennies, n’a pas eu les résultats escomptés. Cet abaissement du taux supérieur a permis en effet aux plus riches de s’approprier une part de plus en en plus importante des revenus et la croissance, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle est due à l’abaissement de ce taux, ne s’est écoulée, ni vers les plus pauvres, ni vers la classe moyenne. La mesure préconisée par Frank, à savoir l’impôt progressif sur la consommation, doit certes être étudiée davantage, mais l’impôt progressif sur le revenu demeure une mesure qui a fait ses preuves pour contrôler les inégalités et que nous aurions tort d’abandonner. La question qui consiste à déterminer jusqu’à quel taux marginal supérieur l’impôt sur le revenu pourrait être élevé appartient au débat public, mais l’expérience des trente glorieuses montre que l’élever à des taux de l’ordre de 80 % ou 90 % est au moins possible. Il semble même devenu plus que jamais nécessaire, comme le suggèrent un nombre croissant d’auteurs[17], de commencer à réfléchir à l’idée d’un revenu maximal, c’est-à-dire à un véritable plafonnement des très hauts revenus mis en oeuvre par le biais d’un taux marginal de l’impôt sur le revenu de 100 %.
Un tel impôt violerait-il le principe de la propriété de soi défendu non seulement par les libertariens, mais aussi par une vaste majorité de citoyens qui, pourtant loin de partager les idées de ces derniers, adhèrent à ce mythe du « libertarisme courant » ? Dans cet article, j’ai tenté de montrer que la réponse est négative, puisque les MGRM représentent un cas concret de marché où les revenus du travail sont fortement supérieurs aux fruits du travail des individus. Dans la mesure en effet où la productivité accrue du travail au sein des sociétés contemporaines s’explique à la fois par la division inter-temporelle et intra-temporelle du travail, les fruits de ce travail « ne représentent pas les fruits du travail des individus, mais les fruits de leur coopération » (Dietsch, 2008b : 68). Puis, le fait que les MGRM permettent, en bonne partie grâce à cette division du travail, de cloner le travail individuel et de canaliser les revenus vers une minorité d’individus, ils contribuent à accentuer encore davantage cet écart entre les fruits du travail et les revenus que l’on croit pourtant représentatifs les uns des autres. En effet, comme l’affirme Robert H. Frank, « les marchés où le gagnant rafle la mise exagèrent les différences de talent, aussi faibles soient-elles ; par conséquent, même si nous avions tous les mêmes chances au départ, l’inégalité resterait prononcée » (2010 : 372).
Ainsi, les MGRM devraient poser un problème non seulement pour les libertariens, mais aussi pour les égalitaristes libéraux qui défendent cette valeur qu’est l’égalité des chances. Dans les MGRM, cette égalité des chances apparaît davantage comme une chance égale de gagner le gros lot dans un marché du travail qui a toutes les caractéristiques d’une loterie et non d’un marché. Cela est-il juste ? On peut penser que non, puisque dans une loterie, la chance et le hasard jouent un rôle bien plus déterminant que le travail. Et, ce qui est sans doute encore plus grave, c’est que toute loterie produit certes un petit nombre de gagnants, mais surtout une majorité de perdants.
Parties annexes
Note biographique
Christian Jobin est candidat au doctorat en philosophie à l’Université de Montréal et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chargé de cours à l’Université de Montréal. Il est ou a été membre du Centre de recherche en éthique (CRE), du Groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique (GRIPP), du Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM) et de la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Ses recherches portent sur la justice distributive et la mise en oeuvre d’une richesse maximale, c’est-à-dire un plafonnement du revenu et du capital au moyen d’un taux marginal de 100 % de l’impôt sur le revenu et sur les successions. Il a publié récemment « Le droit de propriété aux États-Unis et dans le Dictionnaire d’économie politique », dans Josiane Boulad-Ayoub (dir.) L’homme est né libre. Raison, politique, droit (Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, p. 383-399).
Notes
-
[1]
Cet article est tiré d’une conférence présentée lors de l’atelier « Travail, citoyenneté et justice sociale », tenu le 21 mai 2014 à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du congrès 2014 de la Société québécoise de science politique (SQSP). Je remercie, en premier lieu, les organisatrices, Sophie Bourgault et Naïma Hamrouni, de m’avoir invité à participer à cet atelier, ainsi que tous les participants qui m’ont encouragé par leurs commentaires. Je remercie ensuite Peter Dietsch, ainsi que deux évaluateurs anonymes de la revue Politique et Sociétés qui m’ont permis, par leurs critiques, de raffiner mon argumentation et de corriger certaines inexactitudes. Bien entendu, le contenu de cet article ne les engage d’aucune manière et je demeure entièrement responsable de toute erreur qui pourrait malgré tout subsister.
-
[2]
Pour une présentation plus détaillée de la théorie des marchés où le gagnant rafle la mise, voir Frank et Cook (1995). Je traduirai « winner-take-all markets » par « marchés où le gagnant rafle la mise » comme l’ont proposé Monique Arav et John Hannon dans leur traduction du livre de Frank (2010).
-
[3]
Sur le critère de la performance, voir l’ouvrage important de Bebchuk et Fried (2004).
-
[4]
Cette idée a toutefois d’abord été développée par Rosen (1981 ; 1983).
-
[5]
Ce concept commence aussi à faire l’objet d’analyses politiques (voir Hacker et Pierson, 2010).
-
[6]
J’emprunte cet exemple, en le modifiant quelque peu, à Frank et Cook (1995 : 29).
-
[7]
J’emprunte aussi cet exemple à Frank et Cook (1995 : 25).
-
[8]
Sur cette question, voir aussi Holmes et Sunstein (1999).
-
[9]
« My body is the tree; my actions are the branches ; and the product of my labouring activities is the fruit » (Harris, 1996 : 68).
-
[10]
Ces deux dimensions du travail, c’est-à-dire comme facteur de production et comme système de distribution des revenus, se rapprochent, mutatis mutandis, du principe d’acquisition (facteur de production) et du principe de transfert (système de distribution des revenus) que propose Robert Nozick (2012 : 189).
-
[11]
Pour une bonne présentation de cette problématique, voir Steiner et Vallentyne (2009).
-
[12]
Une exception notable est toutefois celle de Dietsch qui propose une théorie à propos de l’appropriation des artéfacts qu’il inscrit au sein du libertarisme de gauche (2008a ; 2008b).
-
[13]
Voir par exemple Nozick : « la conception de la justice fondée sur les droits aux avoirs n’est pas une conception structurée (patterned) de la justice et n’accepte donc pas non plus une distribution en fonction du mérite moral (moral desert) » (2012 : 269).
-
[14]
« (P3) Persons may not be forced to give up or transfer any part of the fruit of their labour to others. » (Michael, 1997 : 137)
-
[15]
Par exemple, au Royaume-Uni, ce taux supérieur était de 98 % de 1941 à 1952, entre 89 % et 95 % de 1953 à 1973, et est revenu à 98 % de 1974 à 1978. À partir des années 1980, ce taux diminue toutefois de manière importante. Durant les années 1979 à 1983, il est de 75 %, puis il chute à 60 % durant les années 1984 à 1987, à 40 % durant les années 1988 à 2009, pour enfin remonter légèrement, c’est-à-dire entre 45 % et 50 %, durant les années 2010 à 2013.
-
[16]
Sur cette question, voir Dabla-Norris et al. (2015).
-
[17]
Sur cette question, voir : Pizzigati (1992 ; 2004) ; Ramsay (2005) ; Blader et Castleton (2010) ; Kempf (2010) ; Giraud et Renouard (2012) ; Reiff (2013) ; et Cottey (2014).
Bibliographie
- Alvaredo, Facundo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, 2016, The World Wealth and Income Database, consulté sur Internet (http://www.wid.world) le 4 février 2016.
- Bebchuk, Lucian A. et Jesse M. Fried, 2004, Pay Without Performance : The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Cambridge, Harvard University Press.
- Becker, Lawrence C., 1976, « The Labor Theory of Property Acquisition », The Journal of Philosophy, vol. 73, no 18, p. 653-664.
- Blader, Ruth Foxe et Edward Castleton, 2010, « L’impératif du salaire maximum : un point de vue outre-Atlantique », Mouvements, vol. 64, no 4, p. 92-99.
- Cohen, Gerald Allan, 1990, « Marxism and Contemporary Political Philosophy, or : Why Nozick Exercises Some Marxists More Than He Does Any Egalitarian Liberals ? », Canadian Journal of Philosophy, « Supplementary Volume », no 16, p. 363-387.
- Cottey, Alan, 2014, « Technologies, Culture, Work, Basic Income and Maximum Income », AI & Society, vol. 29, no 2, p. 249-257.
- Dabla-Norris, Era, Kalpana Kochhar, Frantisek Ricka, Nujin Suphaphiphat et Evridiki Tsounta, 2015, Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective, Washington, International Monetary Fund.
- Dietsch, Peter, 2008a, « Distributive Lessons from Division of Labour », Journal of Moral Philosophy, vol. 5, no 1, p. 96-117.
- Dietsch, Peter, 2008b, « L’interprétation du principe de la propriété de soi au sein du libertarisme de gauche », Dialogue : Canadian Philosophical Review / Revue canadienne de philosophie, vol. 47, no 1, p. 65-80.
- Frank, Robert H., 2010, La course au luxe. L’économie de la cupidité et la psychologie du bonheur [trad. de Monique Arav et John Hannon], Genève, Markus Haller.
- Frank, Robert H. et Philip J. Cook, 1995, The Winner-Take-All Society : How More and More Americans Compete for Ever Fewer and Bigger Prizes, Encouraging Economic Waste, Income Inequality, and an Impoverished Cultural Life, New York, Free Press.
- Fuentes-Nieva, Ricardo et Nick Galasso, 2014, En finir avec les inégalités extrêmes. Confiscation politique et inégalités économiques, Oxford, Oxfam International.
- Giraud, Gaël et Cécile Renouard, 2012, Le facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus, Paris, Carnets Nord.
- Hacker, Jacob S. et Paul Pierson, 2010, Winner-Take-All Politics : How Washington Made the Rich Richer and Turned Its Back on the Middle Class, New York, Simon & Schuster.
- Harris, James W., 1996, « Who Owns My Body », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 16, no 1, p. 55-84.
- Holmes, Stephen et Cass R. Sunstein, 1999, The Cost of Rights : Why Liberty Depends on Taxes, New York, W.W. Norton.
- Kempf, Hervé, 2010, « Le revenu maximum, un levier pour le changement », Mouvements, vol. 4, no 64, p. 87-91.
- Lamont, Julian, 1995, « Problems for Effort-based Distribution Principles », Journal of Applied Philosophy, vol. 12, no 3, p. 215-229.
- Locke, John, 1994, Le second traité du gouvernement : essai sur la véritable origine, l’étendue et la fin du gouvernement civil [trad. de Jean-Fabien Spitz et Christian Lazzeri], Paris, Presses universitaires de France.
- McMahon, Martin et Alice G. Abreu, 1998, « Winner-Take-All Markets : Easing the Case for Progressive Taxation », Florida Tax Review, vol. 4, no 1, p. 1-81.
- Méda, Dominique, 2010, Le travail, Paris, Presses universitaires de France.
- Menger, Anton, 1899, The Right to the Whole Produce of Labour : The Origin and Development of the Theory of Labour’s Claim to the Whole Product of Industry [trad. de M.E. Tanner], New York, Macmillan.
- Michael, Mark A., 1997, « Redistributive Taxation, Self-ownership and the Fruit of Labour », Journal of Applied Philosophy, vol. 14, no 2, p. 137-146.
- Murphy, Liam B. et Thomas Nagel, 2002, The Myth of Ownership : Taxes and Justice, Oxford et New York, Oxford University Press.
- Narveson, Jan, 1999, « Property Rights : Original Acquisition and Lockean Provisos », Public Affairs Quarterly, vol. 13, no 3, p. 205-227.
- Narveson, Jan, 2001, The Libertarian Idea, Peterborough, Broadview Press.
- Nozick, Robert, 2012, Anarchie, État et utopie [trad. d’Evelyne d’Auzac De Lamartine et Pierre-Emmanuel Dauzat], Paris, Presses universitaires de France.
- Piketty, Thomas, 2013, Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil.
- Pizzigati, Sam, 1992, The Maximum Wage : A Common-Sense Prescription for Revitalizing America by Taxing the Very Rich, New York, Apex Press.
- Pizzigati, Sam, 2004, Greed and Good : Understanding and Overcoming the Inequality That Limits Our Lives, New York, Apex Press.
- Ramsay, Maureen, 2005, « A Modest Proposal : The Case for a Maximum Wage », Contemporary Politics, vol. 11, no 4, p. 201-216.
- Reiff, Mark R., 2013, Exploitation and Economic Justice in the Liberal Capitalist State, Oxford, Oxford University Press.
- Robichaud, David et Patrick Turmel, 2012, La juste part : repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains, Montréal, Atelier 10.
- Rosen, Sherwin, 1981, « The Economics of Superstars », The American Economic Review, vol. 71, no 5, p. 845-858.
- Rosen, Sherwin, 1983, « The Economics of Superstars : Reply », The American Economic Review, vol. 73, no 3, p. 460-462.
- Rothbard, Murray Newton, 1978, For a New Liberty : The Libertarian Manifesto, New York, Collier Books.
- Rothbard, Murray Newton, 1991, L’éthique de la liberté [trad. de François Guillaumat et Pierre Lemieux], Paris, Les Belles Lettres.
- Smith, Adam, 1991, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations [trad. de Germain Garnier], Paris, Flammarion.
- Steiner, Hillel, 1992, « The Fruits of One’s Labour », dans David Milligan et William Watts Miller (sous la dir. de), Liberalism, Citizenship and Autonomy, Aldershot et Brookfield, Avebury et Gower, p. 7987.
- Steiner, Hillel et Peter Vallentyne, 2009, « Libertarian Theories of Intergenerational Justice », dans Axel Gosseries et Lukas H. Meyer (sous la dir. de), Intergenerational Justice, Oxford et Toronto, Oxford University Press, p. 50-76.
- Sun, Guang-Zhen, 2012, The Division of Labour in Economics. A History, London et New York, Routledge.
- Thwaites, Thomas, 2011, The Toaster Project, or A Heroic Attempt To Build a Simple Electric Appliance from Scratch, New York, Princeton Architectural Press.
- Vallentyne, Peter, 1999, « Le libertarisme de gauche et la justice », Revue économique, vol. 50, no 4, p. 859878.
- Vallentyne, Peter, 2012, « Libertarianism and the Justice of a Basic Income », Basic Income Studies, vol. 6, no 2, p. 1-11.