Corps de l’article
Think tanks, la partie émergée de la politisation de la recherche
Apparues au seuil du XXe siècle, les organisations de recherche indépendantes traitant des politiques publiques, le plus souvent nommées think tanks de nos jours, ont connu une croissance phénoménale depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pratiquement inexistantes il y a cent ans, on en dénombre maintenant des milliers dans le monde, des centaines aux États-Unis et en Chine, des dizaines au Canada et plus d’une quinzaine au Québec (Lamy 2019a ; Mouton 2019 ; McGann 2020).
Non seulement ces organisations de recherche indépendantes se sont multipliées, mais elles jouissent aujourd’hui de ressources matérielles et humaines non négligeables. Rien qu’au Canada, le budget annuel total de 25 think tanks[1] fonctionnant en tant qu’organismes de bienfaisance s’élevait à 125,6 M$ CA. Ces revenus dépassaient facilement les 90,7 M$ dont disposaient les cinq principaux partis fédéraux en pleine année électorale. De plus, l’ampleur de ces flux économiques rivalisait aussi de plus en plus avec les subventions Savoir de 185,6 M$ CA octroyées la même année par le gouvernement fédéral à l’ensemble des professeurs d’université en sciences humaines au pays. Le secteur économique de la recherche dans les organismes sans but lucratif (OSBL) gagne effectivement en importance comme en témoigne l’évolution du budget moyen de ces mêmes 25 organisations[2] au Canada depuis 16 ans, passant de 2,3 M$ à 4,6 M$ CA annuellement comme l’illustre la figure 1.
En considérant les budgets alloués aux professeurs pour les chaires de recherche du Canada en sciences humaines, variant de 100 000 à 200 000 $ CA annuellement, il serait possible de présenter les think tanks du pays comme des super-chaires fonctionnant généralement avec un budget qui leur est de 20 à 45 fois supérieur. Même en ne faisant qu’effleurer le phénomène, ces quelques données forcent à considérer que ces centres, instituts et observatoires indépendants représentent bel et bien un angle mort majeur de ce que nous savons sur la recherche au Canada.
Néanmoins, même après trente ans de production littéraire les concernant, il demeure difficile de tracer les contours de ces entrepreneurs de recherche qui aiment chevaucher les frontières de divers champs professionnels. En ayant réussi à brancher sur eux par la recherche tant de secteurs (économique, médiatique, politique et universitaire), il devient facile de comprendre les causes de l’absence d’un consensus quant à la définition spécifique de ce que sont les think tanks. Néanmoins, certaines caractéristiques permettent d’en faire un objet capable de structurer des recherches en sciences sociales. Ainsi, les think tanks, autrefois appelés policy institutes, prennent la forme d’organismes qui ne dépendent pas des pouvoirs publics ou des universités ; qui sont non partisans et sans but lucratif ; et, surtout, qui s’adonnent dans la durée à une production de contenu original concernant des sujets de politiques publiques et d’enjeux de société (McGann 2016 ; Abelson 2018). C’est du moins à partir de cette conception prédominante que la recherche a été organisée en Amérique du Nord par les pionniers de ce champ d’étude et par ceux qui ont pris le relais aujourd’hui. Ces organisations se distinguent aussi des firmes de consultants et de relations publiques, car elles interviennent dans l’espace public en leur nom propre plutôt qu’au nom d’un tiers, tout en rendant accessible leur production d’informations à la population et aux élites dans le dessein de contribuer au développement des politiques publiques (Boucher et Royo 2012 ; Medvetz 2012).
Ayant perfectionné leurs moyens de communication avec les années, les think tanks sont devenus des interlocuteurs incontournables des débats entourant les politiques publiques. Si leur influence concrète auprès des élus et des partis politiques demeure matière à débat, il n’en demeure pas moins qu’ils réussissent ponctuellement, à l’aide d’une production de contenu, à influencer la mise au programme d’enjeux politiques dans la conversation publique (Carroll et Huxtable 2014). Dans l’espace médiatique, le capital symbolique que ces organisations ont réussi à accumuler à travers les décennies – autant auprès des décideurs politiques que des bailleurs de fonds – leur permet de populariser des idées en profitant, par exemple, des fenêtres d’opportunité qu’offrent les diverses crises ou faillites de politiques publiques (Hall 1993), qu’il s’agisse de la dette souveraine, des politiques monétaires, du libre-échange, du modèle de financement des universités et des services de santé, ou même des politiques migratoires.
Considérant la place qu’ils occupent dans l’espace médiatique, on peut se questionner quant à leurs modes d’action privilégiés. Encore là, la réalité s’avère plurielle. Voilà plus de trente ans maintenant que Kent Weaver nous a laissé ses catégories devenues essentielles pour départager les think tanks et auxquelles nous pouvons continuer de nous référer : « université sans étudiants », « auxiliaires de recherche » et « advocacy tanks ». Ces derniers s’apparentent davantage à des groupes d’intérêt ou de pression parlant le langage de la recherche en sciences sociales et visent d’abord à influencer les politiques publiques sur la base d’une vision normative forte et prédéfinie ou d’une cause dont ils se font les promoteurs. Selon Andrew Rich (2004), la plupart des think tanks créés depuis les années 1980 aux États-Unis s’inscriraient aujourd’hui dans la perspective de l’engagement (advocacy), voire du militantisme. Même s’ils se présentent publiquement comme les gardiens de l’intérêt général ou du bien commun, en excellant dans le marketing politique des idées, ces think tanks « de combat » attestent du renouvellement de l’agir politique par l’entremise de la recherche. L’essor des organisations de recherche indépendantes que connaissent tous les pays développés ou en voie de développement n’est rien d’autre que la conséquence logique et historique de l’évolution de l’écosystème médiatique et politique marquée par la croissance de la concurrence pour l’attention (Jones et Baumgartner 2005) et par un degré inédit d’intégration des sciences sociales dans l’élaboration des politiques publiques (Landry 2017).
Ceux qu’on pourrait présenter comme les nouveaux intellectuels politiques de notre époque, prenant la forme de groupes d’experts politisés (Lamy 2021), ne peuvent plus être ignorés pour quiconque s’intéresse aux stratégies d’influence en raison du rôle maintenant essentiel qu’occupent une quantité de think tanks au sein des coalitions d’intérêts. C’est à un pareil constat que sont arrivés différents chercheurs dans plusieurs champs d’études : en relations internationales (Abelson, Brooks et Hua 2016), en études environnementales (Plehwe 2014), en sociologie de l’expertise (Fischer 1991), même en géopolitique des idées (Béland et Cox 2011). La force gravitationnelle accrue que gagnent ces organisations atteste du niveau de sophistication, en termes de recherche, de communication et d’expertise, qu’il faut savoir incarner aujourd’hui pour tirer son épingle du jeu dans les débats politiques du XXIe siècle.
Partout dans le monde démocratique, de nouvelles rivalités entre think tanks ont émergé, réifiant les clivages idéologiques antérieurs sur le territoire de la recherche. Au Québec, le duel que se livrent l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) et l’Institut économique de Montréal (IEDM) sur un nombre toujours croissant de tribunes médiatiques donne ainsi vie à un chapitre inédit qui s’écrit sous nos yeux dans l’histoire de la lutte entre la gauche et la droite pour la définition des politiques économiques et sociales. Dans le reste du pays, la polarisation de la recherche s’est aménagée dans un sens similaire. Des organisations favorables au développement du libéralisme économique comme l’Institut Fraser, la Canada West Foundation, l’Institut C.D. Howe et l’Institut Macdonald-Laurier font concurrence à des organisations qui résistent à ce programme politique, notamment le Centre canadien de politiques alternatives, les instituts Parkland, Pembina ou Broadbent.
Le relief de ces nouvelles rivalités politiques sur le territoire de la recherche n’est pas passé inaperçu. John McLevey a démontré empiriquement qu’en matière de financement, les think tanks centristes bénéficiaient davantage des subventions gouvernementales, alors que les organisations plus à droite jouissaient davantage des ressources des entreprises privées. En ce qui a trait aux think tanks occupant la gauche du spectre politique, personne ne sera surpris de voir, là aussi, des soutiens clairs, explicites et souvent publiquement assumés avec les syndicats et les mouvements sociaux (McLevey 2014 ; 2015 ; Lamy 2019a).
D’ailleurs, ces défis de financement que doivent relever les directeurs et les fondateurs des think tanks nous obligent à les garder sous surveillance, car la marge de manoeuvre de leur action est encadrée par les idées, les valeurs et les intérêts de leurs bailleurs de fonds. Cela explique bien pourquoi certaines organisations ferment boutique lorsqu’un gouvernement est défait au profit d’un nouveau, comme ce fut le cas en Ontario avec le North-South Institute en 2014 et le Mowat Centre en 2019 (Crawford 2014 ; Cook 2019). L’inverse est aussi vrai, car des affinités avec un nouveau gouvernement peuvent mener à une amélioration significative de la situation économique des organisations de recherche indépendantes, comme ce fut le cas avec une augmentation de la dotation de 10 millions au profit de l’Institut de recherche en politiques publiques depuis l’élection de Justin Trudeau en 2015 (IRPP 2018). Plus encore, une synchronisation entre entrepreneurs de recherche et gouvernement peut aussi mener à la création de think tanks complètement neufs, comme l’illustre l’Institut canadien pour des choix climatiques qui mène des recherches visant à opérer une transition énergétique au pays à l’aide d’un programme de recherche qui n’aurait pas pu obtenir un financement de 20 millions (Meyer 2020) de la part du gouvernement de Stephen Harper entre 2006 et 2015.
Si le phénomène fait l’objet d’une attention réelle dans le monde anglophone depuis les années 1980, il n’a éveillé l’intérêt des chercheurs que depuis quinze ans dans les francophonies européenne et canadienne. À cet égard, l’engouement notable dans la littérature internationale autour du vocable « think tank » continue de franchir de nouveaux sommets, autant en français qu’en anglais, comme l’illustre la figure 2 fondée sur la méthode de visualisation N-Gram (Michel et Shen 2011) interrogeant les 40 millions de livres numérisés dans la base de données Google Books (Lee 2019).
S’il est vrai que les chercheurs anglophones ont été pratiquement les seuls à s’intéresser au sujet pendant trente ans en raison de l’exclusivité anglo-américaine du phénomène à ses débuts, en français au Canada, la production universitaire donne de plus en plus à ce thème les allures d’un champ de recherche en construction avec, notamment : une thèse de doctorat (Landry 2017), deux mémoires de maîtrise (Savard-Lecomte 2009 ; Noyer 2021), un livre (Landry 2021a), une vingtaine d’articles et chapitres, ainsi qu’un numéro de revue d’histoire (Lamy 2019b), en plus du présent numéro de Politique et Sociétés. Plus encore, il faut souligner que les chercheurs canadiens autant du côté anglophone que francophone forment désormais un relais important dans l’étude des think tanks, comme en témoignent rien qu’en 2021 deux ouvrages clés destinés au public international : un manuel général sur les think tanks (Abelson et Rastrick 2021) et une monographie critique traitant de leurs contributions en matière de politiques publiques et de connaissances (Landry 2021b).
Réseaux, médias, influence : les grands axes des contributions à ce numéro
Pourtant, plusieurs dimensions liées à ces organisations demeurent peu explorées. Se pose, au premier chef, la question des liens qu’entretiennent les think tanks avec les différents acteurs universitaires, politiques et médiatiques. C’est en effet sous l’éclairage de ces liens, et donc des réseaux qu’entretiennent les think tanks avec diverses sources de pouvoir, qu’on peut esquisser une réflexion quant à leur influence concrète en matière de politique publique. On sait d’ores et déjà que ces organisations cultivent une quantité de relations avec les partis politiques, la sphère politico-administrative, les universités, la philanthropie et les médias. En s’intégrant aux interstices de ces univers (Landry 2019), les think tanks réussissent non seulement à mobiliser des ressources matérielles auxquelles ils n’auraient pas accès autrement, mais ils obtiennent une écoute attentive de la part de divers acteurs d’influence, et ce, même si leur rôle spécifique n’est pas officialisé ou ne fait pas l’objet d’une tentative concrète d’institutionnalisation. La question du réseautage de ces acteurs s’avère donc cruciale.
C’est pourquoi les contributions proposées dans ce numéro thématique appréhendent spécifiquement ces aspects de la réalité des think tanks. Stéphanie Yates et Alexandra Turgeon se penchent ainsi sur le phénomène des portes tournantes entre les think tanks, la fonction publique et les partis politiques canadiens, dévoilant la circulation des professionnels entre ces deux univers et les solidarités qui peuvent en découler. Dans une perspective similaire, l’article coécrit par François Claveau, Olivier Santerre, Andréanne Veillette et Sylvain Rocheleau offre une contribution inédite sur la performance médiatique des think tanks au Canada. Croisant budgets, sujets et espaces de diffusion, leur démarche empirique réussit à dévoiler la complexité du commerce symbolique qu’ont développé les médias écrits et les organisations de recherche indépendantes au Canada avec les années. Julien Landry se penche sur les « réseaux de soutien », qu’ils soient universitaires ou politiques, de quatre think tanks canadiens et au rôle de leurs « alliances fondatrices » quant à la construction de leur identité organisationnelle. Le tout permet de saisir la nature du partage des ressources humaines et économiques qui découlent de ce genre de coopération implicite, qu’il s’agisse des administrateurs, des experts, des idées, des fonds, des accès aux élites ou aux auditoires. Dans une étude longitudinale, Guillaume Lamy a reconstitué la position de l’Institut économique de Montréal en matière de réchauffement climatique de 1999 à 2019, qui passe d’une posture de négation du réchauffement à celle d’une résistance systématique aux politiques climatiques contraignantes, mettant en lumière, par le fait même, l’intégration de cette organisation dans la coalition canadienne de l’industrie des hydrocarbures. Enfin, plongeant aussi dans le climatoscepticisme, Alexander Ruser montre comment un think tank a su servir de courtier entre divers acteurs populistes de droite et des organisations néolibérales afin de faire émerger tardivement un réseau d’acteurs climatosceptiques en Allemagne au XXIe siècle, là où la négation du réchauffement climatique n’occupait qu’une place négligeable.
Toutes ces contributions peuvent être reliées par un même phénomène, celui de la manifestation protéiforme de la politisation de la recherche et de la complexification des stratégies d’influence, un phénomène mondial dont les think tanks ne représentent aujourd’hui que la partie émergée d’un continent en expansion.
Parties annexes
Annexe
Figure 1
Budget annuel moyen comparé à l’inflation des 25 think tanks canadiens ayant été en activité de 2004 à 2019
Figure 2
N-Gram illustrant la croissance de l’utilisation des mots « think tank » dans les bases de données anglophone et francophone de Google Books (1950-2019)
Notes
-
[1]
Ce total exclut une quantité d’autres think tanks ne disposant pas d’un numéro d’enregistrement d’organisme de charité, entre autres : Conference Board du Canada, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), Parkland Institute, Manning Centre, Broadbent Insitute, Canada 2020, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), Institut canadien pour des choix climatiques.
-
[2]
Pendant la période allant de 2004 à 2019, il y avait 25 think tanks organismes de charité enregistrés en activité. Le calcul comprend les budgets des organisations suivantes : Asia-Pacific Foundation, Association d’études canadiennes, Atlantic Institute for Market Studies, C.D. Howe Institute, Caledon Institute, Canada West Foundation, Canadian Centre for Policy Alternatives, Canadian Constitution Foundation, Canadian Global Affairs Institute, Canadian International Council, Canadian Tax Foundation, Cardus Institute, Change Foundation, Fraser Institute, Frontier Centre for Public Policy, Institut du Nouveau Monde, Institut de recherche en politiques publiques, Institute on Governance, Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées, International Institute for Sustainable Development, Macdonald-Laurier Institute, Institut économique de Montréal, North-South Institute, Pembina Institute, Public Policy Forum, Vanier Institute of the Family, Wellesley Institute. Parmi les OSBL avec numéro d’enregistrement, seul le Centre for International Governance Innovation (CIGI) a été exclu du calcul en raison d’un budget très fluctuant d’une année à l’autre.
Bibliographie
- Abelson, Donald E. 2018. Do Think Tank Matter? Montréal : McGill-Queen’s University Press.
- Abelson, Donald E., Stephen Brooks et Xin Hua (dir.). 2016. Think Tanks, Foreign Policy and Geo-politics: Pathways to Influence. Londres : Routledge.
- Abelson, Donald E. et Christopher K. Rastrick (dir.). 2021. Handbook on Think Tanks in Public Policy. Cheltenham : Edward Elgar Publishing.
- Béland, Daniel et Robert Henry Cox (dir.). 2011. Ideas and Politics in Social Science Research. Oxford : Oxford University Press.
- Boucher, Stephen et Martine Royo. 2012. Les think tanks. Cerveaux de la guerre des idées. Paris : Éditions du Félin.
- Carroll, William K. et David Huxtable. 2014. « Expose/Oppose/Propose: The Canadian Centre for Policy Alternatives and the Challenge of Alternative Knowledge. » Journal of Canadian Labour Studies (74) : 27-50.
- Cook, Stephen. 2019. « Mowat Centre Think-Tank to Shut down after Ontario Government Eliminates Funding. » The Globe and Mail, 29 avril 2019.
- Crawford, Blair. 2014. « North-South Institute, Ottawa-based Think Tank, to Close. » Ottawa Citizen, 10 septembre 2014.
- Fischer, Frank. 1991. « American Think Tanks: Policy Elites and the Politicization of Expertise. » Governance: An International Journal of Policy and Administration 4 (3) : 332-353.
- Hall, Peter. 1993. « Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. » Comparative Politics 25 (3) : 275-296.
- Institut de recherche en politiques publiques (IRPP). 2018. « Government of Canada Announces Major Contribution to the IRPP to Create a Centre of Excellence on the Canadian Federation. » News Release, 27 février 2018.
- Jones, Bryan D. et Frank R. Baumgartner. 2005. The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems. Chicago : University of Chicago Press.
- Lamy, Guillaume. 2019a. « Les think tanks au Québec : essor d’une industrie de recherche en territoire politique. » Bulletin d’histoire politique 28 (1) : 185-204.
- Lamy, Guillaume (dir.). 2019b. « Think tanks : les métamorphoses des conseillers politiques depuis 1970 : Canada – États-Unis – Chine. » Numéro thématique du Bulletin d’histoire politique 28 (1). Montréal : VLB éditeur.
- Lamy, Guillaume. 2021. « How Advocacy Tanks Wrote the Latest Chapter in the History of Political Intellectuals. » Dans Critical Perspectives on Think Tanks Power, Politics and Knowledge. Sous la direction de Julien Landry, 20-35. Londres : Edwar Elgar Publishing.
- Landry, Julien. 2017. « Les think tanks, les sciences sociales et la généralisation du discours expert au Canada et aux États-Unis. » Thèse de doctorat en science, technologie et société. Université du Québec à Montréal.
- Landry, Julien. 2019. « Les sites d’intégration des think tanks canadiens depuis 1985. » Bulletin d’histoire politique 28 (1) : 121-142.
- Landry, Julien. 2021a. Les think tanks et le discours expert sur les politiques publiques au Canada (1890-2015). Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa.
- Landry, Julien (dir.). 2021b. Critical Perspectives on Think Tanks: Power, Politics and Knowledge. Londres : Edward Elgar Publishing.
- Lee, Haimin. 2019. « 15 years of Google Books. » Google Blog, the Keyword, 17 octobre 2019.
- McGann, James G. 2016. The Fifth Estate: Think Tanks, Public Policy, and Governance. Washington DC : Brookings Institution Press.
- McGann, James G. 2020. 2019 Global Go to Think Tank Index Report. Pennsylvanie : University of Pennsylvania – Lauder Institute.
- McLevey, John. 2014. « Think Tanks, Funding, and the Politics of Policy Knowledge in Canada. » Canadian Review of Sociology 51 (1) : 54-75.
- McLevey, John. 2015. « Understanding Policy Research in Liminal Spaces: Think Tank Responses to Diverging Principles of Legitimacy. » Social Studies of Science 45 (2) : 270-293.
- Medvetz, Thomas. 2012. Think Tanks in America. Chicago : University of Chicago Press.
- Meyer, Carl. 2020. « Newly-formed Canadian Institute for Climate Choices Calls on Canada to Prepare for Change. » Canada’s National Observer, 21 janvier 2020.
- Michel, Jean-Baptiste et Yuan Kui Shen. 2011. « Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books. » Science 331 (6014) : 176-182.
- Mouton, Gauthier. 2019. « Chine : les think tanks au service de l’État. » Bulletin d’histoire politique 28 (1) : 23-42.
- Noyer, Julie. 2021. « Les stratégies d’influence des think tanks au Québec. » Mémoire de maîtrise en science politique. Université du Québec à Montréal.
- Plehwe, Dieter. 2014. « Think Tank Networks and the Knowledge–Interest Nexus: The Case of Climate Change. » Critical Policy Studies 8 (1) : 101-115.
- Rich, Andrew. 2004. Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise. New York : Cambridge University Press.
- Savard-Lecomte, Marie-Odile. 2009. L’Institut économique de Montréal, un think tank influent sur la scène des idées au Québec. Mémoire de maîtrise en science politique. Université de Montréal.
Liste des figures
Figure 1
Budget annuel moyen comparé à l’inflation des 25 think tanks canadiens ayant été en activité de 2004 à 2019
Figure 2
N-Gram illustrant la croissance de l’utilisation des mots « think tank » dans les bases de données anglophone et francophone de Google Books (1950-2019)

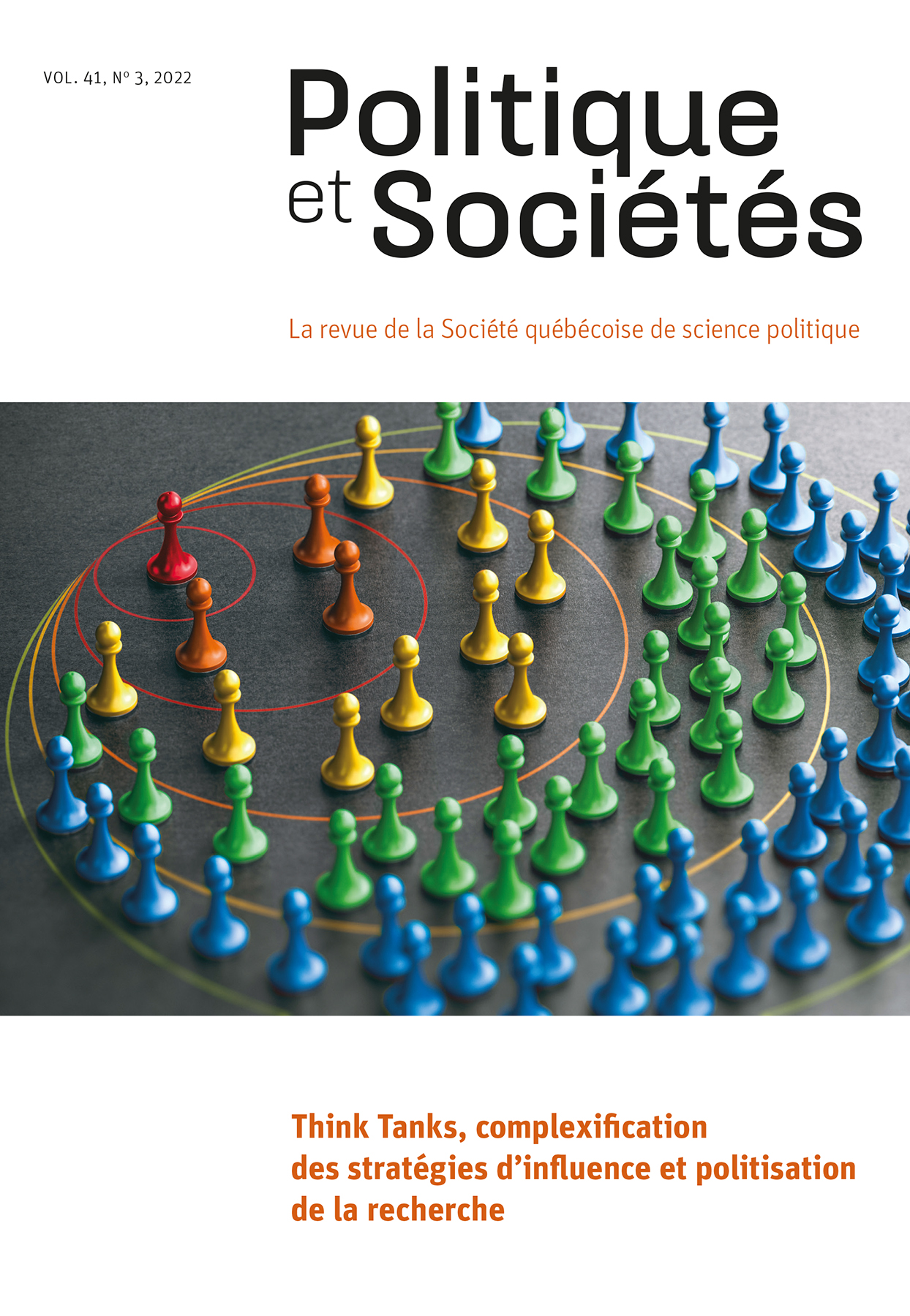


 10.7202/1068565ar
10.7202/1068565ar