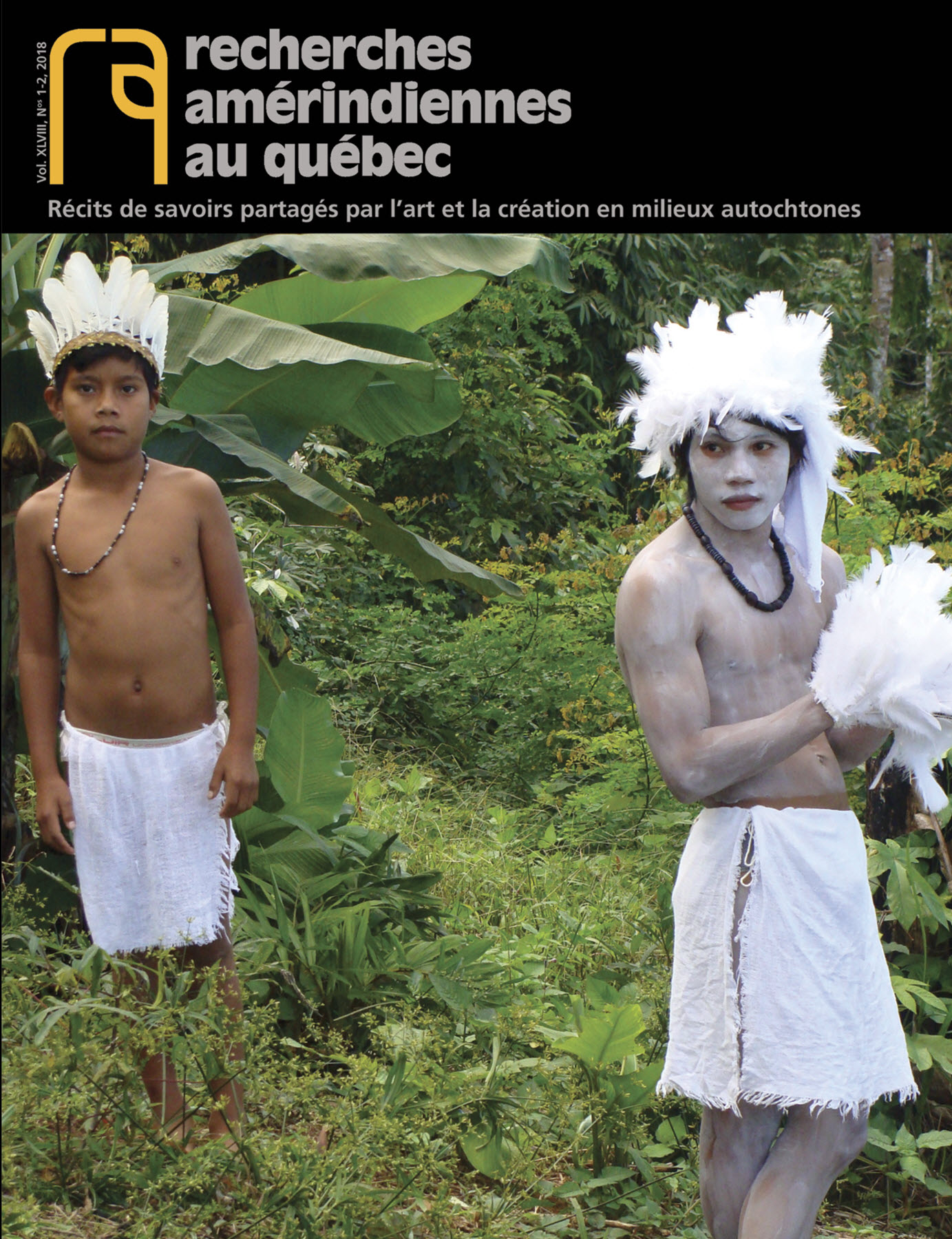Corps de l’article
Je veux faire part ici de ma réflexion sur l’évaluation dans le cadre des travaux que j’ai menés en collaboration avec l’équipe Design et Culture matérielle (DCM) autour de la problématique identitaire des communautés autochtones. Tous les travaux d’évaluation auxquels je fais référence ci-après, tant ceux réalisés avec le groupe DCM que ceux auxquels j’ai collaboré antérieurement, ont été réalisés dans une approche formative où l’évaluation était considérée comme pouvant apporter une contribution au développement des communautés.
En 2008, Élisabeth Kaine et Pierre De Coninck, de l’équipe DCM, me consultent sur le développement d’outils de mesure pour évaluer des projets menés avec des communautés autochtones. Nos échanges entourant l’adaptation d’outils de mesure font ressortir la difficulté d’utiliser des approches classiques avec les communautés autochtones tant pour l’intervention que pour l’évaluation, le regard extérieur et objectif ne faisant qu’ajouter à leur perception d’être objet d’analyse et d’exclusion. L’équipe DCM avait tenté dans les années 2000 plusieurs expériences en vue d’évaluer ses projets. Entre autres, en 2009[1] après notre première collaboration (voir Kaine, Bellemare et De Coninck 2009), l’équipe met en place une stratégie d’évaluation sur plusieurs jours impliquant toutes les parties prenantes d’un projet de recherche-action mené au Brésil en 2008 (ibid.). Cette expérience a amené les chercheurs DCM à se questionner sur la valeur scientifique des résultats d’une telle démarche évaluative participative.
En 2014, j’entreprends une nouvelle collaboration avec l’équipe DCM, cette fois plus en profondeur, sous la supervision de Pierre De Coninck. L’équipe me demande, dans un premier temps, de développer quelques indicateurs simples et applicables par les membres de l’équipe DCM, mais aussi par les acteurs concernés dans les communautés, et dans un deuxième temps de tester la mesure d’un indicateur à partir d’un projet DCM.
Pour arriver à répondre à cette demande, j’ai senti le besoin, d’une part, d’agir de façon structurée – cadre conceptuel et cadre logique de l’intervention – pour mieux comprendre l’approche de l’équipe DCM et la manière dont ce groupe opère sur le terrain. J’ai également réfléchi aux liens que je pouvais faire avec mes expériences professionnelles antérieures dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale menée en collaboration avec le monde universitaire et des intervenants engagés sur le terrain. D’ailleurs dans certains projets, des individus issus de communautés autochtones ou vivant des problématiques identitaires étaient visés. Sans vouloir comparer directement la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale aux problématiques rencontrées au sein des sociétés minoritaires autochtones, notamment celles qui sont associées à la perte d’identité culturelle, je sentais qu’il était possible de faire des rapprochements. Mes échanges avec les praticiens dans les deux champs d’expertise m’amenaient à constater l’existence de visées, d’approches et de questions fondamentales analogues.
Tout comme l’équipe DCM, tous les acteurs avec lesquels j’ai collaboré étaient confrontés à la question des effets réels de leurs actions. Faisaient-elles avancer réellement la communauté ? Amélioraient-elles les conditions et la qualité de vie des individus et de la communauté ou d’un territoire ? Ces questions demeuraient souvent sans réponse ou ne trouvaient que des réponses partielles, faute de ressources et d’expertise en évaluation pour faire le point, mais aussi compte tenu de l’impossibilité de réponses claires et absolues devant la complexité de phénomènes aussi réels et insaisissables que sont la pauvreté, l’exclusion sociale et la quête d’identité d’un peuple.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, trois expériences professionnelles m’ont permis de faire des rapprochements avec l’équipe DCM : ma collaboration avec la Ville de Montréal pendant plus de dix ans, particulièrement lors du projet pilote de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur cinq territoires ; ma participation à la traduction d’un ouvrage américain sur les initiatives de revitalisation communautaires les plus probantes menées aux États-Unis ; et ma collaboration à l’évaluation d’une initiative provinciale, Alliances pour la solidarité, visant à renforcer l’action territoriale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Le projet RUI
Dans le cadre du Projet pilote de revitalisation urbaine intégrée (RUI), j’ai participé à l’élaboration de la stratégie de suivi et d’évaluation sur une période de cinq ans (2005-2010). Ce projet visait à expérimenter une approche considérée comme novatrice sur le plan du leadership local dans cinq territoires montréalais dévitalisés tant sur le plan social et économique qu’environnemental (CREXE et ÉNAP 2010). Ces territoires sont caractérisés par la pauvreté et l’absence de ressources publiques et communautaires, et les individus, souvent de différentes origines ethniques, sont aux prises avec de nombreuses problématiques sociosanitaires et identitaires. Ces territoires sont également dévitalisés sur le plan environnemental par l’absence d’espaces verts et du fait qu’ils se retrouvent enclavés et isolés par des autoroutes, des voies ferrées ou à proximité de terrains contaminés, de parcs industriels, etc. Ces problématiques sociales, économiques et environnementales et même identitaires s’apparentent à celles que vivent certaines communautés autochtones. Tant les territoires visés par le projet RUI que les communautés avec lesquelles travaille l’équipe DCM sont touchés sur plusieurs dimensions fondamentales (multifactorielles), d’où la complexité à bien saisir et évaluer les effets des actions menées pour pouvoir intervenir.
L’approche RUI devait permettre à la communauté de chacun de ces territoires de se doter d’un leadership local fort basé sur la concertation intersectorielle, la mobilisation citoyenne et la participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et cela, en maintenant des relations avec les acteurs externes, notamment les organisations publiques, communautaires et privées aux paliers municipal, régional et provincial. L’objectif était d’amener la communauté à se définir, à s’approprier l’action et à se représenter auprès des diverses instances de pouvoir.
Au cours des cinq années de suivi entre 2005 et 2010, la courbe du cheminement de chacune de ces communautés présentait de grandes variations. Parmi les grandes forces qui se dégagent de cette approche, il ressort qu’elle favorise le rassemblement des citoyens, intervenants et organismes du territoire autour d’une vision partagée basée sur l’analyse des besoins réels tels que vécus par la collectivité. Les actions à entreprendre sont également mieux ciblées en regard des réalités propres au territoire. Cette approche se distingue des programmes publics et des actions entreprises qui s’appliquent en général aux besoins des populations dans un contexte défini à partir de conditions moyennes. L’approche RUI vise à se rapprocher de la population et à prendre des formes mieux adaptées aux besoins et aux réalités spécifiques d’une collectivité, à ses valeurs et son capital humain ainsi qu’à sa démographie et son territoire géographique. Par ailleurs, cette approche permet une meilleure représentation de la collectivité et permet d’attirer l’attention sur des territoires souvent oubliés et laissés pour compte.
Parmi les nombreux défis, il y a la difficulté liée à l’ancrage de la démarche dans la communauté et celle de faire émerger parmi ses membres un leadership fort. Les démarches qui ne réussissent pas à s’imposer suffisamment dans le milieu et à être reconnues dans les structures de pouvoir des paliers régional et national demeurent fragiles et ont tendance à subir des revers importants lorsqu’un partenaire se retire ou lorsqu’un membre important du comité d’action quitte. Les conditions de travail (salaire, horaire de travail, compétences polyvalentes, absence d’infrastructure, personnel minimal...) associées au poste de coordonnateur de la démarche font qu’il est difficile de recruter et de maintenir le personnel hautement qualifié requis pour exercer et imposer son leadership tant dans le territoire qu’aux différents paliers de pouvoir. Une autre grande difficulté, et non la moindre, concerne la mobilisation citoyenne, qui exige des efforts soutenus et continus.
Par ailleurs, certaines interventions dans les domaines de l’emploi et du logement s’avèrent pratiquement impossibles sans une alliance étroite avec les paliers de gouvernement régional et national, ce qui restreint substantiellement le développement d’une communauté ou d’un territoire à moyen terme.
Je retiens ces liens entre l’approche DCM et l’approche RUI : ces deux approches misent à la base sur les forces du milieu et cherchent à renforcer le capital humain. Tout comme l’approche RUI, l’approche DCM permet une meilleure représentation des communautés auprès des différents paliers de pouvoir, basée sur les besoins réels propres à la collectivité, notamment parce que ces approches reposent toutes deux sur la mobilisation citoyenne et l’émergence de leaders forts dans la communauté. Par ailleurs, les deux approches témoignent des efforts continus qu’exigent la mobilisation citoyenne et l’émergence de leaders forts dans la communauté, qui ne se réalisent qu’à petits pas, en développant la complicité et en construisant des relations de confiance sur plusieurs années.
Traduction de l’ouvrage Voices from the Field III (2010)
En 2010, je collabore avec l’organisme communautaire montréalais Dynamo, reconnu pour son engagement dans la communauté, à la traduction de l’ouvrage Voices from the Field III (Kubish et al. 2010). Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, quatre chercheurs et des collaborateurs y font une revue critique des initiatives de revitalisation communautaires les plus probantes menées aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, de 1990 à 2010.
Il faut souligner d’emblée que le contexte dans lequel avaient été mises en place ces initiatives diffère du contexte québécois. Les mesures sociales étant moins développées de façon générale aux États-Unis, de nombreuses fondations – dont Casey, Ford, Rockfeller et Kellogg, parmi les plus connues – jouent un rôle important dans le développement de quartiers défavorisés. Elles s’associent directement ou indirectement avec les communautés et agissent en collaboration avec différents partenaires, dont les municipalités, le gouvernement fédéral, les promoteurs immobiliers et le secteur privé, etc., pour agir sur les plans environnemental, social et économique.
Les initiatives retenues pour analyse par les chercheurs (48 projets) ont toutes en commun un cadre global et intégré d’analyse de la pauvreté tenant compte du caractère multifactoriel et de la complexité du phénomène de la pauvreté. Elles accordent une priorité à la mobilisation des collectivités par une participation accrue des membres les plus vulnérables de la communauté, par l’appropriation de l’action par la communauté à travers la planification et la réalisation des actions et le développement social, en misant sur la consolidation des relations entre les membres et sur le sentiment d’appartenance.
Les auteurs soulignent les progrès importants réalisés au cours de cette période dans les différents secteurs. Ainsi, de plus en plus de programmes de qualité ont été développés et rendus accessibles aux populations les plus démunies, entre autres, un meilleur accès à de l’aide pour la réussite scolaire ou à des soins de santé. La qualité de vie des personnes directement touchées par les programmes s’est aussi améliorée, entre autres par l’accès à des logements salubres, à de l’aide alimentaire, à des soins de santé et à des programmes scolaires rehaussés. Des avancées ont également été observées dans le secteur du développement économique de ces quartiers, par exemple par la revitalisation d’artères commerciales et l’installation de marchés alimentaires ou de centres de services. Les auteurs conviennent que ces approches ont contribué significativement à atténuer les problèmes, notamment chez les personnes directement touchées par les interventions, mais la plupart de ces initiatives ne sont pas parvenues à éradiquer la pauvreté et à amener des changements à l’échelle de la collectivité, trop de leviers politiques et économiques échappant au contrôle des acteurs locaux. Toutefois, selon les auteurs, bien que de telles initiatives aient une portée limitée, lorsqu’elles sont bien structurées elles accroissent la visibilité et aident à obtenir de nouveaux fonds publics, privés et philanthropiques.
En plus de la mobilisation des collectivités (participation accrue, appropriation de l’action et développement du capital humain), les chercheurs identifient cinq facteurs de succès dans les initiatives territoriales intégrées : une mission claire ; l’identification des changements précis attendus en lien avec l’action ; des objectifs réalistes à la mesure des capacités de la communauté ; des liens de collaboration tant avec les partenaires internes qu’avec les acteurs externes ; et une culture d’apprentissage et d’adaptation. Les auteurs soulignent qu’aucune démarche si globale et efficace soit-elle, ne peut à elle seule amener des changements structurels et éradiquer la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale, celle-ci étant intrinsèquement liée aux inégalités sociales et économiques. Ils insistent sur l’importance de développer une culture d’apprentissage et d’adaptation, où le souci de réfléchir et d’évaluer les réalisations devient la responsabilité de tous les acteurs et un outil de travail essentiel à l’avancement du projet.
Concernant l’évaluation, les auteurs de Voices from the Field III proposent d’élaborer des cadres encore plus robustes, identifiant mieux les populations ciblées, les activités plus probantes et des indicateurs de progrès à court, moyen et long termes. Ils recadrent l’évaluation en tant qu’outil de travail pour les praticiens et le rôle de l’évaluateur comme accompagnateur des praticiens, et non comme un expert qui impose une vision objective externe.
Cet ouvrage m’a fait comprendre encore une fois l’énorme défi à relever lorsqu’on s’attaque au développement des communautés fragilisées comme celles des territoires dévitalisés de la RUI à Montréal et les communautés autochtones ayant une problématique identitaire. Ce qui m’a surtout interpellée, c’est l’importance de travailler non seulement avec les forces du milieu, mais aussi avec les forces externes des différents secteurs pour s’en faire des alliés nécessaires pour amener des changements en profondeur.
À cet égard, il m’apparaît de premier abord que l’équipe DCM semble surtout concentrée dans son secteur culturel. Les chercheurs, de même que les intervenants et les membres des communautés autochtones associés à l’intervention, semblent surtout appartenir au secteur de la culture et de l’art. Il ne semble pas y avoir d’intervenants du secteur de la santé et des services sociaux ou d’intervenants économiques directement liés à l’action. Toutefois, l’intervention de l’équipe DCM est effectuée dans une approche globale et elle vise des actions à tous les paliers pour représenter les cultures autochtones, leur donner de la visibilité et les valoriser. Peut-être l’équipe a-t-elle misé sur des actions à la mesure de ses capacités d’agir ? D’autre part, chaque communauté a ses valeurs, sa structure de pouvoir et ses façons de faire, sa langue, ainsi que des secteurs d’action qui lui sont propres et un positionnement spécifique face à cette problématique identitaire. Bien sûr, chaque situation de pauvreté et d’exclusion sociale a ses particularités, mais il m’apparaît que c’est encore plus marqué au sein des communautés autochtones. Dans ce contexte, les partenaires peuvent varier d’une communauté à l’autre. De même, il peut être encore plus difficile de transférer les apprentissages d’une communauté à l’autre.
En ce qui concerne le rôle et l’importance de l’évaluation dans ce domaine d’intervention, je suis assez d’accord avec les auteurs de l’ouvrage américain. L’évaluateur doit lui aussi sortir de son petit univers, aider les intervenants et les outiller pour qu’ils puissent mieux évaluer l’efficacité de leurs actions face aux résultats. Les intervenants expriment une certaine résistance face à l’évaluation arguant qu’ils agissent avec pragmatisme et dévouement à une cause, qu’ils ne s’y connaissent pas en évaluation et qu’en plus, ils n’ont pas la disponibilité pour ce type d’activités. Il est important qu’ils reconnaissent que, pour avancer, il faut pouvoir être critique soi-même par rapport à ses actions. En développant leur esprit critique, ils seront également mieux à même de le reconnaître lorsqu’ils sont sur la bonne voie.
L’initiative québécoise « Alliances pour la solidarité »
Dans le cadre de l’initiative « Alliances pour la solidarité » du Gouvernement du Québec (PAGSIS 2010-2015)[2], j’ai été chargée de réaliser l’évaluation de la mise en oeuvre et de ses premiers effets structurants. En parallèle, des chercheurs de l’INRS-UQO-CRSA réalisaient une étude sur « la concertation intersectorielle et la participation citoyenne pour soutenir le développement des communautés »[3]. Cette étude visait à comprendre en quoi le processus de mobilisation-concertation sur une base territoriale (régionale et locale) promu par la mise en place des Alliances pour la solidarité était structurant et contribuait à renforcer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Chaque Alliance pour la solidarité se concrétisait par une entente signée entre le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et l’organisme régional mandaté pour assurer la coordination et la reddition de compte de la démarche territoriale. Cette approche des Alliances pour la solidarité (2010) apparaissait comme un pas dans la bonne direction. Elle succédait à l’approche territoriale intégrée (ATI), centrée sur un territoire relativement petit et le développement de sa collectivité en misant essentiellement sur ses forces internes. Bien que l’approche ATI ait permis le rapprochement et la complicité de ses membres et qu’elle ait ainsi favorisé le développement d’une vision commune, elle n’avait pas suscité le partage de connaissances et d’expertises attendu et semblait même, au vu de certains, avoir eu un effet de repli. Cette nouvelle initiative des Alliances se basait sur une approche régionale favorisant l’ouverture, l’entraide et une « alliance » entre les territoires locaux d’une même région. Elles avaient pour but de donner aux régions les moyens de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par des actions régionales et locales structurantes, c’est-à-dire qu’elles devaient mener à des actions tenant compte des besoins spécifiques – tels que, par exemple, l’étendue et l’isolement du territoire dans des régions comme l’Abitibi ou les Îles-de-la-Madeleine –, de l’économie locale et des ressources disponibles propres à chaque territoire. Les actions planifiées étant plus directement liées aux besoins des territoires, elles étaient perçues comme étant plus prometteuses en termes d’effets significatifs sur la population vulnérable ainsi que sur l’identification des actions à mener. Deux grandes conditions étaient posées pour obtenir un financement sur cinq ans : la mobilisation et la concertation de tous les acteurs, de même que l’élaboration d’un plan d’action régional tenant compte des démarches locales et des réalités spécifiques. La concertation sociale au Québec ayant pris forme dans les années 80 dans plusieurs territoires, l’esprit des Alliances visait à construire à partir des concertations existantes, et non repartir de zéro. Ainsi, il était important que le plan d’action régional soit élaboré à partir des initiatives et des concertations locales. Par exemple, une région avait pu identifier la « sécurité alimentaire » comme priorité, et les projets locaux retenus étaient alors en lien avec cette priorité – par exemple, la mise en place de cuisines collectives ou d’un jardin communautaire, ou la distribution de repas auprès des personnes isolées.
L’étape initiale de mise en oeuvre, soit l’étape de mobilisation et de concertation menant à un plan d’action, a exigé plus d’efforts et de temps que prévu. L’analyse des processus effectuée par les chercheurs de l’INRS-UQO-CRSA dans six régions du Québec a montré que les dynamiques des territoires sont caractérisées par trois types de relation : de coopération, conflictuelle et de coopération/conflictuelle, variant selon les phases et enjeux de l’action, en fonction des interactions entre les acteurs, des changements d’acteurs dans les structures et de contexte (élection municipale) en cours de processus. Les auteurs soulignent que tous les territoires ont dû procéder à plusieurs ajustements et négociations qui leur ont permis d’évoluer d’une dynamique conflictuelle à une dynamique de coopération et de co-construction, ce qu’ils considèrent comme une condition essentielle pour amener des changements structurants et établir de nouvelles façons de faire plus adaptées à chaque territoire. Leur analyse des pratiques a fait ressortir les différences dans la conception et la logique d’agir en regard de la pauvreté selon les différents groupes d’acteurs (intervenants institutionnels, communautaires, gestionnaires, élus, citoyens). À titre d’exemple, certains élus ne voulaient pas reconnaître l’existence de la pauvreté sur leur territoire et envisageaient le projet des Alliances sous l’angle d’un ajout de ressources financières pour réaliser des projets sociaux. De leur côté, certains organismes communautaires refusaient de voir les élus comme pouvant jouer un rôle positif dans la lutte contre la pauvreté et ne souhaitaient pas transiger avec eux. L’échange de confrontation-négociation a mené les différents acteurs à une reconnaissance mutuelle de leur rôle respectif et de la nécessité de travailler ensemble dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En plus de favoriser l’appropriation de l’action par les différents acteurs du milieu, cela a permis d’édifier les assises de la démarche propre à chaque région.
Par contre, l’analyse des chercheurs fait ressortir la difficulté d’inclure, de mobiliser et d’assurer, aux différentes étapes de la démarche, la participation active des personnes directement touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale. Celles-ci sont plus souvent interpellées sur des bases ponctuelles et très rarement sollicitées pour faire partie de comités de travail à titre de partenaires dans les étapes d’élaboration et de planification.
Dans un survol de la littérature sur l’intervention territoriale intégrée réalisé par l’organisme Communagir (2015), il ressort un consensus sur l’importance de faire participer activement les personnes directement touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale. Le but ultime recherché de toute démarche de lutte dans ce domaine est de permettre aux individus et aux communautés d’acquérir une autonomie sociale et économique pour être capables de se prendre en charge. Selon certains auteurs, les personnes et les communautés ne peuvent s’en sortir seules, cependant elles sont les mieux placées tant pour identifier leurs difficultés et leurs besoins que pour trouver des solutions (expertise du vécu), et elles doivent adopter elles-mêmes de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements.
La mobilisation des personnes ciblées par la problématique de même que la mobilisation des citoyens présentent un défi de taille. Selon certains auteurs, les procédures habituelles de mobilisation et de concertation, favorisant les débats cartésiens et argumentaires, doivent être revues. Elles doivent être repensées, adaptées, réinventées dans un climat de confiance et de respect pour les rendre plus inclusives et ouvertes aux rythmes, langages et manières de penser des personnes et des communautés vulnérables.
Enfin, je dégage de mes expériences professionnelles quatre grands constats : l’importance d’aborder la pauvreté et l’exclusion sociale sous différentes dimensions pour en saisir la complexité ; la reconnaissance de la participation active des personnes directement touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale ; l’ancrage solide de l’action dans le milieu pour que celle-ci soit sous la responsabilité des acteurs du milieu ; la concertation et l’arrimage de la démarche aux autres secteurs et à tous les paliers de pouvoir.
L’approche DCM en regard de ces expériences
Deux éléments principaux de l’approche DCM m’apparaissent ressortir en regard de ces expériences : l’importance qu’accorde l’équipe DCM à la nécessité d’être près de la communauté et de ses membres, mais aussi, un peu à l’opposé, le peu de liens avec les autres secteurs d’activité, notamment celui de la santé et des services sociaux. Tel que déjà mentionné, j’ai l’impression que l’équipe s’est concentrée dans son propre domaine d’expertise (l’art, le design et la culture), développant sa façon à elle d’opérer (l’éducation, outils de représentations culturelles en s’associant aux différentes communautés) dans une approche globale ayant ses dimensions humaine, sociale, économique et politique. À première vue, cette approche m’apparaît contrastée avec les pratiques auxquelles j’ai collaboré, où la concertation intersectorielle représente une priorité incontournable. Je ne peux, par ailleurs, ignorer les percées importantes à différents paliers et la volonté profonde de l’équipe d’aider les communautés autochtones à se reconnaître et à se valoriser. Face à certaines problématiques complexes et selon les ressources disponibles, mieux vaut peut-être, ou du moins serait-il tout aussi valable, de rester concentré dans un secteur plutôt que de vouloir rallier tous les secteurs ou joindre les mouvements entrepris dans d’autres secteurs et ainsi éparpiller ses énergies. Cela semble cohérent avec l’approche de l’équipe DCM d’abord fondée sur le pragmatisme et la sensibilité du terrain plutôt que sur des approches théoriques. À cet égard, l’équipe DCM semble préconiser une approche inclusive et ses actions sont toujours élaborées et menées en partenariat avec les communautés. Le projet d’exposition au Musée de la civilisation du Québec en est un parfait exemple. Il a été mis sur pied en maximisant la participation active des membres des communautés autochtones par leur témoignage, et le projet a été réalisé en partenariat avec les onze nations autochtones. De plus, à cet égard, l’équipe DCM a développé en co-création avec des artistes autochtones toute une gamme de produits de communication vulgarisés tels que des expositions, des publications, des outils interactifs et des vidéos favorisant l’identification des participants autochtones.
Cela dit, je constate une convergence sur plusieurs aspects de l’approche DCM avec les différentes approches décrites ci-dessus. L’approche DCM, bien qu’oeuvrant principalement sur le plan de la transmission culturelle, poursuit des visées similaires aux initiatives de lutte contre la pauvreté, soit de soutenir et renforcer les communautés dans leur quête d’identité afin que les individus et les communautés se développent, retrouvent leur autonomie et s’épanouissent. Les moyens déployés misent, tout comme les autres démarches, sur le développement des compétences des individus pour en faire des leaders de leur communauté, ainsi que sur le développement de leurs capacités d’agir collectivement (pouvoir d’agir) et de leurs capacités organisationnelles pour développer des partenariats efficaces entre eux et avec des acteurs aux paliers provincial et fédéral. À première vue, l’approche DCM est également confrontée aux mêmes grands défis que les autres démarches, soit la mobilisation des communautés qui exige en continu des efforts et du temps, la portée limitée de ses interventions pour amener des changements tangibles et observables, la pérennité des actions dans le temps et leur appropriation par le milieu et, enfin, la capacité du milieu à se donner les moyens d’apprendre et de s’adapter.
Projet pilote d’évaluation avec l’équipe DCM
Ce recul sur les travaux auxquels j’avais participé m’a permis de mesurer l’importance de la participation active des individus, de l’appropriation de l’action par le milieu et de l’importance de l’ouverture vers l’extérieur pour tout projet de développement communautaire.
La démarche que j’ai réalisée avec l’équipe DCM en vue de développer un cadre d’évaluation et des indicateurs s’est largement inspirée des travaux résumés ici. Pour un évaluateur, qui est un acteur externe, c’est toujours un défi de bien saisir une démarche ou un projet, notamment ses fondements et ses visées, d’où l’importance de l’élaboration du cadre conceptuel et du cadre logique (élaboré sous la supervision de Pierre De Coninck). À partir du cadre logique, des indicateurs ont été identifiés pour apprécier les processus et mesurer les résultats et les effets recherchés. Parmi les indicateurs développés dans les travaux antérieurs avec l’équipe DCM, nous avions retenu la participation des individus et des communautés comme indicateur central, c’est-à-dire que les membres des communautés représentent le « moteur » des changements.
L’évaluation de la participation peut se mesurer à différents niveaux :
Le processus : par la présence des individus et des communautés aux différentes étapes du projet, de sa conception à sa réalisation et jusqu’à son évaluation, c’est-à-dire qu’on examine comment les pratiques (les façons de faire) favorisent la présence des personnes et des communautés autochtones.
Les résultats : par le nombre de personnes, groupes, communautés, selon leur statut et leur rôle, s’il y a lieu, ayant participé aux différentes activités réalisées. Les résultats se mesurent surtout de façon quantitative et servent généralement dans les exercices de reddition de comptes.
Les effets : par l’affirmation de soi et de sa culture, c’est-à-dire la qualité de la participation des individus et des communautés. Il est souhaité que l’activité amène les personnes et les communautés à s’affirmer davantage par leur pouvoir d’agir, c’est-à-dire à prendre les décisions qui définissent leurs conditions de vie et à définir leur place dans la société.
J’ai suggéré à l’équipe DCM de tenter de mesurer les effets de la projection du film Indian Time, de Carl Morasse (2016), sur la participation des membres des communautés autochtones. Ce film a été réalisé à partir de témoignages des membres des différentes communautés autochtones dans le but de leur donner la parole dans le cadre de l’exposition du Musée de la civilisation du Québec (MCQ) [voir section suivante]. Tel que mentionné plus haut, dans mes premiers échanges avec les chercheurs, il a été convenu qu’il était inapproprié, à cause de l’effet d’objectivation provoqué chez les personnes, de recourir aux questionnaires et échelles de mesure classiques validées, comme ceux sur l’affirmation de soi ou l’estime de soi. Par contre, je crois que c’est possible de s’en inspirer pour développer des outils adaptés. La consultation de quelques ouvrages, entre autres, celui sur la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryen (2008) avec laquelle j’avais travaillé dans le cadre de la mesure d’effets intermédiaires chez les participants dans les entreprises d’insertion, a mené à l’identification des dimensions de l’affirmation de soi. L’affirmation de sa propre identité est complexe à appréhender et réfère, non seulement à la façon d’affirmer quelque chose, mais aussi au sentiment exprimé et à l’attitude qui l’accompagne. Ainsi, nous avons retenu trois dimensions de la communication pour mesurer qualitativement les effets sur la participation : l’expression (de passive à vouloir agir), le sentiment (de l’indifférence à la fierté et ou au sentiment d’appartenance), l’attitude (du laisser-faire à la recherche de solution). Bien que chaque école de pensée en psychologie (humaniste, cognitive, comportementale et autres) privilégie une forme d’expression ou une autre, depuis les années 1980 les psychothérapeutes tendent de plus en plus à avoir une pratique éclectique, c’est-à-dire qu’ils multiplient les approches et les techniques et reconnaissent les formes d’expression variables selon les clients.
Étant moi-même psychologue de formation, je considère que toutes ces formes d’expression sont importantes et que chaque individu a sa propre façon de s’exprimer, utilisant, selon sa personnalité et les situations, les formes qui lui conviennent.
Aux trois formes d’expression, pour compléter la mesure, les thèmes abordés et les cibles (individus, communautés autochtones et allochtones) ont été ajoutés à la grille d’analyse pour tenir compte des réalités propres aux communautés autochtones. L’équipe de chercheurs avait déjà fait un travail de catégorisation de contenus menant à onze thèmes et dans le présent exercice, les thèmes suivants ont été retenus : religion et croyances, événements historiques et histoire familiale, traditions, sévices, métissages et transmission, apprentissages et savoirs.
L’activité proposée consistait à projeter le film aux communautés autochtones dans le cadre d’« activités de retour » visant à présenter les outils développés (catalogues, livres, site web, etc.) par l’équipe de chercheurs DCM et La Boîte Rouge VIF (BRV). Ces activités visent à favoriser l’appropriation par la communauté des outils dont fait partie le film Indian Time. Les membres des communautés visitées étaient alors conviés vers 17 h pour un souper communautaire suivi de la projection du film. Après la projection, les gens étaient invités à partager leurs réactions ; un animateur intervenait minimalement pour les stimuler et assurer que tous puissent prendre la parole.
Pour les besoins du présent exercice, le film Indian Time, de Carl Morasse (2016), a donc été retenu et la projection a eu lieu dans la communauté algonquine de Kitigan Zibi au cours du printemps 2017. Quinze personnes ont assisté à la projection, et douze sont restées pour les échanges. Pendant la projection, j’ai noté les différentes réactions associées aux scènes projetées, que j’ai ensuite analysées à l’aide de la grille d’analyse développée.
Le film Indian Time (Morasse 2016) a été réalisé à partir de la sélection de témoignages autochtones et de scènes filmées dans le cadre d’une grande concertation menée par l’équipe DCM pour la scénarisation des thèmes et la production d’une exposition sur les peuples autochtones produite en partenariat avec le Musée de la civilisation du Québec (C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit au xxie siècle, MCQ 2015). Des représentants des communautés autochtones étaient invités à parler librement de leur culture en pensant à ce qu’ils aimeraient dire aux autochtones ou aux allochtones ou encore à leurs proches, sans cadre précis ou avec des questions très ouvertes (p. ex. « Que voulez-vous dire aux membres de votre communauté ou aux Blancs ? »). La réalisation du film visait à favoriser l’expression et l’affirmation de soi des personnes. Les témoignages ont été captés sous différentes formes : entrevue générale, Vox pop (témoignage devant la caméra, le participant étant isolé dans une pièce), entrevue sur la cartographie du territoire, entrevue en déplacement, contexte libre...
Déroulement de l’activité
Pendant la projection
Les gens sont demeurés très attentifs tout au long de la projection. Différentes réactions – rires, sourires, chuchotements, exclamations, échanges – ont été observées pour plusieurs scènes. Deux scènes, deux moments forts, ont fait réagir presque tout l’auditoire : la séquence de la cordonnerie du pensionnat de Maliotenam, associée (dans la grille d’analyse) à des sévices passés, et le témoignage de l’Innu Richard Mollen portant sur l’impression d’avoir deux cerveaux – un cerveau blanc et un cerveau autochtone – associée aux métissages et aux réalités contemporaines dans la grille d’analyse développée (voir plus bas).
À un degré moindre, mais important, quelques autres scènes du film ont suscité des réactions chez plusieurs personnes : 1) lorsque l’Inuite Jessica Arngak prépare des lagopèdes tout en racontant comment elle a repris confiance en elle, scène associée aux traditions, sévices et guérison ; 2) lorsque le castor piégé apparaît à l’écran, scène associée aux traditions, à la transmission des savoirs ; 3) lorsque l’aînée crie Mary Jacob Katapatuk finit d’assembler les bandes de peaux de lièvre pour faire un manteau pour un bébé, autre scène associée aux traditions et à la transmission des savoirs.
La « grille d’analyse des échanges après la projection » ne vise pas à définir une progression linéaire du cheminement des individus et des communautés autochtones à partir de préconceptions théoriques. Il s’agit surtout d’un outil pour aider à appréhender et mieux comprendre comment se manifestent par la communication les effets ultimes recherchés, soit l’affirmation de soi. Ce tableau présente les dimensions de l’échelle d’autonomisation développée dans le cadre de ces travaux.
Les échanges exprimés après la projection
La majorité des personnes se sont exprimées. J’ai recueilli et analysé quinze témoignages à l’aide de la grille d’analyse. L’analyse a fait ressortir ceci :
L’expression : plus d’un témoignage sur deux exprimait une prise de position ou faisait référence à une action.
Les sentiments : les sentiments exprimés sont partagés entre, d’une part, la nostalgie et le ressentiment et, d’autre part, la fierté et le sentiment d’appartenance. Plusieurs témoignages empruntaient le « nous » (comme communauté). Personne n’est resté indifférent ou n’a exprimé qu’il ne se sentait pas concerné.
L’attitude : quelques personnes prenaient une position défensive, mais la majorité exprimait une réflexion, le désir de comprendre ce qui est arrivé et pourquoi, tandis que d’autres étaient à la recherche de solution.
Les thèmes : les thèmes abordés étaient assez variés. Les sévices subis dans le passé étaient très présents dans les témoignages, mais le thème de la guérison a été soulevé par plusieurs, ainsi que les réalités contemporaines.
Les cibles : de nombreux échanges et témoignages faisaient d’abord référence aux communautés autochtones. Les témoignages faisant référence aux allochtones étaient surtout associés aux sévices et au ressentiment.
La projection du film semble, d’emblée, avoir touché l’auditoire, suscité des réactions variées et favorisé les échanges entre les participants. À l’aide de la grille d’analyse, les réactions ont pu être décrites et situées en relation à l’autonomie. Les effets recherchés sont bien sûr l’affirmation de soi, mais à l’image d’un processus « thérapeutique ». C’est-à-dire qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise expression : ce qui compte avant tout, c’est que chacun soit rejoint et ait envie d’exprimer ce qu’il vit, et que chacun considère important ce qu’il pense et ressent. De plus, le film a provoqué des échanges entre les personnes. Quant aux communautés, les effets recherchés sont le rassemblement, le sentiment d’appartenance. À cet égard, plusieurs échanges faisaient référence à un sentiment de fierté, une prise de position, un désir d’agir et la recherche de solution. Plusieurs ont exprimé le souhait que le film soit présenté à d’autres membres de leur communauté, notamment aux jeunes dans les écoles, pour faire connaître les cultures autochtones.
Grille d’analyse des échanges qui ont eu lieu après la projection – et nombre d’observations selon l’expression, le sentiment, l’attitude, les thèmes et la cible
Conclusion
Ma réflexion m’amène à penser que la problématique identitaire des communautés autochtones s’inscrit dans un ensemble de problèmes complexes comme la pauvreté et l’exclusion sociale, qui ont chacune leurs particularités, leur historique et des conséquences multiples fragilisant à la fois les individus et les communautés et nécessitant d’intervenir à long terme sur plusieurs fronts pour amener des changements durables.
Je retiens trois indicateurs principaux sur lesquels tant les praticiens que les évaluateurs doivent porter prioritairement leur attention : la participation active des individus, l’appropriation de l’action par la communauté et l’ouverture vers l’extérieur.
J’ai tenté ici d’explorer une façon de mesurer la participation active par l’expression verbale en ayant recours à des outils différents de ceux qui sont utilisés dans les mesures classiques. Cet exercice, mené à la suite de la projection du film Indian Time, a permis de confirmer des effets intéressants produits chez l’ensemble des participants. L’analyse des discours a fait ressortir des prises de position, un désir de passer à l’action, un sentiment d’appartenance fort, un désir de trouver des solutions visant la guérison et une ouverture tant à des thèmes associés à des sévices antérieurs qu’à des problèmes plus contemporains.
Ce type d’analyse peut servir tant à l’évaluation pour mesurer des effets qu’à l’intervenant pour comprendre ce qui préoccupe les membres d’une communauté et pouvoir ainsi mieux cibler son accompagnement.
Je crois que d’autres explorations devront être effectuées pour développer un outil de mesure plus robuste, mais je crois que toutes les expériences d’évaluation, aussi imparfaites ou partielles soient-elles, si elles portent sur la participation, l’appropriation et l’ouverture vers l’extérieur, sont valables et assurent que l’attention de l’évaluateur porte sur les bons enjeux.
Enfin, cette expérience avec l’équipe DCM me permet de mettre à l’épreuve mes outils d’évaluation de programmes, de poursuivre et d’enrichir les apprentissages que j’ai réalisés tout au long de ma collaboration avec des praticiens et des chercheurs qui oeuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Parties annexes
Note biographique
Raymonde Beaudoin est psychologue de formation. Depuis la fin de ses études en 1982, elle a travaillé plusieurs années dans le secteur de la santé et des services sociaux. Depuis 2002, elle est à l’emploi du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à titre d’experte en évaluation de programme. Elle a collaboré avec de nombreux chercheurs universitaires dans le cadre de ses travaux en recherche et en évaluation, notamment dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, des interventions auprès des jeunes et des mesures d’aide à l’emploi.
Notes
-
[1]
Cette évaluation avait trois objectifs : 1) évaluer les retombées de la mission de 2008, son impact dans les communautés un an après sa mise en oeuvre, en termes d’empowerment (niveau individuel) et de développement durable (niveau collectif) ; 2) que le projet soit évalué par les participants eux-mêmes, ainsi que par leurs chefs et par nos partenaires et intervenants indirects ; 3) élaborer de façon conjointe une stratégie pour les projets à venir.
-
[2]
En juin 2010, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lançait le deuxième Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS 2010-2015) dans lequel il exprimait sa volonté de revoir les façons de faire, de rapprocher les décisions des milieux locaux et régionaux et de mettre davantage l’accent sur le soutien de l’action des partenaires territoriaux pour donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (MESS 2010).
-
[3]
Cette recherche a été réalisée dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015. Elle résulte du programme des Actions concertées pauvreté et exclusion, phase 2, priorité # 3 : « la concertation intersectorielle et la participation citoyenne pour soutenir le développement des communautés » (FRQSC 2011 : 6).
Médiagraphie
- BEAUDOIN, Raymonde, et Pierre DE CONINCK, 2015 : Évaluation des approches innovantes – Design et culture matérielle (DCM). Proposition de développement de quelques indicateurs. Montréal. [Document interne non publié].
- CREXE (Centre de recherche et d’expertise en évaluation), et ÉNAP (École nationale d’administration publique), 2010 : Évaluation des processus et étude des trajectoires liés à la revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans cinq territoires de la ville de Montréal. http://www.crexe.enap.ca/CREXE/Publications/Lists/Publications/Attachments/54/SLIMANI%20DIVAY%202012.pdf (consulté le 27 juillet 2018).
- Communagir, 2015 : Regard sur les Alliances pour la Solidarité – Portrait de cinq régions du Québec. Montréal. [Document interne non publié].
- Deci, E.L., et R.M. Ryan, 2008 : « Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life’s Domains ». Canadian Psychology 49(1) : 14-23.
- FRQSC (Fonds de recherche québécois sur la société et la culture), 2011 : Action concertée Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Phase 2, proposé par le MESS, le MESSS, la SHQ et le FRQSC. Gouvernement du Québec.
- KAINE, Élisabeth, Denis BELLEMARE et Pierre De Coninck, 2009 : Reconnaître, valoriser et transmettre la culture guaranie : évaluation de la Mission ACDI 2008. CRSH Fonds d’initiatives internationales.
- KUBISCH, Anne C., et al., 2010 : Voices from the Field III: Lessons and Challenges from Two Decades of Community Change Efforts. Aspen Institute, Washington, D.C.
- LESEMANN, Frédéric, et al., 2014 : Le rôle de la concertation intersectorielle, de la participation citoyenne et de l’action collective pour soutenir le développement des communautés et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Une approche régionale et nationale comparative. Rapport de recherche déposé au FQRSC-Action concertée « Pauvreté et exclusion phase 2 », INRS-UQO avec la collaboration du CRSA.
- MESS (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale), 2010 : Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 2010-2015. Le Québec mobilisé contre la pauvreté. Gouvernement du Québec.
- MORASSE, Carl, 2016 : Indian Time. Chicoutimi, production La Boîte Rouge VIF, 87 min.
Liste des tableaux
Grille d’analyse des échanges qui ont eu lieu après la projection – et nombre d’observations selon l’expression, le sentiment, l’attitude, les thèmes et la cible