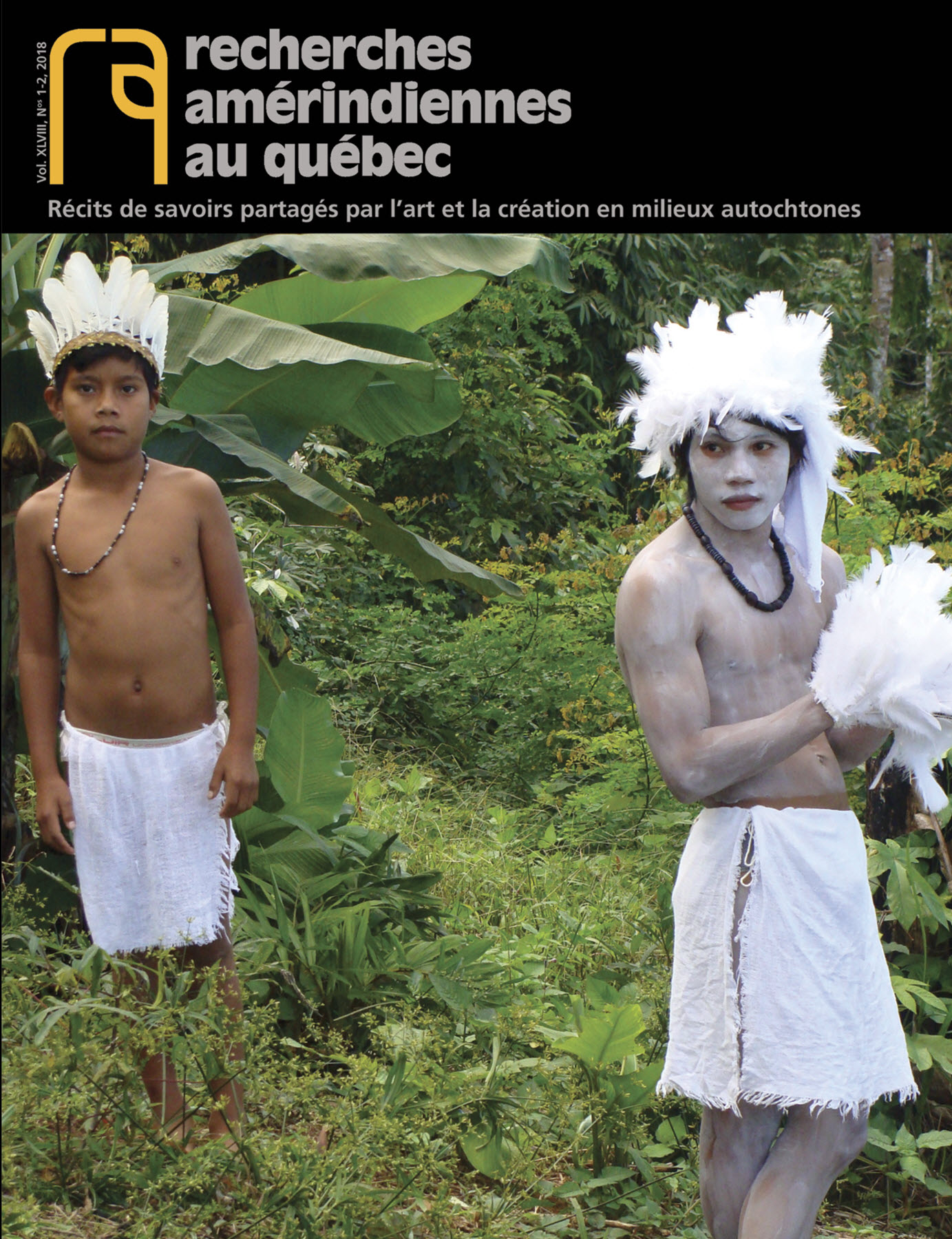Corps de l’article
À l’occasion de la rencontre « Regards croisés : Brésil et Canada » organisée conjointement par Design et Culture matérielle (UQAC), le Laboratório de Imagem e Som (LISA) de l’Université de São Paulo et le Centro de Trabalho Indigenista (CTI) – trois institutions utilisant des ressources audiovisuelles pour leur travail avec les autochtones –, une série de questions posées par les participants autochtones des deux pays ont recoupé des thèmes présents dans ma recherche portant sur mes expériences filmiques chez les Manokis. Dans tous les cas présentés lors du colloque, l’utilisation de la vidéo me paraît centrale pour réfléchir aux modes de relations spécifiques qui caractérisent ce qu’on appelle les socialités[1] amérindiennes, soit les relations diplomatiques avec des altérités distinctes habitant ce monde et d’autres mondes. Dans cette recherche encore en cours[2], j’essaie d’analyser l’appropriation des outils audiovisuels chez les Manokis et chez les Mykys, deux peuples autochtones appartenant à un groupe linguistique isolé du nord-ouest de l’État du Mato Grosso au Brésil. L’approche de ma recherche ethnographique où la vidéo joue un véritable rôle de médiation vise à comprendre les relations interethniques et interspécifiques qui sont nouées entre ces groupes. Pour ce faire, j’offre des ateliers de vidéo et de montage, de manière à comprendre les diverses dynamiques et relations possibles avec les images ou les médiations qu’elles favorisent. Le fait que la production d’images filmiques est à la fois méthode, objet et résultat de recherche dans cette expérience me permet de l’arrimer, surtout en ce qui concerne les Manokis[3], aux réflexions amenées par les Guaranis et les Innus dans le contexte de la rencontre « Regards croisés ».
Le colloque avait pour thème central les modes amérindiens de création et de production cinématographiques. Divers discours mettaient de l’avant les potentialités de la vidéo dans différents contextes autochtones et les deux directions principales envisagées : la première serait d’amorcer une diffusion plus large des images et, de ce fait, de générer une plus grande visibilité à l’extérieur des villages ; la seconde serait davantage liée à l’idée de transmission des savoirs entre les différentes générations, aspect plus lié aux processus internes de créativité.
Ces deux dimensions complémentaires des signifiés et des usages que font les Amérindiens des outils audiovisuels semblent déjà amplement diffusées dans ce qu’on appelle les Basses Terres de l’Amérique du Sud. Dans son travail avec les Kayapós, par exemple, Terence Turner (1991, 1993), partant des réflexions de Faye Ginsburg (1991), propose de voir la vidéo comme un instrument de « médiation culturelle » entre autochtones et occidentaux. Tandis que les productions des Kayapós documentaient des conflits avec la société nationale, d’autres films pouvaient aussi aborder leur « culture traditionnelle », comme le souligne l’auteur. On voit donc que cette « médiation culturelle » se fait soit entre des groupes de cultures distinctes, soit entre différentes générations à l’intérieur d’un même collectif.
On peut retrouver au Brésil plusieurs exemples de même type chez cet organisme pionnier qu’est Vídeo nas Aldeias (VnA), dont le principal objectif est de soutenir la formation de réalisateurs autochtones désireux de devenir des agents actifs dans le processus d’élaboration de vidéos. Les fondateurs de ce projet, Dominique Gallois et Vincent Carelli (1995 : 63), décrivaient eux aussi l’emploi des documents audiovisuels prenant deux directions complémentaires : d’un côté, il s’agissait de témoigner et de divulguer des actions politiques et territoriales ; de l’autre, de « préserver les manifestations culturelles propres à chaque ethnie, en sélectionnant celles qu’ils désirent transmettre aux générations futures ». Beaucoup plus tard, Pat Aufderheide (2011) souligne également, chez les participants aux activités de cette institution, l’emploi de leurs vidéos et comme « cartes de visite » dans leurs relations avec d’autres groupes, et comme « livres de mémoire » voués à l’éducation des jeunes. De façon semblable, Lucas Bessire remarque que pour les participants autochtones dans le VnA, il y a un « projet de mémoire toujours implicite » (2011 : 188). Les exemples de ces expériences, comme le travail de formation audiovisuelle chez les Xavantes et chez les Hunis kuins, démontrent qu’il est possible de considérer la vidéo comme « un chemin pour le renforcement des relations intergénérationnelles entre les jeunes cinéastes “modernes” et les aînés “traditionnels” » (ibid. : 189).
De manière très intéressante, lors du colloque « Regards croisés », ces dimensions complémentaires furent maintes fois réitérées dans le discours des cinéastes autochtones participants. L’un deux, Ariel Kuaray Ortega, décrivait la vidéo – outre le fait qu’elle ait fonctionné comme moyen de communication entre les villages et comme instrument susceptible de minimiser les préjugés envers les autochtones dans les villes – comme un outil de lutte ayant aidé les Guaranis dans la revendication de leurs droits territoriaux et de tout autre droit historique et culturel. Ce réalisateur mettait aussi en avant les fonctions que les images peuvent remplir à l’intérieur des communautés, oeuvrant comme une sorte de « miroir », suscitant des réflexions sur les problèmes intimes des Guaranis. Réal Junior Leblanc, cinéaste innu, considère les ressources audiovisuelles comme autant d’occasions « d’amener les terres sauvages vers les gens », puisqu’il s’avère difficile « d’amener les gens vers les terres sauvages ». Selon le réalisateur, outre cette part d’information sur les réalités autochtones, la vidéo est devenue « une part de leur culture » – un instrument montrant notamment, pour les générations futures, des pratiques disparues telle la chasse traditionnelle. Résumant ses réflexions, Réal affirme : « Aujourd’hui la caméra est mon fusil de chasse ». Pourtant, si d’un côté la diffusion plus large des images enregistrées dans et par les communautés amorce une importante médiation politique entre différents contextes (autochtones et non autochtones, les relations interethniques comme on les nomme) – dans la mesure où, aussi bien au sud qu’au nord des Amériques, ces peuples revendiquent pour leurs nations des droits civiques, sociaux et territoriaux –, d’un autre côté, ces spécificités cosmologiques locales demeurent très importantes par leurs usages et par leurs significations, surtout lorsque ces images sont considérées comme documents pour le futur. La suite de ce texte désire porter sur cet usage spécifique. À partir de certaines caractéristiques locales rencontrées chez les Manokis, on essaiera d’approfondir les questions qui peuvent survenir lorsque l’on évoque une telle idée de « document pour les générations futures » en contexte amérindien.
Les Manokis et la vidéo comme « miroir »
Avec une population d’environ quatre cents personnes, les Manokis se partagent aujourd’hui en huit villages situés entre la rive gauche du Rio Cravari et la route BR-364, au nord-est de l’État du Mato Grosso. En tenant compte de leurs rapports matrimoniaux, les Manokis sont aussi présents dans les villages d’autres peuples de cette région, notamment les Mykys et les Paresis. Après un processus intense de dépeuplement, ainsi que des mariages avec des conjoints de différents peuples et une longue expérience d’internat en mission jésuite, seuls dix aînés parlent aujourd’hui la langue autochtone, le reste de la population ne parlant que le portugais. La préoccupation de la mort de ces personnes âgées pouvant entraîner une « perte » (voir Nevers 2016 et Graham 2012) de leurs propres connaissances, les Manokis se sont intéressés aux techniques d’enregistrement visuel et sonore de la vidéo. Depuis 2009, année où l’association autochtone a acquis une caméra, les Manokis ont filmé en priorité les pratiques et les savoirs de leurs villages qu’ils considèrent comme traditionnels.
L’analogie de ce recours aux images avec le « miroir », déjà évoquée par Ariel Ortega, se retrouve aussi chez les Manokis. Mais cette analogie se rapproche davantage de l’idée de Réal Junior Leblanc, dans la mesure où elle souligne le rôle de la vidéo au service d’une mémoire prospective pour les générations à venir. Marcelino Napiocu[4], un important leader manoki, rappelle l’influence et l’impact des images filmiques sur les transformations subies par son peuple : « En voyant la culture du passé, on peut se fortifier par ces documentaires. Ça encourage davantage les gens, on se sent plus fort pour faire les choses, comme le travail de la terre. Ça nous donne davantage d’enthousiasme et de volonté pour faire ce que l’on faisait. »
Marcelino établit une analogie très révélatrice lorsqu’il compare le pouvoir synergique de l’image documentaire à l’enthousiasme créé par le fait de voir quelqu’un de sa propre communauté cultiver la terre. L’« enthousiasme » est vu chez les Manokis comme une condition fondamentale pour entreprendre une chose, quelle que soit la tâche envisagée, qu’il s’agisse de cultiver la terre ou de réaliser des vidéos, ou encore de préparer des rituels. Cet « enthousiasme » dépend généralement de la participation collective à un travail pour lequel on est disponible et motivé. Cette propriété synergique qui entraîne la coopération ou pousse simplement les autres à engager une action, dépend en général de la visibilité sociale, c’est-à-dire de pouvoir être vu, et de ce qui est montré. La volonté d’une personne à réaliser ou à participer à une activité semble proportionnelle à la quantité de personnes que l’on voit et qui nous voient, et à l’enthousiasme de ceux qui se consacrent à la tâche.
La visibilité chez les Manokis semble être un élan important pour produire, motiver ou engendrer divers types de mécanismes sociaux. Travailler ensemble dans la bonne humeur et, ainsi, être visuellement et socialement disponible les uns pour les autres constitue l’un des aspects fondamentaux de ce que signifie pour les Manokis vivre harmonieusement, comme l’a aussi décrit Elizabeth Ewart (2008) dans son étude sur les Panarás du Brésil central. Selon elle, voir et être vu exerce un rôle central dans les vécus amazoniens.
Photo 1
Le jeune Odair filme l’aîné Luís Tamuxi enseignant la peinture corporelle aux plus jeunes
En général l’effet visuel est nécessaire pour attirer ceux qui assistent aux pratiques rituelles. Les images peuvent donc avoir un potentiel rassembleur susceptible d’inciter les gens à participer collectivement une fois de plus à ces pratiques. Dans ce sens, Marcelino Napiocu, un important leader manoki, souligne l’importance du souvenir pour le futur, en qualifiant les images de « miroirs » puissants :
Pour permettre aux gens que cela ne s’arrête, cette question de la caméra intervient comme un miroir que l’on peut regarder, ou comme une carte : tu la regardes et tu vois ce que tu peux faire pour fortifier la culture. [...] C’est comme si c’était un miroir dans lequel on peut se voir, voir quel chemin on peut suivre, comment on peut vivre, ce que l’on peut faire. Eh bien, voici ma peur : si on ne fait pas ça […], alors tout peut s’arrêter.
Le miroir dont nous parle Marcelino semble suggérer une idée d’autoréflexion et de conscience de soi devant les aspects visuels qui réunissent en eux des éléments cosmologiques et d’ethnicité représentant de possibles guides pour le futur. Cet avenir, quant à lui, doit se dérouler en permettant une différenciation et une inventivité continues, mais toujours inspirées des conventions ancestrales. Ces images du peuple représenté dans des temps révolus appellent à la fois des réflexions et une vision rétrospective de son propre processus de transformation, et elles aident à avoir une vision prospective de la construction d’une identité future, comme une véritable « carte » sur laquelle serait dessiné le tracé des parcours à venir. Sans ces « images-miroirs » agissant comme de possibles guides, Marcelino craint que ne vienne un jour où il n’y ait plus de références assez fortes du passé pour baliser les réflexions et fonder de manière adéquate la création d’un futur.
Puisque le miroir révèle à soi-même ce qui n’était vu que par l’autre, il est possible de « voir » à travers lui ce regard de l’autre et de corriger les « distorsions » potentielles qu’il peut porter. En rendant possible la vision de son propre monde autochtone par simulation du regard de ces autres « Blancs », les images-miroirs dialoguent également avec l’imaginaire des non-autochtones en raccordant divers points de vue. Cet accès à un point de vue extérieur sur soi-même mobilise une grande force de réflexion, il en résulte surtout une révision de l’image de soi et une capacité d’aller voir bien au-delà de la dimension d’ethnicité déchaînant de multiples mouvements internes de création, comme la reprise des rituels, des récits et d’autres pratiques associées à la cosmologie du groupe. Ce qui est donc fondamental dans l’idée « d’image-miroir » pour les Manokis est son caractère prospectif. Les images deviennent dans un futur proche une espèce de garantie de pouvoir réactiver et de recréer des avancées culturelles, éventuellement abandonnées dans un futur lointain.
Itinérance et altérité
L’abandon ou la renonciation à des pratiques ou à des activités, de façon provisoire ou circonstancielle, est un aspect très commun de la temporalité manokie, marquée par son caractère cyclique ou saisonnier, que je propose d’appeler « itinérance ». Les variations produites au long de cette temporalité itinérante sont comme différentes vagues vécues dans le quotidien manoki : les pratiques, les espaces et autres aspects de la vie sociale tendent à se succéder indéfiniment.
Cette itinérance manokie touche aussi à la question soulevée plus haut de l’adhésion collective à participer aux activités : il est rare que quelqu’un se livre tout seul à une quelconque tâche ; en général, on « s’enthousiasme » à travers d’autres gens qui sont en train d’entreprendre la même action. En dépit de l’abandon temporaire de quelque activité, la possibilité de s’y livrer à nouveau reste toujours ouverte. À l’opposé de l’idée de spécialisation, l’itinérance implique plutôt un idéal de personne caractérisé par une sorte « d’érudition productive », des personnes détenant les savoir-faire nécessaires pour vivre et qui peuvent correspondre, dans certaines circonstances, à ce que veut dire l’expression taka’a (celui qui sait). La connaissance de ces savoir-faire permet non seulement l’itinérance d’activités, mais aussi la circulation des gens en des espaces sociaux divers, tendant à une fluidité croissante dans une dynamique, disons, d’inconstance[5]. En ce sens, l’abandon ou la renonciation à certaines activités est un type de « perte » courante dans ce monde vécu, mais elle est réparable justement grâce à la relation avec d’autres sujets susceptibles de fournir à nouveau ces éléments. La temporalité spécifique vécue par ces personnes entraîne donc, dans un mouvement continu, toute une dynamique sociale permettant l’alternance entre l’engagement dans des tâches multiples et des apprentissages importants au cours d’une vie. Cette dynamique itinérante se base sur une matrice relationnelle, au sein de laquelle on utilise à l’occasion une somme de savoirs et d’éléments externes voués à être échangés ou reçus des Autres.
Cela met en évidence l’importance des figures de l’altérité dans cette cosmologie, dans laquelle une grande partie des prédicats culturels, surtout dans les temps mythiques, proviennent d’autres peuples, animaux ou esprits – par exemple les rituels, les répertoires musicaux, les noms, les cultigènes. La relation avec ces Autres est fondamentale pour que les Manokis continuent à avoir accès à ces éléments importants qui constituent les moyens par lesquels ils pourront continuer à se reproduire et à se transformer. Comme dans tant d’autres contextes amérindiens, nous retrouvons ici les figures de l’altérité en tant que pourvoyeurs potentiels (Menget 1999) : après tout, dès qu’on cesse de faire quelque chose c’est aux divers Autres qu’on doit recourir afin de récupérer une « perte » non définitive de pratiques ou de savoirs.
Le rituel, les morts et un nouveau genre de médiation
Dans le cas des images filmiques, qui seraient ces Autres susceptibles d’apporter potentiellement de tels éléments « perdus » ? La réponse à cette question réside justement dans le rôle ambigu qu’ont les morts dans ce monde vécu. Bien qu’ils constituent l’une des plus grandes sources de danger pour les Manokis, les défunts bien traités en termes d’offrandes et de rituels deviennent les pourvoyeurs de « santé » et d’« union » par excellence, puisqu’ils sont devenus comme des « voisins ». Ces êtres, appelés Yetá en langue autochtone, habitent la « maison des hommes » ; ils sont visuellement interdits à toutes les femmes et aux jeunes hommes non initiés, mais ils sont audibles par tous dans le contexte des rituels nommés Yetá[6]. À ces occasions, ils permettent la présentification des morts par le biais de leur performance musicale, principal moyen de communication avec le monde des défunts.
Parallèlement, cette plus grande proximité cosmologique avec les morts lors du rituel ne s’accompagnait pas par le passé d’une continuité des biens et des mémoires dans la sphère quotidienne. Selon les plus anciens, dans ce temps-là, les vivants ne devaient rien garder des défunts. Il s’agit d’une coutume qui traverse depuis peu d’importantes transformations. Contrairement à ce qui se passait auparavant, quand les biens des défunts étaient détruits ou enterrés avec eux, les Manokis commencent aujourd’hui à conserver des objets et des images de leurs morts. Cela peut renforcer un aspect inattendu des relations entre les morts et les vivants, dans la mesure où les images enregistrées et non détruites de personnes décédées peuvent établir un nouveau genre de médiation entre ces différents êtres. En présentifiant les morts dans le temps et l’espace des vivants, ces enregistrements peuvent actualiser leurs relations et causer d’importants effets. Dans ce cas, l’utilisation de la vidéo va donc au-delà d’une « médiation culturelle » en contextes inter-autochtones et interethniques (Ginsburg 1991) ; elle est susceptible d’opérer potentiellement en régimes interspécifiques, c’est-à-dire impliquant une interaction entre vivants et morts qui, en principe, pourraient être considérés dans les mondes amérindiens comme des êtres ontologiquement distincts.
En mourant, les Manokis initiés dans la « maison des hommes » deviennent définitivement des « voisins » et se mettent à fréquenter cet endroit pour se nourrir lors des rituels « d’offrandes ». Tous les hommes initiés qui sont filmés dans le temps présent sont potentiellement des images d’individus qui, dans le futur, se transformeront en « voisins ». Ainsi leurs images et leurs paroles acquerront un autre statut puisque ces êtres méritent tout le respect et l’attention des vivants[7]. En raison de cette forte valorisation des discours enregistrés des défunts, ce nouveau genre de médiation filmée peut voir ses effets amplifiés et devenir imprévisibles. Après tout, les morts continuent à représenter pour les Manokis des êtres ambigus. De ce fait, lorsque les personnes filmées encouragent à poursuivre les rituels et qu’ils redoutent la « perte de la culture » dans leurs discours, ils adressent potentiellement le message vigoureux et inquiétant d’un futur où ces rites ne seront peut-être plus actifs : une fois morts et transfigurés en « voisins », ces personnes et leurs discours devront donc être pris davantage au sérieux, sous peine de possibles actes de vengeance de morts improprement traités, c’est-à-dire mal nourris par des offrandes.
La mémoire prospective de la vidéo, en attribuant aux enregistrements audiovisuels un rôle de fournisseurs potentiels de ressources nécessaires à la constitution de soi dans le futur, se présente donc comme une stratégie indigène en accord avec l’aspect itinérant qui caractérise les modes manokis d’habiter le temps. Face à l’abandon temporaire de tâches, rituels et autres pratiques, leur réactivation opportune constitue toujours un horizon envisageable. Les Manokis semblent vouloir assurer cette possibilité de recourir à une source postérieure afin de rétablir ce qui a été abandonné de manière itinérante. Les ressources de l’image pourraient offrir de nouvelles manières de recourir dans ce monde aux pourvoyeurs potentiels d’« union », de « santé » et de savoirs que sont les morts. En somme, les vidéos et leurs images de futurs morts créent, de manière prospective et par de nouveaux moyens, des Autres qui deviendront indispensables.
Messagers du futur
En ce qui concerne les rapports entre l’enregistrement d’un côté, et l’histoire et la mémoire des groupes de l’autre, il existe deux tendances principales. Comme l’a suggéré Lévi-Strauss (1973 : 315), cette relation peut être « rétrospective, pour fonder un ordre traditionnel sur un lointain passé distant, ou prospective, pour faire de ce passé l’amorce d’un avenir qui commence à se dessiner ». Je pense que ces relations mnémoniques rétrospectives et prospectives sont toujours présentes et sont plus ou moins mises en exergue selon le contexte historique et culturel vécu. Si pour les « Blancs » la relation aux documents peut être majoritairement rétrospective (à l’exemple de la majorité de nos musées et archives), pour les Manokis l’intérêt primordial pour les productions filmiques et photographiques semble souligner son caractère prospectif.
La façon des Manokis d’utiliser les vidéos et les photos démontre en effet une valorisation des images qui soulignent leur sentiment d’appartenance à une trajectoire collective spécifique, dans un contexte où il est nécessaire de défendre leur espace physique et symbolique en tant que peuple autochtone. En ce sens, ces documents audiovisuels semblent être conçus comme une possibilité de venir en aide à la création d’une mémoire sociale, mieux portée à garantir un destin culturellement différencié, plutôt qu’à une mémoire intéressée par la reconstruction d’un passé quelconque. Et cette mémoire intéressée par la reconstruction d’un passé semble caractériser fondamentalement l’accent que nous mettons sur les relations avec les documents, à partir de notre « Histoire ».
Basées sur des registres antérieurs de processus qui ne sont peut-être plus fonctionnels dans un monde marqué par des transformations rapides et une temporalité « itinérante », ces « images-miroir » sont des vecteurs potentiels de mémoire prospective pour les générations à venir. De ce fait, la vidéo, telle que se la sont appropriée les Manokis, ne semble pas être nécessairement liée à un désir de reprise et de reconstruction d’éléments et de fondements d’un passé mais semble davantage reliée à une préoccupation pour une production d’une temporalité qui serve le futur.
Bien que le contexte des Manokis ait d’importantes spécificités, il est inévitable de se demander si cet accent mis sur le caractère prospectif que la vidéo permet de donner à la mémoire sociale de ces groupes pourrait être étendu à d’autres contextes amérindiens où il existe aussi une préoccupation pour l’enregistrement d’images et de sons pour les générations à venir. On peut percevoir ailleurs des perspectives comparables concernant l’emploi des moyens audiovisuels en tant qu’instruments de mémoire dans des contextes de changements, où un risque de disparition de pratiques et de savoirs est perçu comme un supposé manque d’intérêt attribué aux jeunes.
Regina Müller souligne l’évaluation positive des Assurinis de l’usage pragmatique de la vidéo, dès qu’ils y perçoivent une telle fonction prospective de transmission et de reproduction de la culture : « Nous allons faire des fêtes pour qu’on puisse les voir à la télévision. Ce qui est là-dedans pourra être vu dans le futur. On verra dans le téléviseur comment ceux qui sont près de mourir faisaient les choses. » (2000 : 181) Lorsqu’ils se sont rendu compte que d’autres peuples autochtones faisaient eux aussi usage de ces technologies et qu’ils pourraient laisser de telles images à leurs petits-enfants, les Assurinis se sont enthousiasmés devant la possibilité qu’offre la vidéo de perpétuer la visualisation d’événements et de rituels mettant en scène, encore une fois, les morts à venir.
Photo 2
Edivaldo Mampuche filme le perçage du nez de Neilton Irantxe durant le rituel du Yetá lors de l’initiation de plusieurs jeunes dans la « maison des hommes »
À son tour, Sylvia Caiuby Novaes (2000 : 89) propose l’idée de l’image comme dépositaire de la mémoire en des contextes autochtones traversant de multiples et intenses changements : « Mémoire fondamentale pour des groupes dans lesquels le changement et la maîtrise de la situation présente ne sont pas des valeurs en soi, à l’opposé de ce qui se passe dans notre société. » Cette valorisation de la mémoire rendue possible par les documents audiovisuels, implique probablement d’autres transformations ; dans le passé, les Bororos étudiés par cette chercheure n’arrivaient pas à concevoir que l’on peut contempler des photographies de personnes décédées et cela change actuellement.
Dans son travail avec les Ikolens gaviãos de l’État de Rondônia au nord-ouest du Brésil, Priscilla Ermel, quant à elle, rapporte que les autochtones destinent les expériences vidéographiques à une visée remarquablement prospectiviste. L’auteure partage l’idée selon laquelle la vidéo fonctionne comme une sorte de « miroir qui voyage à travers le temps », elle conclut qu’une fois enregistrées les images créent une capacité de projection vers le futur :
[L]es Ikolens gaviãos remarquent l’importance – future – de l’enregistrement – présent – d’une mémoire ancestrale. Ils décrivent aussi le présent comme un événement qui sera, pour les générations à venir, registre du passé. […] [L]a visibilité et l’audibilité presque instantanées de la vidéo rapprochent son écran à cristaux liquides de la surface vitreuse et argentée du miroir.
2009 : 162
Conclusion
Ce sont les paroles des réalisateurs autochtones entendues à « Regards croisés » qui ont fait naître cette réflexion alimentée par des digressions comparatives provenant d’une recherche en cours. À l’occasion de l’une des dernières tables rondes de ce colloque, en parlant des enregistrements réalisés avec les Kuikuros, le réalisateur Takumã a résumé l’idée présentée ici en affirmant que les vidéos réalisées aujourd’hui dans les villages sont les messages des plus anciens pour les individus encore à naître : « Les réalisateurs autochtones sont les messagers du futur ».
Parties annexes
Note biographique
André Lopes, anthropologue-vidéaste, est doctorant en anthropologie sociale à l’Université de São Paulo. Ses principaux champs de recherche sont l’ethnologie autochtone et l’anthropologie visuelle. Il donne depuis 2011 des ateliers de formation en vidéo dans plusieurs communautés autochtones. Son mémoire de maîtrise (2014) est intitulé O vídeo como ibirapema. A apropriação dos recursos audiovisuais pelos Manoki e seus discursos sobre a história (La vidéo comme ibirapema [terme tupi désignant l’arme utilisée lors des rituels d’anthropophagie] : l’appropriation des ressources audiovisuelles par les Manokis et leurs discours sur l’histoire). Au doctorat, il continue cette recherche pour approfondir les interactions entre les Manokis et les Mikis, deux peuples du nord-est de l’État du Mato Grosso do Sul, ainsi que leurs relations avec d’autres figures d’altérité qui peuplent leur monde. Il a réalisé trois documentaires : Vende-se Pequi (2013), Wapu : o açaí dos Wayana (2017) et Ãjãi : o jogo de cabeça dos Myky e Manoki (2018).
Notes
-
[1]
D’après l’usage de Marilyn Strathern : « the creating and maintaining of relationships » (1988 : 16). Voir surtout Strathern (1996). C’est d’ailleurs un concept courant en ethnologie brésilienne.
-
[2]
Recherche menée au sein du PPGAS-USP (Programme de post-graduation en anthropologie sociale) depuis mars 2016, intitulée « L’appropriation des ressources audiovisuelles par les Manokis et les Mykys : une approche de leurs relations avec l’altérité par le biais d’expériences filmiques ».
-
[3]
Les réflexions soulevées ici relèvent d’une exégèse manokie. Les Mykys ne seront donc pas abordés directement dans ce texte, en dépit de nombreuses similarités pouvant les apparenter.
-
[4]
Dans ce cas, on peut dire que l’exégèse de Marcelino, âgé de 40 ans et marié, pourrait être bien acceptée par une grande partie de la population manokie, à l’exception peut-être de quelques anciens pour qui la connaissance enregistrée par les caméras n’a guère d’importance (voir Neves 2016 ; voir aussi Graham 2012 au sujet des activités de diffusion culturelle chez les Xavantes).
-
[5]
Dans la caractérisation de l’itinérance manokie, il faut mentionner le thème de l’« inconstance de l’âme sauvage », décrit par Eduardo Viveiros de Castro (2002, 2009) à partir des discours missionnaires du baroque. Bien que ce motif soit lié, à l’origine, à la totale absence de sujétion des Tupinambás de la côte brésilienne face aux tentatives jésuites de conversion, il s’est répandu dans les analyses actuelles en ethnologie brésilienne. En réévaluant l’instabilité des unités politiques amérindiennes, Calávia Saez (2013 : 11) soutient que ce thème de l’inconstance subit « une transposition de niveau et devient finalement une espèce d’invariant de l’être amérindien, consistant précisément en son instabilité ». Il s’agirait, dans ces termes, de peuples dont la plus remarquable permanence est justement leur capacité et leur disposition au changement.
-
[6]
Nous pouvons aussi étendre ces observations aux Mykys, qui pratiquent également les rituels du Yetá. Même si certaines familles commencent à conserver des images de leurs défunts, les Mykys ne gardent pas les objets de leurs morts comme le font actuellement une grande partie des Manokis.
-
[7]
C’est seulement ainsi que les « voisins » peuvent continuer à agir de façon thérapeutique en faveur du groupe, sans se transformer en agents pathogènes pour ce dernier (ce qui peut survenir par exemple quand leur désir de manger avec/comme les vivants, par le biais des « offrandes », n’est pas respecté).
Ouvrages cités
- AUFDERHEIDE, Pat, 2011 : « Vendo o mundo do outro, você olha para o seu: a evolução do Projeto Vídeo nas Aldeias », in Ana Carvalho Z. Araújo, Ernesto I. de Carvalho et Vincent Carelli (dir.), Vídeo nas Aldeias 25 anos: 1986-2011 : 180-186. Recife, Brésil.
- BESSIRE, Lucas, 2011 : « Olhando do chão para cima: um relato da turnê do Vídeo nas Aldeias », in Ana Carvalho Z. Araújo, Ernesto I. de Carvalho et Vincent Carelli (dir.), Vídeo nas Aldeias 25 anos: 1986-2011 : 187-190. Recife, Brésil.
- ERMEL, Priscila, 2009 : « A construção de si mesmo: Uma experiência etnoaudiovisual com os povos tupi-mondé », in A. Barbosa, E. da Cunha et R. Hikiji (dir.), Imagem-Conhecimento : 159-176. Papirus Editora, Campinas.
- EWART, Elizabeth, 2008 : « Seeing, Hearing and Speaking: Morality and sense among the Panará in central Brazil ». Ethnos 73(4) : 505-522.
- GALLOIS, Dominique, et Vincent CARELLI, 1995 : « Vídeo e diálogo cultural – Experiência do projeto Vídeo nas Aldeias ». Horizontes Antropológicos 1(2) : 61-72.
- GINSBURG, Faye, 1991 : « Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village ». Cultural Anthropology 6(1) : 92-112.
- GRAHAM, Laura, 2012 : « Image and instrumentality in a Xavante politics of existential recognition: The public outreach work of Eténhiritipa Pimentel Barbosa ». American Ethnologist 32(4) : 622-641.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, 1973 : « Comment meurent les mythes », in Anthropologie structurale deux : 301-315. Plon, Paris.
- MENGET, Patrick, 1999 : « Entre memória e história », in Adauto Novaes (dir.), A outra margem do ocidente : 153-165. Companhia das letras, São Paulo.
- MÜLLER, Regina, 2000 : « Corpo e imagem em movimento: há uma alma neste corpo » Revista de Antropologia 43(2) : 166-193.
- NOVAES, Sylvia Caiuby, 2000 : « Quando os cineastas são os índios ». Sinopse, revista de cinema 2(5) : 88-90.
- NEVES, André Luís Lopes, 2015 : O vídeo como ibirapema.A apropriação dos recursos audiovisuais pelos Manoki e seus discursos sobre a história. Dissertação de mestrado, departamento de antropologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- NEVES, André Luís Lopes, 2016 : « Vende-se Pequi: o vídeo como mediador de relações intergeracinais ». Cadernos de Campo 25(25) : 80-106.
- SÁEZ, Oscar Calávia, 2013 : « Nomes, pronomes e categorias: repensando os “subgrupos” numa etnologia pós-social ». Antropologia em primeira mão 138 : 5-17.
- STRATHERN, Marilyn, 1988 : The gender of the gift. University of California Press, Los Angeles.
- STRATHERN, Marilyn, 1996 : « For the motion (1). The concept of society is theoretically obsolete », in Tim Ingold (dir.), Key debates in anthropology : 50-55. Routledge, London.
- TURNER, Terence, 1991 : « The Social Dynamics of Video Media in an Indigenous Society: The Cultural Meaning and the Personal Politics of Video-making in Kayapo Communities ». Visual Anthropology Review 7(2) : 68-76.
- TURNER, Terence, 1993 : « Imagens desafiantes: A apropriação Kayapó do vídeo ». Revista de Antropologia 36 : 81-121.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo, 2002 : A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. Cosac Naify, São Paulo.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo, 2009 : Métaphysiques cannibales. PUF, Paris.
Liste des figures
Photo 1
Le jeune Odair filme l’aîné Luís Tamuxi enseignant la peinture corporelle aux plus jeunes
Photo 2
Edivaldo Mampuche filme le perçage du nez de Neilton Irantxe durant le rituel du Yetá lors de l’initiation de plusieurs jeunes dans la « maison des hommes »