Résumés
Résumé
Cet article rend compte de points de vue autochtones sur le processus de réalisation de l’exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du xxie siècle (2013, en cours) et son résultat. Ce processus a été mené grâce un vaste terrain de concertation dans les communautés autochtones au Québec, après la mise sur pied de comités consultatifs et d’un partenariat privilégié avec l’organisme autochtone La Boîte Rouge VIF. Le résultat de ce processus complexe a été salué et reconnu dans le monde muséal. Mais cette feuille de route a-t-elle réellement participé à la réconciliation entre peuples autochtones et Musées ? L’article propose de valoriser le regard de certains autochtones engagés dans le processus de réalisation de l’exposition et de documenter les rapports qui se sont construits et négociés au sein de l’équipe de réalisation. L’étude permet de constater non seulement que les objectifs de concertation espérés et annoncés au départ ne se sont pas complètement réalisés, mais également qu’a perduré un déséquilibre du pouvoir malgré le processus de décolonisation au sein duquel est engagé le MCQ depuis de nombreuses années.
Mots-clés :
- décolonisation,
- parole autochtone,
- muséologie collaborative,
- racisme systémique,
- musée d’État
Abstract
This article discusses the Indigenous points of view regarding the process in creating the permanent exhibit It’s our Story: First Nations and Inuit of the XXIst Century (2013 - ongoing) at the Musée de la Civilisation in Quebec City. The process was carried out through an extensive consultation with Indigenous communities in Québec following the establishment of special consultative committees and a partnership with the Indigenous organization La Boîte Rouge VIF. The result of this complex process was lauded in the museum world. But did it truly achieve the desired reconciliation between Indigenous Peoples and museums? The article puts forward the perspectives of some Indigenous people on both the creative process and the resulting exhibit, as well as documenting the power play among the people involved. By presenting these Indigenous perspectives at different moments and levels of the development of the exhibit, the article reports on the deficiencies in the desired collaborative process and uncovers the power imbalance that nevertheless was preserved within the museum’s institution, to the detriment of its Indigenous collaborators.
Keywords:
- decolonization,
- Indigenous voice,
- collaborative museology,
- systemic racism,
- state museum
Resumen
Este artículo presenta perspectivas indígenas sobre el proceso de realización de la exposición permanente C’est notre histoire: Premières Nations et Inuit du xxie siècle (Es nuestra historia: Primeras Naciones e Inuit del siglo XXI) (2013, en curso) y sus resultados. Este proceso se llevó a cabo a través de un amplio proceso de consulta dentro de las comunidades indígenas de Quebec, tras el establecimiento de comités asesores y una alianza privilegiada con la organización indígena La Boîte Rouge VIF. El resultado de este complejo proceso ha sido bien acogido y reconocido en el mundo de los museos. Pero ¿esta hoja de ruta ha contribuido realmente a la reconciliación entre los pueblos indígenas y los museos? El artículo propone valorizar la perspectiva de aquellos indígenas involucrados en el proceso de realización de la exposición y documentar las relaciones que se han construido y negociado dentro del equipo de producción. El estudio permite constatar que no sólo los objetivos de la consulta, esperados y anunciados al principio, no se han alcanzado plenamente, sino también que ha persistido un desequilibrio de poder a pesar del proceso de descolonización en el que el MCQ ha estado comprometido durante muchos años.
Palabras clave:
- descolonización,
- discurso indígena,
- museología colaborativa,
- racismo sistémico,
- museo estatal
Corps de l’article
La participation des Autochtones dans l’élaboration des expositions muséales qui les représentent est un enjeu qui a fait l’objet de nombreux travaux et publications dans les trente dernières années (voir, entre autres, Ames 1994 ; Coombes 1991 ; Gibson et Mallon 2010 ; Kahn 2000 ; Nemiroff 1992 ; Onciul 2015 ; Soulier 2013 ; Winnel 1996). Ces auteurs ont documenté les conflits, les tensions, les compromis, mais aussi les réussites de différents projets d’exposition ou de création de musées, contribuant ainsi à l’analyse de la complexité de l’histoire des relations entre les peuples autochtones et les musées (Dubuc et Turgeon 2002 : 11).
L’examen de cette littérature démontre que les musées d’État, et plus particulièrement les collections muséales nationales, sont au coeur des tensions du colonialisme et du nationalisme (Desmarais-Tremblay 2016). Les objets et les oeuvres d’art sont ainsi à la fois des outils de légitimation du pouvoir des sociétés dominantes (destructions, confiscations, commercialisation, détournements) et le coeur des processus actuels d’affirmation identitaire et culturelle (restitution, appropriation) en milieu autochtone. Souvent construits à partir des objets et des oeuvres d’art, les récits muséologiques sont le résultat d’un travail institutionnel d’interprétation du patrimoine qui permet à ces institutions de jouir d’une autorité[1] importante sur la construction du récit national.
La première exposition permanente du Musée de la civilisation du Québec (MCQ), Nous, les Premières Nations (1998-2013), a ainsi été conçue dans la continuité de projets muséologiques importants (Jérôme 2014) mis en place à la suite de changements significatifs dans la participation des Autochtones à la gestion des collections et à la mise en exposition de celles-ci. Le MCQ a ainsi longtemps joui d’une solide réputation en matière de relations avec les peuples autochtones, particulièrement grâce aux actions prises par la conservatrice des collections amérindiennes et inuites, aujourd’hui à la retraite, Marie-Paule Robitaille (Robitaille 2014). Dix ans après son ouverture, cette exposition majeure a fait l’objet d’une réflexion quant à son renouvellement. Elle a finalement été remplacée par une nouvelle exposition : C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du xxie siècle (2013, en cours). Pour la qualité et pour l’étendue du processus d’intégration des voix autochtones au contenu et à la réalisation de l’exposition, le MCQ et son principal partenaire autochtone, La Boîte Rouge VIF (BRV), ont reçu le Prix du Gouverneur général pour l’excellence des programmes en musée : Histoire vivante ! Le jury a encensé l’initiative du Musée et sa réalisation conjointe avec des partenariats autochtones – dont la BRV qui a élaboré et mené le processus de concertation – qui ont permis de proposer
une représentation muséale dont la maturité, le caractère inclusif et la pertinence surpassent tout ce qui s’est fait à ce sujet jusqu’à présent. Elle relate l’histoire des peuples autochtones grâce aux voix de ses membres et en faisant appel à une formidable démarche consultative qui n’est rien de moins que révolutionnaire. Elle expose le savoir de pointe et des perspectives stimulantes, tout en présentant une apparence visuelle exquise et des histoires inoubliables.
Musée de la civilisation à Québec 2014
Si l’expérience menée est une réussite du point de vue institutionnel, comme le démontre la reconnaissance évoquée ci-dessus, qu’en est-il du point de vue[2] autochtone ? La mise en valeur des « voix autochtones » dans l’espace muséal a-t-elle été considérée comme une réussite du côté des premiers concernés ? Comment comprendre ce concept de « voix autochtone », présenté comme la pierre angulaire de ce projet (Kaine 2016) ?
Cet article propose ainsi le regard porté par certains membres des Premières Nations ayant participé au processus de réalisation de cette exposition, soit comme membres actifs des comités consultatifs mis en place, soit comme proches collaborateurs des équipes de réalisation. Nous faisons le choix de nous attarder ici plus spécifiquement aux discours autochtones sur l’exposition, entendus comme les voix autochtones, à la lumière de l’équilibre des pouvoirs entre les groupes autochtones et l’institution (Lynch et Alberti 2010). Basé sur une étude de cas étendue (Burrarow 2009) incluant des entrevues individuelles semi-dirigées menées avec différents acteurs institutionnels de cette exposition, mais aussi sur un groupe de discussions réunissant douze membres de l’Assemblée Mamo[3] accompagnés d’autres représentants autochtones, cet article a pour objectif de valoriser le point de vue autochtone sur les résultats de l’exposition, tant en termes d’autoreprésentation dans l’espace muséal qu’en termes de processus de réalisation. Nous présenterons dans un premier temps l’ancrage théorique et épistémologique de notre propos articulé en trois grands moments. Dans un deuxième temps, nous reviendrons brièvement sur l’histoire de la relation entre les MCQ et les peuples autochtones, ainsi que sur les grandes étapes de réalisation de cette exposition. Dans un troisième temps, nous présenterons et analyserons le point de vue de certains représentants autochtones rencontrés au cours de cette recherche.
Le Musée, une autorité contestée
Cet article poursuit des réflexions présentées ailleurs (Desmarais-Tremblay 2016 ; Jérôme et Kaine 2014). Dans son mémoire, Desmarais-Tremblay valorise les points de vue de nombreux acteurs du processus d’élaboration de l’exposition, dont ceux des professionnels et professionnelles du musée, des membres du comité scientifique, de l’Assemblée Mamo et de participants au processus de concertation dans les communautés, tout en situant ce projet dans une histoire critique de la muséologie. Pour leur part, Jérôme et Kaine ont notamment montré comment les réflexions menées autour de la mise en valeur des objets n’ont pas été totalement prises en considération au moment de l’ouverture de cette exposition.
Nous considérons ainsi le discours muséal comme un texte dont l’écriture est encore bien souvent uniquement pensée et formulée par l’institution, malgré les avancées des dernières décennies. Au Canada, l’épisode du Glenbow Museum est sans doute l’exemple le plus connu de ce déséquilibre, lorsque la Nation du Lac Lubicon a fait un appel au boycott contre l’exposition d’art contemporain The Spirit Sings (1988), subventionnée par une compagnie de pétrole qui exploitait des terres revendiquées par les Neheyiwaks du Lac Lubicon. L’action politique a entraîné la création d’un groupe de travail chargé de faire le point sur les pratiques muséales à l’égard des peuples autochtones, duquel résulte le « Rapport sur les relations entre les Musées et les Premières Nations du Canada » (Erasmus et al 1992). Dans cet épisode, c’est bien cette autorité du discours muséal qui a été et est encore contestée par les peuples autochtones, au même titre qu’ont pu l’être – et le sont toujours – les discours de l’anthropologue, du muséologue ou de l’historien de l’art. Les revendications formulées aux institutions muséales se font entendre de façon accentuée depuis la seconde moitié du xxe siècle, suivant le courant des mouvements sociaux autochtones (Phillips 2008). Cet activisme a assurément alimenté le processus de décolonisation des musées, qui transforme tranquillement leurs façons de faire et évoluent « du temple au forum » (Cameron 1971, repris dans Lonetree 2012 : 4).
Paroles et voix autochtones dans l’institution muséale
Une telle étude de cas participe d’une meilleure compréhension des projets d’expositions traitant des arts et des cultures des peuples autochtones et de la manière dont les contenus muséographiques et les processus de réalisation muséaux se négocient (Jérôme et Kaine 2014 ; Philipps 2011) au sein des mondes autochtones. En tant que chercheure en histoire de l’art et chercheur en anthropologie ayant participé au processus de réalisation de l’exposition, nous avons choisi de nous intéresser à ce cas en particulier pour les raisons suivantes : 1) la réputation du MCQ de développer des projets partenariaux avec les peuples autochtones ; 2) l’originalité du processus de réalisation de l’exposition qui prévoyait une consultation importante des membres des Premières Nations et des Inuit. À travers cette étude, il s’agit d’inscrire la production du savoir développée au Québec dans le champ théorique de la décolonisation en muséologie, en histoire de l’art et en anthropologie. La valorisation de la parole et des voix autochtones a ainsi fonctionné comme balise méthodologique dans le choix des sources en priorisant un corpus théorique autochtone et postcolonial (Denzin, Lincoln et Smith 2008 ; Brown et Strega 2005 ; Skinner 2014) et en conduisant des entrevues avec des personnes autochtones, mais ces voix ont aussi été révélées par le terrain de recherche comme un enjeu fondamental dans le récit de l’élaboration de l’exposition. Considérant les actions de réparation des blessures du colonialisme qui incombent encore aux institutions des sociétés canadiennes et québécoises, l’objectif est ainsi de contribuer aux débats entourant la rédaction d’une histoire de l’art et de la muséologie du colonialisme de peuplement spécifique au Québec qui mette en évidence la persistance des dynamiques coloniales à l’égard des peuples autochtones. Cette persistance prend aujourd’hui différentes formes : sur le plan des contenus, persistance de présentations passéistes des cultures matérielles, invisibilisation des passages sombres de l’histoire coloniale au sein du champ des arts et dans les musées ; pour la main-d’oeuvre des institutions, absence de concertation dans le processus de réalisation d’exposition, pas ou peu de professionnels et professionnelles autochtones engagés à long terme ; ou du côté de l’éducation, pas ou peu de formations aux réalités autochtones destinées aux équipes des musées…
Le débat muséologique historique portant sur la présentation du patrimoine matériel autochtone entre la perspective plus formelle (emphase sur l’esthétisme de l’objet) et l’approche ethnographique (emphase sur la fonction sociale de l’objet), est peu signifiant du point de vue autochtone, puisque ce grand partage est avant tout une préoccupation occidentale, issue du legs de la pensée évolutionniste sur l’anthropologie. Selon Michael Ames, « la division des perspectives autochtones holistiques par des systèmes impersonnels de classification est un acte de violence conceptuelle et une déformation fondamentale de la réalité » (Ames 1994 : 13). Ultimement, la question « C’est de l’art Indien, où va-t-on le placer ? » (Phillips 1988) est caduque face à la dynamique globale d’appropriation qui entraîne un contrôle de l’identité et de l’histoire de l’Autre par ce processus d’identification, de description, de catalogage, de présentation et de marchandisation des objets (Doxtator 1988 ; Phillips 2011 : 118) : les Musées nationaux développent leur collection, écrivent leur texte de description des objets, acquièrent des artefacts et commandent des oeuvres en fonction de priorités identifiées à l’interne, sans qu’une concertation soit systématiquement menée avec les premiers concernés. Puisque les musées sont une construction occidentale d’abord conçue pour répondre à des besoins non autochtones, le rôle de ces institutions n’est pas saisi d’emblée par les Autochtones : comme le rappelle l’artiste et sociologue Guy Soui Durand (Wendat), le musée est d’abord perçu par les peuples autochtones comme un « mouroir » (Sioui-Durand 2014), une vitrine dans laquelle la vitalité des cultures matérielles est enfermée et éteinte.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de plus en plus de communautés cherchent à se doter de leur propre musée ou centre culturel, renforçant l’idée d’une réappropriation du concept même de musée (Child 2009 ; Lonetree 2012). Tant sur le plan architectural que sur celui de l’organisation de l’espace intérieur et des stratégies muséographiques, les musées autochtones se démarquent des musées d’État, élaborés avant tout pour accueillir et satisfaire un public qui n’est pas autochtone. La forme et l’architecture de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw à Oujé-Bougoumou, l’agora circulaire centrale du Musée Shaputuan à Uashat ou la grande salle de transmission de la Maison de la culture innue d’Ekuanitshit ne sont que quelques exemples de cette volonté de faire des musées et des centres culturels des lieux identitaires, historiques et relationnels (Augé 1992 ; Lonetree 2012) où les Autochtones peuvent se sentir chez soi. Cette emphase sur le contenant s’accompagne d’une vision spécifique de la mise en forme du contenu, car les compréhensions autochtones relatives à leurs objets sont radicalement différentes de l’interpréation que peuvent en faire des conservateurs non autochtones (Kaine 2002 ; Smith 1999 : 99 ; Battiste 2008 : 31 ; Mithlo 2012 : 123).
Le musée peut devenir un lieu de négociations (Jérôme et Kaine 2014 : 247 ; Phillips 2011) et d’hybridation des savoirs (McMaster 2002), des compétences et des expertises. Selon Ruth Phillips, ce partage des connaissances occidentales et autochtones donne un caractère hybride au lieu où les ontologies autochtones sont suceptibles de s’adapter au contexte d’une institution occidentale (Poirier 2014). Et inversement, le travail individuel de certains professionnels et professionnelles de musées peut entraîner la mise en place de pratiques visant à reconnaître les spécificités des conceptions autochtones du monde. Prenons ici comme exemple le travail de la conservatrice Marie-Paule Robitaille, qui a pendant plus de trente ans oeuvré au rapprochement entre le MCQ et les peuples autochtones (Robitaille 2014). Les masques kanien’kehá:kas des Faux-Visages qui sont conservés dans les collections du MCQ font l’objet d’un traitement rituel particulier, en accord avec les pratiques et les savoirs de la Société des Faux-Visages. Nourris avec des sachets de tabac, à l’abri des regards extérieurs, ces masques ne sont ni exposés ni sortis de la réserve pour être montrés (Sioui Durand 2014 : 282-283). Lié à leur utilisation rituelle lors de cérémonies de guérison, mais aussi aux entités non humaines qu’ils représentent, le caractère sacré de ces masques est également associé à la nature même de la Société des Faux-Visages, que l’on considère parfois comme une société secrète. Dotés de pouvoirs de protection et de guérison très puissants, ces masques ne peuvent être vus que par les initiés de la Société des Faux-Visages. Leur traitement particulier dans les réserves muséales démontre une reconnaissance par l’institution des spécificités ontologiques autochtones en ce qui a trait aux relations avec les objets.
Alors que les compromis doivent se faire d’un côté comme de l’autre, l’intégration de la présence autochtone à l’histoire canadienne, de même que l’application du concept de « voix autochtone » dans les dernières expositions, montre en quoi les musées canadiens sont en processus d’indigénisation (Phillips 2011) ou de décolonisation. Toujours d’après Phillips, ce processus s’accomplit nécessairement à travers une négociation continue et adaptée aux conditions des relations et aux réalités entre les diverses institutions et communautés. Ce point de vue n’est en revanche pas partagé par certaines auteures autochtones comme Nancy Marie ou Amy Lonetree, qui considèrent plutôt que les inégalités sont toujours présentes :
L’inclusion des Autochtones dans le travail muséologique pour faire un pont des fossés conceptuels a échoué à accomplir une transformation sur le plan des changements sociaux. Quoique bien intentionnée, l’inclusion a trop souvent négligé d’inclure des paradigmes de connaissances alternatives, ce qui a donné lieu à des présomptions de réconciliation des héritages coloniaux. [...] Les musées sont des institutions qui se perpétuent en maintenant leur autorité, malgré les efforts de « donner la voix aux Autochtones ».
Mithlo 2004 : 744-746
Le rapport du Groupe de travail sur les musées et les Premières Nations, Tourner la page (Erasmus et al 1992), visait à construire une ligne directrice favorisant la collaboration dans l’élaboration des expositions. Michael Ames affirmait en 1995 que la collaboration entre commissaires d’expositions et membres des Premières Nations était déjà considérée comme une norme au Canada (Ames 2004 : 73). Or, le seul fait de développer un procédé de collaboration ne peut à lui seul être garant d’une relation équilibrée. En réalité, le degré de collaboration peut varier amplement selon l’interprétation des différentes parties engagées dans la relation de collaboration. Plusieurs études de cas sur les pratiques collaboratives ont démontré la portée limitée des changements apportés au discours et au fonctionnement propres des Musées quant à leurs relations avec les peuples autochtones, en raison du manque de pouvoir de la parole autochtone au sein des projets d’exposition (Onciul 2015 ; Lonetree et Cobb 2008 ; Shannon 2009). Par exemple, un niveau superficiel d’intégration de la participation des Autochtones serait que les Musées engagent de façon temporaire des consultants ou des commissaires externes pour certains projets fixés dans le temps, plutôt que de développer des partenariats qui toucheraient plus en profondeur la structure de l’institution, favorisant par exemple la cogestion à long terme des collections.
En muséologie collaborative ou en « commissariat communautaire » (community curating), la responsabilité et l’autorité dans l’élaboration des contenus sont partagées entre les professionnels et professionnelles des musées et les représentants et représentantes issues des milieux concernés par l’exposition. Le concept de « voix autochtones » est ici compris comme étant les paroles mêmes des Autochtones, exprimées à travers les dispositifs de présentation de l’exposition (Onciul 2015 ; Shannon 2009). Évidemment, ces « voix autochtones » peuvent être multiples, contradictoires et critiques dans le discours final présenté en salle. Elles peuvent également être multiples dans les mécanismes identifiés afin de favoriser la participation à l’élaboration du processus de réalisation, comme ce fut le cas dans l’exposition discutée ici : des représentants et représentantes des dix Premières Nations et des Inuit du Québec ont formulé des avis, des suggestions, des recommandations riches et complexes, parfois consensuelles et d’autres fois contradictoires, rendant le travail de traduction en exposition encore plus complexe. Ce concept de « voix autochtones » a été développé et mis en application dans la foulée des critiques formulées à l’égard du caractère colonial des institutions, jugé dépassé et inadéquat. On retrouve aujourd’hui cette stratégie dans la plupart des musées nationaux en Amérique du Nord, par exemple sous la forme de présentations vidéos, de citations écrites ou d’installations interactives audiovisuelles. La parole est recueillie dans les milieux autochtones lors d’un processus de consultation orchestré par l’institution muséale responsable de l’exposition et forme le coeur du contenu du discours muséographique. Selon cette méthode, le contenu est formulé de façon collaborative et participative avec les communautés, mais mis en forme par les équipes permanentes des musées.
Il s’agissait, au MCQ, de développer une démarche de concertation, entendue comme une prise en compte de ces voix et de cette parole du début à la fin du processus (Kaine 2016), démarche qui s’inscrivait dans la continuité des projets et des initiatives historiques développés par le MCQ, tout en poussant l’audace plus loin.
L’expertise de la BRV dans les projets de muséologie communautaire devait permettre au MCQ de réaliser l’objectif d’un grand chantier de concertation au Québec à travers les onze nations. Pour Élisabeth Kaine, avec le recul, c’est à ce moment qu’une attention plus importante aurait pu être portée à la question de l’équilibre des responsabilités et des décisions entre l’institution et la BRV. Les bases de ce partenariat n’ont pas été mises au clair quant à l’équilibre du pouvoir entre l’équipe du musée et la BRV : « Je n’avais pas d’entente. Moi je dirais à n’importe qui voulant s’embarquer là-dedans : ça prend une entente solide. Comme ça tu reviens avec ton entente : “on s’est entendu là-dessus”. Moi je n’avais rien. Le contrat ne stipulait rien rien rien sur les questions collaboratives. » (Entrevue avec Élisabeth Kaine, Québec, 10 nov. 2014) Cette impression est aussi confirmée du côté du Musée :
Ce qui est évident c’est qu’au départ, je ne pense pas que le Musée soupçonnait quelle serait l’ampleur de tout le travail et du processus. La BRV, on est allés la chercher pour son expertise dans ce type de travail de développement de projet de nature consultative, et même en concertation. Et donc, au départ, effectivement, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être plus claires. Mais en même temps, il y a plein de choses qui nous échappaient. Et là, je dirais même des choses qui échappaient aussi à la BRV, parce que c’était un projet d’une ampleur inégalée pour eux.
Entrevue avec Caroline Lantagne, Québec, 11 juin 2015
À qui la parole ?
Pour la BRV, les objets doivent être porteurs des voix autochtones. Une des innovations dans la démarche de la BRV a été de poursuivre la collaboration autochtone au-delà de la collecte d’informations sur les objets, et ce, grâce à trois ateliers créatifs au coeur desquels les participants ont travaillé à la conception de dispositifs de présentation pour mettre en valeur la vie et la dimension immatérielle des objets. Avec l’inventaire participatif et les ateliers de création, les Autochtones ont ainsi pu construire le discours sur leurs cultures, à la fois sur le plan de la sélection des objets et le contenu informatif divulgué à leur propos, mais aussi sur leur mode de présentation. Ces ateliers se sont déroulés en 2011 et 2012, avec la participation de soixante-dix-huit hommes et femmes autochtones (aînées et aînés, jeunes et adultes), accompagnées toujours d’au moins une représentante du MCQ. Le processus mené par la BRV permettait ainsi d’intégrer un degré de contrôle inédit en termes de muséologie collaborative[4].
À l’ouverture de l’exposition, une faible minorité des objets exposés bénéficiaient d’une voix autochtone, que ce soit par un texte rédigé à partir des contenus tirés de la concertation (seulement seize objets) ou par leur sélection lors des ateliers de création (Jérôme et Kaine 2014 : 232). De plus, les suggestions de mise en scène proposées par les créatrices et créateurs autochtones lors des ateliers de la BRV n’ont pas été retenues. Ce qui limite la visibilité du processus de concertation dans l’exposition. Pour certaines participantes et participants autochtones, la différence de vision sur l’objet marque un décalage :
Je m’attendais à ce que ce soit plus qu’un musée traditionnel. Mais c’est comme ça que je l’ai senti. Il y avait des objets derrière des vitres, des petites descriptions en anglais et en français. Les mots des communautées n’y étaient même pas. Pour moi, ça aurait pu être un bon indice que cela provenait des communautés, plutôt que seulement « bol », « gobelet », « jupe ». Nos mots ne sont même pas utilisés, ce qui aurait pu aider. L’autre chose, c’est que tout, à l’intérieur, était sous verre. Je comprends qu’il y ait des limitations pour cela.
Anon., Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
La représentante anichinabée de Mamo, Anita Tenasco, appuie cette prise de parole : « Il n’y a pas assez de nos langues représentées dans l’espace. Je crois qu’il y a de l’espace pour faire des ajouts. » (Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014) L’utilisation de la troisième personne dans les textes témoigne de l’absence des « voix autochtones » en ce qui concerne les objets. Ces étiquettes sont généralement composées d’un texte descriptif sommaire qui, la plupart du temps, offrent peu d’informations détaillées autres que le nom commun, la provenance – imprécise – et le matériau, par exemple : « Bols, Haudenosaunee, Noyer ». Les étiquettes des objets ont été rédigées par une contractuelle externe non autochtone. Ce choix éditorial inscrit le MCQ dans une pratique muséographique classique, loin des innovations annoncées en début de projet (Jérôme et Kaine 2014 ; Pharand etal. 2010).
Outre l’absence des voix autochtones sur les étiquettes, c’est plus globalement l’invisibilité de la démarche de réalisation au sein de l’espace d’exposition qui a été mentionnée lors de la troisième assemblée Mamo de juin 2014. À l’ouverture, en 2013, il n’était possible pour les visiteurs de s’informer ni sur la structure, ni sur le processus d’élaboration de l’exposition. Rappelons également qu’aucun catalogue n’a été édité par le MCQ pour accompagner cette exposition. Cette absence de référence au processus de réalisation a été relevée par certains membres autochtones, comme Jeanne d’Arc Vollant (Innue) :
[…] je tiens à féliciter le MCQ d’avoir fait cet essai de concertation avec La Boîte Rouge VIF. Peut-être que ce projet colossal devrait être mis plus à l’avant-plan. Je ne le vois pas présentement dans l’expo. Parce que c’est La Boîte Rouge VIF qui a fait le travail de terrain en passant. Je le sais car j’ai participé au processus de concertation sur les terrains.
Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
À la suite des retours avec les divers partenaires du processus, un panneau explicatif a été installé à l’entrée de la salle. Cet ajout a été rendu possible grâce au malheureux incendie de septembre 2014, qui a forcé la fermeture de la salle durant presque un an. Le MCQ a profité de cette occasion pour procéder à certains ajustements, qui n’ont cependant pas constitué un remaniement important. Par exemple, certaines citations provenant des contenus de la concertation effectuée par la BRV ont été ajoutées, apposées à même les vitrines, au sol ou aux murs. Malheureusement, les textes ne sont pas toujours faciles à lire ou à associer aux contenus thématiques. Lors d’une visite en novembre 2015, trois citations étaient presque illisibles, placés dans un coin sombre tout près de la porte de sortie d’urgence.
Selon certaines représentantes et représentants de l’Assemblée Mamo, les voix autochtones se font le mieux entendre dans deux composantes très précises de l’exposition, soit la dizaine d’oeuvres d’art contemporain et la forte présence de contenus vidéo, dont la majorité sont produits par la BRV. Les membres du groupe de discussion ont constaté que cette dernière permettait une visibilité des réalités autochtones contemporaines grâce, entre autres, à la présentation de savoir-faire et d’images tirés de la vie quotidienne dans les communautés. Certaines personnes du groupe rencontré ont exprimé un fort sentiment de fierté à propos de ces voix et de ces images présentées dans l’exposition sous forme de vidéos. La présence d’oeuvres d’art contemporain a également été saluée par plusieurs participants et participantes comme facteur de valorisation des des cultures autochtones en termes positifs et dynamiques. D’autres éléments de l’exposition renforcent la diversité des prises de parole et l’affirmation de la première personne du singulier et du pluriel dans le discours. Par exemple, le scénario correspondant au parcours de l’exposition peut être entendu aux bornes auditives sous forme du « grand récit » écrit et conté par l’artiste Naomie Fontaire (Innue).
La prise de parole, dans C’est notre histoire (CNH), est constituée d’un mélange de différents niveaux de langue et de types de dispositifs regroupant les témoignages personnels présentés dans les vidéos, les textes de présentation inégaux, les citations apposées au mobilier, les étiquettes classiques des objets, les oeuvres d’art contemporain et les dispositifs audiovisuels. L’irrégularité apparente qui ressort de ces observations traduit l’envergure du processus de consultation et de concertation réalisé en milieu autochtone : 800 personnes rencontrées dans dix-huit communautés de onze nations différentes, ainsi que la participation d’une douzaine d’artistes visuels, d’un scénariste, de chercheurs et d’une boîte de design... Pour certaines personnes, il semble néanmoins complexe d’identifier la provenance de la parole autochtone dans l’exposition, comme l’affirme une représentante Mamo de la Nation kanien’kéhá:ka, qui a voulu rester anonyme :
[...] Globalement, c’est très impressionnant. Il y a beaucoup d’informations. C’est très occupé visuellement, on y retrouve la voix de tout le monde. Mais on ressent que ça provient d’un musée. On ne ressent pas la provenance d’une communauté. On ne ressent pas que les gens peuvent se présenter ou s’exprimer eux-mêmes.
Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
Une autre perspective de Kathleen André (Innue) appuie cette analyse :
Je cherchais peut-être un sentier de portage qui serait venu me chercher. Quand j’ai vu les raquettes, je pensais que j’allais voir une photo avec un portage. Pour moi, c’est mes ancêtres qui sont passés par là. C’est important pour moi, dans mon image, pour que mes enfants puissent passer là, que je puisse transmettre mes connaissances à mes enfants.
Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
Selon Amy Lonetree (Ho-Chunk), la stratégie muséologique des « voix autochtones » peut même donner une impression trompeuse sur le respect des perspectives autochtones, car il n’y aurait pas nécessairement de rééquilibre de pouvoir. La représentation des expériences de collaborations entre mondes autochtones et Musées peuvent cacher les inégalités qui perdurent dans la structure de fonctionnement interne de l’institution (Lonetree 2012 : 23-24). Sur papier, la réputation du musée est excellente. Jameson C. Brant (Kanien’kéhà:ka) louange les voix autochtones déployées dans l’exposition CNH (Brant 2014 : 47-49), en assurant que la représentation des identités autochtones dans l’exposition est positive, réaliste et inspirante. Les membres de la Mamo 2014 ont effectivement exprimé le même sentiment. Mais les dynamiques relationnelles internes qui se font et se défont entre les équipes de travail sont invisibles pour une personne n’ayant pas participé au processus. Or, si c’est le cas dans de nombreux projets muséaux, on peut s’interroger sur cette opacité lorsque le processus est aussi important que le résultat lui-même.
À qui appartient le discours muséal ?
C’est la propriété même des voix présentées dans l’exposition qui pourrait être au coeur du problème. Au-delà de « qui parle ? » se retrouve une interrogation plus fondamentale que Claude Kistabish (Anichinabé) formulait déjà à la première Assemblée Mamo : « À qui appartient le discours dans un musée ? Aux Autochtones ou au musée ? » (Pharand et al. 2010 : 23) Lors de la discussion de groupe Mamo 2014, certaines critiques ont été formulées sur le résultat du processus, qui ne semblait pas correspondre à ce qui avait été présenté, compris et prévu. Dès les premières minutes de l’atelier, certains participants ont pris pour exemple le peu d’explications retrouvées dans la salle d’exposition au sujet des conséquences de la politique des pensionnats indiens pour illustrer leurs inquiétudes au sujet de la reconnaissance de la parole transmise lors du processus de consultation. Selon notre méthodologie afin de maintenir les voix autochtones en priorité dans le contenu mais aussi dans la forme, nous reproduisons ici un extrait intégral d’entrevue de groupe. La critique émerge spontanément de la conversation, notamment au sujet des pensionnats :
Jean St-Onge (Innu) – [...] Et l’accent sur les pensionnats qui n’est pas là. On a dit que c’était juste un survol, d’accord, mais c’est un moment douloureux qu’il faut connaître aussi. Il faut savoir qu’on a eu ça.
Jeanne d’Arc Vollant (Innue) – Il aurait fallu aller plus en profondeur pour qu’on puisse comprendre notre histoire et notre réalité d’aujourd’hui. Elle vient de cet impact-là des pensionnats. On dirait qu’elle est mise en arrière-plan. Ça aurait dû être mis beaucoup plus en avant-plan pour qu’on puisse comprendre notre réalité. Qui on est aujourd’hui. On dirait que c’est gardé quasiment sous silence. C’est un peu dans la brume. Et pourtant nous le vivons quotidiennement, cet impact-là.
Jean St-Onge – Tu te sens magané un peu.
Jeanne d’Arc Vollant – Comme si tu n’avais pas le droit de parler encore.
Jean St-Onge – Quand tu sortais d’un pensionnat, tu n’avais pas le droit de parler. Excusez-moi, mais c’est une partie qui m’interpelle.
Jeanne d’Arc Vollant – Je crois que, si on nous donne la parole… Eh bien, vous nous la donnez ou vous nous la donnez pas ? Que ça ne soit pas juste, comment dire... « Ah ! on les a consultés ». Non. Si je suis consultée, je veux qu’on tienne compte de ce que j’ai dit, de ce que je veux, de comment je veux être représentée. Comment dire... je n’ai pas le terme en français... [elle parle en innu-aimun]
Kathleen André (Innue) – On ne veut pas être utilisées…
Jeanne d’Arc Vollant – Utilisée, c’est ça le mot. Je ne veux pas être un objet là-dedans. Mais je ne veux pas jouer à la victime non plus, même si j’ai l’air de ça. [rires]
Jean St-Onge – On comprend les contraintes du Musée aussi. Il y a tellement d’objets, d’écrits et de verbatim. Ils nous ont dit ce matin à quel point il y a eu beaucoup de verbatim.
Jacques Kurtness – Je pense qu’on a été trop doux avec les pensionnats. C’est une tentative de génocide qui a duré sur une longue période de presque cent ans au Canada. Il ne faut pas avoir peur de le mentionner, d’après moi. Parce que sans ça, ça ne fait pas justice. De seulement dire « on a fait un pensionnat »… Mais ça veut aussi dire : perte de la langue, perte de la culture, problèmes sur plusieurs générations, disparitions. Enlever l’Indien dans le corps de l’Indien...
Kathleen André – Il faut mettre les vraies choses, pas comme sournoisement. Il faut prendre les vrais mots. Parce qu’on dirait qu’on sous-entend des choses ici.
Entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
Dans cet extrait, une double conversation se déroule simultanément. À travers une critique de la présentation des pensionnats dans l’exposition, le faible lien de confiance des Autochtones avec l’institution muséale est soulevé. Du point de vue des participants et participantes autochtones, le résultat ne semble pas refléter les consultations préalables. L’expérience de la discrimination étatique – à comprendre les pensionnats – semble se répéter dans un sentiment de discrimination institutionnelle, lorsque Jeanne d’Arc Vollant s’exclame « Tu n’aurais pas le droit de parler encore ? » (emphase mise par l’auteure) Selon les discussions de Mamo 2014 après la visite de l’exposition, les pensionnats constituent un sujet rassembleur pour les nations autochtones qui vivent aujourd’hui les répercussions intergénérationnelles de ce trop long épisode historique. À l’exception de quelques mentions dans les capsules vidéo, la vitrine réservée au sujet est brève et ne fait pas mention de génocide. Lors de l’entretien de groupe, six personnes ont noté que l’exposition CNH ne réservait pas assez d’espace à l’explication des répercussions de ces mesures gouvernementales. Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, qui a privilégié le terme de génocide culturel, recommande aux musées nationaux de « former des citoyens instruits sur le plan de leur histoire qui comprennent pourquoi et en quoi le passé a de l’importance pour leur propre vie et pour l’avenir de leur pays ». Il atteste que « les musées ont la responsabilité éthique de favoriser la réconciliation nationale » (CVRC 2015 : 271). Lors des ajustements dans la salle d’exposition après l’incendie, le dyptique God was a victim too (s.d., acquis par le MCQ) de l’artiste contemporaine Glenna Matoush (Ojibwé anichinabé) a été ajouté au présentoir. Amy Lonetree met en garde les Musées nationaux de rester trop sommaires sur les passages violents du colonialisme (Lonetree 2012 : 166). Selon l’historienne de l’art autochtone, les contenus des expositions à caractère autochtone doivent aborder les épisodes difficiles, à l’instar des méthodes de guérison, pour développer un processus de décolonisation. L’exposition de type anthropologique ou historique devrait donc dépasser la simple présentation de cultures vivantes et mettre en lumière les violences du colonialisme, car il n’y a pas d’autres stratégies de guérison possible. Cette perspective est aussi partagée par les historiennes de l’art autochtone Heather Igloliorte (Inuk) et Carla Taunton (Sinclair 2012 : 31).
Les choix définitifs qui ont orienté le résultat final de l’exposition ont été mis en question par beaucoup d’Autochtones ayant participé de près ou de loin au travail collaboratif entre 2009 et 2013 :
Moi, j’ai été dans le comité Mamo dès le début. Qu’est-ce qui s’est passé ? Parce que moi, je suis déçu de cette exposition-là. Je le répétais souvent, j’aimerais ça, quand je vais aller à cette exposition-là, que je me reconnaisse, quand même un peu. Et malheureusement je ne me reconnais pas. Et c’est peut-être parce que j’avais trop d’attentes. Quand on a commencé, je trouvais ça intéressant, le concept. OK ça va être une collaboration. Moi je disais souvent, je ne veux pas être juste un nom – Christian Coocoo – dans le document. Parce que dans le passé c’est arrivé. [...] Ça a été souligné tout-à-l’heure, je pense, par Jean. Peut-être qu’on n’a pas été écoutés.
Christian Coocoo, entrevue de groupe Mamo, Québec, 18 juin 2014
Il y a eu des réunions qui ont chauffé. À un moment donné, la question a carrément été posée : « Qui parle dans l’exposition ? » J’avais été une des premières à réagir en disant « Mais voyons, c’est le “nous” qui parle. Le message qui sera dans l’exposition sera le “nous” des Autochtones ». Le Musée nous a dit : « Non non non, c’est notre parole à nous tous ensemble. Donc, celle du Musée qui va interpréter le matériel ». Je leur ai dit à ce moment-là que j’étais très surprise d’entendre cela, et que je n’avais jamais compris les choses de cette manière-là. J’étais aussi déçue de le comprendre aussi tard dans le processus.
Entrevue individuelle anonyme, Montréal, 27 nov. 2014
Selon ces deux témoignages, l’écoute incomplète de la parole autochtone a marqué le déséquilibre du pouvoir dans la structure de travail derrière l’élaboration de l’exposition. Il n’est pas question ici de faire le procès des personnes participant au projet ou de leurs orientations politiques. Par contre, comme le formule Jimmie Durham, il serait « impossible, voire immoral, de chercher à discuter intelligemment d’art autochtone sans placer les réalités politiques au coeur de la question » (Nemirroff 1992 : 40). Il est plutôt question de centrer les expériences des personnes autochtones au sein de l’étude du processus.
Dans l’ensemble du contenu des entrevues dirigées avec des personnes autochtones qui ont participé au projet de CNH, l’usage des pronoms indique que, selon ces personnes, le pouvoir décisionnel est resté entre les mains de l’équipe du musée : « Ils ont retenu ce qu’ils voulaient » (Entrevue individuelle anonyme, Montréal, 27 nov. 2014) : « Ça avait été suggéré. Mais ils n’ont pas tout pris ce qu’on a dit » (Jacques Kurtness, entrevue de groupe Mamo 2014, Québec, 14 juin 2014). Caroline Lantagne nuance la situation :
C’est sûr qu’ultimement, le Musée était quand même l’éditeur de l’expo. Quand on arrive à la production et qu’il faut prendre des décisions quand on arrive à la fin du projet, il y a des décisions qui s’imposent parce qu’elles doivent être prises rapidement. Donc c’est le Musée qui les prenait. C’est le Musée qui installait, produisait.
Entrevue avec Caroline Lantagne, Québec, 11 juin 2015
Le discours du directeur général, Michel Côté, lors de la cérémonie d’ouverture de CNH, confirme qu’il y a une certaine confusion dans la vision du Musée et sur le partage du pouvoir décisionnel : « Leurs voix qui nous viennent en tête lorsque nous exposons. » Cette phrase révélatrice laisse entendre que les voix, même si elles sont autochtones, demeurent la propriété du musée (« nous exposons »). Pour comprendre cette dynamique, rappelons que les instances mises en place dans le cadre du projet, tels le comité scientifique et l’Assemblée Mamo, étaient à caractère consultatif plutôt que décisionnel, et que le contrat de partenariat avec la BRV manquait de clarté quant au degré d’autorité d’Élisabeth Kaine. Ces personnes autochtones engagées dans le processus ont perçu une attitude de fermeture de la part du MCQ, qui se démarque de ce qui avait été présenté d’entrée de jeu. Les relations se seraient détériorées avec le temps. Quelques moments clés peuvent illustrer ce problème. Pensons aux mois qui ont précédé l’ouverture de l’exposition, alors que beaucoup de décisions finales ont dû être prises pour respecter les échéances. C’est à ce moment que la parole autochtone aurait pu être perdue de vue, selon une membre du comité scientifique : « Plus les réunions avançaient, moins je sentais qu’on écoutait ma voix et celle des autres également. On avait beau dire, ce n’était pas retenu et à la réunion d’ensuite c’était complètement évacué des travaux. » (Entrevue individuelle anonyme, Montréal, 27 nov. 2014). La direction du musée a à ce moment-là reçu une lettre, signée par sept des huit membres du comité scientifique qui faisaient part des doutes du comité sur le processus de réalisation. L’inconstance du musée exprimée dans les entrevues traduit la difficulté éprouvée par son équipe pour concrétiser les changements préconisés. Le temps, les budgets limités, les dynamiques interpersonnelles, la lourdeur du processus de validation et les différences culturelles sont évidemment des facteurs importants à considérer pour expliquer la complexité et les limites de ce processus (Entrevue avec Caroline Lantagne, Québec, 11 juin 2015). Il faut aussi prendre en considération les multiples changements de garde dans l’équipe du musée qui se sont opérés entre le lancement du projet en 2008 et la réouverture après l’incendie de 2015. En effet, aucune personne de l’équipe du musée n’a suivi le projet du début à la fin. Par ailleurs, il est important de noter que l’affiche promotionnelle et le titre de l’exposition, deux éléments considérables de l’identité de l’exposition, ont été conçus sans aucune consultation ou participation d’Autochtones. Le titre aurait été imposé par la direction, puis l’affiche a été produite à son tour par une firme de design externe.
À une écoute incomplète s’ajoute le sentiment d’être fréquemment en situation de confrontation pour les personnes autochtones qui ont participé aux entrevues. On note aussi des références aux négociations territoriales qui réfèrent directement aux diverses luttes menées par les Autochtones envers l’État lorsqu’ils sentent que leurs voix ne sont pas prises en considération : « On pourrait barricader [rires] » (Kathleen André, Entrevue de groupe Mamo 2014, Québec, 14 juin 2014). De plus, plusieurs passages des entrevues révèlent des expériences de manque de respect ou d’affrontement telles que :
Après cette expérience-là, les jours qui ont suivi, je me suis vraiment rendu compte qu’on s’est foutu de ma gueule. On m’a utilisée quand ça faisait leur affaire. Quand, à un moment donné, on est devenu trop revendicateurs, trop « chialeux », on a tranquillement tassé notre parole et nos recommandations.
Entrevue individuelle anonyme, Montréal, 27 nov. 2014
Rassemblées et considérées, ces expériences personnelles négatives vont au-delà de la simple anecdote. Ces récits de négociations et de confrontations au sein de l’institution révèlent des relations de pouvoir inégales entre le MCQ et les participants et participantes au projet d’exposition, au point qu’Élisabeth Kaine utilise le terme de « racisme » pour expliquer ce déséquilibre systémique : « Il y a peut-être du racisme caché derrière ça, peut-être un esprit colonialiste, encore. » (Entrevue avec Élisabeth Kaine, Québec, 10 nov. 2014) Dans un échange complémentaire réalisé sur cette question en avril 2017, Élisabeth Kaine rappelle plusieurs exemples à l’appui de cette hypothèse :
Une des manifestations de sa présence est un malaise difficile à nommer à mesure que le projet avance. Un sentiment que la parole n’est jamais tout à fait entendue […] il y a toujours une résistance plutôt qu’un accueil, chaque étape demande de convaincre de la valeur et de la pertinence.
Élisabeth Kaine, 19 avril 2017
Le non-respect de certains concepts proposés par des créateurs autochtones ainsi que les demandes d’approbation de choix qui ont déjà été validés ou l’incapacité d’incarner dans l’exposition le sens profond des contenus émanant des concertations, participent, pour Kaine, de ce sentiment de racisme systémique. Un exemple significatif est sans doute celui de la présentation en vitrine de hochets de tortue et d’un tambour innu (teueikan), positionnés derrière ou plus bas qu’un ostensoir alors que la proposition était de les mettre côte à côte pour symboliser une rencontre d’égal à égal entre deux systèmes de croyances, tel qu’exprimé par Jean St-Onge (Innu) : « Dans la vitrine de la spiritualité, il y a un ostensoir qui est mis en évidence. Ce n’est pas ça. On n’a jamais eu d’ostensoirs. On a toujours eu le teueikan pour survivre jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi l’ostensoir est placé devant le teueikan ? Ça devrait être le contraire. Ça me dérange. » (Entrevue de groupe Mamo 2014, Québec, 14 juin 2014) Faut-il dès lors parler de racisme systémique, de discrimination systémique ou, comme le fait Lise Bastien, directrice générale du Conseil en éducation (CEPN), d’ignorance systémique[5] ? Faut-il plutôt expliquer ces ressentis par « une hyper-sensibilité de [la part de la responsable du processus de concertation, Élisabeth Kaine elle-même,] en raison de mon rôle de porteur du message qui m’avait été livré » (Élisabeth Kaine, 19 avril 2017) ?
Il est de notre responsabilité de comprendre cette utilisation des termes « racisme », « discrimination » ou « luttes » et de les analyser pour ce qu’ils sont, soit des paroles autochtones énoncées pour rendre compte d’un déséquilibre ressenti et vécu dans la relation de pouvoir[6]. Un regard structurel aide d’ailleurs à dégager les inégalités persistantes entre Blancs et Autochtones dans l’institution. Sur plus de deux cent trente employés aux Musées de la civilisation, un seul s’identifie aujourd’hui, à notre connaissance, comme Autochtone. Malgré l’intégration d’une participation active – et à plusieurs niveaux – des Autochtones aux projets ponctuels comme l’exposition CNH, la structure de fonctionnement inhérente au MCQ reproduit des formes de discrimination, notamment dans le processus décisionnel final qui reste sous la responsabilité de l’équipe permanente du musée. Selon Élisabeth Kaine, le défi de la concertation n’a pas été achevé :
Quand le résultat justifie la persévérance, ce n’est pas grave, les projets difficiles. Mais quand on n’a pas les résultats, c’est là que ça devient grave. Et ça a été difficile pour moi et très difficile pour mon équipe. […] On a une responsabilité quand on s’engage dans des démarches collaboratives de respecter la parole. D’autant plus dans le travail avec les Premières Nations, parce qu’on a une réparation historique à faire. Il y a eu un bris de confiance.
Entrevue avec Élisabeth Kaine, Québec, 10 nov. 2014
Conclusion
L’exposition C’est notre histoire est racontée à l’aide d’une multiplicité de voix, dont celles des Autochtones, qui déconstruisent les conceptions passéistes et réductrices des cultures des Premières Nations et des Inuit. Néanmoins, la proposition d’intégrer la parole autochtone jusque dans le processus décisionnel de CNH n’a pas abouti comme prévu initialement, d’autant plus que l’approche muséologique valorisant les « voix autochtones » ne suffit pas à développer le niveau de contrôle des peuples autochtones dans le monde des musées (Mithlo 2013 ; Shannon 2009 ; Phillips 2011). À partir d’une intention de départ en faveur d’un réel changement des façons de faire, un processus novateur de consultation et de concertation à une échelle rarement égalée dans l’histoire de la muséologie communautaire a été mis en place. Mais les entrevues avec des participants et participantes autochtones ont démontré que les objectifs énoncés au départ par le MCQ n’ont pas été atteints, voire qu’une confusion sur la place décisionnelle des Autochtones s’est installée. Le Musée a conservé l’essentiel de son autorité sous sa structure d’origine au détriment des partenaires, collaborateurs et consultants. Le manque de visibilité de la parole autochtone dans la salle d’exposition reflète ainsi le manque de considération de la parole autochtone dans le processus final d’élaboration. Les auteurs de la pensée postcoloniale offrent certaines pistes pour poursuivre cette réflexion : puisque la structure organisationnelle d’un musée est fondée dans une conceptualisation du patrimoine provenant de la société dominante, les ontologies autochtones n’y sont pas complètement compatibles (Ames 2004 : 77 ; Mithlo 2004 : 758). L’intégration des compétences et des expertises autochtones dans les musées constituera, en ce sens, toujours un défi de taille (Child 2009 : 255 ; Lonetree 2012).
Pour les professionnels et professionnelles non autochtones du musée engagées dans le déroulement collaboratif, cette expérience s’est révélée formatrice en ce qui concerne la décentralisation d’un professionnalisme muséologique au bénéfice des connaissances autochtones. Selon Caroline Lantagne, plutôt qu’un changement au sein de l’institution, c’est sur le plan individuel que l’expérience collaborative aura probablement le plus d’impact à long terme (Entrevue avec Caroline Lantagne, Québec, 11 juin 2015). Par contre, le manque de perspective ne permet pas de prévoir comment ces changements sur le plan individuel pourraient avoir un impact à plus grande échelle. Le MCQ n’est peut-être pas un « temple », mais peut-on le considérer comme un « forum » (Cameron 1971) ? Le noeud du problème se trouve peut-être dans l’autorité de l’institution qui peut parfois éteindre les aspirations individuelles et les dynamiques interpersonnelles : « Il y avait une force plus grande à l’interne que toutes nos volontés. Je ne sais pas c’est quoi cette force-là. Est-ce qu’elle est centralisée, est-ce qu’elle est diffuse partout, comme une culture ? » (Entrevue avec Élisabeth Kaine, Québec, 10 nov. 2014) On peut également se demander s’il n’y pas eu une incompréhension de la part du Musée à propos des méthodes innovantes de la BRV. Fidèle à son fonctionnement habituel, et malgré de nombreuses actions novatrices (comme la création de l’assemblée consultative Mamo composée de représentants autochtones, ou la participation de l’artiste Yves Sioui Durand (Wendat) à l’élaboration du scénario), le Musée n’a pas voulu confier jusqu’au bout l’ensemble du processus à la BRV.
La renommée du musée raconte une histoire du partage de l’autorité réussie, grâce entre autres à l’obtention du Prix du Gouverneur général. Or, la mise en application effective du processus présenté a été contestée par de nombreuses personnes autochtones ayant participé au projet à divers degrés, ce qui vient relativiser le succès du résultat final.
Malgré les difficultés soulevées et vécues par les participants, le nombre de personnes autochtones mobilisées pour la conception de l’exposition a fait de ce projet de muséologie collaborative le plus vaste et le plus complet de l’histoire du MCQ. Une exposition itinérante a été élaborée dans le but de présenter le processus collaboratif à l’origine de l’exposition. Le titre, Prenons tous place, reflète d’ailleurs le souci de mieux considérer la place de tous les acteurs de ce projet complexe. Il faut également souligner l’important travail réalisé pour enrichir les collections d’art contemporain (plusieurs acquisitions ont été réalisées par le MCQ) et leur présentation dans l’exposition. Ces initiatives ont sans doute permis de considérer les voix autochtones qui, dans ces cas, semblent avoir été entendues. Les modifications apportées à l’habituelle structure de travail méritent d’être tentées et développées de nouveau par le MCQ, mais également par d’autres musées, car il semble maintenant devenu incontournable de travailler à la déconstruction des structures hiérarchiques de pouvoir constituées pendant la période coloniale en sollicitant des partenariats avec les Autochtones. Nous pensons que les regards crtitiques sur l’expérience de C’est notre histoire, comme sur d’autres expositions participatives, ne peuvent que permettre une évolution positive des droits des peuples autochtones quant à leur niveau de contrôle sur leur patrimoine dans le monde des arts, de la muséologie et de l’anthropologie.
Parties annexes
Remerciements
Nous remercions ici chaleureusement les membres des Premières Nations et le personnel du MCQ qui ont participé à cette recherche. Nous tenons également à remercier les membres de La Boîte Rouge VIF ainsi que les évaluateurs anonymes de ce texte pour leurs commentaires très précieux.
Notes biographiques
Laurence Desmarais a obtenu en 2016 une maîtrise en histoire de l’art à l’UQAM, après y avoir complété son baccalauréat. Elle s’intéresse au nouveau champ des études du colonialisme de peuplement, et sa recherche s’insère dans les approches féministes, anti-oppressives et décoloniales. Elle est assistante de recherche au réseau DIALOG – le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones – avec lequel elle travaille à développer des outils de mobilisation des connaissances et organise des activités avec les partenaires autochtones de recherche. Ses textes ont étés publiés aux Éditions du Remue-Ménage et dans la revue Canadian Art.
Laurent Jérôme, Ph.D. en anthropologie (Université Laval, 2010), est professeur au département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il s’intéresse aux politiques de l’identité et de la culture en milieux autochtones contemporains à travers des thèmes comme la ritualisation du territoire, la transmission et la patrimonialisation des savoirs ainsi que les relations entre arts contemporains et cosmologies amérindiennes. Il a écrit plusieurs articles sur les spiritualités amérindiennes, les processus de décolonisation de la recherche et l’importance de l’humour dans les rituels de guérison. Directeur de l’antenne montréalaise du CIÉRA et codirecteur du programme en études autochtones de l’UQAM, il a été responsable des dossiers autochtones aux Musées de la civilisation de Québec et a développé des projets de recherche partenariale avec Femmes autochtones du Québec et le Cercle des Premières Nations de l’UQAM en vue d’améliorer l’intégration des savoirs autochtones dans la recherche et les institutions.
Notes
-
[1]
Nous empruntons le concept d’autorité à l’anthropologue James Clifford pour qualifier ici le déséquilibre dans cette responsabilité de l’écriture du texte. Pour Clifford, l’équilibre des pouvoirs est atteint lorsque les stratégies textuelles « accord[ent] aux collaborateurs non seulement le statut d’énonciateurs indépendants mais celui d’écrivains » (Clifford 1996 : 56).
-
[2]
Notre objectif n’est pas ici de réfléchir au concept de « point de vue » et à sa polysémie ou à ses tensions dans l’exposition C’est notre histoire (cf. Jacobi 2005 et Soulier 2013). Nous nous limitons à une utilisation du concept de « point de vue » comme une manière de voir les choses, plus spécifiquement la manière dont certains représentants autochtones voient le résultat de ce processus complexe.
-
[3]
L’assemblée consultative nommée Mamo-Ensemble, rassemblant au minimum une représentante de chacune des nations autochtones au Québec et du milieu urbain, des organisations autochtones comme Femmes autochtones du Québec et des partenaires de recherche et constituant en tout près de 40 personnes, a été conçue pour faire office de comité culturel.
-
[4]
Si l’on compare par exemple avec le National Museum of the American Indian, le processus d’intégration de la participation des communautés autochtones atteint sa limite au moment de donner forme à l’exposition. Selon Kaine, la BRV prévoyait inclure les créateurs autochtones à ce niveau.
-
[5]
Dans http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/496624/autochtones-un-regard-a-decoloniser (consulté le 19 avril 2017).
-
[6]
Le Rapport de l’observatrice civile indépendante (Lafontaine 2016) sur l’intégrité et l’impartialité des enquêtes policières visant des autochtones offre quelques pistes pour mieux comprendre ce concept de racisme systémique : si le racisme individuel est facilement identifiable et condamnable, le racisme systémique est socialement organisé et plus difficilement reconnaissable. Il perpétue en ce sens un ordre social inégal (ibid : 66). Pour l’instant, aucune étude n’applique ce concept en ce qui concerne les autochtones au Québec. Voir tout de même Wawanoloath 2015 ; Comat et al. 2010 ; Salée 2005 ; Lepage 2001.
Ouvrages cités
- Ames, Michael M., 1994 : « The Politics of Difference: Other Voices in a not yet Post-colonial World ». Museum of Anthropology 18(3) : 9-17.
- Ames, Michael M., 2004 : « Are Changing Representation of First Peoples in Canadian Museums and Galleries Challenging the Curatorial Prerogative? » in Richard West (dir.), The Changing Presentation of the American Indian: Museums and Native Cultures : 73-162. National Museum of the American Indian et University of Washington Press, Washington.
- AUGÉ, Marc, 1992 : Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Seuil, Paris.
- Battiste, Marie, 2008 : « Research Ethics for Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: Institutional Researcher Responsabilities », in N. Denzin, Y. Lincoln et L.T. Smith (dir.) Handbook Of Critical AndIndigenous Methodologies : 497-510. Thousand Oaks, Sage Publications.
- Brant, Jameson C., 2014 : « La redéfinition de la participation des Premières Nations et des Inuit à la préparation des expositions ». Muse (mai/juin) : 47-49.
- Brown, Leslie, et Susan STREGA (dir.), 2005 : Research as Resistance: Critical, Indigenous and Anti-Oppressive Approaches. Canadian Scholar’s Press, Toronto.
- BURRAROW, Michael 2009 : The Extended Case Method. University of North Carolina Press, Berkeley.
- CAMERON, Duncan, 1971 : « The Museum, a Temple or the Forum? » Curator 14(1) : 11-24.
- CHILD, Brenda, 2009 : « Creation of the Tribal Museum », in Susan Sleeper-Smith (dir.), Contesting Knowledge. Museums and Indigenous Perspectives : 251-256. University of Nebraska Press, Lincoln.
- CLIFFORD, James, 1996 : Malaise dans la culture : l’ethnographie, la littérature et l’art au xxe siècle. École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. [Éd. amér. 1988, trad. de M.-A. Sichère].
- COMAT, Ioana, et al., 2010 : « Comprendre pour mieux agir afin d’éliminer la discrimination et le racisme à l’endroit des Premiers Peuples ». Cahiers ODENA (01).
- COOMBES, Annie : 1991: « Ethnography and the formation of national and cultural identities », in Susan Hiller (dir.), The Myth of Primitivism : 189-214. Routledge, London.
- CVRC (Commission de vérité et réconciliation du Canada), 2015 : Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport final. McGill-Queen’s University Press, Montréal.
- DELORIA, Vine Jr., 1969 : Custer Died for your Sins. An Indian Manifesto. Palgrave Macmillan, New York.
- DENZIN Norman, Yvonna LINCOLN et Linda SMITH (dir.), 2008 : Handbook of Critical & Indigenous Methodologies. Sage Publications, Thousand Oaks.
- DESMARAIS-TREMBLAY, Laurence, 2016 : L’histoire de qui ? Une analyse critique des rapports entre les autochtones et le Musée de la Civilisation à Québec dans le cadre de l’élaboration de l’exposition C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du xxie siècle. Mémoire de maîtrise, département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal, Montréal.
- DOXTATOR, Deborah, 1988 : Plumes et pacotilles. Catalogue d’exposition. Centre culturel Woodland, Branford.
- DUBUC, Élise, et Laurier TURGEON, 2002 : « Musées d’ethnologie : nouveaux défis, nouveaux terrains ». Ethnologies 24(2) : 5-18.
- DURAND, Guy Sioui, 2014 : « Un Wendat nomade sur la piste des musées ». Anthropologie et Sociétés 38(3) : 271-288.
- ERASMUS, Georges, et al., 1992 : Tourner la page : Forger de nouveaux partenariats entre les musées et les Premières Nations : Rapport du Groupe de travail sur les musées et les Premières Nations / Turning the Page : Forging New Partnerships Between Museums and First Peoples : Task Force Report on Museums and First Peoples. Association des musées canadiens/Canadian Museums Association ; s.l. : Assemblée des Premières Nations/Assembly of First Nations.
- GIBSON Stephanie, et Sean MALLON, 2010 : « Representing Community Exhibitions at the Museum ». Tuhinga (21) : 56-57.
- JACOBI, Daniel, 2005 : « Les faces cachées du point de vue dans les discours d’exposition ». La Lettre de l’OCIM 100 : 44-53.
- JÉRÔME, Laurent, 2010 : « Vers une nouvelle exposition au Musée de la civilisation ». Recherches amérindiennes au Québec 40(1-2) : 161-163.
- JÉRÔME, Laurent, 2014 : « Peuples autochtones et musées : 25 ans de relations au Musée de la civilisation », in Marie-Paule Robitaille (dir.), Voyage au coeur des collections des Premiers Peuples : 111-123. Septentrion et Musées de la civilisation, Québec.
- JÉRÔME, Laurent, et Élisabeth KAINE, 2014 : « Représentations de soi et décolonisation dans les musées : quelles voix pour les objets de l’exposition C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du xxie siècle (Québec) ? » Anthropologie et Sociétés 38(3) : 231-252.
- KAHN, Miriam, 2000 : « Not Really Pacific Voices: Politics of Representation in Collaborative Museum Exhibits ». Museum Anthropology 24(1) : 57-74.
- KAINE, Élisabeth, 2002 : « Les objets sont des lieux de savoir ». Ethnologies 24(2) : 175-190.
- KAINE, Élisabeth, (dir.), 2016 : Voix, visages, paysages : les premiers peuples et le xxie siècle. Presses de l’Université Laval et La Boîte Rouge VIF, Québec.
- LAFONTAINE, Fannie, 2016 : Rapport de l’observatrice civile indépendante : Évaluation de l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM sur des allégations d’actes criminels visant des policiers de la SQ à l’encontre de femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs. Québec. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq.pdf (consulté le 15 nov. 2016).
- LEPAGE, Pierre, 2001: « Les Autochtones à l’ombre du mépris ». Relations (672).
- LONETREE, Amy, 2012 : Decolonizing Museums: Representing Native America and Tribal Museums. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- LONETREE, Amy, et Amanda COBB (dir.) : 2008 : The National Museum of the American Indian. Critical Conversations. University of Nebraska Press, Lincoln.
- LYNCH, B.T., et S.J.M.M. ALBERTI, 2010 : « Legacies of Prejudice: Racism, Co-Production and Radical Trust in the Museum ». Museum Management and Curatorship 25 : 13-35.
- McMASTER, Gerald, 2002 : « Our (Inter) Related History », in L. Jessup et S. Baggs (dir.), On Aboriginal Representation in the Gallery : 3-8. Canadian Museum of Civilization, Hull.
- MITHLO, Nancy Marie, 2004 : « “Red Man’s Burden” : The Politics of Inclusion in Museum Settings ». The American Indian Quarterly 28(3/4) : 743-763.
- MITHLO, Nancy Marie, 2012 : « No Word for Art in Our Language? Old Questions, New Paradigms ». Wicazo sa Review 27(1) : 111-126.
- MITHLO, Nancy Marie, 2013 : « Here Now, But Not Always: Native Arts and the Museum ». El Palacio 118(4) : 22-27.
- MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC, 2014 : Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence des programmes en musée : Histoire vivante ! décerné à l’exposition C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du xxie siècle. Communiqué, Québec, 4 nov. http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&idArticle=2211048689 (Consulté le 10 octobre 2015).
- NEMIROFF, Diana, 1992 : « Modernisme nationalisme et au-delà », in Diana Nemiroff et al. (dir.), Terre, esprit, pouvoir les premières nations au Musée des beaux-arts du Canada : 16-41. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.
- ONCIUL, Bryony, 2015 : Museums, Heritage and Indigenous Voice. Decolonizing Engagement. Routledge, New York.
- PHARAND, Sylvie, et al., 2010 : Participer à la création d’une nouvelle exposition avec les Premières Nations et les Inuit du Québec. Les travaux de l’Assemblée consultative Mamo-ensemble au Musée de la civilisation. Synthèse du premier atelier. Cahiers DIALOG 2, Montréal.
- PHILLIPS, Ruth B., 1988 : « C’est de l’art indien, où va-t-on le placer ? » Muse 6(3) : 68-71.
- PHILLIPS, Ruth B., 2008 : « L’Ancien et le Nouveau Monde : aboriginalité et historicité de l’art au Canada ». Perspective 3 : 535-550.
- PHILLIPS, Ruth B., 2011 : Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museum. McGill-Queens’s University Press, Montréal.
- POIRIER, Claire, 2014 : « “Ces artéfacts ont un langage bien à eux” : collections muséales, propriété et politiques de la différence ». Anthropologie et Sociétés 38(3) : 61-77.
- ROBITAILLE, Marie-Paule, 2014 : « Vingt fois sur le métier... ou la longue redécouverte de l’histoire des collections des Premiers Peuples des Musées de la civilisation », in Marie-Paule Robitaille (dir.), Voyage au coeur des Collections des Premiers Peuples : 14-48. Septentrion et Musées de la civilisation, Québec.
- SALÉE, Daniel, 2005 : « Peuples autochtones, racisme et pouvoir d’État en contextes canadien et québécois : éléments pour une ré-analyse ». Nouvelles pratiques sociales 17(2) : 54-74.
- SHANNON, Jennifer, 2009 : « The Construction of Native Voice at the National Museum of the American Indian », in Susan Sleeper-Smith (dir.), Contesting Knowledge. Museums and Indigenous Perspectives : 218-247. University of Nebraska Press, Lincoln.
- SINCLAIR, Catherine, (dir.), 2012 : Decolonize Me. Lowe Martin Group, Ottawa.
- SIOUI-DURAND, Guy, 2014 : « Un Wendat nomade sur la piste des musées ». Pour des archives vivantes ». Anthropologie et Sociétés 38(3) : 271-288.
- SKINNER, Damian, 2014 : « Settler-colonial Art History: A Proposition in Two Parts ». Journal of Canadian Art History / Annales d’histoires de l’art canadien 35(1) : 131-171.
- SMITH, Linda Tuhiwai, 1999 : Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London, Zed Books.
- SOULIER, Virginie, 2013 : Donner la parole aux autochtones : quel est le potentiel de reconnaissance de l’exposition à plusieurs points de vue dans les musées ? Thèse de doctorat, département des communications, Université du Québec à Montréal.
- WAWANOLOATH, Maxime-Auguste, 2015 : Aspects discursifs de l’assimilationnisme relatif aux peuples autochtones et du colonialisme d’établissement au Canada. Mémoire de maîtrise, département de science politique, Université d’Ottawa.
- WINNEL, Branche, 1996 : « Indigines in Charge: Are Museums Ready? » in Curatorship: lndigenous Perspectives in Post-colonial Societies : 119-138. Actes du colloque tenu les 16-18 mai 1994 à l’Université de Victoria (C-B). Musée canadien des civilisations et University of Victoria.


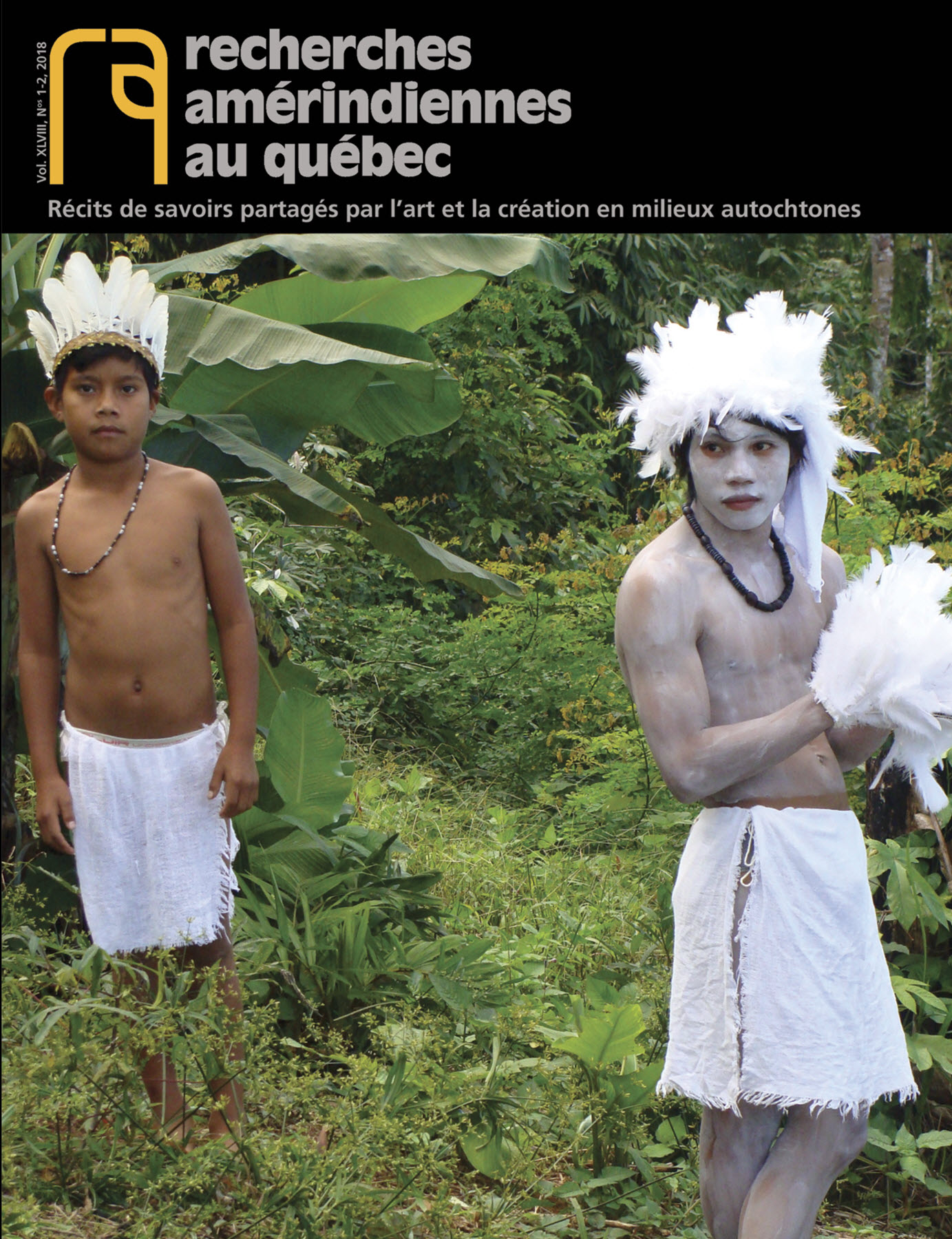
 10.7202/006636ar
10.7202/006636ar