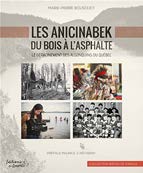Corps de l’article
Marie-Pierre Bousquet, bien connue pour la finesse de ses travaux anthropologiques sur les Algonquins d’aujourd’hui, signe ici un ouvrage majeur, et même un modèle pour l’étude des communautés amérindiennes dans leur réalité et leur imaginaire contemporains. Dans son avant-propos, elle mentionne qu’à son arrivée au Québec, au début des années 90, elle fut surprise de la pauvreté de la documentation sur le monde des réserves et des établissements, mis à part quelques articles sur quantité de problèmes sociaux et sanitaires. La situation s’est certes un peu améliorée depuis, mais le chemin à parcourir reste encore important : que connaît-on des rapports à l’espace au sein des communautés comme lieu d’expression et d’évolution de l’identité redéfinie de l’intérieur ? S’appuyant sur sa thèse de doctorat et sur plus de vingt ans de côtoiement des Algonquins, et plus particulièrement de la communauté de Pikogan, Les Acininabek[1], du bois à l’asphalte allie une synthèse de leur histoire territoriale et sociale à un examen soigné des communautés contemporaines à travers le vécu et le perçu des différentes générations qui vivent ensemble, mais qui ont des rapports différents à l’espace géographique et social.
Les Acininabek, du bois à l’asphalte peut être lu en pièces détachées, comme un ouvrage de référence. Il est composé de trois grandes parties et de 11 chapitres, comportant au total 53 sections thématiques, elles-mêmes subdivisées en rubriques. On peut entrer dans le livre à n’importe lequel de ces niveaux selon l’intérêt qu’on porte au contenu traité, ce qui est facilité par une table des matières aux titres et sous-titres signifiants. On gagne toutefois à lire l’ouvrage dans son ensemble comme une fascinante monographie sur l’histoire des communautés algonquines, sur la transformation de leur mode de vie et de leur rapport à l’espace, ainsi que sur leur univers contemporain.
Pour bien rendre compte du livre, il m’apparaît nécessaire de passer en revue les thèmes qui y sont traités. La première partie porte sur la modification de l’espace symbolique algonquin avec le passage du nomadisme à la sédentarisation et sur les revendications des communautés pour reprendre le contrôle sur leur devenir. Son premier chapitre confronte l’histoire officielle et celle des Algonquins en mettant l’accent sur leur vie, leurs connaissances et leurs croyances antérieures au contact avec les Français, sur les transformations apportées par les contacts subséquents et, brièvement, sur la constitution de chacune des bandes algonquines. Le chapitre suivant décrit le territoire traditionnel dans ses limites, ses caractéristiques géographiques et climatiques, son réseau hydrographique tel qu’il fut exploité pour les déplacements, sa toponymie, son mode d’affectation en territoires familiaux et ce qu’il est devenu avec la mise en tutelle et le découpage territorial (Québec / Ontario ; Abitibi / Témiscamingue / Outaouais). Le troisième chapitre est consacré au passage du nomadisme à la sédentarité lors de la création des réserves et des pensionnats, ainsi qu’à la quête actuelle d’auto-prise en charge en matière d’éducation, de santé, de langue et de retissage des liens entre les générations. Le dernier chapitre de cette section examine la diversité des statuts et des communautés, les réseaux et les rapports de pouvoir qui se créent entre les bandes et les associations, et comment les Algonquins s’autodésignent selon leur appartenance et statut respectifs et en rapport à la désignation de l’Autre.
La deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse aux rapports à la réserve, à la ville et au bois, les trois contextes spatiaux au coeur de l’identité spatiale contemporaine des Algonquins. Comment vit-on aujourd’hui ces univers ? Comment cherche-t-on à y sauvegarder la culture malgré les cassures vécues à travers le temps et le fossé entre les générations ? Le regard est ici ethnographique. L’auteure parle de la vie dans la réserve, un monde imposé et relativement clos, mais réapproprié ; de l’habitation dans les petites villes régionales ou encore de leur fréquentation ; et des migrations vers la grande ville. Le « bois », objet du deuxième chapitre de cette partie, demeure le monde idéal, le lieu indien par excellence, même pour ceux qui n’y vont plus beaucoup : c’est à la fois une fiction identitaire et une réalité qui « symbolise la lutte […] contre l’assimilation et l’autonomie économique pour l’avenir » (p. 200). Le troisième chapitre s’intéresse à la vie quotidienne dans l’espace moderne à travers les pratiques d’aménagement de la maison et de son pourtour, la nourriture consommée, l’habillement porté, les pratiques d’hygiène, toujours en comparant l’habitation principale et le camp de chasse et en cherchant à identifier les moyens par lesquels la tradition est réinvestie dans ces pratiques. Le dernier chapitre sur la participation à la vie communautaire décrit le calendrier des fêtes, festivals, tournois et autres événements spéciaux ; les événements religieux et spirituels selon la religion pratiquée (catholicisme, pentecôtisme et traditionalisme) ; et les journées nationales et internationales, toutes des occasions de repenser l’identité algonquine et autochtone.
L’auteure écrit en introduction du livre que la troisième partie porte sur la politisation du fait culturel algonquin comme instrument de conscientisation et de pouvoir dans la sphère publique : il s’agit là d’une trame sous-jacente à l’ensemble du livre. Cette partie s’attache d’abord plus particulièrement à l’organisation sociopolitique, véhicule de cette politisation, un sujet délicat, traité avec beaucoup de tact en quatre sous-thèmes, soit : l’émergence de nouvelles figures de pouvoir dans la foulée de la contestation politique de la légitimité des pouvoirs de l’État et de l’Église, la notion et les figures de réussite, les réponses aux problèmes sociaux et, enfin, les réseaux de sociabilité et de parenté. L’auteure s’interroge notamment sur l’ambiguïté du statut des aînés, sur la constitution de l’élite politique, sur la montée des figures charismatiques associées à l’idéologie panamérindienne de type Nouvel Âge et sur l’impact des problèmes sociaux et des convictions religieuses sur la parenté. Le dernier chapitre se penche sur diverses modalités de réappropriation du patrimoine culturel algonquin : intérêt pour la généalogie, création de prénoms indiens, recherche sur les territoires de chasse, mise en valeur du patrimoine oral et matériel avec la création de centres culturels et inclusion des points de vue algonquins dans les grandes institutions muséales nationales. Entre les deux, un chapitre consacré au surnaturel passe en revue diverses formes de croyances sur l’au-delà, les rêves et les présages, les êtres surnaturels et la survivance de l’idée d’une possible intervention du surnaturel dans les espaces de vie. Bien que ce chapitre puisse sembler curieusement placé dans l’ensemble de l’ouvrage, l’auteure montre que les croyances sont toujours présentes, dans les réserves, chez les jeunes adultes bien qu’elles soient pour eux colorées plus positivement que chez les aînés. Ainsi, le territoire (aki), sous le vocable de Terre-Mère, et les rituels de respect envers la nature seraient des formes de créativité participant à la restauration culturelle amérindienne et à sa politisation.
Au-delà d’un ouvrage de référence et d’une monographie, Les Anicinabek, du bois à l’asphalte propose un questionnement et une vision des transformations en cours dans la société algonquine. Deux lignes d’argumentation m’apparaissent particulièrement intéressantes. D’abord, un questionnement sur la nature et les effets de la sédentarisation traverse tout le livre. Sans se complaire dans le misérabilisme, bien au contraire, Marie-Pierre Bousquet constate néanmoins la souffrance résultant des transformations apportées par cette sédentarisation, d’abord dans les relations à l’espace : « [Ce livre] traite de nostalgie au sens propre du terme, c’est-à-dire de la souffrance causée par le désir, impossible à satisfaire, de revenir chez soi. […] Mais cette nostalgie est paradoxale : ils n’ont jamais quitté ce territoire, puisque leurs communautés sont situées en son sein. La question que pose cet ouvrage est donc : peut-on être déraciné chez soi ? » (p. 17) Le déracinement, ou la perte de la forêt et du nomadisme en forêt, valide une position idéologique de victimes de l’histoire, un peu comme chez les déracinés, et, comme chez les migrants, les Algonquins construisent des représentations du temps et de l’espace qui leur permettent de maintenir un lien symbolique à cet univers perdu où le retour n’est pas possible.
Mais, au-delà de la nostalgie et du déracinement, il me semble que l’apport principal de l’ouvrage concerne davantage le réenracinement, puisque c’est l’intérêt porté par Marie-Pierre Bousquet au processus de reconstruction de l’identité et de l’appropriation de la réserve comme milieu de vie qui fait son originalité de l’ouvrage. Elle montre comment l’identité se construit en lien avec l’espace et, si le bois façonne sa dimension symbolique, comment la réserve est aujourd’hui le lieu d’ancrage de la nation et le lieu de tous les changements. L’auteure avance que la référence au nomadisme en forêt permet aux Algonquins d’y créer une distance avec le monde blanc et de s’en distinguer. Les communautés puisent donc dans cet univers symbolique les images qui leur permettent de se réapproprier le cadre de vie qui leur a été imposé et de se créer un nouvel univers identitaire – ce qui est abondamment illustré dans la deuxième partie de l’ouvrage. Cette construction symbolique du rapport au bois constitue également une assise idéologique et politique pour revendiquer des droits territoriaux et un droit à l’autodétermination.
Enfin, l’ouvrage offre une belle leçon de méthode. L’auteure insiste tout au long de son ouvrage sur l’importance de distinguer les générations dans les travaux sur les sociétés contemporaines autochtones, car elles n’ont pas connu les mêmes transitions. Chez les Algonquins, les personnes nées avant 1945 ont connu la vie dans le bois et elles parlent essentiellement la langue vernaculaire ; celles qui sont nées entre la fin des années 40 et le milieu des années 60 ont connu les pensionnats ; et la génération postpensionnats, née entre la fin des années 60 et 90, n’a pas connu directement ces périodes mais en a subi les traumatismes. On peut même envisager qu’une quatrième génération soit en train de se former chez les jeunes nés après la fin des années 90. Chaque génération a un temps social et un temps spatial différent, même s’il y a convergence entre elles et qu’elles créent ensemble une unité sociale cohérente, une communauté.
Si j’ai eu un regret à la lecture de ce livre, c’est que Marie-Pierre Bousquet ne discute pas des pistes de recherche qu’elle entrevoit pour approfondir et élargir le terrain couvert par son travail. Cela m’aurait semblé préférable à une conclusion reprenant brièvement deux avenues vers une société plus juste et équitable, soit la reconnaissance du territoire ancestral, l’école comme outil d’accès à la culture et à la création de valeurs communes.
En terminant, tout en soulignant l’accessibilité de l’ouvrage, je tiens à revenir sur les multiples lectorats qu’il devrait intéresser. Les communautés algonquines y trouveront un vaste panorama sur de nombreuses facettes de leur histoire, sur ce qu’elles sont aujourd’hui et sur des questions importantes pour leur avenir. Les autres habitants de l’Abitibi, du Témiscamingue et de l’Outaouais apprendront à connaître leurs voisins et leur rapport à la région. Les étudiants, les enseignants et le grand public y puiseront des tableaux très vivants qui piqueront leur intérêt pour le passé et la vie actuelle des Amérindiens et qui leur permettront d’amoindrir les nombreux préjugés à leur égard. Enfin, les universitaires devraient y trouver un modèle pour produire de tels ouvrages significatifs et capables de situer la vie contemporaine des communautés amérindiennes dans le contexte de leur histoire territoriale, sociale et culturelle. Plus généralement, l’ouvrage devrait inciter les chercheurs et les étudiants, autochtones et allochtones, à étudier la vie quotidienne et l’action sociopolitique contemporaines des communautés autochtones en tenant compte du contexte dans lequel elles évoluent, et surtout en tenant compte des rapports et des différences entre les générations. Notons enfin que, malgré les pressions à publier dans des maisons universitaires, Marie-Pierre Bousquet a fait le choix d’un éditeur de la région pour rejoindre davantage les communautés sur lesquelles elle travaille et le milieu régional qui fait partie de leur cadre de vie.
Parties annexes
Note
-
[1]
Le mot « Anicinabek », pluriel de « Anicinabe », est utilisé par un large éventail de groupes amérindiens. L’auteure utilise le terme « Algonquin » dans un sens plus restreint, pour faire référence spécifiquement aux dix bandes répertoriées sous ce nom, dont neuf sont situées au Québec et une en Ontario.