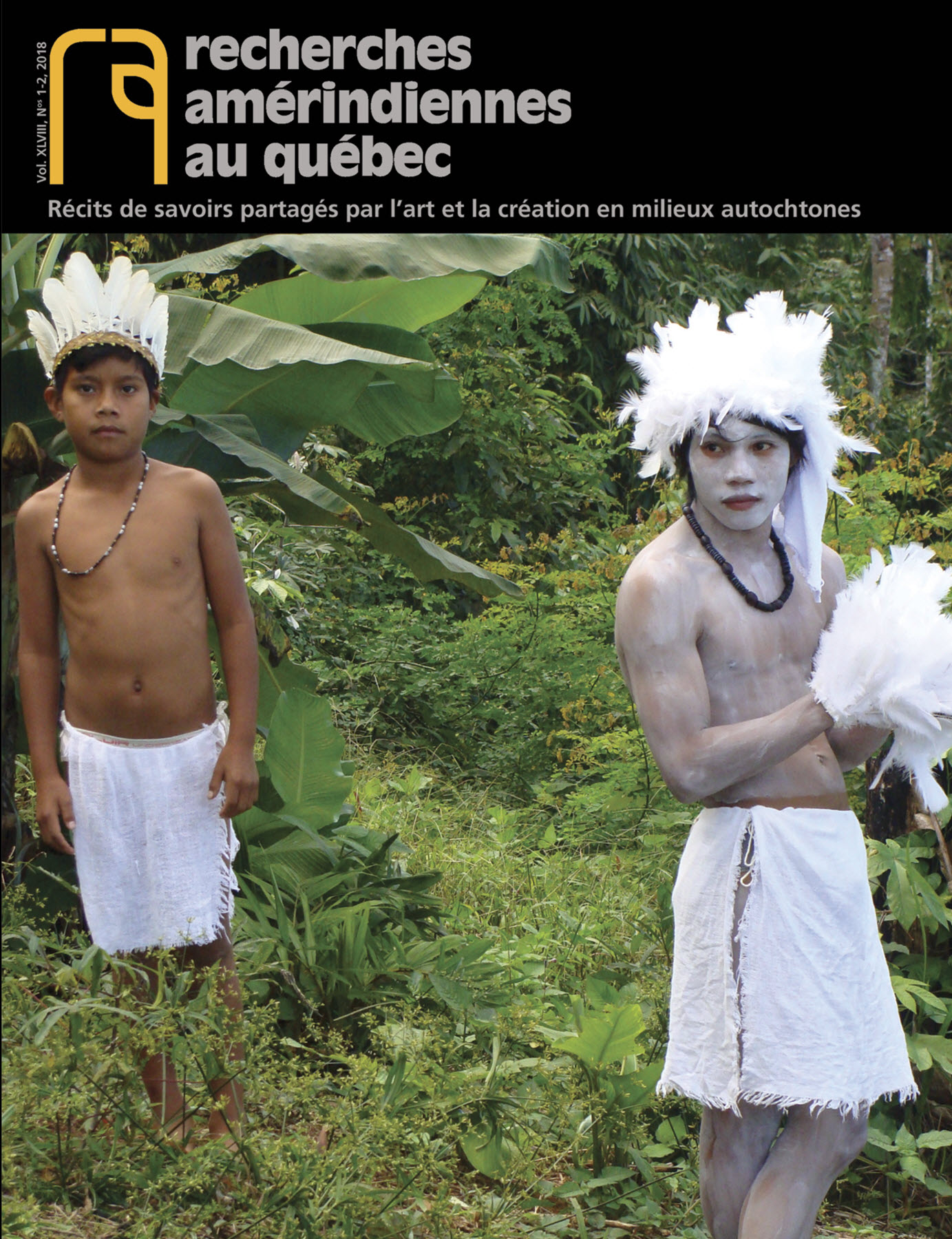Corps de l’article
La démarche ethnohistorique que propose Leila Inksetter dans cet ouvrage tiré de sa thèse de doctorat en fait une contribution fort stimulante à l’histoire autochtone au Québec. L’auteure y trace les contours de la transformation des structures sociales algonquines en Abitibi et au Témiscamingue au cours du xixe siècle, une période marquée par de profonds changements aussi bien aux niveaux social et spirituel que dans les sphères de la culture matérielle, de l’occupation du territoire et de l’environnement. Les quatre chapitres thématiques consacrés au mode de vie algonquin au début du xixe siècle, au rapport avec la traite des fourrures, à l’intégration du catholicisme, ainsi qu’à la colonisation du territoire et la rencontre avec l’État, suivent une logique chronologique qui conduit le lecteur jusqu’à l’aube du xxe siècle. Au fil de ce parcours narré dans un style sobre et soigné, Inksetter accumule les démonstrations suggérant que, loin d’être une expérience désastreuse pour les populations algonquines, la rencontre initiale avec la société coloniale (marchands, missionnaires et travailleurs saisonniers) donne lieu à une série d’initiatives et d’adaptations qui s’avèrent largement bénéfiques.
De prime abord, mentionnons que l’incursion de l’auteure dans le champ de l’histoire environnementale apporte une profondeur d’analyse particulièrement féconde. En soulignant que l’offre nutritionnelle sur le territoire à l’étude au début du xixe siècle est essentiellement constituée de petit gibier, l’auteure démontre de manière convaincante comment l’organisation sociale et l’occupation du territoire par les Algonquins sont modelées par ces contraintes. La nature cyclique de l’approvisionnement en nourriture, la nécessité de se déplacer sur le territoire de manière quasi permanente, ainsi que la difficulté d’accumuler des réserves, ont alors pour conséquence de limiter la croissance démographique et de maintenir la structure sociale centrée sur la cellule familiale associée à un territoire de chasse. Dans ces circonstances, le concept de bande autochtone tel qu’il émerge à la fin du xixe siècle est inexistant, les modes d’exploitation du territoire ne favorisant pas ce type d’organisation sociale. Ce n’est qu’avec la nouvelle capacité de dégager des surplus alimentaires qui se manifeste dans la seconde moitié du siècle grâce à la migration de l’orignal dans la région, à l’accès à la nourriture importée à travers la traite des fourrures et le travail salarié occasionnel, ainsi qu’à une horticulture saisonnière, que se mettent en place les facteurs permettant l’émergence de bandes où le chef devient un acteur politique d’importance. Une fois les conditions réunies, encore faut-il que des éléments déclencheurs contribuent à amorcer la reconfiguration de l’ordre social et des formes d’occupation du territoire.
En étudiant de manière minutieuse les répercussions de l’implantation des postes de traite sur le territoire, de l’entreprise missionnaire, de même que de l’essor de la foresterie dans la région, l’auteure démontre avec finesse comment l’organisation sociale algonquine se transforme afin de tirer profit des nouvelles possibilités qu’engendre la diversification de l’économie locale. Une fois le monopole de la traite des fourrures consolidé sous l’égide de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ces postes de traite sont devenus des lieux d’échange et des points de contact donnant lieu à des rassemblements de courte durée. Ce processus de convergence amorcé à la fin des années 1820 prend une nouvelle ampleur dès lors que l’établissement de missions à proximité a contribué à augmenter le pouvoir d’attraction de ces nouveaux espaces communs. Dans les décennies subséquentes, l’effort des missionnaires pour l’évangélisation des Algonquins augmente le pouvoir d’attraction des postes de traite où les séjours sont de plus en plus longs. C’est que la présence saisonnière des missionnaires donne une nouvelle signification rituelle à cet espace de rencontre. On note par exemple que les Algonquins qui avaient l’habitude d’inhumer leurs morts à divers endroits sur le territoire centralisent désormais les sépultures dans des cimetières aménagés au pied des croix ou près des chapelles érigées à proximité des postes de traite. De façon simultanée, cette pratique contribue à infuser cet espace d’une nouvelle valeur communautaire et symbolique (p. 315), qui témoigne de l’émergence d’un rapport plus fort à l’identité commune en plus de donner du corps au concept de bande.
Bien que l’ensemble de l’ouvrage expose plusieurs aspects positifs engendrés par les changements culturels de manière conséquente, c’est sans doute dans le chapitre traitant de la réception du catholicisme que la thèse d’Inksetter déploie son plein potentiel. Il est vrai que ce chapitre gagnerait à être allégé en synthétisant la description de l’activité missionnaire avec l’analyse des changements dans l’ordre social afin d’abréger un manuscrit déjà volumineux. Cela dit, il en ressort clairement que l’intérêt des Algonquins envers le catholicisme est tributaire du syncrétisme existant avec leur cosmologie. L’auteure est à son meilleur lorsqu’elle démontre que la réception enthousiaste du rite catholique par une partie significative de la population s’explique par une dynamique essentiellement algonquine permettant l’intégration de certains aspects de cette religion étrangère. On ne peut ici s’empêcher de penser à la réflexion entre catholicisme et autochtonie présentée par Allan Greer, dans son ouvrage sur Catherine Tekakwitha (Boréal, 2007). On s’étonne d’ailleurs de ne point retrouver ce titre dans la bibliographie, bien que l’étude soit située dans la vallée du Saint-Laurent au xviie siècle. Notons qu’à force de mettre l’emphase sur les aspects positifs des changements culturels engendrés par l’introduction du catholicisme, l’auteure en vient cependant à créer l’impression que celui-ci a permis d’équilibrer l’univers spirituel algonquin précolonial, qui aurait accusé un déficit en faveur des formes de pouvoir « négatives » des chamanes. Peut-être faudrait-il nuancer l’idée que la religion des missionnaires a offert une protection contre des pouvoirs chamaniques contre lesquels les Algonquins « ne pouvaient rien » auparavant (p. 485). Il apparaît plus à propos de souligner que le pouvoir protecteur des prêtres sur les « forces destructrices » de certains chamanes a plutôt offert de nouveaux outils aux Algonquins pour faire face à leur influence néfaste autrement que par la violence et le recours aux meurtres comme solution ou moyen préventif. En somme, que les Algonquins aient habilement adapté le culte catholique à leurs enjeux et besoins particuliers n’implique pas pour autant leur incapacité préalable à agir afin d’assurer l’équilibre des forces spirituelles.
Quoi qu’il en soit, l’auteure démontre très bien comment l’introduction du catholicisme joue un rôle fondamental sur les mécanismes de régulation de l’ordre social et sur l’émergence d’un nouveau rôle plus important pour le chef de bande. En parallèle de cette analyse axée sur les liens étroits entre spiritualité et politique, il aurait été intéressant que la question du travail et de l’impact de la transformation des modes de production sur le savoir-faire et la société algonquine soit développée davantage. Il est vrai que l’auteure explore certains aspects du travail masculin (traite, transport saisonnier de marchandises, travail salarié occasionnel). Le travail féminin, en revanche, de même que l’impact de la diversification du travail sur le rapport au genre, demeure pratiquement invisible. On aurait souhaité que plus d’espace soit consacré à l’étude des femmes algonquines et à la transformation des rapports genrés au sein de la transformation de l’ordre social. De même, il serait intéressant de pousser l’étude des initiatives déployées par les Algonquines afin de mettre leur savoir-faire à profit dans un espace économique en pleine transformation (chasse et piégeage autour des postes, travail des fourrures, artisanat, cueillette, travail domestique, etc.).
Enfin, la transformation de la chefferie comme institution politique présentée par Inksetter à mesure que l’État étend sa présence sur le territoire au tournant du xixe siècle invite à poursuivre la discussion. On pense notamment à la façon dont le mode de sélection des chefs est influencé par le jeu de pouvoir entre la chefferie traditionnelle, les nouveaux acteurs ayant accumulé un capital symbolique grâce aux nouvelles opportunités économiques, et le pouvoir de l’État que revendique l’agent indien. L’auteure invite à considérer l’introduction du système électoral de la Loi sur les Indiens à la demande des Algonquins comme la marque d’une transition vers un pouvoir délégué par la bande (p. 471). Loin de contester l’idée que le système des élections triennales soit parfois instrumentalisé à leur avantage par des groupes autochtones, l’ampleur de la rupture peut être sujette à discussion. D’une part, « l’ancienne » chefferie traditionnelle, bien qu’héréditaire, n’était pas exempte de mécanismes permettant de contester les détenteurs du pouvoir. De plus, l’adoption volontaire ou l’imposition du système triennal n’implique pas nécessairement un transfert de pouvoirs puisque le vote peut servir de plébiscite légitimant le pouvoir des chefs héréditaires vis-à-vis des Affaires indiennes. Enfin, en comparant l’expérience algonquine avec celle d’autres communautés autochtones de Mi’kma’ki (territoire traditionnel des Mi’kmaq englobant les provinces atlantiques et la Gaspésie) ou du Saint-Laurent et des Grands Lacs aux xixe et xxe siècles, on peut se questionner sur la façon d’interpréter l’introduction du système d’élection triennal. Alors que certains voient une rupture dans la transmission du pouvoir menant à une plus grande démocratisation de la vie politique, d’autres relèveront qu’il s’agit d’un nouvel outil de contestation mobilisé dans un contexte de luttes de pouvoirs internes aux communautés – notamment entre l’élite traditionnelle et une nouvelle génération aspirant au leadership –, auquel s’ajoute l’ingérence de l’agent indien. À cet égard, il est intéressant d’examiner le cas de la bande de Timiskaming présenté par Inksetter (p. 441-450). Celui-ci nous apparaît être un exemple de l’utilisation de la législation coloniale dans une dynamique de légitimation de certains groupes aspirant à la chefferie au sein de la bande – incluant l’agent indien McBride d’origine métisse – davantage qu’un signe de la mise en place d’une nouvelle forme de leadership basée sur la compétence (p. 478).
En conclusion, l’auteure souligne son étonnement face à l’absence de contrainte dans le processus menant aux changements culturels observés chez les Algonquins au xixe siècle. Certains historiens familiers avec l’historiographie des xviie et xviiie siècles, voire du début du xixe, y reconnaîtront un schéma assez typique de la phase initiale de la rencontre, moment précédant la colonisation intensive du territoire généralement caractérisé par les échanges et l’interdépendance. Ce n’est qu’une fois l’accaparement des terres et des ressources bien amorcé que la relation de pouvoir bascule à l’avantage de la société coloniale. En même temps que celle-ci met en place les outils législatifs et institutionnels lui assurant la mainmise et le contrôle du territoire, de ses ressources, voire des premiers occupants eux-mêmes, la capacité des communautés autochtones à prendre des initiatives et à s’adapter à ces changements se trouve drastiquement restreinte par l’horizon limité des réserves.
Grâce au travail de recherche minutieux qu’Inksetter présente dans cette monographie d’un grand intérêt, nous disposons non seulement d’un meilleur portrait des impacts positifs de certains échanges culturels et adaptations chez les Algonquins de l’Abitibi et du Témiscamingue durant le xixe siècle, mais aussi des transformations engendrées sur la structure même de l’organisation sociale et du pouvoir politique. Nous ne saurions donc trop recommander la lecture de cet ouvrage appelé à devenir une référence en histoire autochtone au Québec et nous espérons qu’un index sera ajouté aux éditions subséquentes.