Résumés
Résumé
Plus souvent fantasmée dans la littérature des hommes, figurée en objet, la travailleuse du sexe s’écrit dorénavant de plus en plus souvent au « Je », qui plus est par des personnes ayant pratiqué le travail du sexe, rompant ainsi avec les représentations figées et stéréotypées. L’auteure analyse les romans Putain, de Nelly Arcan (2001), Pute de rue, de Roxane Nadeau (2003), et Bordel, de Camille Fortin (2008) dans le but de révéler les signes d’agentivité du personnage.
Mots-clés :
- littérature,
- représentation,
- prostitution,
- agentivité sexuelle,
- subjectivité
Abstract
The sex worker fantasized in men’s literature, represented as object, is now more and more in first-person narratives written by people having been in the sex trade, thus creating a break with fixed, stereotypical representations. The author analyzes the novels Putain (2001) by Nelly Arcan, Pute de rue, by Roxane Nadeau (2003), and Bordel, by Camille Fortin (2008) in view of displaying the character’s agency.
Resumen
A menudo fantaseada en la literatura de los hombres, figurada como un objeto, la prostituta ahora se escribe cada vez más a menudo en el « Yo », sobretodo por personas que practican el trabajo sexual, rompiendo así con las representaciones hechas y estereotipadas. En este artículo, se analizan las novelas Putain, de Nelly Arcan (2001), Pute de rue, de Roxane Nadeau (2003) y Bordel, de Camille Fortin (2008) para revelar los signos de agencia del personaje.
Corps de l’article
Les pouvoirs reconnaissent depuis toujours la fonctionnalité du travail du sexe, mais à la condition, officieuse, que celles qui l’exercent soient souillées.
Boucher (2010 : 39)
Bien qu’il y ait eu quelques échappées avant les années 2000 (pensons à Albertine Sarrazin ou à Grisélidis Réal), la prise de parole littéraire de la prostituée[1] paraît, à compter de ce moment-là, outrepasser l’injonction au silence jetée sur cette condition. Je voudrais observer l’agentivité[2] de quelques personnages de prostituées, l’agentivité étant posée comme signe de la possibilité d’exercer un certain pouvoir. On considérera ici que l’agentivité inclut la subjectivité, tout en la dépassant : si la subjectivité concerne le sentiment de soi, l’agentivité renvoie au pouvoir d’agir. Ainsi, faire montre d’agentivité est nécessairement faire preuve de subjectivité.
Je me pencherai sur trois romans figurant un personnage de travailleuse du sexe qui s’exprime au « je » et écrits par des auteures ayant pratiqué le travail du sexe – dans un contexte, je le précise, qui exclut la traite, laquelle annihile d’emblée la prise en main de ses actions – : Putain, de Nelly Arcan (2001), Pute de rue, de Roxane Nadeau (2003), et Bordel, de Camille Fortin (2008). J’examinerai, pour chacun d’eux, les indices de subjectivité et d’agentivité, plus particulièrement d’agentivité sexuelle (Lang 2011). La travailleuse du sexe est-elle agentive dans ce que Gail Pheterson (2001) appelle l’« échange prostitutionnel »? Quel pouvoir a-t-elle sur les conditions de la « transaction sexuelle[3] », transaction s’inscrivant à travers un « prisme », selon la proposition de Pheterson, ou dans un continuum, selon la proposition de Paola Tabet? L’examen permettra de se prononcer sur la possibilité de reconnaître la prostituée comme figure agentive, ce qui peut être perçu comme une transgression des limites imparties à sa position.
Les représentations littéraires des travailleuses du sexe proviennent, tradition oblige, davantage des hommes. Selon cette perspective, les personnages de prostituées sont dépourvus de subjectivité et de pouvoir; elles sont la plupart du temps instrumentalisées par des hommes, subordonnées à leur(s) désir(s) et à leur(s) pouvoir(s). L’accession des femmes à l’écriture littéraire[4] change la donne, a fortiori les oeuvres littéraires émanant de femmes ayant pratiqué le travail du sexe[5], lesquelles montrent des figures de prostituées qui ne sont pas intrinsèquement dépourvues d’agentivité[6]. À travers ce déplacement « se jouent […] de multiples parties esthétiques qui sont autant de questions profondes : vérité et nudité, production et enfantement, aller-retour entre sujet et objet, hybridation des corps et des êtres, explication de soi et généalogie… » (Fraisse 2016 : 85-86). Comme le résume Yagos Koliopanos (2015), dès lors qu’une travailleuse du sexe écrit, la « dichotomie stricte entre ce que l’on appelle sujet et ce que l’on appelle objet devient […] extrêmement problématique ». Qui plus est, dans un contexte où les femmes ont longtemps été tenues d’adopter une posture pudique en matière de sexualité et de taire toute allusion à leur vie sexuelle et où le stigmate de la honte a longtemps été attaché aux travailleuses du sexe, on peut considérer la prise de parole littéraire comme un coming out (Sedgwick 2008). Ainsi, l’assomption publique du travail du sexe peut être vue comme un premier indice d’agentivité – et de performativité.
On sait que la prostitution divise les féministes : pour certaines, c’est une forme d’aliénation absolue, tandis que d’autres soutiennent qu’elle traduit « l’expression d’une liberté sexuelle et d’une forme d’émancipation qui peut être valorisante pour celles qui s’y livrent » (Geadah 2003 : 115). Ainsi, la prostitution peut être envisagée comme une « forme possible de manifestation d’agentivité féminine » (Leclerc 2005 : 100). Si l’agentivité renvoie à la « capacité d’agir » ou au pouvoir d’action que détient un sujet, l’agentivité sexuelle « fait référence à la capacité des [sujets] de prendre en charge leur propre sexualité et de l’exprimer de façon positive » (Lang 2011). Elle renvoie donc « au fait de “ régir ” sa propre sexualité et de s’en sentir “ responsable ”, élément important à la fois pour définir ses désirs et ses limites » (Lang 2011 : 192). Cette définition invite à considérer que le rapport prostitutionnel ne conduit pas automatiquement à une réification[7]. Elle permet aussi de rappeler qu’il y a bien deux sujets engagés dans la négociation – et non un sujet nécessairement masculin et un objet nécessairement féminin. Je postule donc que la prostitution n’est ni le signe obligé d’une aliénation ni en soi celui d’une libération – ainsi qu’on le verra : c’est bien le contexte qui en détermine la teneur.
Dans les textes littéraires, cette agentivité devrait pouvoir se détecter à travers le discours des personnages aussi bien qu’à travers leurs actions. Outre la prise de parole commune aux trois romans me serviront ici d’indices pour mesurer l’agentivité de la prostituée d’abord le motif ayant mené à la décision de pratiquer la sexualité tarifée, ensuite la part de pouvoir dévolue au sujet prostitué de décider des conditions de sa pratique et du choix des partenaires, enfin les affects traduits. La prostituée peut-elle être agentive? Qu’est-ce qui l’a menée à la prostitution? Décide-t-elle des clients, des actions? En tire-t-elle de la honte ou renverse-t-elle ce stigmate en fierté? Du seul fait qu’elle se pose, cette dernière question traduit à elle seule la charge morale qui plombe le travail du sexe. Enfin, qu’en est-il des aspects formels et institutionnels qui viennent appuyer ou atténuer ce caractère agentif?
Putain, de Nelly Arcan : « tout a été voulu par moi, mon père et aussi ma mère »
Cynthia[8], narratrice du roman de Nelly Arcan, travaille pour une agence d’escorte de luxe. Seule dans la chambre payée par l’agence, elle ressasse ses observations sur la prostitution, sur la culture qui la rend possible et l’encadre. La narration est peu centrée sur l’anecdote, sur l’événementiel; il s’agit plutôt d’un discours qui relaie les pensées de la narratrice, par association libre : le destinataire implicite est son psychanalyste.
L’agentivité de la putain qui donne son titre à l’oeuvre de Nelly Arcan est régulièrement contestée; le plus souvent, on souligne son ambivalence[9]. Si l’on se tourne vers les motifs qui ont mené Cynthia vers la prostitution, ils renferment eux aussi un paradoxe entre autonomie et hétéronomie[10]. Originaire d’une petite ville en région, Cynthia vient habiter Montréal pour y étudier en littérature. Les bars de danseuses jouxtant l’université qu’elle fréquente font se dissoudre les deux mondes dans son esprit : « j’ai quitté ma campagne pour m’installer en ville, j’ai voulu travailler et je suis devenue putain, quelle bêtise, quelle belle suite logique d’évènements, de l’anorexie à la putasserie, il n’y a qu’un pas à faire » (Arcan 2001 : 94). Plus précisément, la narratrice soutient : « ll a été facile de me prostituer, car j’ai toujours su que j’appartenais à d’autres, à une communauté qui se chargerait de me trouver un nom, de réguler les entrées et les sorties, de me donner un maître qui me dirait ce que je devais faire et comment, ce que je devais dire et taire, j’ai toujours su être la plus petite, la plus bandante » (ibid. : 15). Ces deux passages désignent sans contredit l’injonction à la féminité comme l’ayant menée à la prostitution, celle-ci apparaissant comme un débouché naturel de celle-là, ce qui dénote une hétéronomie certaine, mais certainement pas exclusive à la prostituée. Par ailleurs, la position d’énonciation de la narratrice y surimpose une forte autonomie.
Quant aux conditions de pratique, même si la narratrice livre peu d’informations factuelles, elle les présente sous un jour paradoxal, jouant des tensions entre asservissement et autonomie (Arcan 2001 : 26) :
[Il] y a l’agence qu’il faut d’abord joindre par téléphone le matin pour réserver sa place, il faut appeler très tôt pour que me soit donnée l’autorisation d’être présente ce jour-là, dans le menu du jour, est-ce que je peux travailler pour vous aujourd’hui, est-ce que je suis autorisée à me prostituer chez vous, dans vos appartements […] et après le premier coup de fil du matin, après que m’a été donné le consentement du patron d’être là ce jour-là, je dois me rendre sur Doctor Penfield.
Ainsi, la prostituée offre sa force de travail, ce qui sous-entend qu’elle en est maître; toutefois, l’autorisation et le consentement reviennent au patron. Le paradoxe se manifeste également dans la distribution des profits : outre qu’elle loue la chambre (Arcan 2001 : 31), l’agence « fait de la publicité, en échange de quoi [la narratrice] donne la moitié de ce [qu’elle] gagne » (ibid. : 30); la formulation, ici – c’est la travailleuse qui « donne » l’argent à l’employeur –, insiste pour redonner l’agentivité à la travailleuse.
L’assomption de la condition prostituée est totale pour le personnage d’Arcan : nulle part n’y a-t-il remise en question, hésitation, autodénigrement, pas plus d’ailleurs qu’aucune fierté n’est affirmée : la prostituée est, simplement – mais pleinement : elle est et elle pense, tout en critiquant le dispositif patriarcal qui organise les rapports entre les hommes et les femmes et préside à l’échange prostitutionnel. Du coup, la position qu’elle occupe constitue un lieu singulier d’où observer le monde, hors de la morale. C’est plutôt par un filtre ethnographique que sont livrées les observations de la narratrice. La posture narrative installe le personnage de la prostituée en position de surplomb par rapport aux scènes auxquelles elle participe elle-même et dans lesquelles ce sont les hommes qui visitent son lit qui sont objectivés. Disant sa réification par eux, elle ne les réifie pas moins eux-mêmes.
Pute de rue, de Roxane Nadeau : « Si c’était pas de la honte obligée »
Vicky est « pute de rue », à l’angle des rues Ontario et Dufresne dans l’est de Montréal, quartier marqué par la pauvreté. Elle n’a pas de souteneur : « Y’a pas grand monde de la rue qui va me faire chier [...] Je dois rien à personne, pis j’ai pas de preuves à faire, à qui que ce soit » (Nadeau 2003 : 19). Son entrée en prostitution est déterminée par un évènement marquant, alors qu’à 12 ans elle est violée par un homme lui tenant un revolver sur la tempe : « Après qu’il ait fait sa job, y m’a demandé si on pouvait se revoir. J’y ai demandé de payer » (ibid. : 83). Par la suite, à 13 ans, elle « faisai[t] officiellement son premier client » : « [“] T’es belle, t’es fine, suce-moi pour quarante piasses [”] […] J’étais en business » (ibid. : 84). Insoutenables psychiquement, ces violences, parmi d’autres, la conduisent à la drogue[11]. Ainsi, c’est bien davantage à la drogue qu’elle semble assujettie qu’à un homme.
Dans la pratique, Vicky affirme être celle qui établit les conditions de l’échange (« c’est […] moi qui ronne[12] » (Nadeau 2003 : 12)), mais elle ne réussit pas toujours, admettant qu’elle est parfois « pognée pour en sucer un pas de capote » (ibid.). Même si elle n’est pas toujours très regardante, en fonction de ses besoins de drogue, elle sélectionne tout de même ses clients, en rejetant un, par exemple, parce qu’il sent mauvais (ibid. : 28). Elle n’en défend pas moins son autonomie : « Je fais ce que je veux au moins. J’ai beau être complètement accro à la dope et me faire crisser une volée quasiment à tous les trois mois, il en reste pas moins que, dans tout ça, j’ai du pouvoir. Sur les gars, ça c’est officiel. Sur ma vie, aussi » (ibid. : 48). Elle affirme être « là où [elle veut] être » (ibid. : 19). « Je sais comment ça marche, pis je fais mon affaire » (ibid. : 19). Au point où elle dit préférer gagner moins, mais rester maître de son argent plutôt que de se faire payer hôtel et drogue par des clients car, dès lors que ces derniers fournissent la drogue, observe-t-elle, ils « gardent le contrôle » (ibid. : 76). Elle reconnaît donc que cette « liberté » a un prix (ibid.) :
J’aime mieux avoir mon cash à moi, pis ma dope à moi. Même si ça me prend plus de temps à le faire. Des fois je me trouve nouille, surtout en hiver, quand j’attends dehors pendant trois heures, la nuit, parce que j’ai refusé un gars qui voulait aller au motel [...] c’est ma façon de fonctionner. Je préfère être la boss de chaque vingt piasses que je gagne, pis de faire ce que je veux avec, quand je veux.
Les activités sexuelles de Vicky semblent être déterminées par le marché où elle se situe : ce sont le plus souvent de courtes passes, même si elle fait parfois des « complets ». Elle dit aimer le sexe (Nadeau 2003 : 24), tout en admettant être habituellement « trop gelée » (ibid.) pour ressentir quoi que ce soit. Ainsi, tout se passe comme si sa position assujettie était extrinsèque au rapport prostitutionnel lui-même. C’est son amour de la drogue qui la mène à marchander ses services sexuels : « J’veux juste du cash pis de la dope » (ibid. : 20).
Cependant, Vicky est également affectée par des facteurs indirects : ses conditions de pratique font qu’elle est souvent harcelée par la police. Sans compter que ces conditions sont peu sécuritaires : « c’est rendu que tu sais jamais si tu vas sortir du char avec tout tes morceaux, pis avec ton cash […] c’t’une job risquée, faire la rue » (Nadeau 2003 : 15). Enfin, elle subit l’opprobre des passants, qui la laissent avec la honte (ibid. : 25).
Même si elle admet qu’elle aimerait être en relation, Vicky ne croit pas au prince charmant (Nadeau 2003 : 23) – d’ailleurs, elle aime les filles. Elle dit avoir « le feu […] au corps » (ibid. : 23) et que c’est là son moteur. Elle n’en demeure pas moins consciente du système qui l’identifie et la stigmatise, réfléchissant à la dissymétrie qui organise les rapports (ibid. : 26) :
J’suis quelqu’un. Je suis moi. C’est plus que ben du monde. Pis les clients, eux autres, c’est juste quand y sont clients qu’y sont dégueulasses? Autrement, c’est des bons pères de famille, des travailleurs! Pis moi, quoi, même si je travaille, j’suis pas une travailleuse? Si y a une affaire qui m’écoeure, c’est que les gars, y sont clients seulement pendant qu’y sont avec une pute, mais une pute, c’est une pute tout le temps!
Vicky émet le souhait que les positions s’inversent : « il est grand temps qu’il y ait plus de femmes clientes. Payer pour du cul ou bien passer des soirées dans des bars à se demander si on va rentrer seule » (Nadeau 2003 : 84). Le monde idéal serait celui où elle pourrait être « cliente ou travailleuse, selon [ses] désirs de l’instant. Et [ses] besoins financiers » (ibid. : 85).
Sur le plan de l’énonciation littéraire, comme je l’ai souligné plus haut, le discours est direct. Il est par ailleurs notable que nulle parole d’homme ne soit rapportée en discours direct. Lors des échanges transactionnels, nécessairement dialogués, le discours des hommes est remplacé par des points de suspension. Signe d’autonomie dans la clôture du texte, qui ne laisse entrer nul homme.
Bordel, de Camille Fortin : « Je suis mes chaînes »
Bordel, roman de Camille Fortin, est sous-titré ainsi : Journal d’une amoureuse et d’une putain. Soulignant une dualité, il relaie en effet deux discours, celui de Camille, adressé à son ex-amoureux, et celui de Naomie, qui rapporte ses activités prostitutionnelles. Toutefois, Camille et Naomie sont la même personne, la seconde étant le personnage créé par la première pour se prostituer, signe d’une impossible assomption. Naomie travaille dans un bordel du centre-ville, repaire de douchebags.
C’est tout bonnement l’argent qui a mené Camille à se prostituer, alors qu’elle avait 19 ans. Son moteur : « Faire le plus d’argent possible » (Fortin 2008 : 21). S’ennuyant sur les bancs d’école, elle quitte tout à 16 ans. Sans diplôme, elle collectionne les petits boulots, puis se laisse tenter par les annonces de recrutement. « Durant l’été, j’avais vu un reportage à la télévision sur la prostitution et ç’avait piqué ma curiosité, ç’avait déclanché un désir en moi, comme si j’avais enfin trouvé un monde à découvrir, quelque chose à essayer, quelque chose qui demande beaucoup de guts » (ibid. : 42). Étant donné qu’elle est mineure, c’est comme danseuse nue qu’elle débute, à 17 ans, même si, dans les faits, ceci n’empêche pas cela : « Ce soir-là, j’ai couché avec quatre hommes et j’en ai sucé trois, tous plus âgés que mon père » (ibid. : 43). C’est par la suite qu’elle rencontre son amoureux, qui lui reprochera plus tard de ne pas lui avoir dit qu’elle se prostituait (ibid. : 106) :
Pourquoi ne t’ai-je rien dit alors? Je crois que je suis restée muette parce que je ne savais pas très bien pourquoi je faisais cela. Je savais pourquoi je l’avais fait, plus jeune, […] nous n’étions pas encore ensemble […] C’est pour cette raison que je ne t’ai rien dit, en fait, cher trésor, parce que je ne savais pas moi-même pourquoi j’avais acheté le journal ce matin-là avec la volonté de trouver un travail de prostituée.
Lorsque l’ami de Camille apprend qu’elle pratique la prostitution, il la quitte. Elle a alors 20 ans : c’est cinq ans avant le temps de la narration, et elle est toujours obsédée par lui.
Camille affirme plus tard que « personne [ne la] retient contre [son] gré, [qu’elle n’est] pas prisonnière du Bordel » – « je suis là [, dit-elle,] parce que je veux y être. Je suis mes chaînes » (Fortin 2008 : 107). Cependant, le roman se termine sur Naomie qui exprime son désir de ne plus vouloir retourner au Bordel (ibid. : 163), laissant les lectrices et les lecteurs sur ce souhait.
En arrière-plan est rejouée la dichotomie morale entre propreté et saleté[13], entre bonne fille et mauvaise fille sur laquelle est érigée la prostitution, tout comme sont reconduits les clichés les plus convenus sur le monde prostitutionnel, sur le plan tant du représenté que de l’énonciation – il est, par exemple, question des « filles de petite vertu mais au grand coeur » (Fortin 2008 : 32). Ici aussi paraît le personnage du psychanalyste. Cependant, si la figure ne revêt qu’une fonction narrative en tant que destinataire implicite chez Arcan, elle est littérale chez Fortin : la jeune femme se fait offrir les services d’un psychanalyste par le patron[14]. Elle dit avoir compris là, sur le divan, « pourquoi » elle se prostituait : « C’est ici que j’ai appris qu’il me fallait faire le deuil de toutes ces amours passées qui planent sur moi comme l’ombre d’une mort que j’ai tant désirée. De l’amour fort et vrai de mon père, de mes frères, de mon grand-père adoré, de mes amis, et surtout, de cet amour, ce grand amour, cet inguérissable amour » (ibid. : 36). On aura noté l’absence des femmes dans cet encadrement chaleureux – « amis » est au masculin pluriel. Ainsi conclut-elle : « Ce n’est ni la drogue, ni l’alcool, ni un proxénète […] qui m’a poussée à vendre mon corps. J’étais triste. Un point c’est tout […] Je voulais un homme dans ma vie à n’importe quel prix. Maintenant, des dizaines se succèdent dans mon lit, pour un prix fixé d’avance » (ibid. : 37). Plus tard, elle évoque sa solitude comme élément déterminant : « Mon pimp à moi, c’est la façon que j’ai de n’être à l’aise nulle part […] Mon pimp, c’est moi, personne d’autre que moi. Je n’ai rien, mais pourtant j’ai toute cette solitude qui fait de moi quelqu’un de triste et sauvage » (ibid. : 88-89). S’il y a aliénation, ici, elle déborde certainement la condition de prostituée : elle est plus globalement hétéronormative. « Non je ne suis pas une salope. Je suis simplement aguichante. Je brûle d’envie d’avoir un copain, un gars qui me dirait que je suis belle, qu’il m’aime, qui m’écrirait des billets doux » (ibid. : 39).
Une affaire de classe?
À bien y regarder, on pourrait affirmer qu’au final chacune a été conduite à la prostitution par les valeurs de son milieu. Chez Arcan, la jeune femme devient prostituée presque par voie naturelle, à force de se conformer aux normes de la féminité normative. Chez Nadeau, le personnage est constitué « putain » par la violence de son environnement. Chez Fortin, c’est motivée par l’argent que la jeune femme se prostitue, et des trois, c’est elle qui paraît être la plus aliénée aux valeurs de l’amour romantique, tout comme aux hommes eux-mêmes, objets de son adoration.
Si l’on en sait peu sur le pouvoir que ces jeunes femmes détiennent quant aux conditions de pratique – c’est la « pute de rue » qui en révèle le plus, et elle se montre plutôt agentive en regard de ces conditions –, il ressort globalement que, parmi ces trois figures de prostituées, la plus agentive et autonome semble être la putain d’Arcan : elle paraît surplomber le dispositif même de la prostitution, le jaugeant dans la distance. Et même si elle a un souteneur – le responsable de l’agence d’escorte –, évoqué dans le texte, il demeure une instance absente. La narration de Cynthia est pleine de ses propres pensées, attestant elles aussi une distance, contrairement à Vicky, pute de rue de Nadeau, qui, elle, se trouve très proche de l’action. Si cette dernière est soumise à des facteurs extrinsèques, dont la pauvreté et la drogue, elle conserve malgré tout une bonne part d’agentivité. Certes, comme le rappelle la psychosociologue Pheterson (2001 : 61), « les femmes qui sont dans les situations les plus vulnérables et les plus dépendantes ont moins le choix des clients et des actes que les prostituées qui possèdent davantage d’autonomie, un meilleur statut et plus d’expérience ». À cet égard, le sociologue Lilian Mathieu (2007 : 111) soutient qu’« [a]ppréhender la prostitution comme un moyen de répondre à un besoin urgent d’argent […] ne doit pas […] conduire à dénier aux personnes qui s’y livrent toute autonomie ou capacité de choix ». En outre, il demeure que, sur le plan littéraire, le texte de Nadeau est sien, traduisant sa propre vision du monde, livrée dans l’immédiateté et une fois encore l’homme est quasi absent et n’a pas droit de parole[15]. La moins agentive, la plus hétéronome est bien la prostituée du bordel de Fortin : le caractère double des entrées du journal suggère que Naomie est assujettie à Camille avant que de l’être aux clients, Camille étant elle-même assujettie à son ex-amoureux[16] et, à travers lui, à son milieu, que l’on devine hétéronormatif, romantique et empreint de valeurs néolibérales. Et si c’est précisément l’argent qui motive l’action de Camille, il ne relève en rien d’un « besoin urgent » (Mathieu 2007 : 111), à la différence de la pute de rue. Plutôt, l’argent est le moyen nécessaire pour se fondre dans ce milieu même, où les hommes sont des hommes d’affaires et des amateurs de sport aimant posséder des femmes, et celles-ci des femmes qui aiment être possédées par ceux-là, même en dehors de l’activité prostitutionnelle.
Enfin, les putains d’Arcan et de Nadeau n’exhibent ni fierté ni honte : la posture distante, ethnographique, empruntée par Cynthia éradique toute émotion, et la « pute de rue » se montre bourrue, réfutant tout sentimentalisme. Leurs oeuvres ont une double portée performative : elles dédramatisent le travail du sexe, tout en témoignant de l’opprobre jeté sur les travailleuses du sexe par les regards extérieurs. Quant à la prostituée de Fortin, si une part d’elle assume ses gestes, les justifiant pour accéder à une aisance économique, une autre part rejoue la dichotomie moralisante qui la place du côté de la honte et fait briller le stigmate.
Les variations paraissent en partie tributaires de la classe sociale, ce dont la géographie des lieux de pratique nous informe[17] – et que les lieux de publication redoublent. Cependant, la moins autonome n’est pas la plus pauvre : c’est bien la prostituée du bordel, membre de la classe moyenne, qui semble la plus dominée. Le texte est publié chez Voix parallèle, maison sans grande personnalité, et le travail d’édition du texte laisse à désirer. Pute de rue est publié aux Intouchables, maison connue pour son catalogue éclectique, ne dédaignant pas la provocation comme valeur marchande. Putain est publié au Seuil, institution de prestige – a fortiori pour une Québécoise, selon la logique du champ littéraire.
Cependant, à elle seule, la prise de parole de ces trois travailleuses (ou ex-travailleuses) du sexe suffit à déconstruire les représentations imaginaires de la prostituée telles qu’elles ont été dessinées par des hommes. La putain regarde[18], voit, parle; elle écrit, elle est publiée : c’est déjà une prise de pouvoir. Elle parle de son activité prostitutionnelle, ce qui est doublement transgressif, puisque ce faisant elle outrepasse la limite imposée aux travailleuses du sexe, dont la première est certainement de se cacher et de se taire. Elle dévoile son activité prostitutionnelle et, avec elle, révèle la figure du client, le constituant en objet.
Plus haut, je soutenais que l’assomption publique du travail du sexe pouvait être vue comme un premier indice d’agentivité. Soulignons à cet égard que la première parmi ces trois-là à avoir transgressé la limite et levé le stigmate de la honte enjoignant au silence sur sa propre condition de prostituée est Nelly Arcan. Cependant, Roxane Nadeau ne mérite pas moins de reconnaissance, dans la mesure où sa « pute de rue » porte plus lourdement que l’escorte le stigmate de la honte et du mépris. De plus, ces deux écrivaines ont assumé publiquement leurs textes, tandis que Camille Fortin est restée dans l’ombre. Tout semble indiquer que le milieu bon chic bon genre qu’elle met en scène s’accommode mal de la prise de parole publique d’une femme, de l’assomption de la condition de travailleuse du sexe.
* * *
S’il faut se garder de « confond[re] sexe gratuit et autonomie sexuelle » (Boucher 2010 : 8), il convient également d’éviter d’assimiler sexe tarifé et aliénation : au final, les trois romans révèlent la difficile coupure entre aliénation et agentivité. « Nous sommes tous·tes aliéné·e·s – mais en a-t-il jamais été autrement? » demande le collectif transféministe Laboria Cuboniks (2016). Aussi le seul critère de l’aliénation ne saurait-il suffire à nier toute subjectivité ou agentivité aux prostituées. Et si cela était, constater l’aliénation de l’une devrait conduire à travailler à déconstruire les structures qui l’aliènent plutôt qu’à sa stigmatisation. Les travailleuses du sexe sont des femmes comme les autres. Elles sont aliénées comme les autres. Chose certaine, leur subjectivité est irréductible – encore faut-il que cette subjectivité leur soit reconnue (Honneth 2000). Si, comme le soutient Éric Fassin, « nous vivons dans des sociétés où le sujet se construit dans et par la “ vérité ” de son sexe et de sa sexualité » (Tervonen et Nocent 2014), on ne voit pas pourquoi la vérité de certaines serait moins vraie que celle de certaines autres. L’accession des travailleuses du sexe à la parole littéraire fait en sorte que leurs « vérités » soient exprimées. Elles ne sont plus strictement muses, faire-valoir dans les créations masculines. Elles s’écrivent, se disent et, renversant le regard autrefois porté sur elles, reconfigurent la figure séculaire de la prostituée, lui injectant une agentivité – non pas totale, certainement paradoxale – et une subjectivité propre.
Parties annexes
Note biographique
Isabelle Boisclair est professeure titulaire d’études littéraires et culturelles à l’Université de Sherbrooke. Ses recherches portent principalement sur les représentations de l’identité de sexe/genre et la sexualité dans les textes littéraires. Elle a publié Ouvrir la voix/e. Le processus constitutif d’un sous-champ littéraire féministe au Québec (1960-1990) (Nota bene, 2004) et dirigé plusieurs collectifs, dont Nelly Arcan. Trajectoires fulgurantes (en collaboration avec Christina Chung, Joëlle Papillon et Karine Rosso, Les éditions du remue-ménage, 2017).
Notes
-
[1]
Dans le présent article, j’emploie indistinctement les termes « prostituée » et « travailleuse(s) du sexe », même si l’on peut établir des distinctions entre les deux : le premier renvoie, d’une part, à l’idée, au stéréotype, à la figure fantasmée de la travailleuse du sexe et, d’autre part, aux personnes enrôlées malgré elles dans des transactions sexuelles (elles sont « prostituées » par quelqu’un), tandis que le second fait référence aux personnes réelles qui choisissent d’exercer le travail sexuel tarifé. En littérature, bien que ce soit tantôt le référent qui est convoqué, tantôt davantage la figure, les deux se confondent facilement, se surimposant tour à tour l’un à l’autre puisque, bien qu’un réel soit évoqué ou représenté, il y a toujours médiation symbolique.
-
[2]
Nous devons à Barbara Havercroft (1999) cette traduction du concept d’agency.
-
[3]
Selon plusieurs sociologues et anthropologues, rares sont les rapports sexuels exempts de négociations ou de transactions économiques : « contrairement à ce que laissent supposer les représentations occidentales, ce sont nos pays occidentaux qui constituent une exception dans le rapport à la sexualité : nous l’espérons libre d’économie, alors que presque partout ailleurs dans le monde il est admis que la sexualité fait (et doit faire) l’objet de transactions. Certes, entre des transactions qui peuvent être en nature (cadeaux divers et variés, prestige, etc.), et somme précise d’argent, il y a des différences » (Catherine Deschamps dans Camille (2013); voir aussi Christophe Broqua et Catherine Deschamps (2014) ainsi que Philippe Combessie et Sibylla Mayer (2013)). Le terme est déjà présent chez Bronisław Malinowski (1970).
-
[4]
Au Québec l’entrée massive des femmes dans le champ littéraire a lieu au courant des années 60; avant cette date, celles qui écrivent sont l’exception (Boisclair 2004).
-
[5]
Les premières femmes qui accèdent à la littérature viennent de familles lettrées bourgeoises. La démocratisation de la parole s’étend ensuite sur plusieurs décennies. Pour que les travailleuses du sexe arrivent à la littérature, il faut, outre la levée de la honte qui impose l’anonymat, qu’il soit possible de conjuguer instruction – qui permet l’accès au champ littéraire – et travail du sexe. Au tournant du millénaire, les conditions sont réunies pour que ces deux mondes antinomiques, qui semblaient jusque-là inconciliables, ne le soient plus, fait auquel l’autonomisation des femmes en matière de sexualité n’est pas étrangère.
-
[6]
Sur cette question, on lira avec profit Ruwen Ogien (2010) et Marie-Pierre Boucher (2010).
-
[7]
Pas plus que n’importe quel autre domaine, la prostitution n’est exempte de rapports de domination, pas plus qu’elle ne garantit l’absence d’exploitation. Pour une déconstruction des noeuds entourant le travail du sexe, dont celui du moralisme accompagnant toute activité sexuelle, voir Ogien (2010).
-
[8]
On ne saura pas le « nom de baptême » de la narratrice; elle dit le refuser parce qu’« il a été choisi par [sa] mère » (Arcan 2001 : 122). Cynthia était le prénom de sa soeur, morte un an avant sa naissance.
-
[9]
Voir Isabelle Boisclair et autres (2017).
-
[10]
J’établis ici un lien entre autonomie – le fait de décider pour soi-même – et agentivité, de même qu’entre hétéronomie – le fait de s’assujettir à des lois dictées par d’autres – et instrumentalisation.
-
[11]
« Quand j’suis gelée, c’est presque comme si y était rien arrivé. Ni à sept, dix ou douze ans. Ni hier. Ni demain. J’arrive à exister » (Nadeau 2003 : 82).
-
[12]
Citons aussi ce passage : « Si y en a un qui me touche, c’est juste les seins, pis c’est moi qui y dit comment. Sinon, c’est just too bad. Pour le reste, y en a pas un qui approche sa bouche ou ses mains. Absolument réservé. Ça me préserve. Je fais attention à ce que je donne, et à qui » (Nadeau 2003 : 87-88).
-
[13]
« [M]on corps est propre […] je sais que je suis sale » (Fortin 2008 : 89); le mot « souillure » revient à deux reprises (ibid. : 28 et 52).
-
[14]
« Mon patron couvre complètement les frais de ces brèves rencontres » (Fortin 2008 : 35).
-
[15]
Il n’y a pas davantage de discours rapporté dans Putain. Si le discours relaie les dires du père (Boisclair 2017), jamais on n’entend sa voix; c’est la voix de la narratrice qui domine le texte.
-
[16]
La dépendance psychique et fantasmatique de Camille en témoigne.
-
[17]
« Le lieu d’exercice et les conditions de travail marquent positivement les positions dominantes de l’espace prostitutionnel lorsqu’elles permettent un confort, un accès à l’hygiène relatifs ainsi qu’une certaine sécurité » (Mathieu 2007 : 57).
-
[18]
Sur la portée performative du regard, voir Lucie Guillemette (2005).
Références
- ARCAN, Nelly, 2001 Putain. Paris, Seuil.
- BOISCLAIR, Isabelle, 2017 « Écho : Faire entendre la voix du père », dans Isabelle Boisclair et autres (dir.), Nelly Arcan. Trajectoires fulgurantes. Montréal, Les éditions du remue-ménage : 259278.
- BOISCLAIR, Isabelle, 2007 « Accession à la subjectivité et autoréification : statut paradoxal de la prostituée dans Putain de Nelly Arcan », dans Daniel Marcheix et Nathalie Watteyne (dir.), L’écriture du corps dans la littérature québécoise depuis 1980. Limoges, Presses universitaires de Limoges, coll. « Espaces humains » : 111-123.
- BOISCLAIR, Isabelle, 2004 Ouvrir la voie/x. Le processus constitutif d’un sous-champ littéraire féministe au Québec (1960-1990). Québec, Nota bene.
- BOISCLAIR, Isabelle, et autres (dir.), 2017 Nelly Arcan. Trajectoires fulgurantes. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- BOUCHER, Marie-Pierre, 2010 Sexe, inc. Saint-Laurent, Éditions Poètes de brousse, coll. « Essai libre ».
- BROQUA, Christophe, et Catherine DESCHAMPS (dir.), 2014 L’échange économico-sexuel. Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, coll. « Cas de figure ».
- CAMILLE, 2013 « Prostitution ou “ sexualité négociée ”? », Sexpress, 8 novembre, [En ligne], [blogs.lexpress.fr/sexpress/2013/11/08/prostitution-ou-sexualite-negociee/] (8 avril 2019).
- COMBESSIE, Philippe, et Sibylla MAYER, 2013 « Une nouvelle économie des relations sexuelles? », Ethnologie française, 43, 3 : 381-389.
- FORTIN, Camille, 2008 Bordel. Journal d’une amoureuse et d’une putain. Montréal, Éditions Voix parallèles.
- FRAISSE, Geneviève, 2016 « Le dérèglement des représentations », dans Geneviève Fraisse, La sexuation du monde. Réflexions sur l’émancipation. Paris, Presses de SciencesPo : 85-101.
- GEADAH, Yolande, 2003 La prostitution, un métier comme les autres? Montréal, VLB éditeur.
- GUILLEMETTE, Lucie, 2005 « Les figures féminines de l’adolescence dans l’oeuvre romanesque d’Anne Hébert. Entre le mythe du prince charmant et l’agentivité », Globe : revue internationale d’études québécoises, 8, 2 : 153177.
- HAVERCROFT, Barbara, 1999 « Quand écrire, c’est agir. Stratégies narratives d’agentivité féministe dans Journal pour mémoire de France Théoret », Dalhousie French Studies, 47, été : 93-113.
- HONNETH, Axel, 2000 La lutte pour la reconnaissance. Paris, Gallimard, coll. « Folio essais » (traduction de l’allemand par Pierre Rusch) [1re éd. : 1992].
- KOLIOPANOS, Yagos, 2015 « “ Prostitution et littérature : l’oeuvre subversive de Grisélidis Réal ”, Master 2, Théorie des arts et du langage, sous la direction d’Annick Louis, École des Hautes Études en Sciences Sociales », Genre & Histoire, 15, printemps, [En ligne], [journals.openedition.org/genrehistoire/2099?lang=en] (9 avril 2019).
- LABORIA CUBONIKS, 2016 « Le xénoféminisme : une politique de l’aliénation », Glass Bead, [En ligne], [www.glass-bead.org/article/xenofeminism-a-politics-for-alienation/?lang=frview] (8 avril 2019).
- LANG, Marie-Eve, 2011 « “ L’agentivité sexuelle ” des adolescentes et des jeunes femmes : une définition », Recherches féministes, 24, 2 : 189-209, [En ligne], [www.erudit.org/revue/rf/2011/v24/n2/1007759ar.html?vue=resume&mode=restriction] (8 avril 2019).
- LECLERC, Mélanie, 2005 L’agentivité et la figure de la prostituée : une lecture de Nécessairement putain de France Théoret et Terroristes d’amour de Carole David. Mémoire de maîtrise. Trois-Rivières, Université de Trois-Rivières, [En ligne], [depot-e.uqtr.ca/7344/1/000123672.pdf] (8 avril 2019).
- MALINOWSKI, Bronisław, 1970 La vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie. Paris, Payot.
- MATHIEU, Lilian, 2007 La condition prostituée. Paris, Textuel, coll. « La Discorde ».
- NADEAU, Roxane, 2003 Pute de rue. Montréal, Les Intouchables.
- OGIEN, Ruwen, 2010 Le corps et l’argent. Paris, La Musardine.
- PHETERSON, Gail, 2001 Le prisme de la prostitution. Paris, L’Harmattan.
- SEDGWICK, Eve K., 2008 Épistémologie du placard. Paris, Éditions Amsterdam (traduction de l’anglais par Maxime Cervulle).
- Tabet, Paola, 2004 La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel. Paris, L’Harmattan (traduction de l’italien par José Contréras).
- TERVONEN, Taina, et Mathieu NOCENT, 2014 « L’éthique est un luxe – Éric Fassin », Sautez dans les flaques, [En ligne], [sautezdanslesflaques.wordpress.com/2014/09/14/lethique-est-un-luxe/] (5 avril 2019).

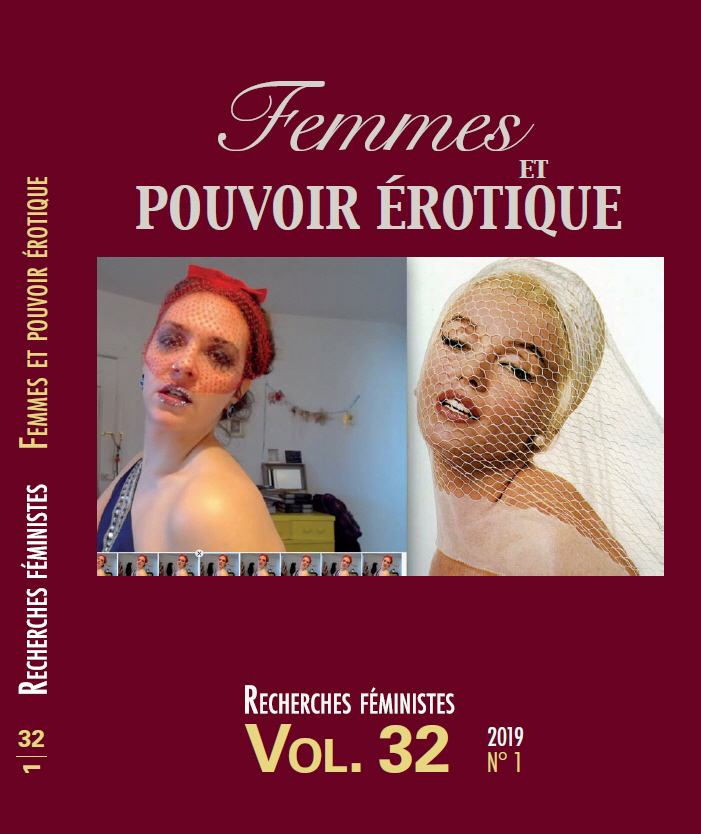
 10.7202/1000913ar
10.7202/1000913ar