Corps de l’article
Comme le laisse supposer l’étiquette « lesbiennes féministes », le féminisme et le lesbianisme semblent entretenir une relation symbiotique. En effet, partant du principe que toute définition est lacunaire mais nécessaire, le féminisme, pensé de manière large et inclusive, désigne selon Maggie Humm (1989 : 74) « both a doctrine of equal rights for women (the organised movement to attain women’s rights) and an ideology of social transformation aiming to create a world for women beyond simple social equality », alors que le lesbianisme décrit « the condition of emotional and sexual relationships between women or between self-identified lesbians » (ibid. : 117). Il n’y a alors qu’un pas à franchir pour lier féminisme et lesbianisme : la valorisation de relations émotionnelles, et a fortiori sexuelles, entre femmes constitue certainement une idéologie de transformation sociale, celle de l’hétéronormativité, par-delà la simple égalité! Et pourtant, les relations entre le féminisme et le lesbianisme ont souvent été tendues. Dans sa présentation de l’ouvrage de Diane Lamoureux intitulé Fragments et collages, Françoise Collin (1986 : 14) écrit du lesbianisme qu’il « casse le code des relations amoureuses qui ont soutenu jusqu’à ce jour l’institution patriarcale de la famille, ou qu’il libère le désir de sa “ contrainte à l’hétérosexualité ” ». De fait, le féminisme reste prisonnier d’une contradiction fondamentale : celle, en ce qui concerne les hétéroféministes, de coucher avec l’ennemi, pour reprendre une invective servie à satiété, alors que par leur simple existence les lesbiennes font un pied de nez à la « pensée straight » (Wittig 1980). Autrement dit, le féminisme serait la théorie et le lesbianisme, la pratique, d’après une lecture attribuée à Ti-Grace Atkinson (Lamoureux 2009).
Au Québec comme ailleurs, le fait de voir dans l’hétérosexualité les fondements politiques et idéologiques de l’oppression des femmes a contribué à jeter l’opprobre sur les lesbiennes qui, au demeurant, sont soupçonnées de faire mauvaise presse à un mouvement féministe en besoin de légitimité politique et symbolique. Le cadrage des lesbiennes comme constituant une sorte d’épée de Damoclès au-dessus du féminisme en a incité plus d’une à quitter le mouvement féministe et à former les premiers mouvements lesbiens autonomes au Canada, certes, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni au début des années 70 (pour un aperçu de ces tensions dans ces pays, voir Bonnie Zimmerman (2012)). Ainsi, le groupe américain Radicalesbians a été fondé en réaction aux propos de la présidente de la National Organization for Women (NOW), Betty Friedan, qui a qualifié de « menace violette » (lavender menace, le violet étant la couleur des lesbiennes) les lesbiennes au sein de la NOW (Echols 1989 : 213). Cet ostracisme a aussi régné outre-Atlantique, au pays des droits de « l’Homme » [sic]. Alors que Les gouines rouges de Paris ont vu le jour en réaction à la domination masculine au sein du Front homosexuel d’action révolutionnaire (groupe qu’elles avaient pourtant contribué à fonder en 1972), les lesbiennes ont aussi dû lutter pour accéder à une certaine reconnaissance au sein du Mouvement de libération des femmes (MLF), employant pour cela des tactiques de conscientisation publique (zapping), comme perturber les procédures de la Journée de dénonciation des crimes contre les femmes en 1972 afin que soient entendues leurs revendications au sein du mouvement féministe (Bonnet 1998). Au Canada, les travaux de Becki L. Ross (1995), The House that Jill Built: A Lesbian Nation in Formation, et de Liz Millward (2015), Making a Scene: Lesbians and Community across Canada, 1964-84, rendent compte de tensions similaires entre féminisme et lesbianisme, bien qu’ici ces tensions aient été complexifiées par l’éternel clivage linguistique sur fond nationaliste.
Le lesbianisme n’a pas eu le gros bout du bâton dans cette relation tumultueuse avec le féminisme. De fait, si les femmes ont été exclues de l’Histoire officielle (c’est-à-dire l’histoire des hommes), les lesbiennes ont été exclues de l’histoire des femmes. Dans l’ouvrage classique du Collectif Clio (1982 : 497), L’histoire des femmes au Québec, les lesbiennes y sont persona non grata : « Quelques féministes, une très petite minorité, poussent l’analyse [féministe] jusqu’à l’exaltation du lesbianisme comme seule expression possible de la sexualité des femmes. Leur option est souvent brandie comme un épouvantail pour discréditer le féminisme, ce qui contribue à entretenir un climat de malaise ». Cette invisibilité désolante ressort aussi dans un autre ouvrage, Le féminisme québécois raconté à Camille (Dumont 2008), même lorsqu’il est question de la revue La Vie en rose et de la troupe de théâtre Les folles alliées, des institutions où les lesbiennes étaient pourtant bien présentes. À vrai dire, les lesbiennes sont dans le placard de l’histoire des femmes. Qui plus est, cette exclusion n’est pas qu’histoire d’un passé lointain, comme en témoignent les résistances à l’inclusion des droits des lesbiennes à la plateforme de la Marche mondiale des femmes (Demczuk 2000). L’ouvrage de Denyse Baillargeon (2012 : 239-240), Brève histoire des femmes au Québec, fait exception à cette règle, alors qu’elle nomme clairement la discrimination, voire l’ostracisation, des lesbiennes au sein du mouvement féministe québécois.
Cela dit, les relations entre féminisme et lesbianisme n’ont pas été que difficiles; elles se sont aussi révélées fécondes et complexes, comme l’ouvrage de Carolle Roy (1985) en fait la démonstration et comme le soutiennent également Anne Revillard (2002) et Sébastien Chauvin (2005). Ainsi, des lesbiennes ne sont pas politisées (c’est-à-dire qu’elles ne pensent pas leur lesbianisme en termes de rapport de pouvoir dans une société hétérosexiste), tandis que d’autres le sont, et ce, pour tout un ensemble de raisons qui plongent leurs racines dans divers courants de pensée. Par exemple, le féminisme matérialiste, pour lequel l’oppression des lesbiennes se comprend à la lumière de leurs conditions sociales d’existence, y compris leurs émotions et leur sexualité, telles qu’elles leur sont imposées par le patriarcat et son dispositif du sexage, a constitué une source théorique significative dans le cas des réflexions et des mobilisations lesbiennes (sur le féminisme matérialiste, voir les écrits de Christine Delphy ou encore de Nicole-Claude Mathieu et Paola Tabet). De fait, l’autonomie célébrée par les lesbiennes se comprend à l’aune d’une perspective féministe plus large ayant pour objet le contrôle par les femmes de leur corps, de leur sexualité et de leur reproduction ainsi que leur indépendance économique, sociale et symbolique par rapport aux hommes. Dans la mesure où les oppressions vécues par les lesbiennes découlaient aussi de leurs conditions sociales d’existence en tant que femmes, et en dépit d’une certaine lesbophobie ambiante au sein des mouvements féministes, qui avait pour pendant une « lesbogynie » au sein du mouvement de libération gai (Faderman 1991 : 210-212), plusieurs lesbiennes y sont néanmoins restées avec le dessein d’y promouvoir leur visibilité et leurs revendications. Or, pour des lesbiennes radicales, l’objectif d’un épanouissement des subjectivités lesbiennes ne pouvait passer par un mouvement féministe où les existences lesbiennes non seulement n’étaient pas les bienvenues, mais étaient aux prises avec de la méfiance et de la suspicion – d’où l’importance d’espaces « pour lesbiennes seulement » (Turcotte 1998 : 363). Au Québec, le lesbianisme « radical » s’est incarné dans des Danielle Charest[1] et Louise Turcotte; il s’est exprimé dans la revue Amazones d’Hier, Lesbiennes d’Aujourd’hui[2].
Plus récemment, les théories ainsi que les pratiques lesbiennes et féministes, plutôt que de se replier sur elles-mêmes, ont dû prendre acte des diversités parmi les femmes et les lesbiennes en vue de les intégrer à leurs analyses et à leur mobilisation[3]. Aujourd’hui, les mouvements féministe et lesbien se déploient à l’échelle transnationale et souscrivent à l’intersectionnalité comme principe d’analyse et d’action. Les interactions entre les mouvements LGBT (réunissant des personnes s’identifiant en tant que lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres), queer et transféministe génèrent de nouveaux rapports de pouvoir et des défis différents (pour le Québec, voir les travaux d’Alexie Labelle (2019a et 2019b)). De fait, à l’ère de la théorie queer, de l’identité postlesbienne et de renouveau du féminisme radical, la relation entre le sexe, le genre et la sexualité est de nouveau au coeur des débats des politiques LGBTQ+ et féministe. Avec la montée de la politique LGBTQ+ et des pensées queers, le lesbianisme et sa posture identitaire sont considérés comme dépassés (« ringards »), en ce qu’ils témoigneraient d’un repli sur soi et d’une rectitude politique, et, surtout, « essentialistes », en ce qu’ils interpelleraient le sexe biologique pour définir et asseoir leurs actions politiques (Phelan 1989; Walters 1996). Plus récemment, l’objectif à long terme de créer, tant au sein du féminisme que du mouvement LGBTQ+, des espaces pour le lesbianisme a refait surface, mais il a été décrié et assimilé à des factions conservatrices antitrans au sein de la société (Earles 2019; Serano 2013). Alors que les identités des hommes gais demeurent largement incontestées, le lesbianisme est de plus en plus déplacé et effacé par des épithètes dites non spécifiques et plus « inclusives » comme « queer », sans compter que dans une ère « postlesbienne » est encouragée une identification plus large avec la notion parapluie « LGBTQ+ » (Forstie 2020).
En vérité, historiquement, la théorie et la politique lesbiennes ont été à l’avant-garde des approches déconstructivistes qui inspirent les pensées queers contemporaines, savoir auquel la francophonie a contribué de manière non négligeable. Alors qu’Adrienne Rich (1981) et Gayle Rubin (2002) ont jeté quelques-uns des fondements essentiels à la théorie queer, les réflexions féministes matérialistes francophones des Colette Guillaumin (1978a et 1978b), Nicole-Claude Mathieu (1989) et Monique Wittig (1980), entre autres, les ont inscrits dans une filiation théorique plus vaste (Chetcuti 2009; Falquet 2011b). L’énoncé « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » de Wittig (1980), à la suite du célèbre « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir (1949), évoque la possibilité d’interactions plus complexes qu’il n’y paraît entre le sexe, le genre et la sexualité, ce qui pave ainsi la voie aux réflexions déroutantes, mais ô combien stimulantes, de Judith Butler (1990) sur le genre et ses troubles ainsi que de Teresa de Lauretis (1991) sur la théorie queer. Les critiques queers de l’hétéronormativité, en tant que dispositif hégémonique d’alignement du sexe, du genre et des désirs, puisaient à de nombreuses réflexions, en particulier celles de lesbiennes radicales francophones (Falquet 2009; Turcotte 1998).
En dépit de cet apport fécond des écrits francophones aux réflexions et aux pratiques lesbiennes, depuis les années 80 la francophonie a somme toute généré peu d’écrits sur le lesbianisme dans ses rapports pourtant inévitables avec son alter ego : le féminisme[4]. En vérité, les relations entre féminisme et lesbianisme ont été peu explorées, ce qui est tout à la fois étonnant et d’un grand intérêt : était-ce parce que ces rapports étaient considérés comme allant de soi et donc au-dessus de tout questionnement quant à leur nature ou parce que les remettre en question relevait de l’interdit? Cela dit, trois ouvrages ont approfondi les rapports entre féminisme et lesbianisme – ce sont des ouvrages qui puisent d’ailleurs aux pensées des Guillaumin, Rich et Wittig.
Dans Les lesbiennes et le féminisme, Roy (1985) propose une cartographie des positionnements politiques lesbiens au sein du mouvement féministe québécois du début des années 80. Pour elle, le féminisme et le lesbianisme ont entretenu une sorte de relation donnant-donnant, en cela que le féminisme a rendu possible la visibilité lesbienne et que les lesbiennes ont alimenté les réflexions féministes, notamment pour ce qui est du rôle de l’hétérosexualité dans l’oppression des femmes. Roy (1985 : 59-60) résume ainsi sa cartographie des rapports entre féminisme et lesbianisme :
Si les lesbiennes s’orientent sexuellement vers les femmes et ne présentent pas de position politique “ consciente ”, plusieurs des lesbianistes auront d’abord eu une démarche féministe qui les aura conduites au lesbianisme considéré alors comme pratique politique. La même distinction doit d’ailleurs être établie entre les hétérosexuelles, ayant des relations hétérosexuelles sans contenu politique explicite, et les hétérosexistes, hétérosexuelles féministes dont la démarche et l’option politique mènent au rejet du lesbianisme (en tant que collectivité de femmes et/ou comme action politique) et à situer l’action féministe à l’intérieur de l’hétérosexualité exclusivement.
Mis à part certains termes employés par Roy[5], cette lecture demeure d’actualité en cela que bien des lesbiennes ne sont pas féministes (ne serait-ce que parce qu’elles voient dans le féminisme un mouvement qui, pour l’essentiel, se consacre à défendre les modes de vie des femmes hétérosexuelles et néglige les revendications lesbiennes) et considèrent que leurs attirances pour des femmes sont totalement dépourvues de tout contenu politique alors que, par ailleurs, beaucoup d’hétéroféministes entretiennent toujours une bonne dose de suspicion à l’égard du lesbianisme.
Publié sous la direction de Natacha Chetcuti et Claire Michard (2003), l’ouvrage collectif Lesbianisme et féminisme. Histoires politiques a pour objet « de rendre compte de l’interdépendance historique des mouvements lesbiens et des mouvements féministes à partir du point de vue de différents courants du lesbianisme » (quatrième de couverture). Répartis entre quatre sections, les dix-neuf textes de l’ouvrage explorent les relations entre lesbianisme et féminisme sous l’angle tantôt des idées, tantôt des pratiques ou encore des institutions (y compris les sexualités). Désireuses, par leur ouvrage, de combler un vide dans les connaissances quant aux liens entre féminisme et lesbianisme, Chetcuti et Michard constatent les relations tout en dents de scie qu’ils entretiennent, faites d’alliances, de même que de tensions et de dissociations. C’est pourquoi le lesbianisme a besoin d’utopie car, « pour penser et combattre le système actuel, nous avons l’extrême nécessité de pouvoir l’imaginer dans une perspective d’abolition de sa structure d’ensemble : l’hétérosocialité » (Chetcuti et Michard 2003 : 18). Ces mots rappellent que l’imaginaire, loin d’être insignifiant et sans portée heuristique, au contraire sied au coeur du pouvoir symbolique, de ce pouvoir de se penser, d’être, de dire et de faire.
En réalité, un constat ressort des ouvrages de Roy ainsi que de Chetcuti et Michard (2003) : en dépit de quelques frictions, le féminisme et le lesbianisme entretiennent une communauté théorique, partagent un bassin de militantes et travaillent à déstabiliser (voire éradiquer, selon les inspirations idéologiques) le patriarcat. Dans l’optique de soutenir et de célébrer un domaine de recherche prometteur mais encore à ses balbutiements à l’époque, la revue Genre, sexualité & société a fait porter son premier numéro (en 2009) sur le thème « Lesbianisme : théories, politiques et expériences sociales » (coédité par Cécile Chartrain et Natacha Chetcuti). Publication innovante et inspirante, la revue regroupe dans ce numéro des chercheuses d’horizons variés (dont plusieurs issues du Québec) et des travaux interdisciplinaires. Les textes qui composent la première partie jettent un regard croisé sur le féminisme et le lesbianisme pour, sans étonnement, révéler la relation d’interdépendance qui est la leur, mais aussi rappeler la contradiction dont le féminisme est porteur, soit d’analyser les rapports femmes-hommes davantage dans une perspective d’adaptation (c’est-à-dire que les femmes s’adaptent à la société patriarcale et que la société patriarcale consent à quelques accommodements pour que les femmes s’y sentent mieux) que de révolution (soit faire voler en éclats les rapports femmes-hommes et les oppressions qu’ils impliquent pour elles). Plus récemment, Eloit (2012, 2018 et 2019) a orienté ses recherches sur le cadrage discursif du lesbianisme au sein du mouvement féministe français au cours des années 70. Dans son article paru en 2019 dans la revue Feminist Theory, Eloit soutient que l’invisibilisation du sujet lesbien au sein du mouvement féministe français des années 70 répondait à l’éthos du républicanisme qui impose l’unité de la nation française une et indivisible par quelque trait que ce soit : le communautarisme est source de division et d’éclatement de la nation. Plus récemment, cet argument républicain a été employé pour limiter les droits des femmes et des minorités sexuelles, comme en témoignent les débats sur la parité ou sur le « mariage pour tous » et, aujourd’hui, certains délires publics contre la « théorie du genre ».
Bien évidemment, les écrits en français qui portent sur le lesbianisme, sans que leurs regards soient nécessairement croisés avec le féminisme, sont plus nombreux – même si, au final, ils le sont bien peu en comparaison de leur importance du côté de l’anglophonie. Un ouvrage pionnier est celui de Marie-Jo Bonnet, Un choix sans équivoque : recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes xvie-xxe siècle (paru en 1981 et réédité dans un format généreusement enrichi en 1995). Bonnet part d’un constat, celui de l’invisibilité des femmes qui s’aiment, invisibilité physique certes, mais plus encore dans le langage (une structure symbolique essentielle à l’existence). Cet effacement a à voir avec le fait que les institutions qui régulent la re/production de la vie (l’hétérosexualité, bien sûr, mais aussi le mariage et la famille, auxquelles institutions il faudrait aussi ajouter le droit, l’éducation, les religions, etc.) sont patriarcales et reposent sur le principe totalitaire de l’assujettissement des femmes à la « politique du mâle », pour reprendre Kate Millett (1971). Toute la beauté de l’ouvrage de Bonnet a été de lever la chape de silence sur l’existence des lesbiennes, de le faire à une époque où les écrits à leur sujet adoptaient bien davantage le ton de l’insulte que des louanges et enfin, et surtout, d’avoir révélé les stratégies adoptées par les femmes pour s’aimer. En réalité, Un choix sans équivoque fait écho aux travaux très inspirants de Lilian Faderman (1991) en anglophonie.
Plusieurs ouvrages[6] sur le lesbianisme dans la francophonie, notamment en France et au Québec, sont parus depuis Un choix sans équivoque : ce sont aujourd’hui des incontournables, à commencer par Adieu les rebelles! où Bonnet (2014) jette un regard très critique sur les relations historiques entre féminisme et lesbianisme en France (essentiellement à Paris). Sans aucune prétention à l’exhaustivité, mentionnons l’ouvrage Sortir de l’ombre. Histoire des communautés lesbienne et gaie de Montréal (1998), sous la direction d’Irène Demczuk et Frank W. Remiggi, dont plusieurs chapitres traitent des lesbiennes :
le texte de Muriel Fortier sur les livres de poche dont le contenu de fiction lesbienne (lesbian pulp) sert d’outil de conscientisation à l’existence lesbienne;
le texte de Line Chamberland sur les bars lesbiens comme stratégies de conquête d’un espace public;
le texte de Diane Lamoureux qui traite de front la question du lesbianisme au sein du mouvement féministe montréalais;
le texte d’Andrea Hildebran qui pose un regard historique sur la communauté lesbienne montréalaise des années 70;
le texte de Dominique Bourque sur les réseaux de communication mis en place par les lesbiennes de Montréal au cours des années 70 et 80;
le texte de Suzanne Boisvert et Danielle Boutet sur le fascinant projet Gilford comme espace lesbien d’expression artistique et politique (et dont traite un article du présent numéro);
l’incontournable texte de Louise Turcotte sur le lesbianisme radical au Québec.
Plus de deux décennies après sa parution, Sortir de l’ombre reste ainsi l’un des rares ouvrages à traiter des communautés lesbiennes et gaies au Québec et – fait remarquable – à consacrer un espace significatif aux problématiques lesbiennes, ces dernières étant le plus souvent ignorées ou traitées sommairement : nous pensons notamment aux titres De la clandestinité à l’affirmation. Pour une histoire de la communauté gaie montréalaise, de Ross Higgins paru en 1999, et La répression des homosexuels au Québec et en France. Du bûcher à la mairie, de Patrice Corriveau (2006). Ces ouvrages constituent, par ailleurs, des apports importants aux savoirs sur les communautés LGBTQ au Québec et en France. Précisons que l’invisibilité lesbienne n’a rien d’étonnant, puisque les femmes ont longtemps été considérées comme des êtres du privé dont la présence dans l’espace public était jugée illégitime, dépourvues de désirs sexuels (sinon aux fins de reproduction); ce n’est qu’au milieu du xxe siècle que le droit criminel a explicitement visé les relations lesbiennes par une modification en 1954 aux dispositions criminelles en matière de grossière indécence (Pearlston 2020).
Pour autant, même si leur existence se déployait à l’abri des regards publics et que pour l’essentiel elles échappaient à la répression du droit criminel, les lesbiennes n’étaient pas exemptes de régulation sociale. Deux ouvrages parus à la fin des années 90 en font la démonstration. Publié sous la direction d’Irène Demczuk (1998), le livre Des droits à reconnaître. Les lesbiennes face à la discrimination met au jour de nombreuses facettes du régime de discrimination systémique (le mot est dit!) responsable du statut de citoyennes de seconde catégorie des lesbiennes, qu’il soit question de son ancrage dans le Code civil du Québec en matière de droit familial, de l’invisibilité imposée aux lesbiennes en milieu de travail ou de relations lesbiennes violentes qui passent sous le radar de la reconnaissance sociale. Dans son ouvrage Mémoires lesbiennes. Le lesbianisme à Montréal entre 1950 et 1972, Chamberland (1996) s’affaire à mettre au jour certains des dispositifs du contrôle social du lesbianisme dans la métropole québécoise des années 50 à 70, mais aussi les stratégies privilégiées par les lesbiennes pour leur résister et vivre leurs désirs saphiques en dépit du carcan de l’hétéronormativité – particulièrement en cette ère (les années 50 et 60) du diktat du Normal (Adams 1997). L’ouvrage de Chamberland avive les espoirs que paraissent pour le Québec des études de cas approfondies comme celles qui ont été réalisées sur les communautés lesbiennes au Canada anglais, telles The House that Jill Built: A Lesbian Nation in Formation (Ross 1995) et Making a Scene: Lesbians and Community across Canada, 1964-84 (Millward 2015).
D’ici là, les soifs de savoir à propos des existences lesbiennes en France et au Québec peuvent trouver à s’épancher dans un certain nombre d’écrits parus depuis le tournant du siècle. Nous en énumérons quelques-uns, à titre d’illustration et sans aucune prétention à l’exhaustivité. Du côté de la France, à la suite d’une conférence tenue à la Columbia University et qui avait réuni un groupe exceptionnel de chercheuses et de militantes de France, du Québec et d’ailleurs (dont Dominique Bourque, Teresa de Lauretis, Beatriz [Paul B.] Preciado, Simonetta Spinelli et Louise Turcotte), Bourcier et Robichon (2002) ont fait paraître Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes… Autour de l’oeuvre politique, théorique et littéraire de Monique Wittig, ouvrage qui, comme son titre l’indique à propos, fait le point sur l’oeuvre de Wittig. Bien que le phénomène des mères lesbiennes ne soit en rien nouveau (combien de lesbiennes ont été contraintes à l’hétérosexualité et aux maternités), les importants travaux de Martine Gross (2003 et 2011) ont permis de reconnaître à proprement parler leur existence en contexte d’homoparentalité. En 2012, la revue Nouvelles Questions féministes a consacré un numéro à la question de l’homophobie, certains textes jaugeant cette notion à l’aune de celle de lesbophobie. Ainsi, Stéphanie Arc et Philippe Vellozzo (2012) soutiennent que l’homophobie n’est en rien un phénomène neutre au regard du genre et que doivent se multiplier les études afin de mettre au jour les spécificités des violences phobiques de toute nature concernant les lesbiennes, ou la lesbophobie, notion qui ne peut être conceptualisée comme une simple version féminisée de la gaiphobie. Ajoutant une touche d’intersectionnalité à leur lecture, Chamberland et Lebreton (2012 : 41) renchérissent en soutenant ceci :
[La sphère d’application de la notion d’homophobie] se limite trop souvent à l’homosexualité masculine, voire à la vision d’un sujet homosexuel blanc et de classe moyenne qui décide des conduites jugées homophobes ou censées découler d’une homophobie intériorisée. La déclinaison du terme sous forme de lesbophobie, biphobie et transphobie contrarie efficacement la position dominante de l’homme gai dans le champ politique, sans toutefois résoudre les difficultés théoriques inhérentes à cette notion ancrée dans la pathologie individuelle.
Dans l’ouvrage Se dire lesbienne. Vie de couple, sexualité, représentation de soi, paru en 2013, Chetcuti explore les voies qu’empruntent les lesbiennes pour dire leurs identités et sexualités stigmatisées. Par cette publication, non seulement Chetcuti a joué un rôle important dans l’étude de ce que signifie s’identifier comme lesbienne en France, mais son engagement dans le monde de l’édition lui a permis d’avoir une incidence notable sur le domaine des études lesbiennes.
Le Québec baignant dans l’anglophonie, et Montréal vivant pour une bonne part dans la langue de Shakespeare, plusieurs écrits sur la vie lesbienne dans la métropole sont rédigés en anglais. En 1993, Chamberland a fait paraître un texte dans ce qui était alors l’une des très rares revues universitaires à se consacrer explicitement à l’étude de l’homosexualité, soit Journal of Homosexuality. Dans son article intitulé « Remembering Lesbian Bars: Montreal, 1955-1975 », Chamberland (1993; voir aussi Chamberland (1998)) adopte une approche intersectionnelle avant l’heure pour examiner le développement des bars lesbiens dans la métropole du Québec pendant le long règne de Jean Drapeau. Si les bars lesbiens ont été des sources d’autonomisation (empowerment) pour les lesbiennes qui les fréquentaient (d’autant plus que les minorités sexuelles, dont les lesbiennes, n’avaient pas nécessairement bonne presse, selon Higgins et Chamberland (1992)), ils ont aussi été le terrain de luttes de classe et, au final, des espaces d’affirmations identitaires. Pour certaines lesbiennes, les bars offraient un espace protégé où se construire en opposition aux femmes hétérosexuelles de même qu’aux hommes gais et hétérosexuels (straights). Il est possible également que les bars aient été interprétés comme des espaces de libération, à la manière de la libération nationale québécoise (Pidduck (2015); plus globalement sur les liens entre [homo]sexualité et identité nationale québécoise, voir Jeffery Vacante (2012) et Jean-Philippe Warren (2012)). Dans une perspective similaire de conquête de l’espace comme dispositif d’autonomisation identitaire, Julie Podmore (2006, 2013 et 2015; Podmore et Chamberland 2015; Podmore et Tremblay 2015) a publié (en anglais) un nombre important de textes sur les stratégies retenues par les lesbiennes pour s’approprier des parcelles du tissu urbain montréalais et les marquer de leurs existences saphiques.
La revue Recherches féministes a été une alliée institutionnelle pour la diffusion des savoirs sur le lesbianisme et les lesbiennes. Dès la deuxième année d’existence de la revue, en 1989, Chamberland y fait paraître le premier article sur le lesbianisme : « Le lesbianisme : continuum féminin ou marronnage? » Elle y explore les différents sens que revêt le lesbianisme selon que se posent sur lui des regards féministes constructivistes, matérialistes, ou encore selon qu’il est examiné sous l’angle du continuum lesbien de Rich en tant que forme de résistance à l’institution de l’hétérosexualité.
Le numéro consacré à la Marche mondiale des femmes en 2000 comptait deux textes clés sur le lesbianisme. Dans son article « Marcher pour le droit des lesbiennes à l’égalité », Demczuk met au jour certaines résistances manifestées au moment de la rencontre internationale préparatoire à la Marche, tenue à Montréal en 1998 par des délégations féministes, d’inscrire dans la plateforme de la Marche des revendications en matière de droits des lesbiennes. Dans le même numéro, Ruth Rose pose un regard critique dans son texte intitulé « Les droits des lesbiennes au Québec et au Canada », où elle évalue les acquis et les combats à venir pour éliminer les discriminations envers les lesbiennes, notamment en matière de filiation et de mariage, d’immigration et, surtout, de transformation des attitudes publiques. Pour sa part, Vanessa Watremez s’est intéressée, en 2005, à un phénomène réel, mais hélas largement tu, soit celui de la violence entre lesbiennes dans un cadre domestique. C’est peut-être parce que cette violence fait mentir bien des mythes à propos des relations lesbiennes, entre autres qu’elles seraient éminemment égalitaires et à saveur de vanille, au contraire des relations hétérosexuelles qui se dérouleraient sous le signe de l’exploitation et de la domination. Or, ce silence n’est pas sans conséquence, notamment au regard du processus d’élaboration des politiques publiques, problématique à laquelle Watremez réfléchit en s’inspirant des perspectives du féminisme matérialiste et du lesbianisme politique.
Plusieurs textes ont été publiés dans la revue au cours de la dernière décennie. Ainsi, en 2009, Isabel Côté signe un texte sur la lesboparentalité, dans lequel elle pose la question de savoir si cette forme de filiation reproduit ou subvertit les normes de la famille hétéroparentale. Ce questionnement s’avère d’autant plus important qu’il a miné les débats sur l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. En 2010 paraissent deux textes. Le premier, signé par Line Chamberland et Christelle Lebreton, adopte une facture méthodologique : s’intéressant à la santé des adolescentes lesbiennes et bisexuelles, les auteures constatent que ce qui est posé comme une neutralité méthodologique génère plus de discriminations par invisibilisation des réalités des jeunes lesbiennes que cela n’agit comme une « garantie de vérité scientifique » (2010 : 103). Le second texte, écrit par Barbara Ravel, s’intéresse au monde du sport, notamment à l’affirmation de l’identité sexuelle de jeunes sportives montréalaises qui voient leurs sexualités à l’extérieur des pourtours de l’hétérosexualité pour se dire lesbiennes, gaies, bisexuelles ou autres. Stimulants, les constats que pose Ravel rappellent la complexité des processus de formation identitaire en matière de genre et de sexualité. L’année suivante, dans un texte intitulé « Les “ féministes autonomes ” latino-américaines et caribéennes », Jules Falquet (2011a) soutient que les lesbiennes féministes amérindiennes et afrodescendantes assument un rôle progressiste au sein de ce qu’elle nomme le « féminisme dominant » en y déployant des lectures intersectionnelles à propos des femmes et de leurs conditions où s’entrecroisent rapports sociaux de sexe, de classe et de « race ».
En 2015, dans le contexte du numéro « Intersectionnalités », nous (Manon Tremblay et Julie Podmore) faisions paraître un texte, « Depuis toujours intersectionnels : relecture des mouvements lesbiens à Montréal, de 1970 aux années 2000 », dans la revue Recherches féministes avec l’intention d’insister sur le caractère éminemment hétérogène du lesbianisme, des identités lesbiennes et de leurs mouvements dans le Montréal des années 1970 à 2000. Certes, envisager les lesbiennes, leurs identités et leurs mouvements sous l’angle de leurs diversités présente le risque de faire disparaître le sujet lesbien comme entité analytique à force de le morceler; pour autant, cette approche permet aussi d’en révéler les complexités et les tensions – une image éclectique plus choquante, mais sans doute plus près de la réalité que sa contrepartie policée. Finalement, l’article de Christelle Lebreton paru en 2016, « Les rapports sociaux de sexe et le lesbianisme dans le Québec contemporain », révèle de manière saisissante l’actualité du cadre théorique féministe matérialiste, pourtant élaboré et formalisé durant les années 70 et 80 par les Christine Delphy, Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Adrienne Rich et Monique Wittig, pour comprendre la socialisation à la sexualité de jeunes lesbiennes en tant que processus coercitif rendu possible, notamment, par la contrainte à l’hétérosexualité. Des notions comme le patriarcat, le sexage et l’hétérosexualité comme régime politique, loin de témoigner d’un quelconque délire féministe, constituent de puissantes clés de lecture pour donner sens à l’existence lesbienne dans le Québec contemporain.
La revue Recherches féministes a aussi fait paraître des textes qui traitent plus largement du lesbianisme, notamment par le truchement de l’intersectionnalité et des théories queers et postmodernes (au demeurant, dans cette approche le lesbianisme est une étiquette dépassée, voire indésirable). Deux textes se donnent ainsi à lire dans le numéro « Les féminismes » (2007) sous la direction de Diane Lamoureux. Dans son article intitulé « De la construction du genre à la construction du “ sexe ” », Alexandre Baril décortique les implications du constructivisme butlérien sur la reconnaissance sociale et politique des différents genres et des multiples sexualités. Dans leur texte ayant pour titre « Mon/notre/leur corps est toujours un champ de bataille », Émilie Breton et ses collègues (2007) analysent une batterie de discours publics critiques du patriarcat et de l’hétérosexisme tenus à Montréal au début du xxie siècle, en dégagent trois courants dont l’un, animé par des groupes queers radicaux, s’affaire à déconstruire l’identité sexuelle « femme » et à faire l’apologie d’un militantisme aux identifications plurielles. Par ailleurs, certains textes inclus dans le numéro thématique sur l’art et le féminisme en 2014 examinent les relations entre les pratiques artistiques féministes et queers au Québec (comme le texte de Marie-Claude Gingras-Olivier, « Les pratiques artistiques queers et féministes au Québec : art et activisme en tous lieux », et celui de Rébecca Lavoie, « Pratiques artistiques féministes et queers en art vidéo : propositions politiques post?-identitaires »). Enfin, le numéro « Intersectionnalités », sous la direction de Dominique Bourque et Chantal Maillé, paru en 2015, surfe sur une perspective théorique qui intègre la sexualité et le genre, ainsi que d’autres axes de différence. Par exemple, le texte de Baril examine les différentes lectures que font les féminismes du sexe/genre et en suppute les portées politiques pour penser les identités et les réalités trans, et ce, dans un souci de favoriser les solidarités entre féministes et transactivistes.
Bien que la revue Recherches féministes soit une alliée institutionnelle de longue date pour la diffusion des connaissances sur le lesbianisme et les lesbiennes, un numéro n’avait pas encore été consacré au complet à ce thème. C’est ce vide que le présent numéro cherche bien modestement à combler. Il vise à explorer les relations entre féminismes et lesbianismes, dans une perspective historique et contemporaine. Notre objectif est d’examiner leurs discours et leurs pratiques en termes de continuités et de ruptures ainsi qu’au regard de leurs modes d’hybridation sous l’influence d’autres forces sociétales (comme le colonialisme, l’hétérosexisme et le patriarcat). Le numéro compte six textes[7] qui, chacun à leur manière, explorent les enchevêtrements entre féminisme et lesbianisme, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs – c’est d’ailleurs sous cet angle qu’ils sont présentés, même si leur contenu va bien au-delà de ce qui en est dit ici.
Comme nous l’avons soulevé au début de notre présentation, les relations entre féminismes et lesbianismes peuvent sembler aller de soi; pourtant, il n’en est rien : d’une part, des féministes ont vu dans le lesbianisme une menace au mouvement des femmes (l’exemple le plus célèbre étant la dénonciation par Betty Friedan de la « menace violette » qui, apparemment, guettait la NOW) et, d’autre part, des lesbiennes ont interprété le féminisme comme une contradiction, voire une aberration, en tant qu’il était incarné par des hétérosexuelles. C’est ce second aspect qu’explore Stéphanie Mayer dans son texte « Des critiques féministes de l’hétérosexualité : contribution et limites des théorisations lesbiennes et queers ». Adoptant une perspective de philosophie politique, l’auteure se propose de problématiser ce qui l’est rarement en raison de son apparente naturalité, soit l’hétérosexualité. Pour ce faire, elle met au jour les idées maîtresses qui sous-tendent les écrits de quatre auteures féministes lesbiennes, lesbiennes radicales ou queers à l’oeuvre entre 1970 et 2017, soit Judith Butler, Stevi Jackson, Adrienne Rich et Monique Wittig, avec l’intention d’en circonscrire les portées et les limites quant à la compréhension de l’hétérosexualité, mais aussi leurs usages possibles pour les hétérosexuelles. Les analyses de Mayer révèlent que des débats théoriques qui semblent dépassés et éloignés s’avèrent, au contraire, féconds pour inspirer des postures et des luttes identitaires actuelles.
C’est ce terrain qu’explore Tara Chanady dans son texte « Les identités lesbiennes et les positionnements queers comme stratégies politiques : perspectives et transformations dans l’espace montréalais ». De manière plus précise, l’auteure se propose d’offrir une lecture des transformations des postures lesbienne et queer à l’aune de considérations de cultures, de migrations et de temps. Pour ce faire, Chanady a mis au point une méthode pour le moins originale : d’une part, elle a mobilisé l’approche de la phénoménologie critique queer, qui voit dans le désir un motif à l’action des corps dans l’espace; d’autre part, elle a précisément voulu tirer profit de l’espace en invitant une vingtaine de participantes au profil diversifié (englobant un large éventail d’identités sexuelles, mais aussi des femmes âgées de 24 à 80 ans, des francophones et des anglophones, des femmes nées à Montréal ou ailleurs, etc.) à discuter autour de la question « Qu’est-ce que ça veut dire, pour toi, être lesbienne ou queer à Montréal? », dans le contexte d’entrevues marchées : « Pour saisir le mouvement et la nature contextuelle des identifications, j’ai proposé aux participantes de faire des entrevues marchées d’environ une heure et demie dans des espaces significatifs par rapport au vécu de leur orientation sexuelle » (p. 48). Finalement, Chanady constate que les postures lesbienne et queer, bien plus que le contenu sexuel auquel elles sont trop souvent réduites, se tissent d’un substrat identitaire et politique façonné au rythme d’un maelstrom de tensions générationnelles, linguistiques et raciales, entre autres. Autrement dit, les postures lesbienne et queer sont politiques, car elles inspirent, hier comme aujourd’hui, à Montréal et sans doute ailleurs aussi, des luttes s’articulant autour de re/significations et de ré/appropriations identitaires.
La question identitaire court aussi en filigrane du texte de Julianne Pidduck, « Les conditions et les “ scènes ” de visibilité médiatique lesbienne et féministe : l’atelier de photographie Plessisgraphe des années 70 et 80 ». Soucieuse que les vies LGBTQ d’autrefois, pour l’essentiel écoulées dans la clandestinité, ne disparaissent pas dans l’oubli d’un présent qui semble obnubilé par l’avenir, Pidduck examine la question de la visibilité lesbienne et des femmes queers, notamment « [les] nouvelles possibilités de visibilité et d’énonciation lesbiennes qui voient le jour en rapport avec les mouvements de libération lesbiens et féministes montréalais à partir des années 70 et 80 ». Pour ce faire, elle considère le cas relativement méconnu de l’atelier de photographie montréalais Plessisgraphe qui, pendant une décennie (de 1977 à 1987), s’est avéré un terreau de visibilité lesbienne et féministe, en cela que des photographes lesbiennes et féministes (dont deux qu’elle a interrogées et dont elle a exploré les archives photographiques) s’y sont consacrées à la représentation des expériences lesbiennes et féministes. Puisant aux approches théoriques et méthodologiques des études de la culture visuelle, Pidduck soutient que non seulement ces pratiques de visibilité médiatique ont contribué à documenter les expériences lesbiennes et féministes, mais que, ce faisant, elles les ont constituées et investies de sens. Pidduck conclut à l’absence des lesbiennes et des femmes queers des mises en image des Québécoises[8] et du mouvement féministe, invisibilité que le style du « documentaire intime » de l’atelier Plessisgraphe a su renverser en captant « les intimités, les subjectivités et les expériences de certaines lesbiennes de l’époque » (p. 84).
Cependant, l’invisibilité des lesbiennes, de l’espace hétéropublic en général et de la scène féministe plus particulièrement, découle peut-être de ce qu’elles n’avaient pas la masse critique pour affirmer, voire imposer leur visibilité. Un constat de Camille Morin-Delaurière est que le nombre importe. Dans son texte intitulé « Étude comparée de Rennes et de Paris : une autre histoire des relations entre les mouvements féministe et lesbien en France (1970-1980) », elle examine l’évolution des relations ambiguës entre féminisme et lesbianisme au cours des années 70 et 80 en France, notamment à Paris et à Rennes. Morin-Delaurière a mené une analyse comparative de nature sociohistorique où, s’appuyant sur l’approche de l’ethnographie historique, elle a réalisé des entrevues auprès de lesbiennes qui, durant les années 70 et au début des années 80, militaient dans des groupes lesbiens à Paris et à Rennes, des interviews qu’elle a jumelées à un travail archivistique. Son texte est porteur d’un enseignement manifeste mais trop souvent négligé : il révèle toute l’importance de tenir compte du contexte. En d’autres termes, il n’existe pas un mouvement lesbien français mais des mouvements – à la limite, autant de mouvements que de contextes. Si la concentration militante de féministes et de lesbiennes à Paris a permis, après un temps, la formation d’un mouvement lesbien autonome, cela n’a pas été possible à Rennes (et dans d’autres villes comme Lyon et Toulouse), ce qui a obligé les mobilisations lesbiennes rennaises à adapter leurs objectifs, leurs alliances et leurs répertoires d’action en conséquence (souvent en s’alliant aux gais).
Les deux derniers textes, soit celui de Valérie Millette et Valérie Bourgeois-Guérin et celui de Jules Falquet, font la part belle à l’analyse intersectionnelle. Dans leur texte « Un filet de sécurité imaginé? Le rapport de femmes âgées à la communauté LGBTQ+ à la suite du deuil d’une partenaire de même sexe », Millette et Bourgeois-Guérin explorent la problématique du deuil chez des femmes âgées ayant vécu le décès d’une partenaire de même sexe. De manière plus précise, elles cherchent à circonscrire leurs conceptions de la « communauté » et les retombées de cette dernière sur les expériences de deuil de ces femmes. S’inspirant du concept de « communautés imaginées » et concevant le deuil comme un passage liminaire, les deux auteures ont mené dix-huit entrevues auprès de dix femmes âgées de plus de 65 ans vivant dans l’agglomération de Montréal. Réalisée à la lumière d’une approche féministe intersectionnelle, leur analyse révèle que la communauté, qu’elle soit d’allégeance féministe ou lesbienne, se veut une notion instable et fluide : elle constitue un référent dans des moments de vulnérabilité, source de soutien mais aussi d’attentes quant à la façon de vivre un deuil. Ainsi, à la manière d’une oasis qui fait rêver, la communauté, en tant que fruit de l’imaginaire, est porteuse d’espoirs pour l’avenir. En cela, l’analyse de Millette et Bourgeois-Guérin oblige à penser les entrecroisements entre féminismes et lesbianismes non pas seulement en fonction du passé et du présent, mais aussi du devenir, de ce qui pourrait advenir.
C’est aussi dans une perspective féministe intersectionnelle, croisant sexisme et racisme, que Jules Falquet situe son texte titré « De la lutte contre le racisme au soutien aux demandeuses d’asile lesbiennes : expériences lesbiennes féministes en France depuis la fin des années 90 ». Son objectif est de faire sortir de l’ombre et d’interpréter quelques expériences de mobilisations lesbiennes féministes survenues en France depuis le tournant du millénaire, en réponse au racisme du mouvement lesbien et au durcissement nationaliste des politiques migratoires du gouvernement de l’Hexagone. Falquet fait sienne une perspective épistémologique du point de vue situé suivant laquelle sa propre expérience de militante devient un matériau d’analyse, qu’elle joint à diverses productions d’associations à l’oeuvre sur le terrain. Falquet constate que les dénonciations de racisme initialement exprimées par des lesbiennes racisées se sont muées, de 2005 à 2010, en luttes pour décrier l’hétérosexisme des politiques migratoires, alors que les notions d’hétérocirculation des femmes et de lesbonationalisme, inspirées du concept d’homonationalisme (Puar 2007), jettent un éclairage sur la période plus récente. Au final, c’est « l’institutionnalisation d’une bonne partie du mouvement féministe, puis LGBTQI+, et leur instrumentalisation pour légitimer le modèle néolibéral » (p. 129) que regrette Falquet.
En somme, ce numéro s’inscrit dans une riche tradition de recherche sur les féminismes, et dans une moindre mesure les lesbianismes, en contexte francophone (notamment, en France et au Québec). Pourtant, en faisant la part belle au lesbianisme, il cherche tout à la fois à alimenter un champ d’études et de recherches relativement dépouillé et, du coup, à encourager le développement des recherches sur les lesbianismes et leurs rapports avec les féminismes en contexte francophone – idéalement par-delà la France et le Québec, pour embrasser la francophonie internationale. Ainsi, qu’en est-il des rapports entre femmes en Afrique francophone, des rapports que l’Occident qualifie de lesbiens, mais qui peuvent là revêtir d’autres significations? Plus important encore, puisque l’anglophonie domine l’espace des artéfacts culturels et imaginaires des lesbianismes planétaires (par exemple, les publications, les films ou les festivals s’expriment pour l’essentiel en anglais), le lesbianisme se déploie-t-il dans la francophonie selon des paramètres spécifiques et novateurs s’inscrivant dans une stratégie d’affirmation identitaire, voire de résistance à l’impérialisme anglophone? Cette question n’est pas farfelue, car il importe de savoir si l’étude des lesbianismes au sein de la francophonie peut se contenter de « copier/coller » l’appareillage théorique, conceptuel et méthodologique élaboré pour mener les recherches sur les lesbianismes en anglophonie ou si, au contraire, les recherches francophones doivent les adapter, voire concevoir de nouveaux outils. La réception très animée en France de la traduction de Gender Trouble/Trouble dans le genre témoigne de ce que la recherche se satisfait rarement d’une reproduction littérale et que le substrat culturel ne peut être ignoré. Quoi qu’il en soit, des études approfondies du côté de la francophonie se font attendre sur les enchevêtrements complexes liant féminismes et lesbianismes, à l’image de celles qui ont été faites au Canada anglais par Millward (2015) et Ross (1995). Il reste tellement à faire!
Articles hors thème
Deux articles hors thème s’ajoutent aux textes de ce numéro thématique.
Le premier article, de Myriam Bergeron-Fournier et Émilie Genin, porte sur le plafonnement de carrière des femmes accessoiristes de plateau au Québec. En effet, dans l’industrie du cinéma québécoise, les deux tiers des postes d’assistants accessoiristes de plateau sont occupés par des femmes, alors qu’elles ne représentent que 16 % des chefs accessoiristes. L’auteure présente une étude novatrice et fort intéressante à examiner, car les inégalités vécues par les femmes accessoiristes de plateau sont sans doute analogues à celles qui se produisent dans d’autres corps de métier de l’industrie du cinéma au Québec. Pour mieux comprendre cette situation, l’auteure a rencontré dix-sept personnes du milieu. Ses résultats de recherche font ressortir une situation de discrimination systémique dans le métier d’accessoiriste, qui découle, entre autres, des stéréotypes de genre, des conditions de travail et de la division sexuées des tâches entre les hommes et les femmes au sein des équipes.
Dans le second article hors thème, consacré à l’émancipation féminine dans la série StarWars, Patrice Cailleba et Johanna Edelbloude examinent, à travers le prisme du leadership féminin, les trajectoires individuelles des femmes protagonistes et la visibilité de ces dernières, qui va croissant tout au long de la célèbre saga cinématographique échelonnée sur cinq décennies. Leur démarche méthodologique s’appuie sur le cadre théorique des structures anthropologiques de l’imaginaire de Gilbert Durand, et ce, afin d’analyser la manière dont les héroïnes de Star Wars s’émancipent à la fois des institutions patriarcales et de l’oppression religieuse. La dimension féministe de la série, qui transparaît dans les trajectoires individuelles des protagonistes, est plutôt différencialiste et non simplement postféministe. Les protagonistes étudiées incarnent en effet un leadership éthique au féminin, qui les caractérise dans la saga.
Parties annexes
Notes biographiques
Manon Tremblay est professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la représentation politique des minorités, notamment celle des femmes et des personnes de la communauté LGBTQ au Québec et au Canada.
Julie Podmore est professeure de géographie au Collège John Abbott et professeure adjointe au Département de géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia. Ses recherches portent sur les géographies historiques lesbiennes, l’activisme et les espaces LGBTQ+, l’urbanisme queer, ainsi que la vie quotidienne des personnes de la communauté LGBTQ+ en banlieue.
Notes
-
[1]
Voir le numéro que la revue Amazones d’Hier, Lesbiennes d’Aujourd’hui (AHLA) lui a consacré (26-27, 2014).
-
[2]
Pour un aperçu de la revue depuis sa fondation en 1982, voir AHLA (2020).
-
[3]
À noter que cette démarche d’ouverture et d’inclusion reste lacunaire, comme en témoigne la (piètre) prise en considération des réalités trans par le féminisme francophone (Baril 2016).
-
[4]
Rappelons qu’au Québec Line Chamberland (2002) et surtout Diane Lamoureux (1986, 1998a, 1998b, 2003, 2004 et 2009) ont consacré un certain nombre de textes à cette question. Pour la France, voir Ilana Eloit (2012 et 2018).
-
[5]
Par exemple, les hétérosexistes d’aujourd’hui sont les personnes qui interprètent l’hétérosexualité et son régime de normativité en termes de supériorité par rapport aux autres sexualités.
-
[6]
Il existe aussi une multitude d’écrits à ce propos sur le Web (par exemple, Brigitte Boucheron (2012)).
-
[7]
La pandémie de la COVID-19 a posé de nombreux défis à la réalisation de ce numéro. En effet, plusieurs personnes ont été dans l’incapacité de donner suite à leur proposition de texte, notamment en raison d’une conjoncture marquée par l’inconnu et d’un rythme de travail rendant impossible la réflexion essentielle à l’écriture.
-
[8]
En témoigne également l’ouvrage d’Hélène-Andrée Bizier (2007), Une histoire des Québécoises en photos : ayant parcouru cet album, par ailleurs d’un grand esthétisme, à la recherche de lesbiennes, nous avons dû nous contenter de quelques soupçons.
Références
- ADAMS, Mary Louise, 1997 The Trouble with Normal: Postwar Youth and the Making of Heterosexuality. Toronto, University of Toronto Press.
- AMAZONES D’HIER, LESBIENNES D’AUJOURD’HUI (AHLA), 2020 AHLA – D’hier à aujourd’hui, [En ligne], [www.youtube.com/watch?v=a8F h8fSTnR4] (2 novembre 2020).
- AMAZONES D’HIER, LESBIENNES D’AUJOURD’HUI (AHLA), 2014 « Danielle Charest (1951-2011), militante lesbienne radicale », Amazones d’Hier, Lesbiennes d’Aujourd’hui, 26-27.
- ARC, Stéphanie, et Philippe VELLOZZO, 2012 « Rendre visible la lesbophobie », Nouvelles Questions féministes, 31, 1 : 12-26.
- BAILLARGEON, Denyse, 2012 Brève histoire des femmes au Québec. Montréal, Boréal.
- BARIL, Alexandre, 2016 « Francophone Trans/Feminisms: Absence, Silence, Emergence », TSQ: Transgender Studies Quarterly, 3, 1-2 : 40-47.
- BARIL, Alexandre, 2015 « Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des transidentités », Recherches féministes, 28, 2 : 121-141.
- BARIL, Alexandre, 2007 « De la construction du genre à la construction du “ sexe ” : les thèses féministes postmodernes dans l’oeuvre de Judith Butler », Recherches féministes, 20, 2 : 61-90.
- BEAUVOIR, Simone de, 1949 Le deuxième sexe. Paris, Gallimard.
- BIZIER, Hélène-Andrée, 2007 Une histoire des Québécoises en photos. Montréal, Fides.
- BOISVERT, Suzanne, et Danielle BOUTET, 1998 « Le projet Gilford : mémoires vives d’une pratique artistique et politique », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 313-336.
- BONNET, Marie-Jo, 2014 Adieu les rebelles! Paris, Flammarion.
- BONNET, Marie-Jo, 1998 « De l’émancipation amoureuse des femmes dans la cité : lesbiennes et féministes au xxe siècle », Les Temps modernes, 598 : 85-112.
- BONNET, Marie-Jo, 1981 Un choix sans équivoque : recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes xvie-xxe siècle. Paris, Odile Jacob.
- BOUCHERON, Brigitte, 2012 « Introduction à une histoire du mouvement lesbien en France », C.L.F. Coordination lesbienne en France, [En ligne], [www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article212] (22 novembre 2020).
- BOURCIER, Marie-Hélène, et Suzette ROBICHON (dir.), 2002 Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes… Autour de l’oeuvre politique, théorique et Littéraire de Monique Wittig, Actes du Colloque des 16-17 juin, New York, Columbia University. Paris, Éditions Gaies et Lesbiennes.
- BOURQUE, Dominique, 1998 « Voix et images de lesbiennes : la formation d’un réseau de médias », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 291-311.
- BRETON, Émilie, et autres, 2007 « Mon/notre/leur corps est toujours un champ de bataille : discours féministes et queers libertaires au Québec, 2000-2007 », Recherches féministes, 20, 2 : 113-139.
- BUTLER, Judith, 1990 Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge.
- CHAMBERLAND, Line, 2002 « La place des lesbiennes dans le mouvement des femmes », Labrys : études féministes, 1-2, juillet/décembre, [En ligne], [www.labrys.net.br/labrys1_2/chaberland2.html] (26 octobre 2020).
- CHAMBERLAND, Line, 1998 « La conquête d’un espace public : les bars fréquentés par les lesbiennes », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 129-164.
- CHAMBERLAND, Line, 1996 Mémoires lesbiennes. Le lesbianisme à Montréal entre 1950 et 1972. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- CHAMBERLAND, Line, 1993 « Remembering Lesbian Bars: Montreal, 1955-1975 », Journal of Homosexuality, 25, 3 : 231-270.
- CHAMBERLAND, Line, 1989 « Le lesbianisme : continuum féminin ou marronnage? Réflexions féministes pour une théorisation de l’expérience lesbienne », Recherches féministes, 2, 2 : 135-145.
- CHAMBERLAND, Line, et Christelle LEBRETON, 2012 « Réflexions autour de la notion d’homophobie : succès politique, malaises conceptuels et application empirique », Nouvelles Questions féministes, 31, 1 : 27-43.
- CHAMBERLAND, Line, et Christelle LEBRETON, 2010 « La santé des adolescentes lesbiennes et bisexuelles : état de la recherche et critique des biais androcentristes et hétérocentristes », Recherches féministes, 23, 2 : 91-107.
- CHARTRAIN, Cécile, et Natacha CHETCUTI, 2009 « Lesbianisme : théories, politiques et expériences sociales », Genre, sexualité & société, 1, printemps, [En ligne], [journals.openedition.org/gss/635] (4 novembre 2020).
- CHAUVIN, Sébastien, 2005 « Les aventures d’une “ alliance objective ”. Quelques moments de la relation entre mouvements homosexuels et mouvements féministes au xxe siècle », L’Homme & La Société, 158, 4 : 111-130.
- CHETCUTI, Natacha, 2013 Se dire lesbienne. Vie de couple, sexualité, représentation de soi. Paris, Payot.
- CHETCUTI, Natacha, 2009 « De “ On ne naît pas femme ” à “ On n’est pas femme ”. De Simone de Beauvoir à Monique Wittig », Genre, sexualité & société, 1, printemps, [En ligne], [journals.openedition.org/gss/635] (4 novembre 2020).
- CHETCUTI, Natacha, et Claire MICHARD, 2003 Lesbianisme et féminisme. Histoires politiques. Paris, L’Harmattan.
- COLLECTIF CLIO, 1982 L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. Montréal, Quinze.
- COLLIN, Françoise, 1986 « Le féminisme et la crise du moderne », dans Diane Lamoureux (dir.), Fragments et collages. Essai sur le féminisme québécois des années 70. Montréal, Les éditions du remue-ménage : 7-16.
- CORRIVEAU, Patrice, 2006 La répression des homosexuels au Québec et en France. Du bûcher à la mairie. Sillery, Septentrion.
- CÔTÉ, Isabel, 2009 « La lesboparentalité : subversion ou reproduction des normes? », Recherches féministes, 22, 2 : 25-38.
- DEMCZUK, Irène, 2000 « Marcher pour le droit des lesbiennes à l’égalité », Recherches féministes, 13, 1 : 131-144.
- DEMCZUK, Irène (dir.), 1998 Des droits à reconnaître. Les lesbiennes face à la discrimination. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- DEMCZUK, Irène, et Frank W. REMIGGI (dir.), 1998 Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur.
- DUMONT, Micheline, 2008 Le féminisme québécois raconté à Camille. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- EARLES, Jennifer, 2019 « The “ Penis Police ”: Lesbian and Feminist Spaces, Trans Women, and the Maintenance of the Sex/Gender/Sexuality System », Journal of Lesbian Studies, 23, 2 : 243-256.
- ECHOLS, Alice, 1989 Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967-75. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- ELOIT, Ilana, 2019 « American Lesbians are Not French Women: Heterosexual French Feminism and the Americanisation of Lesbianism in the 1970s », Feminist Theory, 20, 4 : 381-404.
- ELOIT, Ilana, 2018 Lesbian Trouble: Feminism, Heterosexuality and the French Nation (1970-1981). Thèse de doctorat. Londres, London School of Economics and Political Science.
- ELOIT, Ilana, 2012 Le sujet politique lesbien à Paris : compositions, recompositions et décompositions du sujet féministe (1970-1984). Mémoire de maîtrise. Paris, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
- FADERMAN, Lillian, 1991 Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth-Century America. New York, Columbia University Press.
- FALQUET, Jules, 2011a « Les “ féministes autonomes ” latino-américaines et caribéennes », Recherches féministes, 24, 2 : 39-58.
- FALQUET, Jules, 2011b « Pour une anatomie des classes de sexe : Nicole-Claude Mathieu ou la conscience des opprimé-e-s », Les Cahiers du genre, 50 : 193-217.
- FALQUET, Jules, 2009 « Rompre le tabou de l’hétérosexualité, en finir avec la différence des sexes : les apports du lesbianisme comme mouvement social et théorie politique », Genre, sexualité & société, 1, printemps, [En ligne], [journals.openedition.org /gss/635] (4 novembre 2020).
- FORSTIE, Clare, 2020 « Disappearing Dykes? Post-lesbian Discourse and Shifting Identities and Communities », Journal of Homosexuality, 67, 12 : 1760-1778.
- FORTIER, Muriel, 1998 « Les lesbian pulps : un instrument de conscientisation », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 27-52.
- GINGRAS-OLIVIER, Marie-Claude, 2014 « Les pratiques artistiques queers et féministes au Québec : art et activisme en tous lieux », Recherches féministes, 27, 2 : 153-169.
- GROSS, Martine, 2011 « Qu’est-ce qui empêche en France qu’un enfant ait deux parents de même sexe? », dans Patrice Corriveau et Valérie Daoust (dir.), La régulation sociale des minorités sexuelles. L’inquiétude de la différence. Québec, Presses de l’Université du Québec : 135-154.
- GROSS, Martine, 2003 L’homoparentalité. Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je? ».
- GUILLAUMIN, Colette, 1978a « Pratique du pouvoir et idée de nature. (I) L’appropriation des femmes », Questions féministes, 2 : 5-30.
- GUILLAUMIN, Colette, 1978b « Pratique du pouvoir et idée de nature. (II) Le discours de la Nature », Questions féministes, 3 : 5-28.
- HIGGINS, Ross, 1999 De la clandestinité à l’affirmation. Pour une histoire de la communauté gaie montréalaise. Montréal, Comeau & Nadeau.
- HIGGINS, Ross, et Line CHAMBERLAND, 1992 « Mixed Messages: Lesbians, Gay Men and the Yellow Press in Québec and Ontario during the 1950s and 1960s », dans Ian McKay (dir.), The Challenge of Modernity:A Reader on Post-Confederation Canada. Toronto, McGraw-Hill : 421-438.
- HILDEBRAN, Andrea Logan, 1998 « Genèse d’une communauté lesbienne : un récit des années 1970 », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 207-233.
- HUMM, Maggie, 1989 The Dictionary of Feminist Theory. New York, Harvester Wheatsheaf.
- LABELLE, Alexie, 2019a « Intersectional Praxis from Within and Without », dans Elizabeth Evans et Éléonore Lépinard (dir.), Intersectionality in Feminist and Queer Movements: Confronting Privileges. Londres, Routledge : 202-218.
- LABELLE, Alexie, 2019b « Why Participate? An Intersectional Analysis of LGBTQ People of Color Activism in Canada », Politics, Groups, and Identities, [En ligne], [doi.org/10.1080/21565503.2019.1674671] (22 novembre 2020).
- LAMOUREUX, Diane, 2009 « Reno(r/m)mer “ la ” lesbienne ou quand les lesbiennes étaient féministes », Genre, sexualité & société, 1, printemps, [En ligne], [journals.openedition.org /gss/635] (4 novembre 2020).
- LAMOUREUX, Diane, 2004 « Traces lesbiennes dans le paysage urbain montréalais », dans Christine Bard (dir.), Le genre des territoires : féminin, masculin, neutre. Angers, Presses de l’Université d’Angers : 217-226.
- LAMOUREUX, Diane, 2003 « De la tragédie à la rébellion : le lesbianisme à travers l’expérience du féminisme radical », Tumultes, 21/22 : 251-263.
- LAMOUREUX, Diane, 1998a « Agir sans “ nous ” », dans Diane Lamoureux (dir.), Les limites de l’identité sexuelle. Montréal, Les éditions du remue-ménage : 87-108.
- LAMOUREUX, Diane, 1998b « La question lesbienne dans le féminisme montréalais : un chassé-croisé », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 167-185.
- LAMOUREUX, Diane (dir.), 1986 Fragments et collages. Essai sur le féminisme québécois des années 70. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- LAURETIS, Teresa de, 1991 « Queer Theory. Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 3, 2 : iii-xviii.
- LAVOIE, Rébecca, 2014 « Pratiques artistiques féministes et queers en art vidéo : propositions politiques post?-identitaires », Recherches féministes, 27, 2 : 171-189.
- LEBRETON, Christelle, 2016 « Les rapports sociaux de sexe et le lesbianisme dans le Québec contemporain », Recherches féministes, 29, 1 : 199-214.
- MATHIEU, Nicole-Claude, 1989 « Identité sexuelle/sexuée/de sexe? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre », dans Anne-Marie Daune-Richard, Marie-Claude Hurtig et Marie-France Pichevin (dir.), Catégorisation de sexe et constructions scientifiques. Aix-en-Provence, Université de Provence : 109-147.
- MILLETT, Kate, 1971 La politique du mâle. Paris, Stock [1re éd. : 1970].
- MILLWARD, Liz, 2015 Making a Scene: Lesbians and Community across Canada, 1964-84. Vancouver, UBC Press.
- PEARLSTON, Karen, 2020 « “ Something More ” The State’s Place in the Bedrooms of Lesbian Nation », dans Christopher Dummitt et Christabelle Sethna (dir.), No Place for the State. The Origins and Legacies of the 1969 Omnibus Bill. Vancouver, UBC Press : 200-222.
- PHELAN, Shane, 1989 Identity Politics: Lesbian Feminism and the Limits to Community. Philadelphie, Temple University Press.
- PIDDUCK, Julianne, 2015 « Reading the Multimedia Archive Surrounding Montreal’s Post-war LGBTQ Bars: A Genealogical Return to Madame Arthur and Il était une fois dans l’Est », Quebec Studies, 60 : 35-65.
- PODMORE, Julie, 2015 « Contested Dyke Rights to the City: Montréal’s 2012 Dyke Marches in Time and Space », dans Kath Browne et Eduarda Ferreira (dir.), Lesbian Geographies. Gender, Place and Power. Farnham, Ashgate : 70-90.
- PODMORE, Julie, 2013 « Lesbians as Village “ Queers ”? The Transformation of Montréal’s Lesbian Nightlife in the 1990s », ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 12, 2 : 220-249.
- PODMORE, Julie, 2006 « “ Gone Underground ”? Lesbian Visibility and the Consolidation of Queer Space in Montréal », Social & Cultural Geography, 7, 4 : 595-625.
- PODMORE, Julie A., et Line CHAMBERLAND, 2015 « Entering the Urban Frame: Early Lesbian Activism and Public Space in Montréal », Journal of Lesbian Studies, 19, 2 : 192-211.
- PODMORE, Julie, et Manon TREMBLAY, 2015 « Lesbians, Second-wave Feminism and Gay Liberation », dans David Paternotte et Manon Tremblay (dir.), The Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism. Farham, Ashgate : 121-134.
- PUAR, Jasbir K., 2007 Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham, Duke University Press.
- RAVEL, Barbara, 2010 « Le sport comme espace favorable à l’expression de sexualités non traditionnelles : le cas de différents sports d’équipe féminins au Québec », Recherches féministes, 23, 2 : 109-125.
- REVILLARD, Anne, 2002 « L’identité lesbienne entre nature et construction », Revue du MAUSS, 19, 1 : 168-182.
- RICH, Adrienne, 1981 « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles Questions féministes, 1, mars : 15-43.
- ROSE, Ruth, 2000 « Les droits des lesbiennes au Québec et au Canada », Recherches féministes, 13, 1 : 69-92.
- ROSS, Becki L., 1995 The House that Jill Built: A Lesbian Nation in Formation. Toronto, University of Toronto Press.
- ROY, Carolle, 1985 Les lesbiennes et le féminisme. Montréal, Saint-Martin.
- RUBIN, Gayle, 2002 « Penser le sexe. Pour une théorie radicale de la politique de la sexualité », dans Gayle S. Rubin et Judith Butler (dir.), Marché au sexe. Paris, Epel : 78-92 [1re éd. : 1984] (traduction de l’américain par Éliane Sokol et Flora Bolter).
- SERANO, Julia, 2013 Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive. Berkeley, Seale Press.
- TREMBLAY, Manon, et Julie A. PODMORE, 2015 « Depuis toujours intersectionnels : relecture des mouvements lesbiens à Montréal, de 1970 aux années 2000 », Recherches féministes, 28, 2 : 101-120.
- TURCOTTE, Louise, 1998 « Itinéraire d’un courant politique : le lesbianisme radical au Québec », dans Irène Demczuk et Frank W. Remiggi (dir.), Sortir de l’ombre. Histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal. Montréal, VLB éditeur : 363-398.
- VACANTE, Jeffery, 2012 « Sexualité et identité nationale dans les années 1940 », dans Jean-Philippe Warren (dir.), Une histoire des sexualités au Québec au xxe siècle. Montréal, VLB éditeur : 87-100.
- WALTERS, Suzanna Danuta, 1996 « From Here to Queer: Radical Feminism, Postmodernism, and the Lesbian Menace (or, Why Can’t a Woman be more like a Fag?) », Signs: Journal of Women in Culture and Society, 21, 4 : 830-869.
- WARREN, Jean-Philippe, 2012 « Un parti pris sexuel : la sexualité dans la revue Parti pris », dans Jean-Philippe Warren (dir.), Une histoire des sexualités au Québec au xxe siècle. Montréal, VLB éditeur : 172-195.
- WATREMEZ, Vanessa, 2005 « La violence des femmes et des lesbiennes : analyses et enjeux politiques contemporains? », Recherches féministes, 18, 1 : 79-99.
- WITTIG, Monique, 1980 « The Straight Mind », Feminist Issues, 1, 1 : 103-111.
- ZIMMERMAN, Bonnie (dir.), 2012 Lesbian Histories and Cultures: An Encyclopedia. New York et Londres, Routledge.

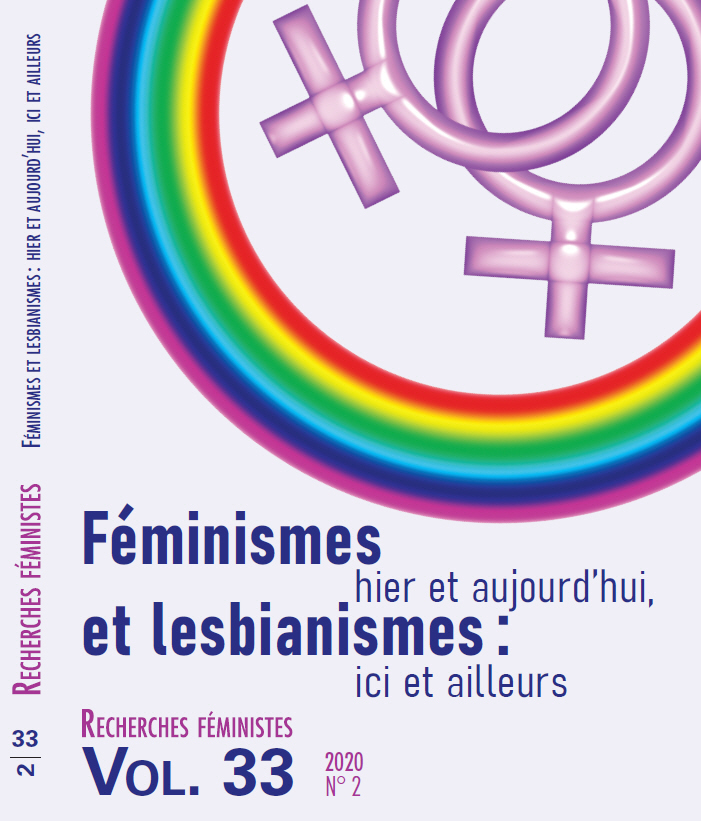
 10.7202/1034178ar
10.7202/1034178ar