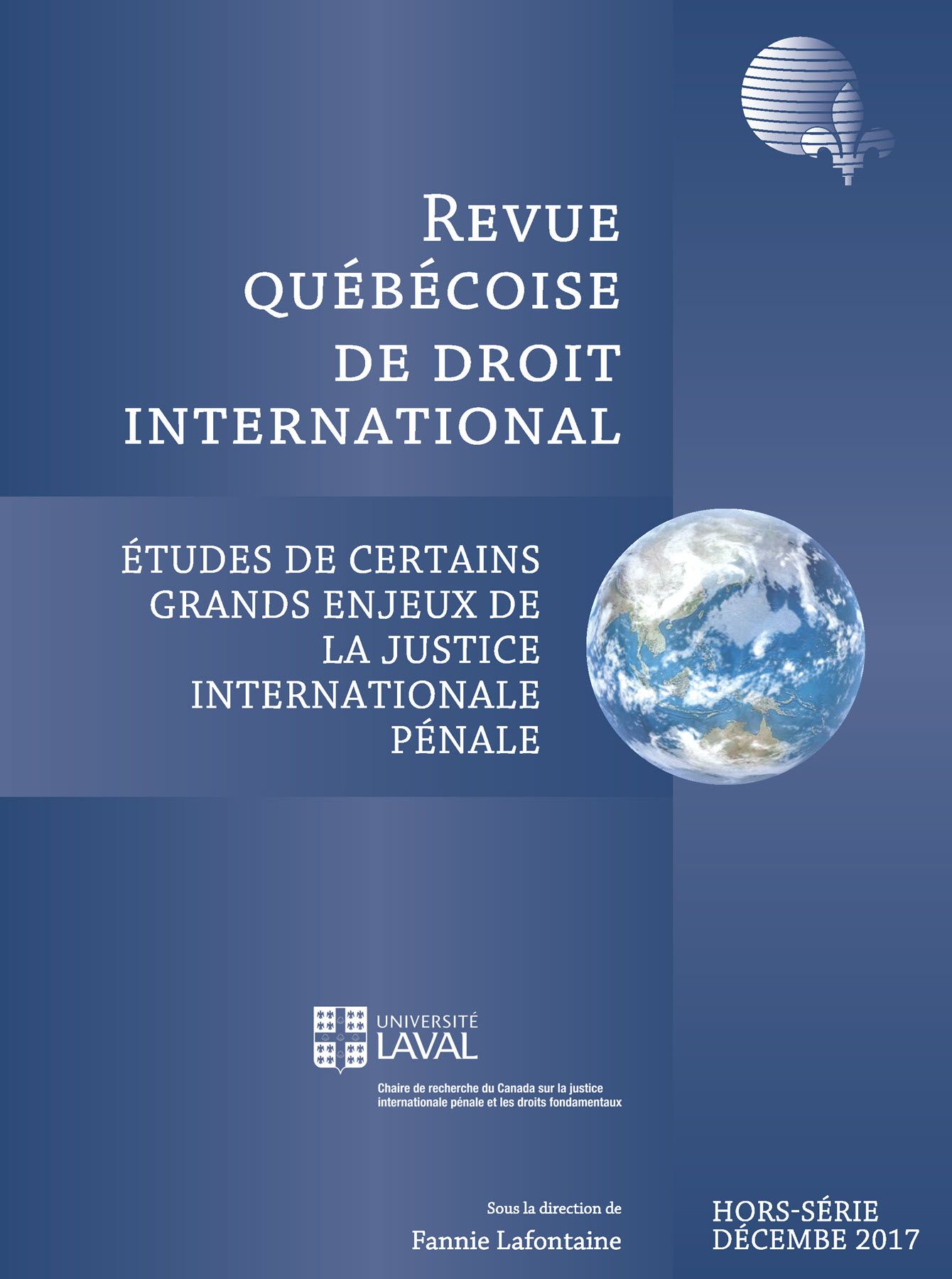Résumés
Résumé
Le 28 septembre 2016, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu son verdict dans l’affaire Le Procureur c Ahmad Al Faqi AlMahdi relative à la destruction des mausolées de Tombouctou. Ce procès, perçu comme un instant historique, était très attendu par les acteurs de la justice pénale internationale, car c’était la première fois que la Cour a connu, depuis sa création, une affaire concernant les violations des règles qui protègent le patrimoine culturel. Toutefois, la décision de la Cour, eu égard au moyen par lequel elle est intervenue, à savoir le plaidoyer de culpabilité, semble limiter l’apport du premier jugement sur les biens culturels selon certains observateurs. Cet article revient sur les différents points de vue et porte une analyse critique sur les enjeux du procès quant à l’avenir de la CPI, soit la signification du plaidoyer de culpabilité, son incidence sur le procès et sur les attentes des victimes, l’avenir de la répression des violations des règles de protection des biens culturels ainsi que la stratégie du bureau du procureur dans la gestion de ce dossier.
Abstract
On September 28th, 2016, the Trial Chamber of the International Criminal Court (ICC) delivered its verdict in the case The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, pertaining to the destruction of the mausoleums of Timbuktu. This trial, perceived as a historical moment, was long awaited by the actors of international criminal justice, considering it was the first time that the Court heard a case on violations of rules protecting cultural heritage. However, the decision of the Court, with respect to the means by which it was rendered, namely a guilty plea, appears to limit the contribution of the first decision on cultural property, according to some commentators. This article reconsiders the different perspectives and critically analyzes the challenges surrounding the trial as concerns the future of the ICC, namely the significance of the guilty plea, its effect on the trial and on the expectations of victims, the future of the repression of violations of the rules protecting cultural property, as well as the strategy of the Prosecutor’s office in the management of this issue.
Resumen
El 28 de septiembre de 2016, la cámara de primera instancia de la Corte penal internacional (CPI) pronunció su veredicto en El asunto contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi relativo a la destrucción de los mausoleos de Tombuctú. Este proceso, percibidocomo un instante histórico, eramuyesperadopor los actores de la justiciapenalinternacional, porque era la primera vez que la Corte conoció, desde su creación, un asunto que concernía a las violaciones de las reglas que protegen el patrimonio cultural. No obstante, la decisión de la Corte, en atención al medio por el cualintervino, al saber el alegato de culpabilidad, parecevenido para limitar la aportacióndel primer juicio sobre los bienes culturales segúnciertosobservadores. Este artículovuelve sobre los diferentespuntos de vista y porta un análisiscrítico de los retosdelproceso en cuanto al futuro de la CPI, es decir, el significadodelalegato de culpabilidad, su incidencia sobre el proceso y sobre las previsiones de las víctimas, el futuro de la represión de las violaciones de las reglas de protección de los bienes culturales asícomo la estrategia de la oficinadel fiscal en la gestión de este expediente.
Corps de l’article
Le 18 juillet 2012, soit douze ans après avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), le gouvernement du Mali a décidé de déférer la situation qui prévaut sur son territoire depuis le mois de janvier 2012 à la justice pénale internationale[1]. L’enquête du procureur a essentiellement visé à déterminer l’ensemble des crimes qui auraient été commis dans trois régions du nord, soit Gao, Kidal et Tombouctou, et, dans le sud, Bamako et Sévaré pour certains faits[2]. Or, la question des atteintes aux biens protégés, notamment les tombeaux de saints musulmans, a spécifiquement retenu l’attention du bureau du procureur de la CPI et de la communauté internationale[3]. Enquêtant déjà sur la situation du Mali depuis plusieurs mois, et ayant réuni plusieurs preuves au sujet de la destruction de ses biens culturels classés patrimoine mondial[4], la procureure[5] n’a pas eu du mal à convaincre le juge Cuno Tarfusser, siégeant en tant que juge unique désigné au stade de cette affaire, d’autoriser un mandat d’arrêt le 18 septembre 2015 pour l’arrestation d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi[6]. Son arrestation a été rendue possible grâce à la coopération exemplaire du Niger, où l’accusé était détenu, car poursuivi pour d’autres chefs relevant de la compétence du juge national[7]. Ainsi, Al Mahdi est arrivé de Tombouctou à la prison de Scheveningen de La Haye (Pays-Bas) le 25 septembre 2015.
Présenté au juge en audience publique lors de sa première comparution le mercredi 30 septembre 2015, l’accusé avait, lors de l’audience de confirmation des charges[8] et en prélude à son procès, manifesté son intention de plaider coupable[9]. C’est ainsi que, presque sans surprise, le 22 août 2016, à l’ouverture de son procès, Al Mahdi a plaidé coupable des crimes de guerre consistant en la destruction de monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou prévus à l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome[10]. En enregistrant un tel plaidoyer, il devient historiquement le premier accusé du tribunal à opérer un tel choix.
Condamnant à neuf années de prison le 28 septembre 2016, le procès de celui qu’on surnomme Abou Tourab a donné lieu à plusieurs commentaires, pour le moins contradictoires. Certains se satisfont d’une peine jugée juste, exemplaire et suffisante[11], tandis que d’autres s’attendaient à une peine très sévère[12]. Au-delà de la question même de la sentence, c’est aussi les questions comme l’aveu de culpabilité[13], la rapidité du procès[14] et le fait que certains auraient souhaité que l’accusé soit poursuivi et condamné également pour des crimes de sang, qui retiennent les critiques[15].
Tout ce qui précède amène à poser plusieurs questions. Les juges ont-ils réussi à poser les bases d’une répression effective des atteintes aux biens culturels au sein la CPI ? L’accord de plaidoyer de culpabilité visait-il à servir les intérêts de la poursuite ou à aider les victimes à connaître la vérité ? La peine prononcée visait-elle à châtier l’accusé ou à récompenser sa coopération avec le tribunal ? Le procureur avait-il la latitude de concilier sa stratégie en matière de poursuite avec les attentes « légitimes » des victimes ?
Le jugement Al Mahdi était attendu non seulement pour clarifier ces questionnements, mais surtout pour donner des réponses précises sur l’étendue de la protection des biens culturels ainsi que sur la place et l’apport du plaidoyer de culpabilité au sein de la justice pénale internationale.
Avec la décision du 28 septembre 2016, la CPI a-t-elle réussi à lever les équivoques sur ces problématiques et à satisfaire les attentes sur ces questionnements ?
Il est difficile de répondre péremptoirement à cette question vu l’accueil mitigé réservé à la décision au sein des différents acteurs de la justice pénale internationale. Si tout le monde s’était accordé sur l’historicité d’un procès dont le verdict était impatiemment attendu au-delà des murailles de Tombouctou (I), l’accord de plaidoyer de culpabilité entre le bureau du procureur et la défense semble, pour bon nombre, avoir dilué l’apport historique du jugement (II). Ainsi, il a été soutenu que le plaidoyer de culpabilité, ses conséquences et le choix des chefs d’accusation opérés par la CPI ont foncièrement contribué à relativiser la portée du jugement. Si ces points de vue sont défendables, il sera important dans l’analyse de les relativiser pour saisir l’ensemble du problème.
I. Un procès à enjeu historique ?
L’historicité du procès des mausolées tient sans doute à un enjeu principal. C’est la toute première fois que les juges de la CPI ont été dans l’obligation de répondre à une accusation portant sur les atteintes au patrimoine culturel (A). Toutefois, en décidant de s’attarder exclusivement sur le chef unique d’atteintes aux biens culturels, la position de la CPI a fait l’objet de plusieurs controverses (B).
A. La sanction des violations au patrimoine culturel
Le souci du droit international d’accorder une protection juridique aux biens culturels en cas de conflits armés est né bien avant la création des juridictions pénales internationales. Avant même que les États s’accordent pour mettre en place une justice pénale internationale permanente[16], ils avaient déjà pris conscience de la nécessité d’une solidarité contre les atteintes inutiles et injustifiées aux biens patrimoniaux[17]. Néanmoins, il a fallu véritablement attendre la condamnation des leaders du nazisme par les jugements de Nuremberg, pour voir se dessiner la volonté de faire assumer la responsabilité pénale individuelle aux « salauds de la terre »[18], qui, par leurs actes, s’attaquent à des patrimoines culturels considérés comme des biens de valeurs fondamentales, et qui transcendent les intérêts propres à chaque État.
Cela dit, la codification par plusieurs statuts de juridictions internationales[19], puis par le Statut de Rome[20], des dispositions réprimant la violation des normes protégeant les biens culturels en période de conflits armés est le résultat d’un lent progrès[21].Celui-ci a connu ses premières manifestations concrètes dans la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé[22]. Bien que la majorité de la doctrine n’ait pas manqué de critiquer les limites d’une telle codification[23], l’effet du temps et l’audace de la jurisprudence autorisent à reconnaître l’existence d’une règle coutumière protégeant les biens culturels[24], liant ainsi tous les États du monde, et ce, quel que soit le type de conflit en cause[25].
Si l’existence de cette règle coutumière a été timidement réaffirmée dans le jugement[26], les contours de l’analyse que fait la Cour, relativement à la protection de ces biens en période de conflits armés, soulèvent un certain nombre de questionnements sur lesquels il faut revenir. En fait, la Chambre de première instance a bien relevé que les biens visés par les attaques d’Al Mahdi et de son groupe étaient des biens consacrés à la religion et des monuments historiques[27]. Par conséquent, ils ne pouvaient pas constituer des objectifs militaires[28]. Malgré la justesse de cette exclusion, il nous semble que la Chambre appréhende mal le problème en faisant un mélange de genres entre les règles relatives à la conduite des hostilités[29] et celles qui concernent la protection des biens au pouvoir de l’ennemi[30]. En effet, l’interdiction d’attaquer des biens culturels qui ne sont pas des objectifs militaires, sauf en cas de nécessité militaire, s’applique dans le cadre de la conduite des hostilités [31]mettant en cause au moins deux parties adverses qui s’affrontent[32]. Au surplus, les attaques justifiées qui obéissent au critère de nécessité militaire effective répondent, la plupart du temps, à une riposte ou à une attaque de la partie adverse dans le cadre d’affrontement pour atteindre des objectifs militaires précis[33]. Or, dans le cas d’espèce, les éléments de preuve visés par la Cour elle-même révèlent qu’au moment de l’attaque des sites culturels protégés, le territoire de Tombouctou ainsi que sa population étaient sous le contrôle des groupes islamistes au moyen d’une administration locale[34]. Alors, la question qui se pose est celle de savoir si le droit des conflits armés permet — tel que l’insinue la Cour — d’appliquer les notions d’« attaque » et d’« objectifs militaires » en dehors d’actes commis dans la conduite des hostilités, et qui ne mettent en cause, au moment même où se déroulent les actes, aucune partie adverse belligérante? Autrement dit, étant donné que les biens culturels en question étaient au pouvoir, même de ceux qui les ont détruits, pouvaient-ils, dans cette situation précise, faire l’objet d’« attaque » et constituer pour eux-mêmes des « objectifs militaires » au sens du droit des conflits armés ? Le débat peut être relancé, mais la réponse évidemment nous parait négative[35].
La Cour aurait pu limiter et construire son raisonnement en invoquant simplement les règles relatives au traitement des personnes et des biens au pouvoir de l’ennemi[36] afin de trouver une protection appropriée pour les biens culturels dans le cadre d’un conflit armé non international (CANI)[37]. Cette astuce lui aurait évité de se lancer dans une longue démonstration dont la substance ci-après manque de convaincre :
[l] a Chambre considère que l’élément consistant à « diriger une attaque » inclut tous les actes de violence commis contre des biens protégés, et elle ne fera pas de distinction selon que ces actes auront été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé. Le Statut ne fait aucune distinction de ce type. Cela reflète la qualité spéciale reconnue aux biens religieux, culturels, historiques ou de nature similaire, et la Chambre ne devrait pas revenir sur cette qualité en opérant des distinctions qui ne ressortent pas du texte du Statut. Le droit international humanitaire protège en effet les biens culturels en tant que tels contre les crimes commis tant dans le cadre des combats qu’en dehors de ce cadre. […] Le Statut protège les personnes et les biens culturels de manières différentes. Les personnes sont protégées par nombre de dispositions distinctes, qui s’appliquent au cours des hostilités, après la prise de contrôle par un groupe armé, et contre divers types spécifiques de préjudices. En revanche, la seule disposition qui protège les biens culturels en tant que tels — et non de façon générique en tant que biens civils — dans les conflits armés ne présentant pas un caractère international, est l’article 8-2-e-iv, lequel ne fait aucune distinction entre les attaques menées lors de la conduite des hostilités et celles menées après[38].
Le fait pour les juges de se fonder sur le texte de la CPI pour conclure de façon sibylline que le Statut de Rome ne fait pas de distinction selon que les actes incriminés aient été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé[39], n’est pas convaincant. Il suffit de l’illustrer par le fait que la Cour, dans son jugement, est allée volontairement puiser dans plusieurs instruments historiques, notamment le Règlement de La Haye de 1907, pour interpréter l’origine de l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome[40]. Cette référence aux textes historiques est la preuve évidente que cette dernière disposition du Statut, sur laquelle la Cour fonde son raisonnement, ne peut à elle seule (alors même que la Chambre a sitôt admis qu’elle l’applique pour la première fois) servir de directive exclusive pour une interprétation absolue de la situation en cause[41].
Après ce bref survol de l’état du droit relatif à la protection des biens culturels, il convient de réitérer que la poursuite d’Al Mahdi, fondée sur le fait d’avoir attaqué des biens protégés tel que visé à l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome[42], ouvre une nouvelle aube pour la Cour, et plus encore, pour la communauté internationale tout entière. Si, comme le reconnaissent les juges eux-mêmes, « c’est la première affaire dans laquelle la Cour applique l’article 8-2-e-iv[43] », ce n’est malheureusement pas la première fois que l’humanité assiste dans l’impuissance totale à la dégradation du patrimoine culturel et spirituel des peuples. On peut citer plusieurs exemples à savoir le Cambodge[44] l’Afghanistan[45], territoires de l’ex-Yougoslavie[46], la Syrie[47]. Dans toutes ces situations, le défi de la protection des biens culturels a été mis à rude épreuve. Ainsi, la communauté internationale et les instruments juridiques ont longtemps montré leurs limites face à des actes délibérés visant à s’attaquer à des biens communs à l’humanité et représentant une valeur exceptionnelle et vitale pour tant de peuples[48]. À l’aune de ces précédents, on peut facilement déduire que la destruction des dix bâtiments à caractère religieux et historique sis à Tombouctou est loin d’être un cas isolé, mais s’inscrit dans un vaste mouvement de criminels de guerre, qui, après les précédents de l’ex-Yougoslavie, ont su tirer profit de la passivité des outils de répression internationale relative aux biens culturels. Le discours de la procureure de la CPI ne révèle pas autre chose, quand, en se réjouissant de l’exceptionnalité du procès Al Mahdi[49], elle est contrainte de remarquer que :
la période présente est marquée par une rage destructrice, où le patrimoine de l’humanité est l’objet de saccages répétés et planifiés, par des individus et groupes dont le but est d’éradiquer toute représentation du monde différente de la leur, en éliminant les éléments matériels qui sont au coeur de la vie de communauté dont l’altérité et les valeurs sont ainsi tout simplement niées et annihilées[50].
Le constat est donc clair. Le jugement de la CPI du 26 septembre 2016 jette une lumière crue sur la vulnérabilité des biens représentant l’histoire et la culture des peuples. Il pourrait aussi — gageons-le pour une fois encore — sonner un coup d’arrêt à l’impunité qui a trop longtemps servi de prétexte à un acharnement délibéré et sans motifs légitimes contre ces biens spécifiques.
Si, en décidant de juger Al Mahdi pour atteinte aux biens culturels, la CPI a certainement fait preuve d’audace, le choix de viser uniquement un seul chef a fait l’objet de vives controverses.
B. Des critiques quant au choix d’un chef d’accusation unique
Le processus judiciaire dans l’affaire Al Mahdi, on l’a dit, a soulevé non seulement l’ire de plusieurs observateurs[51], mais aussi des observations critiques de la part de certains auteurs[52]. Au-delà des réflexions d’ordre purement académique[53], le reproche a porté principalement sur le fait que la stratégie du procureur a conduit à écarter, du processus d’incrimination, les nombreuses atrocités commises dans la ville de Tombouctou, et dont il appert pour certains écrits[54] que la responsabilité d’Abou Tourab aurait dû être directement ou indirectement engagée.
Comme on peut facilement le deviner, le point d’achoppement de ces critiques est simple. D’une part, il est reproché au procureur de ne pas avoir prêté attention aux possibles violations pouvant tomber dans d’autres infractions associées à la catégorie des crimes de guerre, notamment les violations touchant à l’intégrité physique[55]. D’autre part, il y a, sans doute, les interrogations sur le choix du bureau du procureur, de refuser d’associer à la situation du Mali, et donc, dans le cas précis d’Al Mahdi, la possibilité que des crimes contre l’humanité aient été commis dans cette partie du Mali sous le contrôle des groupes armés, mais possiblement aussi, dans la partie sud du pays gouvernée par les autorités civiles[56].
Ces préoccupations sont d’autant plus légitimes que des organisations non gouvernementales (ONG), reconnues et travaillant sur le terrain, ont attiré l’attention de la communauté internationale sur de nombreuses atrocités commises se situant dans l’ordre des mauvais traitements graves, de tortures, de disparitions forcées et de meurtres, possiblement orchestrés de manière systématique et sur une certaine échelle[57]. De même, de nombreux faits ont été révélés et donnent à croire que des crimes de guerre autres que les violations de biens culturels (meurtres, viols, etc.) ont été commis par divers acteurs en présence, y compris la branche armée responsable dont Al Mahdi incarnait l’une des ramifications importantes[58].
Ces différentes attaques dirigées directement ou incidemment contre les civils, selon les cas, ont été confirmées à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité des Nations unies lui-même, dans plusieurs résolutions adoptées sur le Mali. Ainsi, dans la Résolution 2295, le Conseil condamne « les atteintes aux droits de l’homme et les actes de violence commis sur la personne de civils, notamment des femmes et des enfants, au Mali et dans la région, par des groupes terroristes[59] ». Dans une autre résolution, après avoir marqué sa grave préoccupation pour la menace de la paix, la sécurité et la stabilité des États de la région, le Conseil de sécurité énumère puis condamne tous les crimes qui sont censés avoir été commis dans la région nord du Mali en ces termes :
condamnant fortement toutes les atteintes aux droits de l’homme commises dans le nord du Mali par des rebelles armés, des terroristes et d’autres groupes extrémistes, notamment celles qui prennent la forme de violences infligées à des civils et particulièrement à des femmes et à des enfants, de meurtres, de prise d’otages, de pillage, de vol, de destruction de sites culturels et religieux et de recrutement d’enfants soldats[60].
Et le Conseil de « réaffirm [er] que certains de ces actes peuvent constituer des crimes au regard du Statut de Rome et que ceux qui s’en rendent coupables doivent absolument en répondre[61] ». D’autres institutions, notamment le Conseil des droits de l’homme des Nations unies viennent corroborer, dans plusieurs rapports[62], l’existence d’atteintes graves à l’intégrité physique dans les zones contrôlées, notamment des atteintes au droit à la vie, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires ainsi que des violences sexuelles, incluant le viol, parfois collectif, l’esclavage sexuel et le mariage forcé[63].
On le voit, tous ces indices viennent appuyer les critiques, parfois acerbes, et donnent l’impression que la justice pénale internationale a éludé les nombreuses souffrances physiques que les groupes djihadistes ont fait subir à la population de Tombouctou. Le titre d’un journal, qui reprenait en substance les arguments de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), « Les crimes oubliés des djihadistes de Tombouctou[64] », est révélateur du sentiment qu’une prime à l’impunité a été octroyée dans le cadre de ce procès, en ignorance totale de l’ampleur des violations aux droits de l’homme tombant dans la catégorie des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l’humanité[65].
Il faut à ce stade s’interroger sur la question de savoir si le choix du bureau du procureur, d’instruire son acte d’accusation contre Al Mahdi uniquement en direction des biens culturels protégés, ne répond pas à une certaine stratégie du poursuivant, bien pensée par ailleurs, et ce, malgré les critiques qu’on a pu voir[66]. En effet, on peut bien se demander si l’historicité du procès, attaché en grande partie à l’idée de la destruction du patrimoine culturel, n’aurait pas perdu sa résonnance [67]dans le cas où l’accusé aurait aussi été reproché d’autres crimes, liés notamment à des exactions contre les personnes physiques protégées. En tout état de cause, même si des critiques sont utiles pour s’élever contre une stratégie ou une autre en matière de poursuite criminelle, il est souvent mal aisé d’aller plus loin dans le débat, au grand risque de créer un ordre hiérarchique, parfois inutile, dans l’élan de la victimation[68].
Il est certes vrai, les nombreuses atteintes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire (DIH) constatées à travers le monde, et qui portent une atteinte physique grave aux personnes protégées, sont à réprouver en tout temps et en tout lieu par les juridictions pénales internationales. Cependant, l’actualité internationale qui nous a fait découvrir les politiques de « nettoyage ethnique » en ex-Yougoslavie et le génocide de Srebrenica[69], est aussi fraiche dans la mémoire collective pour mettre en garde sur le fait que : « les attaques délibérées perpétrées contre des biens culturels constituent souvent des signes précurseurs des atteintes les plus ignobles portées [directement] contre une population » et son intégrité physique[70]. La poursuite n’a donc pas tort d’ajouter que :
les attaques perpétrées contre des monuments historiques et des bâtiments consacrés à la religion constituent de fait des attaques contre les personnes qui portent ces biens corporels dans leur coeur et qui les considèrent comme une partie de leur identité culturelle[71].
Sur ce dernier point, il y a lieu de mentionner que la manière dont la Chambre de première instance s’y est prise pour distinguer le degré de gravité entre les crimes contre les personnes et ceux liés à l’atteinte des biens n’était pas nécessaire[72], car elle risque de révéler une position officielle aussi minimaliste que relative[73], qui donne de précieux arguments à ceux qui défient ces biens protégés, qui pourtant, constituent la raison même de vivre de certains peuples[74]. En effet, la Chambre de première instance écrit de manière péremptoire ceci : « [elle est d’avis que, bien que fondamentalement graves, les crimes contre les biens le sont généralement moins que les crimes contre les personnes[75] ». La Cour a suivi par-là les arguments de la défense qui l’invitait indirectement à minorer les crimes liés aux atteintes contre les biens, comparés dans leur échelle de gravité avec les crimes contre les personnes. La défense invoque à l’appui une pratique des « décisions des cours et tribunaux internationaux », en la matière, mais contre toute attente, elle ne mentionne qu’une seule décision du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)[76]. Quelle que soit notre position sur la hiérarchisation des crimes[77], cet article n’est pas le lieu approprié pour soulever des controverses sur cette question. Toutefois, il est important de mettre en garde contre la formule péremptoire utilisée par la Cour pour opérer sa démonstration de la hiérarchisation des crimes. Il nous semble que l’importance de la question traitée et de la spécificité du crime en cause, ainsi que le contexte international de leur commission, nécessitait que la Chambre s’y attarde plus pour convaincre en l’espèce de la pertinence d’une telle hiérarchisation et ses conséquences directes sur le quantum de la peine suggérée ou envisagée. Ce qui n’a pas été le cas.
Si malgré les critiques et les controverses ci-dessus, la reconnaissance de la responsabilité d’Al Mahdi pour violations des biens culturels garde son caractère exceptionnel, il faut vérifier si l’accord de plaidoyer de culpabilité par lequel la culpabilité a été établie, n’est pas venu atténuer finalement la portée du jugement.
II. Un jugement aux apports limités ?
Certains observateurs ont estimé que l’accord sur le plaidoyer de culpabilité entre la défense et le bureau du procureur a atténué la portée globale du jugement rendu, car il n’a pas permis d’atteindre les effets escomptés. Pour vérifier ce postulat, il sied de s’attarder d’abord sur les contours du plaidoyer de culpabilité (A) avant d’analyser les critiques relatives aux conséquences du plaidoyer de culpabilité sur le jugement lui-même (B).
A. Le plaidoyer de culpabilité de l’accusé
Inspiré principalement du guilty plea de la common law[78], le plaidoyer de culpabilité est une procédure par le biais de laquelle l’accusé accepte volontairement de se déclarer coupable vis-à-vis d’un ou de plusieurs chefs d’accusation. En contrepartie de cette reconnaissance, il espère que le procureur modifie son acte d’accusation par l’abandon de certains chefs, et/ou, qu’il accepte l’imposition d’une peine jugée clémente par l’accusé[79]. Le mot signifie que le plaidoyer de culpabilité est une négociation, laquelle est la résultante directe d’un accord conclu entre la Défense et le bureau du procureur. À l’origine du Statut de Rome, les auteurs ont rechigné à faire de cette procédure une sorte de « deal » entre les deux parties[80], mais dans la pratique des tribunaux nationaux et même des tribunaux ad hoc, ce processus s’apparente au contraire à une sorte de « marchandage judiciaire[81] » hors cour, conduisant à des concessions et avantages mutuels[82] entre l’accusation et la défense. Il semble difficile à la procédure devant de la CPI d’échapper à cette religion. On le voit, cette pratique de la justice pénale internationale est exceptionnelle. Emprunté des systèmes nationaux de common law, son mérite principal est de permettre aux parties de s’entendre pour terminer une affaire pénale par un règlement définitif, et chacune y tire son profit[83]. Cependant, le plaidoyer de culpabilité n’apparaissait pas dans les premiers statuts des juridictions pénales internationales[84]. Toutefois, les auteurs du Statut de Rome ont eu le mérite de le codifier en esquissant clairement les modalités de la procédure[85]. Ainsi, selon le Statut de Rome, les juges ont l’obligation de s’assurer à l’ouverture du procès que l’accusé comprenne les charges qui fondent son inculpation[86], et qu’il a la possibilité de plaider coupable ou non des accusations qui pèsent sur lui[87].
Comme on le voit, la procédure de plaidoyer de culpabilité est bien encadrée par le Statut de Rome. C’est un processus libre et volontaire auquel l’accusé doit adhérer sans y être contraint que ce soit au plan psychologique ou physique. Il est important que l’accusé comprenne et mesure toutes les conséquences d’une telle procédure avant de s’y engager[88], car, dès que la Cour est convaincue que les conditions du plaidoyer de culpabilité sont réunies, « elle peut reconnaître [directement] l’accusé coupable de ce crime[89] ». Dans la cause qui nous occupe, dès le 18 février 2016, les parties sont parvenues à un accord sur l’aveu de culpabilité[90] concernant la charge unique, selon laquelle Al Mahdi serait responsable du crime de guerre consistant à attaquer des biens protégés, tel que visé à l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome[91]. Dès l’obtention et l’acceptation de cet aveu, il n’y avait plus de place pour un débat véritablement contradictoire[92], et il fallait maintenant vérifier l’étendue de cette responsabilité et les conséquences sentencielles qui en découlaient. Bien que la Cour ne soit pas liée par l’accord de plaidoyer de culpabilité conclu[93], le jugement Al Mahdi témoigne du fait que les juges de La Haye ont largement tenu compte des propositions des parties tant au niveau des chefs retenus[94] que de la peine à imposer[95]. Cela découle d’une certaine logique, car la Chambre a pris le soin de s’assurer que les éléments de preuves qui lui ont été présentés par les parties permettaient d’établir les faits et de corroborer hors de tout doute raisonnable la responsabilité de l’accusé dans leur commission directe[96]. Qui plus est, au vu des éléments et des faits, elle n’a pas jugé nécessaire d’exiger de l’accusation « de présenter des éléments de preuve supplémentaires[97] ».
En acceptant le plaidoyer de culpabilité d’Al Mahdi et en infligeant une peine de neuf ans à l’accusé, peine jugée néanmoins trop clémente par les représentants légaux des victimes et certains acteurs[98], les juges de la CPI ont sans doute fait preuve de réalisme judiciaire, jugeant tous les avantages que la justice pénale internationale pourrait tirer de ce plaidoyer[99]. En effet, les nombreuses circonstances atténuantes dont a bénéficié l’accusé[100] peuvent être jugées incompréhensibles par certains[101], mais elles envoient certainement un message à ses détracteurs pour insinuer que la justice pénale n’est pas que répressive. Ainsi, à l’image des ordres judiciaires nationaux, elle s’inscrit, malgré quelques hésitations, dans la dynamique de réhabilitation de l’accusé lorsque celui-ci accepte de se plier à un véritable acte comminatoire[102]. D’ailleurs, le fait pour les juges de retenir les circonstances atténuantes tient à plusieurs facteurs sur lesquels il convient de s’arrêter.
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que l’attitude coopérante d’Al Mahdi, qui a reconnu sa responsabilité dans la destruction des mausolées, a permis d’escamoter une bonne partie des procédures prévues par les Statuts pour l’organisation normale d’un procès. Ainsi qu’il a été déjà dit, l’acceptation du plaidoyer a permis de mettre un terme au débat judiciaire sur la culpabilité de l’accusé, la Cour se limitant dès lors à entendre les parties sur la détermination de la peine.[103]Ayant manifesté très rapidement son intention de plaider coupable, l’accusé a permis à la Cour, à l’étape du procès, de rendre son jugement en moins de deux mois, une réalisation hautement significative, qui permet de faire l’économie de ressources et de temps considérables[104], à l’heure même où la question des ressources financières se pose avec acuité non seulement pour la CPI, mais aussi pour l’ensemble de ses États contributeurs[105]. Ensuite, Al Mahdi a été aussi jugé en tant que coauteur dans la destruction des mausolées[106]. Cela signifie dans le jargon de la justice pénale internationale, que l’accusé a participé au crime qu’on lui reproche, en apportant une contribution substantielle à l’exécution d’un plan criminel commun[107]. De ce fait, et étant donné qu’il est en ce moment le seul membre de cette coaction à être traduit devant la CPI, le témoignage du désormais criminel de guerre sera une source crédible d’éléments de preuve pour aider la poursuite à rechercher et à traduire en justice, tous les présumés auteurs encore en fuite, de cette coaction criminelle, visant à s’attaquer à des biens hautement symboliques pour l’humanité.
Ensuite, le fait que les accusés plaident rarement coupables devant la CPI est un facteur atténuant qui a guidé le raisonnement des juges. En effet, contrairement aux tribunaux pénaux internationaux où le plea guilty était devenu un instrument incontournable[108], les accusés de la CPI sont réticents à admettre en tout ou en partie leur responsabilité dans les crimes commis et pour lesquels ils sont accusés. En plaidant coupable aux actes et aux crimes qui lui sont reprochés, Abou Tourab vient sans doute d’écrire une nouvelle page des relations entre la défense et le bureau du procureur, en tout cas, pour les futurs candidats au départ pour Scheveningen[109]. Il faut ainsi espérer qu’un tabou soit levé, et qu’après ce jugement historique, la pratique signe une continuité dans ce sens.
Il n’est donc pas hasardeux de suggérer aux équipes de la défense de jouer le rôle de conseil neutre et détaché, en expliquant largement à leur client le rôle bénéfique qui résulterait d’une reconnaissance précoce de responsabilité pénale. Il ne s’agit pas ici, bien entendu, de suggérer aux avocats de se substituer à leur client dans l’expression de ce choix crucial[110]. C’est d’ailleurs dans les limites de la conception des auteurs Proulx et Layton, tirée du contexte du droit pénal canadien, qu’il faut se situer pour comprendre notre position :
Plea discussions, if properly conducted by defence counsel, thus involve respecting the client’s freedom of choice in entering a plea, all the while fulfilling the lawyer’s professional obligation to provide the client with competent advice » [...] « Counsel walks a fine line in undertaking plea discussions and advising the client. He or she must avoid adopting the role of the “player” who dominates the client and imposes a course of action without much regards for the client’s wishes. Nor should counsel act as a “double agent” who facilitates “assembly line justice” while appearing to help his or her clients [...] the lawyer’s duty is to support the client’s freedom of choice through the provision of quality legal advice[111].
Si l’idée selon laquelle l’accord de plaidoyer de culpabilité sert les intérêts de la justice est partagée par plusieurs auteurs, son application dans le jugement Al Mahdi a soulevé une controverse qui influe sans doute sur l’apport de l’ensemble de la décision.
B. Des critiques sur le contenu du jugement
Si le caractère historique du plaidoyer de culpabilité enregistré par Al Mahdi a été bien salué par le bureau du procureur[112], et même par les juges présidant l’audience du procès[113], le processus judiciaire a révélé que les victimes et plusieurs observateurs n’ont pas partagé le même enthousiasme. Les propos tenus par le représentant légal des victimes lors du second jour du procès sont suffisamment éloquents pour montrer la différence d’esprit :
les victimes ont certainement raison de douter de la sincérité de l’aveu et des remords exprimés par l’accusé. […] Certaines pensent même que l’aveu de culpabilité ne sert que les responsables de ces crimes. J’en témoigne parce que j’en reviens. Toutes les victimes sont remontées. Le pardon… Le pardon est prononcé au mauvais endroit, selon leurs dires. Pourquoi devant la Cour ? Il fallait avant. Le pardon est prononcé tardivement au stade du procès[114].
Et cette dernière observation de Maître Kassongo résume bien la position tranchée des victimes : « [l] a réalité est que les victimes prennent mal l’aveu de monsieur Al Mahdi[115] ». On constate bien de la répulsion, mais aussi de la confrontation idéologique qui se dégagent de ces dernières déclarations. En effet, la véritable pierre d’achoppement entre la poursuite et les victimes dans une procédure de plaidoyer de culpabilité réside dans plusieurs facteurs qu’il convient d’expliquer pour mieux situer le débat. Le premier facteur tient à la nature même de l’accord de plaidoyer de culpabilité au sein des instances pénales internationales, qui, comme précédemment mentionné, se déroule intrinsèquement entre la défense et le bureau du procureur. Même si la situation des victimes, quant à l’ampleur de leur participation dans les procédures pénales internationales, s’est largement améliorée avec l’avènement de la CPI et la mise en place des tribunaux hybrides[116], ainsi que des décisions audacieuses prises par le juge international dans ce sens[117], force est de reconnaître qu’en matière de plaidoyer de culpabilité, les victimes sont encore pratiquement absentes du processus[118] et leur point de vue n’est pas déterminant pour influer sur la conclusion d’un tel « pacte ». Le second facteur est le point de vue qui donnerait aux victimes l’impression que le plaidoyer de culpabilité est en contradiction totale avec la mission des juridictions pénales internationales. Certains pourraient à tort insinuer qu’elles ont été créées essentiellement pour châtier les coupables, afin de rendre exclusivement justice aux victimes de violations massives et systématiques des droits de l’homme et du DIH[119].
Si cette conception de la justice pénale internationale peut à première vue paraitre vraie, il y a lieu de vite rappeler que la nécessité d’intégrer le plaidoyer de culpabilité dans les procédures pénales internationales a fait l’objet de longues tractations au niveau des participants à l’élaboration du Statut de Rome avant qu’il soit codifié[120]. Une fois consacrés dans le texte fondateur, les accords de plaidoyer de culpabilité font désormais partie intégrante de l’ensemble du processus judiciaire, et doivent être acceptés comme tels, à moins d’en appeler à une remise en cause de l’équilibre général du Statut de Rome. Si les appels à reformer les plaidoyers de culpabilité ne peuvent être totalement ignorés[121], les critiques qui semblent insinuer que la philosophie du plaidoyer de culpabilité contredit la mission protectrice du tribunal due aux victimes [122]risquent, à force d’insister, d’en appeler à l’avènement d’une justice partiale en oubliant vite que la véritable attitude, qu’est censée incarner la justice pénale permanente, est celle d’être juste et exemplaire, y compris dans la prise en compte effective des droits des accusés[123], dont le plaider coupable, lorsqu’il est parfaitement mené, constitue une des incarnations.
Un autre facteur de réprobation des victimes face au plaidoyer de culpabilité d’Al Mahdi réside — et il a été déjà souligné — dans le fait que l’enregistrement, puis l’acceptation du plaidoyer par les juges n’ont pas réellement permis aux victimes de comprendre les circonstances qui ont conduit à l’attaque, puis à la destruction du patrimoine culturel de Tombouctou. Le témoignage d’un habitant de cette ville, interrogé par RFI à la fin des audiences du procès, pourrait résumer la perception que se font certains observateurs qui estiment que les faits et les évènements ayant donné lieu aux crimes à Tombouctou ont été escamotés par l’accord de plaidoyer conclu entre l’accusation et la défense. La teneur de la déclaration se résume comme suit :
[s] i on peut nous expliquer un peu plus, qu’on puisse comprendre. Bien. Mais finir le procès, comme ça, aussi vite. Les accords, c’était quoi ? On aimerait bien en savoir un peu plus. J’aimerai bien comprendre pourquoi il s’est retrouvé dans al-Qaïda et quelle est la raison exacte, et pourquoi ils ont fait tout ce qu’ils ont fait[124].
Comme relevé plus haut, ce dernier constat est effectivement l’une des conséquences directes du plaidoyer de culpabilité sur l’issue normale du procès. En acceptant le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, les juges écourtent par-là même le débat et donc la confrontation des parties[125], comme ce fut le cas lors de ce procès[126]. Il n’y a donc pas de véritable procès[127] au sens qui permet d’expliquer dans les détails toutes les circonstances qui ont entrainé ou concouru à la commission des atrocités. Mieux, cette simplification de la procédure profite exceptionnellement à l’accusé d’autant plus que, l’absence de témoignage empêche la contradiction et évite de connaître réellement tous les motifs de ses agissements[128]. De ce fait, il atténue, quoi qu’on dise, l’étendue de sa responsabilité pénale individuelle[129]. Il en résulte une cascade de récriminations des victimes vis-à-vis du plaidoyer de culpabilité. En plus du fait qu’elles n’ont quasiment pas droit à la parole dans cette procédure[130], au total, cette méfiance s’explique clairement dans le fait que le plaidoyer de culpabilité ne favorise pas pleinement la manifestation de la vérité[131]. Or pour les victimes, cet axiome constitue le point de départ pour la reconstitution exacte des faits, préalable à toute idée de justice[132]. Le tout visant à empêcher — du moins théoriquement — que ce genre d’évènement ne se reproduise[133].
On le constate, le fond du problème qui sous-tend le débat sur la procédure du plaidoyer de culpabilité est la cause, du moins la compassion face au sort des victimes[134]. L’idée étant d’arriver à la satisfaction des victimes des crimes internationaux[135]. De là, une question plus fondamentale, mais qui dépasse sans doute le cadre de cette analyse se pose : bien qu’il existe de « réels espoirs[136] » pour les victimes depuis la création de la CPI, le droit international pénal peut-il vraiment répondre aux besoins légitimes des victimes des crimes internationaux [137]? Le débat est ouvert.
Revenons précisément au jugement Al Mahdi pour dire que la plus importante critique faite à la décision de la Chambre de première instance est probablement le quantum de la peine attachée aux crimes commis par Abou Tourab[138]. On sait maintenant que l’accusation et la défense ne semblent pas avoir eu trop de difficulté pour s’entendre sur la peine à infliger[139]. Les observations de l’accusation, conformément à l’accord de plaidoyer de culpabilité transmis au tribunal, relèvent, d’une part, une proposition de peine allant de neuf à onze années de prison[140], et, d’autre part, un engagement à ne pas interjeter appel si la sentence prononcée par le tribunal se situe dans les proportions visées par l’accord de plaidoyer de culpabilité[141]. Même si la Chambre a estimé que le crime pour lequel Al Mahdi est accusé est d’une gravité considérable[142], elle n’a retenu, contrairement à l’appel des victimes[143], aucune circonstance aggravante[144], susceptible d’influer sur la gravité de la peine. Au contraire, la Cour après avoir retenu cinq circonstances atténuantes[145], est restée dans la fourchette de peine proposée par les deux parties, en condamnant Al Mahdi à neuf ans de prison[146]. Comme il a été dit plus haut, aussi bien du côté de la poursuite que de la défense, aucune des parties n’a trouvé utile de demander une révision de la sentence. Bien au contraire, les deux parties s’accordent à y voir une peine proportionnée et acceptable, reflétant la nature et la gravité du crime commis[147]. Les victimes par contre, on l’a dit, ainsi que d’autres observateurs, jugent la peine trop clémente et en deçà de la gravité des crimes commis. La réaction du maire adjoint de Tombouctou va dans ce sens :
[c]ette peine, elle n’est pas à la hauteur du forfait. Comme vous le savez, Tombouctou, c’est une ville de culture. Or la culture humanise l’homme. C’est ancré dans le coeur des Tombouctiens que le pardon existe. Mais en toute chose il faut que l’homme soit puni à l’aune de ce qu’il a commis[148].
Quant à la FIDH et d’autres organisations, elles ont dénoncé après le prononcé de la sentence « [u] ne victoire au goût d’inachevé[149] », pour le fait que la peine prononcée par les juges n’ait pas pris en compte les autres crimes commis, notamment les infractions contre les personnes ainsi qu’il a été développé ci-dessus[150].
À l’examen attentif du débat quant à la minoration de la sentence infligée, on ne peut qu’accorder un poids relatif à la désapprobation exprimée par les parties qui se sentent lésées par le prononcé de la peine. En effet, il semble important de rappeler, une fois encore, que la diminution de la sentence est une conséquence logique d’un accord de plaidoyer de culpabilité si les parties se sont entendues que l’étendue de l’accord concernera ce dernier élément[151]. Tel a été le cas dans le procès Al Mahdi[152]. Il est certes difficile et choquant pour les victimes d’admettre cette occurrence, et de comprendre ce type d’échange qui s’apparente à un mauvais marché largement désavantageux pour elles ; mais, c’est ainsi que les États parties au Statut de Rome sont arrivés au difficile compromis[153], en épousant ce créneau dans lequel se règle la plupart des affaires criminelles en droit national, surtout dans les États de tradition common law[154]. Néanmoins, et comme déjà souligné, si le juge n’est pas tenu d’entériner cette entente commune, il serait néanmoins incompréhensible qu’il s’en écarte, surtout s’il appert qu’elle est raisonnable et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice[155]. En décidant de rester dans les limites de la suggestion commune présentée par l’accusation et la défense dans l’accord de plaidoyer de culpabilité, les juges de la Chambre de première instance ont opéré eux-mêmes leur propre test et ont, sans aucun doute, jugé que la peine suggérée par les parties se situait dans les limites de l’acceptable et de la raisonnabilité. Pour avoir tranché ainsi, la Cour a rendu une décision souveraine que ni la « stature » ou le « péché mortel » de Al Mahdi, ni la déférence que nous avons l’obligation d’avoir vis-à-vis des victimes des crimes ignobles ne peuvent infléchir, car « justicia omnibus » y compris pour les damnés de la justice.
***
La procédure dans l’affaire Al Mahdi a été perçue comme « un pas de géant », un moment historique pour la justice pénale permanente incarnée par la CPI. En une seule affaire découlant du désastre qui règne dans la situation au nord du Mali depuis 2012, la Cour de La Haye aura gagné le pari de réussir deux réalisations majeures : d’abord, celle d’avoir rendu opérationnelle la répression effective des crimes relatifs aux biens culturels prévue dans son statut fondateur[156] ; ensuite, celle d’être parvenue à activer pour la première fois de son existence la procédure du plaidoyer de culpabilité prévu par le Statut de Rome et les règlements de preuve et de procédure. Néanmoins, le procès de Tombouctou, qui a connu son apothéose par le rendu du jugement de la Chambre de première instance de la CPI le 28 septembre 2016, a donné lieu à des appréciations aussi réservées que contradictoires. Si, comme on l’a vu, l’historicité du procès de l’ancien responsable de la brigade islamique des moeurs d’Ansar Dine a été relevée et saluée, aussi bien par la communauté internationale que par toutes les parties impliquées dans la procédure, le choix des chefs d’accusation par la poursuite, l’accord de plaidoyer de culpabilité conclu entre l’accusation et la défense, ainsi que la peine infligée au désormais criminel de guerre, ont été accueillis différemment par les parties et ont mis fin à l’enthousiasme unanime qui a suivi l’annonce de l’arrestation d’Al Mahdi.
Le fait que la poursuite ait limité la responsabilité de l’accusé essentiellement à la commission des crimes relatifs aux biens culturels, sans prendre en compte les crimes contre les personnes, et le fait que les victimes et certains observateurs aient perçu le plaidoyer de culpabilité comme une mauvaise transaction ayant entrainé conséquemment une réduction de la peine de l’accusé, est, en substance, la principale pierre d’achoppement ayant conduit de l’avis des victimes et certains observateurs à limiter la portée historique de ce jugement
En tout état de cause, les critiques qui ont été portées de part et d’autre concernant ce jugement sont utiles et démontrent indubitablement l’inexistence d’une vision harmonisée des acteurs de la justice pénale internationale qui — quoi que poursuivant les mêmes finalités de répression des crimes internationaux — sont loin d’être sur le même fil quant aux voies et moyens appropriés pour y parvenir.
De notre point de vue, le jugement Al Mahdi est une avancée significative sur plusieurs points de droit, mais il est aussi teinté de nombreuses imperfections qui ont été révélées dans l’analyse. Néanmoins, en l’absence d’appel, le jugement est devenu définitif et le verdict s’impose à tous ; l’effort doit désormais être conjugué et fusionné dans le sens de rechercher et punir sans exception, tous les autres auteurs de crimes répertoriés dans la situation du Mali depuis 2012. Gageons que la précieuse coopération d’Al Mahdi lors de son procès et le témoignage fourni au bureau du procureur dans le cadre de l’accord de plaidoyer de culpabilité permettront d’atteindre pleinement cet objectif. Il faut surtout espérer que le procès Al Mahdi ait un double effet didactique : d’abord, qu’il renforce désormais la protection du patrimoine culturel mondial et ouvre définitivement la voie à une répression permanente des atteintes faites à cette richesse des peuples ; ensuite, qu’il encourage les futurs accusés de la CPI qui le désirent d’enregistrer spontanément, mais librement et volontairement, des plaidoyers de culpabilité s’ils estiment que leur responsabilité pénale individuelle est de toute évidence établie dans les faits et les accusations qui sont portés contre eux.
Au-delà de ces souhaits prospectifs, une conclusion définitive s’impose : la première décision de la CPI qui a jugé la portée juridique des crimes aux biens culturels et la valeur du plaidoyer de culpabilité d’Al Mahdi constitue également un examen test pour la justice pénale internationale permanente. Mise dans un contexte historique et en relation avec les nombreux plaidoyers de culpabilité enregistrés sous l’ère des tribunaux ad hoc[157], il devient tout de même certain que les acteurs de la justice pénale internationale ne pourront plus, malgré tout, faire l’économie des voix criticistes qui, en doctrine[158] comme en jurisprudence[159], s’élèvent pour appeler à une réflexion sur l’efficience et la raison d’être des plaidoyers de culpabilité.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Le Mali a procédé à la signature du Statut de Rome le 17 juillet 1998. Il a été le quinzième État à avoir déposé son instrument de ratification du Statut de Rome, le 16 août 2000; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].
-
[2]
Voir « Situations Under Investigation : Mali » (26 novembre 2016), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/Pages/Situations.aspx?ln=fr>.
-
[3]
Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Situation au Mali :Rapport établi au titre de l’article 53-1, 16 janvier 2013, aux pp 32–34, en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/itemsDocuments/SASMaliRapportPublicArticle53_1FRA16Jan2013.pdf> [Rapport établi au titre de l’article 53-1]; Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à l'ouverture du procès dans l'affaire contre M. Ahmad Al-Faqi Al Mahdi, (22 août 2016) (Cour pénale internationale, Bureau du Procureur), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-al-mahdi-160822&ln=fr>[Déclaration du Procureur de la CPI]; « Déclaration solennelle sur la situation au Mali », Conférence de l’Union Africaine, Assembly/AU/Decl. 1-4 (XIX), (2012) au para 5; Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session, Doc off UNESCO NU, 36esess, Doc NU WHC-12/36.COM/19 (2012) aux pp 151–53.
-
[4]
Rapport établi au titre de l’article 53-1, supra note3 aux pp 32, 33 et 36.
-
[5]
La procureure, la poursuite, le bureau du procureur et l’accusation désignent la même chose, à savoir l’institution du procureur de la CPI, et seront donc utilisés indistinctement dans ce texte.
-
[6]
Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi (18 septembre 2015) (Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int> [Al Mahdi, Mandat].
-
[7]
Ibid à la p 6 au para 14.
-
[8]
L’audience de confirmation des charges a débuté le 1er mars 2016. Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Audience de confirmation des charges, huis clos, Transcription (12 mai 2016) (Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I) [Al Mahdi, Audience]; Voir aussi Marie Nicolas, « Le procès de Tombouctou : un tournant historique » (2016) Revue des droits de l'homme 1 à la p 6, en ligne : Open Edition : <journals.openedition.org/> [Nicolas, « Procès de Tombouctou »].
-
[9]
Al Mahdi, Audience, supra note 8 aux pp 68–69, aux paras 25-28.
-
[10]
Le procès a duré trois jours. Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/02-01/15, Jugement portant condamnation (27 septembre 2016) (Cour pénale internationale, Chambre de première instance VIII), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/> [Al Mahdi, Jugement]; Statut de Rome, supra note 1 art 8-2-e-iv.
-
[11]
Voir la réaction des parties en cause (poursuite, défense et victimes) sur : « Procès Al Mahdi à la CPI : fin des audiences, verdict attendu le 27 septembre », Le RFI Afrique (24 août 2016), en ligne : RFI.fr <www.rfi.fr/afrique/20160824-mali-fin-audiences-proces-cpi-al-mahdi-tombouctou> [RFI, Procès Al Mahdi à la CPI]; Voir également Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 109–10.
-
[12]
Voir plus spécifiquement la position du représentant légal des victimes, Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/02-01/15-135-Conf, Observations des victimes tendant à la fixation d’une peine exemplaire pour crime de guerre (22 juillet 2016) aux paras 45–50 (Cour pénale internationale, Chambre de première instance VIII), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_05301.PDF>; The Prosecutor v Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15-T-6-ENG, Audience (24 August 2016) aux pp 18–33, tel que cité dans Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 106, note de bas de page 180 [Observations des victimes quant à la fixation de la peine].Voir aussi Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Procès (audience publique), Transcription (24 août 2016) (Cour pénale internationale, Chambre de première instance VIII) à la p 32, lignes 10–17 [Al Mahdi, Procès].Voir aussi le point de vue de Drawi Assékou Maiga, Maire adjoint de Tombouctou sur : «Verdict clément pour le djihadiste Al Mahdi », DW (27 septembre 2016), en ligne : DW <www.dw.com/fr/verdict-cl%C3%A9ment-pour-le-djihadiste-al-mahdi/a-35902962> [Assékou Maiga].Voir aussi la déclaration disponible sur :« Destruction des mausolées de Tombouctou : un verdict sans surprise », Le RFI Afrique (28 septembre 2016), en ligne : RFI.fr <www.rfi.fr/afrique/20160927-mali-cpi-destruction-mausolees-tombouctou-verdict-surprise>[RFI, Destruction des mausolées].
-
[13]
Voir RFI, Procès Al Mahdi à la CPI supra note 11; Voir aussi Al Mahdi, Procès, supra note 12.
-
[14]
Les propos d’un habitant de Tombouctou rapportés par la chaine internationale (RFI) sont révélateurs de la perception générale qui se dégage relativement à la durée du procès : « [s]i nous pouvons nous expliquer un peu plus, qu’on puisse comprendre, bien. Mais finir le procès comme ça, si vite. J’aimerais bien comprendre pourquoi il s’est trouvé dans al-Qaïda et c’est quoi la raison exacte? Et pourquoi ils ont fait tout ce qu’ils ont fait ? J’aimerais bien vraiment savoir un peu plus. », sur « Destructions à Tombouctou : retour sur un procès inédit devant la CPI », Le RFI Afrique (26 août 2016), en ligne : RFI.fr <www.rfi.fr/afrique/20160825-mali-destructions-tombouctou-cpi-justice-verdict-proces-al-mahdi> [RFI, Destructions à Tombouctou].
-
[15]
Claire Magnoux, « Affaire Al Mahdi (destruction des biens religieux et culturels au Mali) : retour sur quelques enjeux »(3 novembre 2015), Clinique de droit international pénal et humanitaire de la faculté de droit de l’Université Laval (blogue), en ligne : ˂www.cdiph.ulaval.ca/en/blogue/Mahdi-CPI˃; Olivier Pelletier, « Ahmad Al Faqi Al Mahdi : le bourreau d’Ansar Dine » (21 juin 2016) Clinique de droit international pénal et humanitaire de la faculté de droit de l’Université Laval, en ligne : ˂www.cdiph.ulaval.ca/en/blogue/le-bourreau˃;FIDH, communiqué« Mali : la comparution d’Al Mahdi devant la CPI est une victoire, mais les charges à son encontre doivent être élargies » (30 septembre 2015), en ligne : FIDH <www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/mali-la-comparution-d-al-mahdi-devant-la-cpi-est-une-victoire-mais>[FIDH, Mali].
-
[16]
Mohamed Bennouna, « La création d’une juridiction pénale internationale et la souveraineté des États » (1990) 36 AFDI 299 aux pp 299–306; Alain Pellet, « Pour la Cour pénale internationale, Quand même! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine » (1998) 5 Ob NU 144 aux pp 144–63; Gilles Cottereau, « Statut en vigueur : la Cour pénale internationale s'installe » (2002) 48 AFDI129 aux pp 129–61.
-
[17]
Voir Jiří Toman,« La protection des biens culturels en cas de conflit armé : commentaire de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de son protocole, signés le 14 mai 1954 à La Haye, et d’autres instruments du droit international concernant cette protection », Dartmouth, publication de l’UNESCO, 1996 aux pp 4–10, tel que cité dans Le Procureur c Pavle Strugar, IT-O1-42-T, Jugement (31 janvier 2005)au para 279, note de bas de page 779 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance II)[Strugar].
-
[18]
L’expression est du professeur Pellet, voir supra note 16 à la p 163.
-
[19]
Voir par exemple, Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie adopté le 25 mai 1993 par la Rés CS 827, Doc OFF CS NU, 3217e sess, Doc NU S/RES/827 (1993), art 3-d [Statut du TPI]; Loi sur la création des chambres extraordinaires, avec inclusion d’amendements, 27 octobre 2004, NS/RKM/1004/006, art 7.
-
[20]
Le Statut de Rome dans sa rubrique crime de guerre prévoit de nombreux paragraphes ou sous paragraphes qui peuvent constituer des bases juridiques pour la répression des crimes de guerre portant atteinte au patrimoine culturel. Or, les paragraphes ou sous paragraphes les plus pertinents, et qui incriminent directement ces atteintes, sont les articles 8-2-e-iv et 8-2-b-ix : « [L]e fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».Statut de Rome, supra note 1, arts 8-2-e-iv et 8-2-b-ix.
-
[21]
Voir dans ce sens Strugar, supra note 17; Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907, La Haye, vol. 1, art 27. [Règlement de La Haye de 1907]. Voir aussi, Francesco Francioni, « Au-delà des traités : l’émergence d’un nouveau droit coutumier pour la protection du patrimoine culturel » (2008) 5 European University Institute 1 à la p 4 [Francioni].
-
[22]
Depuis l’adoption de cette Convention, mais aussi de son protocole, il n’y a plus de doute sur le fait que la destruction des biens culturels engage effectivement la responsabilité pénale individuelle de ses auteurs. Voir Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 14 mai 1954, art 4 (entrée en vigueur : 7 août 1956) [Convention de La Haye de 1954]. Voir aussi l’art 28 de la Convention de La Haye de 1954 : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention. »;Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le 26 mars 1999, 2253 RTNU 172, arts 15–16 (entrée en vigueur : 9 mars 2004) [Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954.Voir aussi, Francioni, supra note 21 à la p 1; Yaron Gottlieb, « Criminalizing Destruction of Cultural Property: A proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of ICC » (2005) 23:4 Penn State International Law Review 857 aux pp 860-61 [Gottlieb]. Il y a lieu de signaler qu’avant la Convention de La Haye de 1954, aucun instrument n’avait défini la notion de biens culturels comme « catégorie juridique autonome » exigeant de ce fait une protection internationale indépendante et entière, Francioni, supra note 21 à la p 5.
-
[23]
David Keane, « The Failure to Protect Cultural Property in Wartime » (2004) 14:1 DePaul Journal of Art, Technology &International Property Law 1 à la p 1. Selon cet auteur « [t]he provision does not, however, provide a list of violations that require a criminal sanction ». Dans le même sens, voir Jean-Marie Henckaerts, « New rules for the protection of cultural property in armed conflict » (1999) 81:835 Itnl Rev Red Cross 693 aux pp 615–20; Gottlieb, supra note 22 à la p 862.
-
[24]
Voir dans ce sens, Le Procureur c Duško Tadić alias « Dule », IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 octobre 1995) au para 98 (Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, Chambre d’appel), en ligne : ICTY <www.icty.org/fr/case/tadic/4#acjug>; Strugar, supra note 17 aux paras 228–29. Voir aussi, Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 271, art 53 (entrée en vigueur : 7 décembre 1978) [Protocole I];Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, 1125 RTNU 649, art 16 (entrée en vigueur : 7 décembre 1978) [Protocole II]; Amilcar Romero Beltran, « La protection de biens culturels en cas de conflits armés » (2015) 1 Revista Peruana de Estudios Internationales 1 à la p 17 [Amilcar]; Francioni, supra note 21 aux pp 3, 7 et 8.
-
[25]
Voir notamment Strugar, supra note 17 au para 229.Contra, Guido Carducci, « L’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’arts en cas de conflits armés » (2000) RGDIP aux pp 290 et ss.
-
[26]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10au para 14.
-
[27]
Ibid au para 39.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Les règles relatives à la conduite des hostilités, aussi appelées droit de La Haye, désignent des règles du droit de la guerre règlementant la conduite des hostilités. Autrement dit, c’est une série de règles qui a pour but de distinguer les moyens et méthodes de guerre licites ou non. Robert Kolb, Ius in bello: Le droit international des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2009aux pp 237-551 [Kolb]; Éric David (A), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2012 aux pp 273-792 [David (A), Principes].
-
[30]
Les règles relatives au traitement des personnes au pouvoir de l’ennemi, communément appelées droit de Genève, s’intéressent à la protection des personnes protégées lors des conflits armés. Kolb, supra note 29 aux pp 317-551; David (A), Principes, supra note 29 aux pp471–792.
-
[31]
Protocole II, supra note 24, art 16; Convention de La Haye de 1954, supra note 22, art 19; Éric David (B), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2002 aux pp 240-41 et 410 [David (B), Principes].Dans ce sens, voir aussi, Yves Sandoz, dir, « Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 », Commentaire, (1987) CICR [Sandoz, « Commentaire »].Dans l’affaire Strugar, en spécifiant clairement qu’aucune position militaire croate de nature à justifier le bombardement des forces croates ne se trouvait dans la vieille ville de Dubrovnik, et que « the protection accorded to cultural property is lost where such property isused for military purposes », la Chambre du TPIY indiquait par-là l’exigence d’un affrontement dans lequel les biens culturels sont utilisés par la partie adverse à des fins militaires. Par conséquent, l’éventuel usage à des fins militaires, aurait pu faire perdre, dans le cadre des hostilités, la nature protectrice dont bénéficiaient lesdits biens culturels. Strugar, supra note 17 aux paras 182-214 et 310.Voir aussi, infra note 40.
-
[32]
Ibid.
-
[33]
Dans ce sens, Françoise Bouchet-Saulnier, dir, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, La Découverte, 2000 à la p 309.
-
[34]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 31.
-
[35]
Voir supra notes 30 et 31; voir infra note 40; voir aussi Sandoz, « Commentaire », supra 31 note aux pp 613–17.
-
[36]
Voir David (B), Principes, supra note 31 à la p 241; Kolb, supra note 29 aux pp 461–62.
-
[37]
Ibid.
-
[38]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 15-16.
-
[39]
Ibid.
-
[40]
Ibid au para 14. La référence de la Cour est d’autant plus exacte que dans la doctrine, plusieurs auteurs ont confirmé que l’article 8-2-e-iv du Statut origine des articles 27 et 26 du règlement de la Haye de 1907. Voir William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010aux pp235–36 [Schabas]; Aurélie Achou « La répression internationale des atteintes au patrimoine culturel dans le Statut de la Cour pénale internationale : origines et évolutions possibles » (2005) 2 Revue Juridique d’Auvergne 183.
-
[41]
Or, la structure générale du Règlement de La Haye de 1907 est explicite à l’effet que l’article 27 qui traite des questions similaires à l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome s’applique à la conduite des hostilités. Voir la section intitulée « Des hostilités » et le Chapitre I qui traite « Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements ». Voir aussi, David (A), Principes, supra note 29aux pp 316–17.
-
[42]
Statut de Rome, supra note 1, art 8-2-e-iv.
-
[43]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 13.
-
[44]
Il s’agit par exemple du site d’Angkor qui fut détruit suite au conflit armé qui a ravagé le pays dans les années 1980. Voir Amilcar, supra note 24 à la p 4.
-
[45]
Il s’agit par exemple de l’affaire des Bouddhas de Bâmiyân. Pour en savoir plus sur ce site et comment il a pu être détruit malgré les protestations de la communauté internationale, voir Pierre Lafrance, « Comment les bouddhas de Bamyan n'ont pas été sauvés » (2001) 3 :12 Critique internationale 14 aux pp 14–21. Voir aussi, Amilcar, supra note 24 aux pp 4–5. Pour une analyse juridique, voir Francesco Francioni and Federico Lenzerini « The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law » (2003) 14:4 Eur J Intl L619.
-
[46]
La destruction de la vieille ville de Dubrovnik classée, dans sa totalité, au patrimoine culturel mondial en 1979 peut être donnée en exemple. Le TPIY a produit des décisions relatives à l’ampleur de la destruction qui eut lieu. Pour une narration du contexte et des implications juridiques quant aux conséquences pénales de la destruction de la ville de Dubrovnik, voir Strugar, supra note 17 aux paras 12–72 et paras 298–312.
-
[47]
On se rappelle encore de l’ampleur de la destruction de plusieurs monuments historiques ou culturels en Syrie par l’État islamique, notamment, la cité antique de Palmyre. Pour une narration des faits, Michel Al-Maqdissi, « La destruction du patrimoine archéologique syrien » (2016)144 Les nouvelles de l'archéologie, en ligne : Open Edition <journals.openedition.org/nda/>.
-
[48]
Yves Sandoz Des priorités à définir : traiter la protection des biens culturels comme un chapitre du droit international humanitaire » dans Protection des biens culturels en cas de conflit armé : rapport d’une réunion d’expert, Genève, CICR, 2000, 21 [Sandoz, « Des priorités »].
-
[49]
Déclaration du procureur de la CPI, supra note 3.
-
[50]
Ibid.
-
[51]
Voir supra notes 11, 12 et 13.
-
[52]
Voir RFI, Destructions à Tombouctou supra note 14. Voir aussi Julia Grignon, « Un effet secondaire de la décision Al-Mahdi de la Cour pénale internationale : une mauvaise utilisation de la notion d’occupation en droit international humanitaire » (29 septembre 2016) Clinique de droit international pénal et humanitaire de la faculté de droit de l’Université Laval (blogue), en ligne : CDPIH<www.cdiph.ulaval.ca/node/1167> [Grignon].
-
[53]
Voir spécifiquement l’analyse de Julia Grignon quant à sa critique du mauvais usage par la Chambre de première instance de la notion juridique d’occupation. Ibid.
-
[54]
Voir supra notes 12, 13 et 14.
-
[55]
Ibid.
-
[56]
Rapport établi au titre de l’article 53-1, supra note 3 aux paras 127–32.
-
[57]
FIDH, communiqué« Mali : Ouverture devant la CPI du procès Al Mahdi sur la destruction du patrimoine culturel » (17 août 2016), en ligne : FIDH <www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/mali-ouverture-devant-la-cpi-du-proces-de-al-mahdi-sur-la-destruction> [FIDH, « Mali : Ouverture »];Le Rapport de la procureure de la CPI fait justement cas des faits qui lui ont été rapportés par plusieurs ONGs, et qui font état de l’existence de possibles crimes contre l’humanité. Rapport établi au titre de l’article 53-1, supra note 3 aux paras 130–31.
-
[58]
Jean-Jacques Louarn, « Procès de la destruction des mausolées devant la CPI : insuffisant selon Florent Geel (FIDH) », RFI Afrique (22 août 2016), en ligne : RFI.fr <www.rfi.fr/emission/20160822-florent-geel-fidh-tombouctou-proces-cpi-ahmed-al-faqi-al-mahdi>[Louarn];FIDH,« Mali: Ouverture »,supra note 57.
-
[59]
Rés CS 2295, Doc off CS NU, 7727esess, Doc NU A/RES/2295 (2016). Voir aussi, Rés CS 2100, Doc off CS NU, 6952e séance, Doc NU A/RES/2085 (2013);Rés CS 2164, Doc off CS NU, 7210e séance, Doc NU A/RES/2164 (2014).
-
[60]
Rés CS 2085, Doc off CS NU, 6898e séance, Doc NU A/RES/2085 (2012).
-
[61]
Ibid.
-
[62]
Conseil des droits de l’homme, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Doc off AG NU, 22esess, Doc A/HRC/23/57 (2012) aux paras 18–31; Conseil des droits de l’homme, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Doc off AG NU, 23esess, Doc A/HRC/23/57 (2013) aux paras 22-48; Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de homme au Mali, Suliman Baldo, Doc off AG NU, 25esess, Doc A/HRC/25/72 (2014) aux paras 41-56; Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de homme au Mali, Suliman Baldo, Doc off AG NU, 31esess, Doc A/HRC/31/76 (2016) aux paras 38-49;Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Doc off AG NU, 23esess, Doc A/HRC/23/57 (2013) aux paras 22–48.
-
[63]
Ibid.
-
[64]
Il est important de citer quelques passages du journal pour bien comprendre l’enjeu du débat : « en acceptant les aveux d'Abou Tourab et en confirmant les charges retenues contre lui, la Cour a également renoncé à mener de nouvelles investigations. Selon des informations du Point, l'homme est pourtant soupçonné de bien d'autres exactions. Et quelque abject qu'il ait été, le crime de destruction de biens culturels pour lequel il va être jugé ne reflète pas suffisamment l'horreur qui a régné à Tombouctou pendant les quelques mois qu'a duré l'occupation djihadiste. Le Point est aujourd'hui en mesure de révéler l'ampleur des abominations commises dans la "cité des 333 saints" par Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Des scènes de viol et de torture, des détentions arbitraires, des flagellations en place publique… Autant de potentiels crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été à ce jour ignorés par la justice internationale »; Marc Leplongeon, « Les crimes oubliés des djihadistes de Tombouctou » Le Point (30 mars 2016), en ligne : Le Point <www.lepoint.fr/justice/les-crimes-oublies-des-djihadistes-de-tombouctou-30-03-2016-2028824_2386.php>.
-
[65]
Ibid.
-
[66]
Voir supra notes 11, 12 et 13.
-
[67]
En appelant expressément les juges de la CPI, à l’occasion du procès, à « poser la première pierre à l'édifice de la jurisprudence de la Cour en la matière », le discours de la procureure met clairement en évidence l’importance attachée à l’idée, non pas de minimiser la poursuite classique des crimes contre les personnes dans la situation spécifique du Mali, mais de poser les bases juridiques d’une intolérance désormais affirmée et permanente contre les attentes graves aux monuments historiques de la vie des peuples et au patrimoine commun de l’humanité. Ce faisant, la poursuite a saisi une occasion privilégiée pour rendre désormais effectives certaines dispositions, non moins essentielles du Statut, qui n’avaient jamais été activées auparavant. Sur le discours de la procureure, voir Déclaration du procureur de la CPI, supra note 3. Pour une position similaire, voir aussi Sandoz, « Des priorités », supra note 48.
-
[68]
Voir aussi Sandoz, « Des priorités », supra note 48.
-
[69]
Sur la notion du « nettoyage ethnique », ses implications et son rapport au crime international du génocide, voir Emile Ouédraogo, « Le "nettoyage ethnique" en droit international », 54 ACDI188 aux pp 188–226.
-
[70]
Déclaration du procureur de la CPI, supra note 3. Voir aussi, Sandoz, « Des priorités », supra note 48.
-
[71]
Ibid.
-
[72]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 77.
-
[73]
Ch. Prem. Ins. Jugement portant condamnation, « Observations de la Défense sur les principes devant gouverner la peine et les circonstances aggravantes et/ou atténuantes en la cause, en conformité avec l'ordonnance ICC-01/12-01/15-99 de la Chambre (ICC-01/12-01/15-141-Conf) », No.: ICC-01/12-01, 20 septembre 2016 aux paras 121-25 et 127-28 et note 64 plus particulièrement [Ch. Prém. Ins.].
-
[74]
Voir supra notes 48 et 67.
-
[75]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 77.
-
[76]
Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01, Jugement portant condamnation, Observations de la défense sur les principes devant gouverner la peine et les circonstances aggravantes; Ch Prém Ins, supra note 73.
-
[77]
Voir supra note 67.
-
[78]
Nancy Amoury Combs, « Procuring Guilty Pleas for International Crimes: The Limited Influence of Sentence Discounts » (2006) 59 Vand L Rev 67 aux pp 70–71 [Combs]; Jeanne Nicolas, « Procédure d’aveu de culpabilité »dans Julian Fernandez et Xavier Pacreau, dir, Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Commentaire article par article, vol 2, Paris, Éditions Pedone, 2012à la p 1474 [Nicolas, Commentaire]; Anne Marie La Rosa, « Réflexion sur l’apport du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie au droit à un procès équitable » (1997) 4RGDIP 945 aux pp 956–57; Jean Pradel, « Le plaider coupable confrontation des droits américain, italien et français » (2005)57:2 RIDC 473 aux pp 473–76.
-
[79]
Combs, supra note 78; Jean-Paul Perron, « La négociation en droit pénal » dans Droit pénal (infractions et moyens de défense), vol 12, Collection de droit de l’École du Barreau, 2016-2017, aux pp 363 et 365 [Perron].
-
[80]
Conseil des droits de l’homme, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Doc off AG NU, 22esess, Doc A/HRC/23/57 (2012) aux paras 18-31; Comité préparatoire, Rapport du Comité préparatoire pour la création de la Cour criminelle internationale (vol 1), Doc off AG NU, 51e sess, supp n° 22, Doc A/51/22 (1997) aux pp 60-61 aux paras 260-62; Schabas, Commentary, supra note 40 à la p 780; Pierre Robert, « La procédure du jugement en droit international pénal », dans Hervé Aschensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, dir, Droit pénal international, Paris, Pedone, 2000, 823 à la p 832.
-
[81]
André Kuhn, « Le plea bargaining américain est-il propre à inspirer le législateur suisse? » (1998) 116 :1 Revue pénale suisse 73 à la p 74.
-
[82]
Ibid.
-
[83]
Perron, supra note 79 à la p 363; Combs, supra note 78 aux pp70-71.
-
[84]
Voir Damien Scalia, « Constat sur le respect du principe nulla poena sine lege par les tribunaux internationaux ad hoc » (2006) 58 :1 RIDC 197 à la p 197 [Scalia, « Constat »]; Les règlements de procédure et de preuve (RPP) ont toutefois consacré quelques dispositions au plaidoyer de culpabilité. Voir par exemple, RPP du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), IT/32/Rev. 49, La Haye, Pays-Bas, 22 mai 2013, arts 62, 62 bis et 100. Le RPP du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) reprend à l’identique les mêmes dispositions.
-
[85]
Statut de Rome, supra note 1 aux arts 64-8-a et 65. Elles sont complétées par certaines dispositions RPP, notamment la règle 139 et la règle 136. Voir Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3 et Corr.1, 1èresess, New York, 3-10 septembre 2002, 2epartie. A.
-
[86]
Statut de Rome, supra note 12, art 64-8-a.
-
[87]
Ibid.
-
[88]
Le procureur c Erdemović, IT- 96-22-A, Arrêt (7 octobre 1997) (TPIY, Chambre d’appel du TPIY) aux paras 16et 20[Erdemović].
-
[89]
Statut de Rome, supra note 1, art 65-2.
-
[90]
Le Procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Version publique expurgée du « Dépôt de l’accord sur l’aveu de culpabilité de M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi » du 25 février 2016, ICC-01/12-01/15-78-Conf-Exp, (19 août 2016) (Cour pénale internationale, Chambre préliminaire).
-
[91]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 11.
-
[92]
Nicolas, « Procès de Tombouctou », supra note 8 à la p 5.
-
[93]
Voir Erdemović, supra note 88.
-
[94]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 11-12.
-
[95]
Public redacted version of "Prosecution’s submissions on sentencing", 22 July 2016, ICC-01/12-01/15-139-Conf, ICC-01/12-01/15-139-Red (21 Août 2016) (Cour pénale internationale, Chambre de première instance VIII), en ligne: CPI <www.icc-cpi.int/> aux paras 64–70; Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 5.
-
[96]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 55-56.
-
[97]
Statut de Rome, supra note 1, art 65-4.
-
[98]
Voir supra notes 11, 12 et 13.
-
[99]
Il faut le dire clairement, il y avait ici un risque sérieux pour l’avenir même des plaidoyers de culpabilité devant la justice pénale permanente, dans le cas où les juges – confrontés pour la première fois à ce scénario – avaient refusé de lui accorder un intérêt quelconque. Déjà en 2010, alors qu’il commentait la procédure de plaidoyer de culpabilité et l’attitude que les juges pourraient avoir face à cet accord bipartite entre procureur et défense, Schabas écrivait ceci : « [t]he first case or two before the Court involving an admission of guilt will determine the outcome of the procedure for many years to come. If the Trial Chamber shows deference for the agreement between Prosecutor and defence, this will instil trust among other accused persons and encourage them to do likewise. On the other hand, if the Trial Chamber indicates that procedure is full of uncertainty for the accused, defence counsel will strongly advise clients not to avail of the possibility ».Schabas, Commentary, supra note 40 à la p 780.
-
[100]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 89, 91, 93, 97–105 et 109.
-
[101]
Voir Observations des victimes quant à la fixation de la peine, supra note 12 ; Voir aussi Assékou Maiga, supra note 12; Al Mahdi, Procès, supra note 12.
-
[102]
Le procureur c Deronjić, IT-02-61/1-S, Sentence (30 mars 2004) (TPIY, Chambre de première instance II) au para 234 [Deronjić];Le procureur c Krstić, IT-98-33-T, Jugement (2 août 2001) (TPIY, Chambre de première instance) au para 704; Le procureur c Predrag Banović, IT-02-65/1-S, Jugement portant condamnation (28 octobre 2003) (TPIY, Chambre de première instance) au para 68 [Banović];Le procureur c Momir Nikolić, IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation (2 décembre 2003) (TPIY, Chambre de première instance I) au para 93 [Nikolić]. Voir dans le même sens, Damien Scalia, « La peine privative de liberté en droit pénal européen et international : une "sanction à tout faire" », dans Diane Bernard et al, dir, Fondements et objectifs du droit pénal européen et international, Limal, Anthemis, 2013 aux pp 462–63.
-
[103]
On peut dès lors comprendre la légitimité des remarques des victimes qui auraient sans doute souhaité en savoir plus relativement à la commission des infractions et de leur contexte; supra notes 11 et 13.Or, s’attarder sur les faits et la procédure n’était pas une des options souhaitables et envisagées par la défense. Voir Nicolas, « Procès de Tombouctou », supra note 8 à la p 5.
-
[104]
Ces avantages du plaidoyer de culpabilité ont été mis en évidence par les décisions du TPIY. Voir notamment, Le procureur c Todorović, IT-95-9/1-S, Sentence (31 juillet 2001) (TPIY, Chambre de première instance II) au para 81 [Todorović]. Les chambres de première instance ont expressément souligné l’apport incontestable du plaidoyer, surtout quand elle intervient avant l’ouverture du procès comme c’est le cas dans ce premier jugement de la CPI, ibid au para 81;Le procureur c Erdemović, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame la Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah (1997) (TPIY, Chambre d’appel) au para 2;Le procureur c Erdemović, , Opinion individuelle et dissidente du juge Cassese (1997) (TPIY, Chambre d’appel) au para 8; Le procureur c Predrag Banović, IT-02-65/1-S, Jugement portant condamnation, (28 octobre 2003) (TPIY, chambre de première instance) au para 68;Le procureur c Biljana Plavšić, IT-00-39 & 40/1-S, Jugement portant condamnation, (27 février 2003) (TPIY, Chambre de première instance) au para 73;contra, Nikolić, supra note 102 au para 67.
-
[105]
Voir le plaidoyer des responsables de la Cour, Projet de budget-programme de la Cour pénale internationale pour 2017, 15esess, La Haye, 16-24 novembre 2016, CC-ASP/15/10, (17 août 2016) (Cour pénale internationale, Assemblée des États Parties).
-
[106]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 aux paras 61-63.
-
[107]
Ibid au para 61.
-
[108]
Voir dans ce sens, Combs, supra note 78 aux pp 69–151; Scalia, supra note 84 aux pp 197–98.
-
[109]
Voir dans ce sens, Déclaration du Procureur de la CPI, supra note3.
-
[110]
Sur l’observation de ces règles, voir CPI, Code de conduite professionnelle des conseils, Rés ICC-ASP/4/Res.1, 3e séance, 2 décembre 2005, préambule, arts 6, 14 et 15.
-
[111]
Michel Proulx et David Layton, Ethics and Canadian Criminal Law, Toronto, Irwin Law Edition, 2001 aux pp 413-739.
-
[112]
Déclaration du Procureur de la CPI, supra note 3.
-
[113]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 13.
-
[114]
Al Mahdi, Procès, supra note 12à la p 32, lignes 10-17.
-
[115]
Ibid à la p 31, ligne 11.
-
[116]
Cherif Bassiouni, « International Recognition of Victims' Rights » (2006) 6 HRLR203 à la p 230; David Lounici et Damien Scalia, « Première décision de la cour pénale internationale relative aux victimes : état des lieux et interrogations », (2005)3:76 Rev IDP 375 aux pp 375-408 [Lounici et Scalia]; Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des crimes internationaux » (2009) 50 CDDR 691aux pp 691-734.
-
[117]
Lounici et Scalia, supra note 116.
-
[118]
Voir Nikolić, supra note 102 au para 62.
-
[119]
Dans ce sens, ibid au para 57; contra, voir l’opinion individuelle du juge Mumba, Deronjić, supra note 102 à la p 108, para 3.
-
[120]
Schabas, Commentary, supra note 40 à la p 775; Nicolas, Commentaire, supra note78 aux pp 1474–75.
-
[121]
Claude Jorda et Jérôme De Hemptinne, « Un nouveau statut pour l’accusé dans la procédure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », dans John Hocking, Ken Roberts, Bing Bing Jia, Daryl Mundis and Gabriel Oosthuizen, dir, Essays on ICTY Procedure and Evidence In Honour of Gabrielle Kirk McDonald, La Haye, Kluwer Law International, 2001 aux pp 226-29 [Jordaet De Hemptinne].
-
[122]
Dans ce sens, Al Mahdi, Procès, supra note 12à la p 32, lignes 10-17.Voir aussi surtout la position de la Chambre de première instance I dans l’affaire Nikolić où les juges exprimaient de la méfiance face aux accords de plaidoyer de culpabilité en écrivant que: «[…] la Chambre estime nécessaire de se poser la question de l’opportunité des accords sur le plaidoyer dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire portées devant ce Tribunal». Nikolić, supra note 102 au para 57.
-
[123]
Luc Walleyn, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole » (2002) 84 :845 RICR à la p 76. Dans le même sens, voir l’opinion individuelle du juge Mumba, Deronjić, supra note 102.
-
[124]
RFI, « Procès Al Mahdi à la CPI : fin des audiences, verdict attendu le 27 septembre » Le RFI Afrique (24 août 2016), en ligne : RFI <www.rfi.fr/afrique/20160824-mali-fin-audiences-proces-cpi-al-mahdi-tombouctou>.
-
[125]
Nikolić, supra note 102 au para 61.
-
[126]
Généralement, les procédures devant la justice pénale internationale sont trop longues et la confrontation des parties, ainsi que les procédures éprouvantes, sont sources de difficultés diverses. Ces facteurs font durer les affaires déjà ouvertes. À titre d’exemple, alors qu’un mandat d’arrêt a été émis contre l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo le 23 novembre 2011, et qu’il a été remis à la CPI le 30 novembre suivant, son procès ne s’est finalement ouvert que le 28 janvier 2016, soit plus de trois ans après, et devrait encore durer plusieurs mois de suite. Voir Mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11, (23 novembre 2011) (CPI, Chambre préliminaire III). Voir aussi les informations relatives au procès, « Trial Stage », en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/Pages/trial.aspx?ln=fr>; Contrairement à l’affaire Laurent Gbagbo, la procédure Al Mahdi - on l’a vu - n’a duré au total qu’une seule année du fait du plaidoyer de culpabilité.
-
[127]
Nikolić, supra note 102 aux paras 57–61.
-
[128]
Ibid au para 61.
-
[129]
Ibid.
-
[130]
Ibid au para 62.
-
[131]
Ibid aux paras 61–62; Jorda et De Hemptinne, supra note 121 à la p 229.
-
[132]
Ibid.Dans ce sens aussi, voir l’opinion dissidente du Juge Schomburg, Deronjić, supra note 102 aux pp 96 et 103.
-
[133]
Nikolić, supra note 102au para 59.
-
[134]
Voir sur cette question l’article de Xavier Pin, « L’objectif de satisfaction des victimes en droit pénal international », dans Diane Bernard, Yves Cartuyvels, Christine Guillain, Damien Scalia, Michel van de Kerchove, dir, Fondements et objectifs du droit pénal européen et international, Limal, Anthemis, 2013 aux pp 651–65 [Pin].
-
[135]
Ibid.
-
[136]
Robert Cario, « Les victimes devant la CPI » (2007)6 AJ PÉNAL 261 à la p 261; Damien Scalia, « La place des victimes devant la CPI », dans Droit international pénal, Robert, dir, Bruxelles, Bruylant, 2008 aux pp 311 et s.; Robert Cryer, dir, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, à la p 485 dans Pin, supra note 134 à la p 655.
-
[137]
Damien Scalia, Du principe de la légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011 à la p 335.
-
[138]
Observations des victimes quant à la fixation de la peine, supra note 12; voir aussi Al Mahdi, Procès, supra note 12;AssékouMaiga, supra note 12;RFI, Destruction des mausolées, supra note 12.
-
[139]
The Prosecutor v Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Public redacted version of "Prosecution’s submissions on sentencing" (21 Août 2016) au para 64 [Al Mahdi, version of Prosecution’s submissions on sentencing].
-
[140]
Ibid.
-
[141]
Ibid aux paras 64-70.
-
[142]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10 au para 109.
-
[143]
Ibid. Al Mahdi, Procès, supra note 12à la p 131, lignes 18 à 28.
-
[144]
Al Mahdi, Jugement, supra note 10au para 109.
-
[145]
Ibid au para 104. En rappel, la Chambre a tenu compte des circonstances atténuantes suivantes : son aveu de culpabilité, sa coopération avec l’accusation, les remords et l’empathie qu’il a exprimés à l’égard des victimes, sa réticence initiale à l’idée de commettre le crime, les mesures qu’il a prises pour limiter les dommages causés ainsi que sa bonne conduite en détention malgré sa situation familiale.
-
[146]
Ibid. Tel que nous l’avons déjà indiqué, la Chambre de première instance prend le soin d’indiquer que « [c]onformément à l’article 78-2 du Statut, Ahmad Al Mahdi a droit à ce que soit déduit de sa peine le temps qu’il a passé en détention sur ordre de la Cour, c’est-à-dire le temps écoulé depuis son arrestation en exécution du mandat d’arrêt délivré le 18 septembre 2015 »,Al Mahdi, Jugement, supra note 10.
-
[147]
Voir dans ce sens, Al Mahdi, version of Prosecution’ssubmissions on sentencing, supra note 139 aux paras 65-66;Al Mahdi, Jugement,supra note 10; RFI, voir la réaction des parties en cause, RFI, Procès Al Mahdi à la CPI, supra note 11.
-
[148]
Assékou Maiga, supra note 12; RFI, Destruction des mausolées, supra note 12;
-
[149]
RFI, Destruction des mausolées, supra note 12.
-
[150]
Ibid.
-
[151]
Voir encore Akila Taleb, « Les procédures de guilty plea: plaidoyer pour le développement des formes de justice ‘négociée' au sein des procédures pénales modernes. Étude de droit comparé des systèmes pénaux français et anglais » (2012) 83 :1Rev IDPaux pp 94 et 99; Combs, supra note 78 aux pp 70–71.
-
[152]
Al Mahdi, version of Prosecution’s submissions on sentencing, supra note 139.
-
[153]
Schabas, Commentary, supra note 40 à la p 775; Nicolas, Commentaire, supra note 78.
-
[154]
Perron, supra note 79 aux pp 355–56.
-
[155]
Ibid à la p 356.
-
[156]
Statut de Rome, supra note 1 art 8-2-e-iv.
-
[157]
Voir dans ce sens, Combs, supra note 78; Scalia, Constat, supra note 84.
-
[158]
Jordaet De Hemptinne, supra note 121 à la p 229.
-
[159]
Voir notamment Nikolić, supra note 102 aux paras 57 et 73.