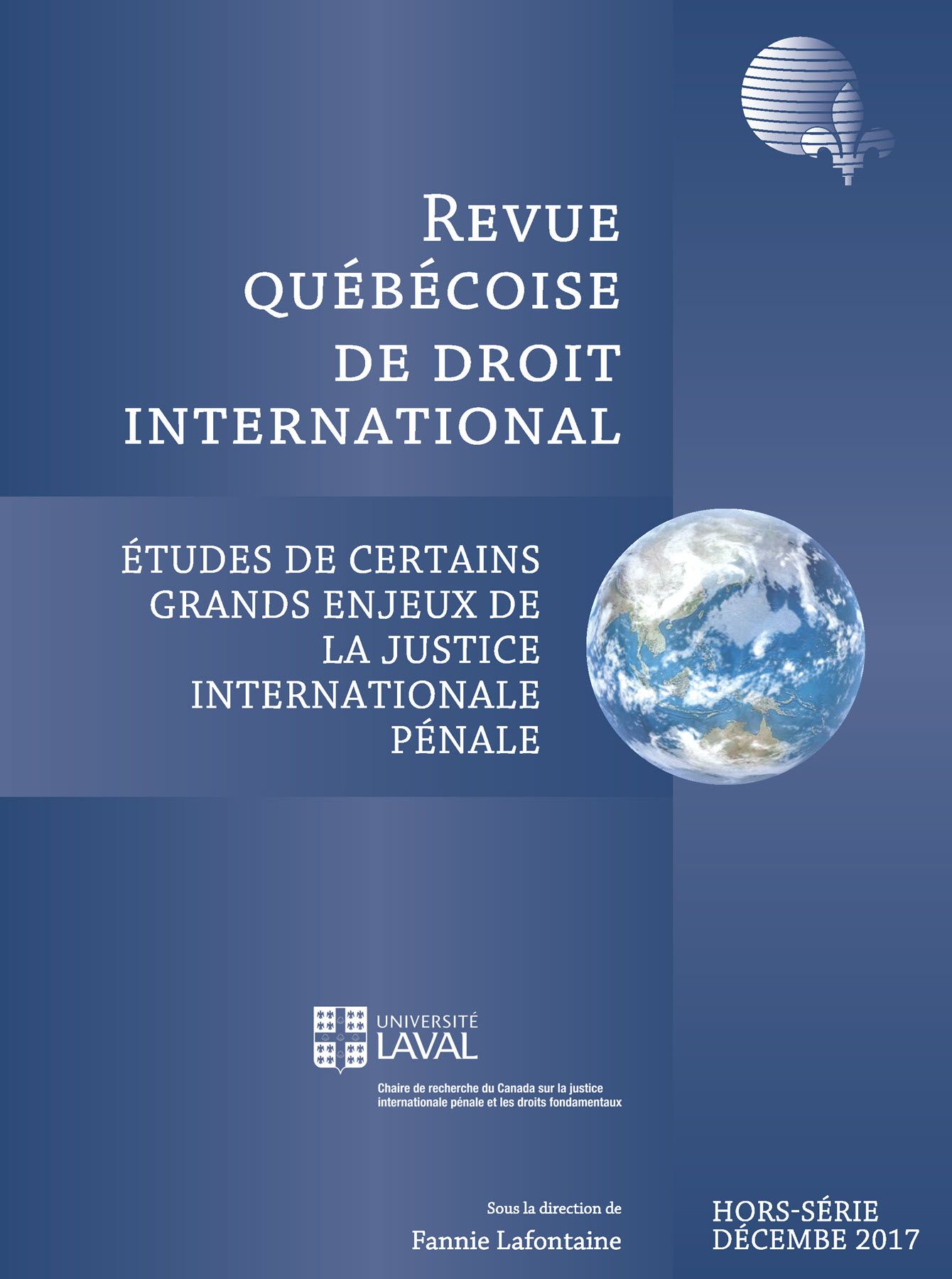Résumés
Résumé
Le développement de la justice pénale internationale, comme branche incidente des processus de maintien de la paix, ne laisse pas indifférents les Africains, particulièrement concernés par les violations graves du droit international humanitaire occasionnées par les conflits armés. L’Union africaine, dont l’Acte constitutif fait du rejet de l’impunité un principe fondamental, plaide, depuis les divergences politiques qui ont entravé la collaboration de ses membres avec la Cour pénale internationale, pour une régionalisation accélérée de la répression pénale internationale. Cet article a pour objectif d’apprécier les enjeux juridiques de cette africanisation de la justice pénale motivée par de nombreux facteurs politiques.
Abstract
The development of the international criminal justice, as the incidental branch of the processes of preservation of the peace, does not leave unmoved the African, who are particularly concerned by the important violations of international humanitarian law caused by armed conflicts. The African Union, the Constitutive Act of which makes of the rejection of the impunity a fundamental principle, pleads, since the political differences which hindered the collaboration of its members with the International Criminal Court, for a regionalization accelerated of the international penal repression. This article has for objective to appreciate legal stakes in this africanisation of the criminal justice motivated by numerous political factors.
Resumen
El desarrollo de la justicia penal internacional, como rama que incide en los procesos de mantenimiento de la paz, no deja indiferente a los africanos, particularmente afectados por las violaciones graves del derecho internacional humanitario ocasionadas por los conflictos armados. Para la Unión africana, el rechazo de la impunidad es un principio fundamental consagrado por su Acta constitutiva, la cual promueve, a pesar de las divergencias políticas que han dificultado la colaboración de sus miembros con la Corte penal internacional, una regionalización acelerada por la represión penal internacional. Este artículo tiene como objetivo exponer las cuestiones jurídicas de la africanización de la justicia penal motivada por numerosos factores políticos.
Corps de l’article
L’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [1](Statut de Rome) en 2002 et la création de la Cour pénale internationale (CPI ou Cour) ont permis la réalisation d’un vieux rêve[2] sur l’instauration d’une juridiction pénale internationale permanente chargée d’examiner les crimes de masse et ayant une portée internationale. Alors que la compétence de la CPI s’étend aux crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale et encadrés par le droit international humanitaire (DIH), elle s’est manifestement réduite au continent africain, au gré des situations soumises à la sanction de la juridiction. Ce déséquilibre géographique des poursuites que mène la Cour altère ses relations avec l’Union africaine (UA) et les États africains. Cet état de fait rappelle pourtant la compétence universelle[3] mise en oeuvre par certaines juridictions européennes, et accrédite la thèse d’un certain « impérialisme judiciaire[4] » exercé à l’encontre de l’Afrique. Le 28e Sommet de la Conférence de l’Union africaine qui s’est déroulé à Addis-Abeba en Éthiopie les 30 et 31 janvier 2017 a été l’occasion pour les chefs d’État africains de rediscuter d’un retrait collectif de la CPI. Cette volonté réaffirmée des dirigeants africains soulève à nouveau la question de la légitimité d’une juridiction pénale internationale prompte à n’appliquer sa compétence qu’aux crimes graves commis en Afrique.
Cette « suractivité africaine » discutée de la Cour ne répond pourtant qu’à l’incapacité des juridictions nationales à juger les auteurs de crimes graves et à l’inexistence d’un système continental de répression pénale efficace. La résurgence des conflits armés en Afrique et l’usage incontrôlé de la force qui en résulte ne sont que peu encadrés par les institutions africaines. Si depuis les années 2000, l’UA tente tant bien que mal de changer la donne, son action est plus normative, aussi bien dans la gestion des crises que dans l’effectivité de la responsabilité pénale individuelle, qu’opérationnelle. Le lot d’horreurs laissé par le génocide tutsi ayant fini de convaincre la communauté internationale de la nécessité d’une juridiction pénale internationale permanente capable de mettre un terme à l’impunité, c’est « logiquement » que les États africains ont accueilli cette initiative dans un premier temps, avant de ralentir leur coopération avec la CPI, au gré des poursuites, quasi exclusivement[5] dirigées contre des Africains, et notamment certains de ses dirigeants. Le point d’achoppement entre la CPI et l’Union ne se situe pas, en effet, au niveau des questions d’exercice de compétence de la Cour, mais de ses modes de saisine. Alors que les premières années d’activité de la Cour se sont caractérisées par une collaboration étroite avec les États africains, les positions adoptées lors des dernières sessions de la Conférence de l’Union africaine laissent supposer une certaine rupture entre l’organisation africaine et l’institution répressive universelle. La méfiance de certains de ces États à l’égard de la CPI est née des cas où la Cour n’a pas été directement saisie par les États concernés (le Soudan en 2005 et le Kenya en 2010), mais par le Conseil de sécurité et le procureur de la Cour et impliquant pour les premières fois des dirigeants en exercice.
La présente contribution a pour objectif d’apprécier les nombreuses divergences politiques qui ont émaillé les relations entre la CPI et l’UA (I). Fondées ou non, les réserves africaines à l’égard de la politique répressive de la CPI ont mis en évidence la nécessité d’une justice pénale régionale à la compétence personnelle large (II). En cas de retrait (ou non) des États de l’Union de la CPI, l’absence d’alternative juridictionnelle au niveau régional constituerait en effet une garantie implicite de l’impunité.
I. Les divergences politiques entre la CPI et l’UA
Depuis sa création, la CPI est compétente pour connaître des crimes qui entrent dans ses zones de compétence matérielle – à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les crimes de génocide – et temporelle – commis après le 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur du Statut de Rome[6]. Compétente pour connaître des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale[7], l’activité de la Cour est cependant et de façon incontestable concentrée sur l’Afrique[8]. Ce déséquilibre géographique des poursuites que mène la Cour crée à son égard des critiques de plus en plus poussées de l’UA qui y voit un traitement différencié et arbitraire (A), notamment lorsque le procureur de la Cour exerce son droit de saisine (procédure proprio mutu), sans considération de la qualité officielle de la personne poursuivie (B).
A. La concentration africaine des affaires de la Cour
Les relations entre la CPI et les États africains n’ont pas toujours été conflictuelles. L’adhésion massive de ces États au Statut de Rome et leur rapide collaboration avec la Cour a d’ailleurs contribué à une reconnaissance légitime de cette juridiction. Le double objectif de l’instauration d’une juridiction pénale internationale permanente, à savoir lutter contre l’impunité des auteurs de crimes graves et prévenir de nouveaux crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde[9], ne pouvait que correspondre aux besoins d’une Afrique spécialement marquée du sceau des conflits[10]. C’est donc logiquement que de nombreux États africains ont reconnu la compétence de la CPI, bien que cette reconnaissance ait souvent été motivée par des considérations politiques.
Sur les 124 États parties que compte le Statut de Rome au 14 mars 2017, 34[11], soit plus du quart, sont membres du groupe des États d’Afrique[12]. Il faut d’ailleurs noter que le premier instrument de ratification du Statut de Rome a été déposé par un État africain, en l’occurrence le Sénégal. Plusieurs autres États africains, souvent à la faveur d’une sortie de conflit armé[13] ont depuis reconnu cette compétence. Le constat d’une réelle adhésion apparaît évident, nonobstant le fait qu’une dizaine d’États déjà signataires[14] pourrait allonger cette liste dès que la barrière des ratifications sera levée.
Soucieux de se débarrasser d’une image persistance du culte de l’impunité, mais incapables d’assurer de manière effective l’indépendance des juridictions pénales nationales, les États africains ne pouvaient qu’adhérer à la CPI. D’autant plus qu’en sortie de conflit armé, juger des vaincus sur le territoire de leur État, ne peut que renvoyer l’image d’une justice des vainqueurs. La procédure de la CPI apparaît ainsi comme doublement attractive pour les États africains, d’abord parce que, jugées extra-muros[15], les personnes accusées ne peuvent inciter à la violence ni leurs partisans, ni les victimes en quête de vengeance. Elles sont, ensuite, politiquement éliminées par les gouvernements en place[16].
Au titre de l’exercice de la compétence, la CPI a également été véritablement adoubée par les États africains puisque les trois premiers cas de saisine de la Cour trouvent leur origine dans la volonté des gouvernements de ces États[17] (Ouganda en 2004, République démocratique du Congo en 2004 et République centrafricaine en 2005) de purger leur passé criminel en soumettant à la toute nouvelle juridiction internationale les personnes accusées de crimes graves et sanctionnés par le droit international[18]. Cette volonté s’est cependant avérée partiale à l’épreuve des inculpations opérées par le procureur de la Cour puisqu’elles n’ont concerné que des personnes en conflit avec les gouvernements concernés.
Il est donc légitime de s’interroger sur les réelles motivations politiques de ce plébiscite africain et sur la part exclusivement régionale des enquêtes ouvertes par la Cour. La résurgence des conflits armés non internationaux sur le continent africain offre, il est vrai, un véritable panel de compétences à la CPI, mais l’Afrique n’est pas le seul continent à abriter des conflits armés et encore moins les crimes pouvant fonder la compétence de la Cour. Il n’empêche qu’à l’heure où la CPI recherchait crédibilité et légitimité, les nombreux théâtres de conflit en Afrique lui ont offert un véritable point d’ancrage.
Les premières années d’activités de la CPI se sont caractérisées par une collaboration étroite entre l’Afrique et le premier procureur de la Cour, Luis Moreno-Ocampo, soucieux de vite incarner la légitimité de la juridiction. Ces prémices traduisaient la réalité d’intérêts politiques confluents. Les dirigeants africains pouvaient se débarrasser d’opposants politiques encombrants et la CPI inculper d’éventuels auteurs de crimes relevant de sa compétence. Entre une compétence de la Cour, restreinte aux crimes de génocide[19], aux crimes contre l’humanité[20], aux crimes de guerre[21] ainsi qu'aux crimes d’agression[22] et un principe de complémentarité qui ne permet la compétence de la Cour que si les autorités judiciaires de l’État concerné ne peuvent ou ne veulent pas connaître des crimes dont il est question[23], la CPI ne peut exercer sa compétence que dans de rares situations. À ce conflit de juridictions, les nombreux conflits internes en Afrique – et la faible opposition que pouvaient fournir ces États face à une action de la CPI, contrairement aux autres continents dont des États-clés disposent d’une qualité d’État permanent au sein du Conseil de sécurité et étaient fermement opposés au Statut de Rome (États-Unis, Chine, Russie) – offraient à la CPI les conditions favorables d’une action effective.
La CPI connaitra d’ailleurs sa première affaire sur saisine de l’Ouganda. Le président Museveni, dans le but d’enrayer la mécanique de violences et de victoires de l’Armée de Résistance du Seigneur dirigée par Joseph Kony contre les forces armées ougandaises s’est en effet dirigé vers la CPI en juin 2004. La Cour sera ensuite saisie par les autorités congolaises pour enquêter sur les massacres commis en Ituri (République démocratique du Congo)[24]. Ces situations vont fonder la légitimité judiciaire[25] de la CPI à travers l’exercice de sa compétence et un premier cycle de l’engagement des responsabilités individuelles pour les crimes les plus graves.
Les fondements juridiques à l’exercice de la compétence de la CPI sont variés et concernent un domaine large qui soulève de nombreuses critiques, notamment de l’UA, sur les réelles motivations de la Cour lorsqu’elle est saisie d’une affaire et de l’opportunité de la juger. L’exercice de cette compétence est de fait fortement soumise à un jeu politique qui décrédibilise l’action de la Cour. Sa politique répressive est ainsi délicatement éprouvée dès lors qu’elle agit en-dehors du cadre de collaboration des États qui se manifeste à travers leur droit de saisine, et est plutôt initiée par le procureur de la Cour et par le Conseil de sécurité des Nations unies.
Cette défiance à l’égard de la Cour est évidemment politique. Le jeu de puissance des relations internationales s’impose en effet à la juridiction pénale internationale. La compétence ratione loci de la Cour ne peut ainsi s’appliquer aux situations de conflits armés ayant entraîné des violations graves du DIH sur le territoire d’États n’ayant pas ratifié son Statut. Le déficit de crédibilité de la Cour est ainsi exacerbé par la non-adhésion des grandes puissances telles que la Fédération de Russie, l’Inde et surtout les États-Unis d’Amérique[26]. Cette non-adhésion traduit surtout la volonté de ces États de soustraire à la compétence de la Cour leurs ressortissants. Elle n’induit pourtant pas systématiquement un défaut de compétence de la Cour, sa saisine n’étant pas exclusivement conditionnée à la reconnaissance de compétence des États[27]. La Cour peut en effet exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions de son Statut,
si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies[28].
La position du Conseil de sécurité, déjà juridiquement contestable dans la création des tribunaux pénaux internationaux (TPIs)[29], est politiquement critiquable à ce niveau. Sans considération de la qualité d’État partie et en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies [30](Charte) qui lui confère le maintien de la paix et de la sécurité internationales, son pouvoir de saisine peut s’entendre mais n’échappe pas pour autant aux critiques. Ses membres, qui rejettent eux-mêmes l’existence de la Cour, permettent, cependant, la remise en cause de sa légitimité et de son action pacificatrice. Comment, en effet, légitimer une action de la CPI sur saisine du Conseil de sécurité sur la situation au Darfour[31], et donc au Soudan et en Libye[32], deux États non-parties au Statut de Rome, alors que trois États membres de ce Conseil de Sécurité (États-Unis, Chine et Russie) sur cinq n’ont pas encore ratifié ce statut? La réponse à cette question se trouve dans les rapports étroits qu’entretiennent maintien de la paix et justice pénale internationale. L’imbrication logique entre maintien de la paix et justice pénale internationale (qui a d’ailleurs motivé la création des tribunaux pénaux internationaux par le Conseil de sécurité) et le rôle de garant de la paix et de la sécurité internationales que lui confère l’article 24 de la Charte, légitiment d’un point de vue politique l’immixtion du Conseil de sécurité dans le pouvoir de saisine de la CPI. Cette critique serait moins forte si toutes les situations menaçant la paix et la sécurité internationale étaient soumises à la Cour par le Conseil de sécurité.
Le Procureur de la CPI n’a déclenché une procédure proprio motu[33] que trois fois : au Kenya[34], en Côte d’Ivoire[35] et en Géorgie[36]. Alors que la situation ivoirienne n’a sensiblement pas soulevé de polémique avec l’UA, dans le cas des violences post-électorales survenues au Kenya en 2007, la poursuite engagée directement contre un chef d’État en exercice, et cela par saisine directe du procureur, a véritablement entaché les relations entre la CPI et l’Afrique. Cette situation kenyane présentait pourtant un cas idoine de lutte contre l’impunité hors conflit. Plutôt que d’induire un énième débat sur la compétence de la Cour[37], cette initiative aurait pu, à défaut d’aboutir, inciter les dirigeants africains à promouvoir une application de la répression pénale aux niveaux national et régional. Elle a, au contraire, crispé l’opinion générale africaine, confortée dans l’action afrocentriste de la CPI[38]. L’émission de mandats d’arrêt en 2011 à l’encontre du président soudanais Omar Al-Bachir avait déjà posé les bases d’une rupture entre les dirigeants africains et la CPI. La première mise en accusation d’un dirigeant africain en exercice a manifestement altéré la coopération politique « cordiale » entre les États membres de l’UA et la CPI[39]. Cette coopération entre l’UA et la CPI, qui s’est vue déféré la situation au Soudan par la Résolution 1593[40], résulte pourtant d’une obligation pour l’UA conformément à la résolution précitée, mais surtout d’une combinaison des articles 25 et 27 de la Charte des Nations unies qui entrainent un caractère obligatoire pour l’exécution des décisions du Conseil de sécurité[41]. À cette obligation, l’UA va cependant opposer une fin de non-recevoir en demandant à ses États membres d’ignorer toute demande de la CPI en vue de l’arrêt et du transfert du président Al-Bashir[42]. Bien que privilégiant la restauration de la paix à la lutte contre l’impunité, sacrifiant ainsi la justice au profit de la paix[43], l’UA n’en occasionne pas moins pour ses États membres, ces derniers ayant suivi ses prescriptions, une violation de l’obligation de coopération des États membres de l’ONU. Les obligations des États membres en vertu d’un accord régional (l’Acte constitutif de l’Union africaine[44] en l’occurrence) ne sauraient en effet prévaloir sur leurs obligations envers la Charte des Nations unies en cas de conflit[45] de normes.
L’apport de la CPI dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes graves s’effrite également par le penchant exclusivement africain des situations connues par la Cour. L’Afrique n’est pourtant pas le seul continent qui abrite des conflits armés, source de violations graves du droit international humanitaire. L’Irak et la Syrie ont, au-delà de l’internationalisation de leurs conflits armés et des actes de terrorisme perpétrés, réuni toutes les conditions d’une répression pénale internationale. Cette distorsion dans l’application internationale du droit constitue l’un des arguments majeurs pour les pourfendeurs d’une juridiction politisée et partiale dans ses choix de poursuite. La Cour s’est ainsi aliéné l’UA, qui, ces dernières années, a souvent remis en cause la légitimité de ses activités sur le continent[46]. Cette dernière a ainsi, à l’issue du 26e Sommet de la Conférence des chefs d’État le 31 janvier 2016, adopté une proposition initiée par le président Uhuru Kenyatta pour la préparation d’une feuille de route sur le retrait massif des États africains de la CPI. Même si cette stratégie de retrait collectif demeure non contraignante et n’est pas prévue par le droit international[47], elle apporte un fort discrédit à l’action de la juridiction. Des trois États (Burundi[48], Afrique du Sud[49] et Gambie[50]) qui avaient déjà annoncé l’engagement d’une procédure de retrait du Statut de Rome, celle de l’Afrique du Sud apparaissait à double titre comme la plus marquante. Les présidents burundais (Pierre Nkurunziza) et gambien (Yaya Jameh) étant fréquemment accusés de violations graves de droits de l’homme, et potentiellement sujets à des poursuites pénales, la position sud-africaine semblait ainsi la plus neutre et revendicatrice d’une position panafricaniste. Les violations récurrentes des droits de l’homme au Burundi et en Gambie font en effet planer sur le chef des dirigeants de ces deux pays des risques de poursuite par la CPI. Cette position sud-africaine a constitué un prélude à la stratégie de retrait collectif entérinée par l’UA[51] à l’issue de son 28e sommet tenu à Addis-Abeba (30-31 janvier 2017). La connotation africaine des affaires de la CPI ne doit pas néanmoins occulter les violations graves des droits de l’homme sur ce continent. La tendance meurtrière des conflits armés en Afrique est évidemment réelle, et tout retrait de la CPI, seule juridiction pénale permanente compétente pour juger les crimes graves commis en Afrique, signifierait une garantie de l’impunité dont les dirigeants africains souhaiteraient se départir[52]. L’existence d’une juridiction alternative compétente pour les mêmes crimes que la CPI est ainsi indispensable avant tout retrait. Les vives critiques de l’UA à l’égard de la CPI devraient ainsi permettre la création à l’échelon régional d’une cour pénale régionale dotée des mêmes compétences que la Cour et dont la compétence territoriale se limiterait au continent africain.
En évoluant d’une justice exclusivement punitive des vaincus pour ses premiers cas, par nécessité légitimatrice, à une répression étendue aux vainqueurs, pour crédibiliser son action, la Cour est devenue « une institution judiciaire dans un environnement politique[53] », son soutien étant étroitement lié à la coopération des États et des institutions internationales. La CPI est ainsi devenue par la force de son fonctionnement une organisation internationale hybride (politique et judiciaire). N’ayant aucun bras armé et résolu à coopérer avec les États pour que ses mandats d’arrêt connaissent une exécution, l’action judiciaire de la CPI ne peut ainsi avoir un rôle répressif et dissuasif que si les États parties au Statut de Rome coopèrent avec l’institution.
Cette coopération, aux prémices encourageantes avec l’Afrique, bien que pouvant paraître partiale, aurait pu continuer si la concentration géographique des enquêtes de la Cour et surtout ses poursuites contre des gouvernants en exercice n’avaient braqué les présidents africains, si soucieux de la souveraineté de leurs États et inquiets du respect de leur immunité diplomatique. Même si les procédures contre Omar Al-Bashir et Uhuru Kenyatta n’ont pas entraîné un retrait massif des États africains du Statut de Rome, malgré les critiques, elles les ont incités à reconsidérer la question de l’immunité.
B. Les désaccords internationaux sur la question de l’immunité
L’UA et le Kenya ont échoué en 2009 et 2010 à obtenir du Conseil de sécurité qu’il sursoie aux procédures engagées contre les présidents Béchir et Kenyatta. En raison du refus passif du Conseil de sécurité dû à son silence en réponse à la demande formulée, les États africains ont profité de la Conférence de révision du Statut de Rome organisée à Kampala en Ouganda du 31 mai au 11 juin 2010 pour proposer un amendement à l’article 16 du Statut de Rome sur le sursis à enquêter ou à poursuivre[54]. Cet amendement avait pour objectif d’élargir le pouvoir accordé au Conseil de sécurité de surseoir à toute procédure de la CPI pendant douze mois à l’Assemblée générale. Le silence du Conseil de sécurité dans les deux cas précédemment évoqués aurait ainsi pu être surmonté puisque l’Assemblée générale aurait pu statuer sur la question en l’absence de réponse du Conseil de sécurité à toute demande de sursis dans un délai de six mois. Cette proposition d’amendement n’a cependant pas été retenue.
L’idée de cette proposition n’est point surprenante, les deux affaires Soudan et Kenya ayant notoirement altéré la bonne coopération qui existait entre la CPI et les États africains. Dès 2008, l’UA s’était en effet inquiétée de la requête faite par le procureur de la CPI à la Chambre préliminaire sur la base de l’article 58 du Statut de Rome d’émettre un mandat d’arrêt contre Omar Al-Bashir[55]. Cette position sera confirmée par le Conseil de paix et de sécurité dans une décision de 2009 dans laquelle elle note que la requête du procureur
intervient à un moment critique dans le processus visant à promouvoir une paix durable, la réconciliation et une gouvernance démocratique au Soudan, et souligne que la recherche de la justice devrait être poursuivie de manière à ne pas gêner ou mettre en péril la promotion de la paix[56].
L’UA n’a ainsi jamais voilé son choix dans le dilemme justice et paix et ignore de fait l’incidence de l’impunité à travers le risque qu’apporte l’immunité. Elle semble d’ailleurs ne pas croire en ce dilemme tant que la justice dont il est question concerne un des membres de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. Elle entend ainsi collaborer avec la CPI à la condition que les poursuites de celle-ci ne concernent que les criminels vaincus. La question de l’immunité des dirigeants africains s’oppose ainsi de facto aux deux modes de saisine qui échappent au contrôle unilatéral des États : la saisine par le Conseil de sécurité des Nations unies et l’ouverture d’une enquête par le procureur de sa propre initiative. Le Tchad en 2010, le Nigéria en 2013 et l’Afrique du Sud en 2015, pays respectivement hôtes du sommet annuel de l’UA, ont refusé d’exécuter le mandat d’arrêt contre Al-Bashir sur instruction de l’Union.
L’immunité diplomatique des personnes occupant des fonctions officielles au sein des États est un principe bien établi en droit international[57]. Si cette mesure soulève peu de difficultés devant les juridictions pénales nationales[58], le débat a été ouvert à l’occasion des jugements des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. L’un des apports de la justice pénale internationale est de distinguer la responsabilité pénale individuelle de la fonction (préalablement) occupée par la personne accusée. La gravité des crimes reprochés aux individus dans le cadre du droit pénal international et de la justice internationale qui a été mise en place semble échapper au risque d’impunité que pourrait faire courir le jeu des immunités des chefs d’État. Conséquence inhérente à ce principe de base, le rang officiel d’une personne dans la structure gouvernementale de son pays n’a aucune incidence et ne l’exonère nullement de la responsabilité criminelle qu’elle a pu encourir au cours de ses activités[59].
Si cela peut déjà s’avérer difficile à mettre en place lorsque cette responsabilité est soulevée alors que la personne accusée n’exerce plus ses fonctions officielles, mais peut néanmoins arguer son immunité, cela est encore plus complexe, voire impossible, lorsque ces personnes exercent encore leurs activités. En Afrique, deux cas ont largement illustré cette difficulté. Il s’agit des mandats d’arrêt émis contre Charles Taylor, alors président du Libéria, par le Tribunal spécial pour la Sierra Léone et contre Omar Al-Bachir, l’actuel président soudanais, par la CPI. Dans ces deux cas, l’immunité diplomatique dont ils jouissent ou ont pu jouir a empêché toute procédure à leur encontre pendant leur mandat.
Nonobstant le fait qu’en ratifiant le Statut de Rome, les États s’engagent en principe à respecter leurs obligations de coopération, l’UA semble fermement opposer la dynamique de la justice et la nécessité de la paix en invoquant le principe de l’immunité des hauts responsables africains. Cette immunité, principale conséquence de l’impunité des dirigeants africains, viderait pourtant de son sens l’idée même d’une justice pénale internationale. Prônant ouvertement le respect d’une immunité des hauts responsables étatiques devant les juridictions internationales, l’UA s’est ainsi fait rappeler à la conférence de Kampala que « l’impunité n’était plus une option pour les coupables des crimes les plus graves définis par le Statut de Rome[60] ».
Cette question de l’immunité des dirigeants africains devant des juridictions autres que nationales n’est pourtant pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée lorsque les tribunaux d’États occidentaux, forts de la compétence universelle prévue par leur législation nationale, avaient déclenché des poursuites contre des dirigeants africains anciens ou nouveaux. D’abord bilatéraux, ces incidents diplomatiques avaient été régionalisés dans les deux sens, puisqu’ils avaient fini par opposer l’UA à l’Union européenne.
La tension entre les deux Unions avait été exacerbée par l’ordonnance des juges français et espagnols favorable à des poursuites contre des dignitaires rwandais dont le président en exercice, Paul Kagamé, accusé de participation active dans l’attentat de 1994 contre l'avion du président Juvénal Habyarimana, élément déclencheur du génocide tutsi. Initiée par le Rwanda, la position de l’UA considèrera comme abusive « l’utilisation du principe de compétence universelle par des juges de certains États non africains contre des dirigeants africains, en particulier du Rwanda[61] ». Cette décision de l’organisation panafricaine a donné lieu à des rencontres avec l’Union européenne et la transmission d’un mémorandum au Conseil de sécurité des Nations unies sur la question de la compétence universelle[62].
L’« espace d’impunité[63] » laissé par les juridictions nationales incapables de juger des responsables de crimes internationaux rend finalement indispensable l'existence d’une compétence des juridictions internationales et d’un exercice de la compétence universelle. À défaut d’une amélioration immédiate de l’activité des tribunaux étatiques africains dans la lutte contre l’impunité des dirigeants, les intérêts confluents des États africains à s’insurger contre les poursuites engagées par des juridictions non africaines incitent l’UA et ses États membres à assurer l’effectivité des juridictions existantes. Contrairement aux relations entre les États et les juridictions internationales comme la CPI, dont la compétence serait vidée de son exercice par le jeu des immunités, les relations purement interétatiques ne peuvent l’ignorer. Le droit international conventionnel reconnait d’ailleurs les immunités personnelles à certains hauts responsables étatiques[64], immunités dont le respect participe au maintien de relations bilatérales cordiales.
II. Vers une africanisation de la justice pénale
L’appropriation régionale de la répression pénale des crimes internationaux commis en Afrique est l’un des principaux arguments invoqués par les dirigeants africains qui souhaitent un retrait collectif de la CPI. Cette perspective a d’ailleurs connu un tournant décisif à travers la création des Chambres extraordinaires africaines au sein du système judiciaire sénégalais, mais surtout l’élaboration, à travers le Protocole de Malabo[65] adopté en juin 2014, d’une section de droit international pénal au sein de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH). L’africanisation ainsi évoquée et abordée traduit dès lors une tendance, et non un contexte juridique établi, incarnée par une volonté de sanctionner en Afrique et par des juridictions africaines les violations graves du DIH qui y sont perpétrées. Bien que cette alternative contribue à la promotion d’une justice pénale régionale (A), le Protocole de Malabo ne permet pas d’envisager une efficacité réelle de la lutte contre l’impunité (B).
A. La promotion alternative d’une justice pénale régionale
La résurgence des conflits armés non internationaux en Afrique n’a cessé d’entraîner la répétition de nombreux crimes internationaux que l’instauration de juridictions ad hoc comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour la Sierra Léone n’auront pas su limiter. La création de la CPI laissait augurer une répression permanente face à ces crimes graves mais les récents remous entre cette juridiction et l’UA pourraient laisser craindre un ralentissement de la dissuasion judiciaire et de la lutte contre l’impunité.
Les limites diplomatiques de la compétence universelle mise en oeuvre dans certaines situations et l’internationalité du Tribunal pénal international pour le Rwanda ont manifestement nourri la nécessité d’une appropriation africaine de la lutte contre l’impunité. Surtout pensée pour la période post-conflit, la judiciarisation de la lutte contre les violations graves des droits de l’homme participe, pour peu que l’intention y soit, à la lutte contre l’impunité. La répression des crimes graves commis sur le continent africain devrait être mise en oeuvre sur ce même continent et par des juridictions africaines à défaut d’être nationales. Le rejet de l’impunité constitue d’ailleurs l’un des principes fondamentaux de l’UA et figure notamment dans son Acte constitutif[66]. La lutte contre l’impunité des personnes accusées de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre devrait ainsi parfaitement intégrer l’architecture africaine de paix et de sécurité sur le fondement des articles 3(h), 4 (h et o) relatifs au « [r]espect du caractère sacro-saint de la vie humaine et [à la] condamnation et [au] rejet de l’impunité[67] ». C’est d’ailleurs en s’appuyant sur ces articles que l’UA a considéré que les crimes reprochés à Hissène Habré, l’ancien président tchadien, relevaient de sa compétence. L’absence d’organe judiciaire continental pour le juger, malgré l’appropriation du dossier par l’UA[68], a ainsi largement participé à la nécessité pour l’UA de progressivement mettre en place une juridiction continentale.
Elle permettrait à l’Afrique de disposer d’une juridiction permanente pour lutter contre l’impunité et dotée en théorie de la même force rétributive que la CPI, tout en donnant forme à l’appropriation africaine de la répression pénale internationale. Les critiques sur l’africanisation de la CPI pourraient ainsi être évitées pour partie.
La création d’une Cour pénale africaine pourrait également permettre de rediriger les accords en vue de juger les auteurs de crimes graves sur le continent. Juridiction internationale à part entière, le Tribunal pénal international pour le Rwanda est né d’un compromis entre les Nations unies et la défunte organisation panafricaine (l’Organisation de l’Unité africaine)[69]. Le Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL), « une juridiction internationale nationalisée[70] », a mieux valorisé l’approche nationale puisqu’il est le résultat d’accords entre l’ONU et la Sierra Léone. Par la suite, l’UA, dans le cas du jugement des auteurs présumés des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, a permis la mise en place d’une juridiction nationale régionalisée : les Chambres extraordinaires au sein du système judiciaire sénégalais. Cette dernière juridiction, certes ad hoc, présente l’avantage d’être uniquement africaine, et l’essai pourrait se répéter s’il connaît un certain succès. Si paradoxalement cette compétence pénale régionale reconnue à la CAJDH est née de ce que l’UA considère comme étant un abus du principe de compétence pénale universelle par des États non africains à l’encontre des dirigeants africains[71], c’est cette même compétence universelle, certes africaine, qui a donné forme à la toute première juridiction africaine chargée de sanctionner Hissène Habré, l’ancien président de la République du Tchad.
La création
au sein des juridictions sénégalaises des chambres extraordinaires chargées de poursuivre le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale, et des conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal, commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990[72],
marque un grand pas pour l’Afrique et pour l’UA dans la régionalisation de la justice pénale internationale. Si réfractaire à l’idée de sanctionner ses (anciens) membres, la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA semble avoir cédé[73] aux nombreuses pressions internationales visant à juger et à faire condamner l’ancien président tchadien pour les crimes graves qu’il aurait commis au Tchad.
Tout en mettant en lumière le défaut d’une juridiction pénale régionale pour juger les auteurs de crimes graves que ses différents instruments juridiques sanctionnent, l’instauration des chambres extraordinaires africaines au sein des juridictions sénégalaises augure d’une nouvelle alternative judiciaire dans la lutte contre l’impunité. Non seulement elles permettront de poser des précédents juridiques profitables à la future CAJDH, mais elles offrent surtout à l’UA la première affaire afro-africaine dans laquelle un ancien président est jugé en Afrique par des juges nationaux[74]. La mise en place de ces juridictions ad hoc symbolisent ostensiblement la volonté des victimes de violations des droits de l’homme d’obtenir réparation, mais aussi et surtout la double obligation qu’elle implique pour les États africains : juger pour ne pas extrader et ne pas laisser impunis les crimes internationaux quelle que soit la qualité officielle des personnes poursuivies.
Accusé de crimes contre l’humanité, exterminations, tortures, actes de barbarie et disparitions forcées, c’est en réalité sur le fondement de la compétence universelle que l’ancien président tchadien est devenu le premier ancien chef d’État à faire l’objet d’une poursuite judiciaire continentale. La compétence universelle des juridictions sénégalaises en la matière a été juridiquement établie sur l’article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[75]. C’est pourtant l’acharnement des victimes et associations tchadiennes à l’origine de cette plainte qui permettra aux juridictions sénégalaises d’être aujourd’hui les premières à juger un ancien président. C’est en effet par le biais de la plainte déposée devant les juridictions belges en novembre 2000 sur le fondement de la compétence universelle que les victimes tchadiennes feront déclencher les nombreuses demandes d’extraditions formulées par le gouvernement belge aux autorités sénégalaises[76]. Cette compétence reconnue aux juridictions sénégalaises repose également sur la décision rendue par la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à la demande d'Hissène Habré[77], et l’arrêt de la Cour internationale de justice du 20 juillet 2012 invitant les autorités sénégalaises à extrader Hissène Habré à défaut de le juger[78].
Quoi qu’il en soit, la procédure actuelle à l’encontre de l’ancien président tchadien est de nature à constituer un précédent. Elle pourrait en effet inspirer d’autres procédures judiciaires fondées sur la compétence universelle des seuls États africains[79] ou sur demande de l’UA à tout État membre à l’encontre d’anciens responsables étatiques qui se seraient rendus coupables de crimes. Elle pourrait aussi et surtout encourager les États africains à de profondes réformes juridiques et institutionnelles comme l’a fait le Sénégal pour le cas Habré[80], ce qui permettrait aux États eux-mêmes d’inquiéter leurs (futurs) (anciens) dirigeants, même si cela peut bien entendu provoquer un effet pervers. Ces mêmes dirigeants, craignant d’être poursuivis, pourraient s’éterniser au pouvoir. Ces procédures judiciaires devraient surtout symboliser une lutte effective contre l’impunité et corrélativement avoir un effet dissuasif sur la commission éventuelle de crimes graves susceptibles d’altérer le maintien de la paix.
La création d’une Cour pénale africaine pourrait aussi assurer la mise en oeuvre d’un principe de « complémentarité positive[81] » préconisé par l’UA pour améliorer les systèmes judiciaires nationaux. Régie par le principe de complémentarité, la CPI n’a pas véritablement permis aux juridictions nationales de se développer. Leur capacité à juger les éventuels criminels sur leur territoire comporterait pourtant un aspect déterminant dans l’africanisation de la lutte contre l’impunité. Le problème de l’extra-territorialisation des juridictions pourrait également être évité. Une justice pénale régionale pourrait soutenir les juridictions nationales dans leur lutte contre l’impunité, et cela allègerait d’ailleurs les éventuelles contraintes techniques, logistiques et financières auxquelles devrait faire face une juridiction unique. Cette justice pénale régionale semble prendre corps depuis l’élaboration du Protocole de Malabo.
La création de la CAJDH résulte du Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté en juillet 2008[82] par la Conférence de l’Union africaine. Elle est née de la fusion de deux juridictions que sont la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples[83] et la Cour de justice[84] comme prévu par les sessions de 2004 et 2005[85]. La fusion de ces deux cours en une cour unique a d’abord donné lieu à la création de deux sections : la section des affaires générales (correspondant à la Cour de justice de l’Union africaine (CJUA)) et la section des droits de l’homme (reprenant les attributions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)). La CAJDH n’est cependant pas encore opérationnelle, le Protocole l’ayant créée n’étant pas encore entré en vigueur[86]. L’UA a néanmoins adopté le Protocole de Malabo en juin 2014[87] qui crée une troisième section consacrée au droit pénal international au sein de la CAJDH. Pour le professeur Stéphane Doumbé-Billé, la création de la Cour unique ne devrait cependant pas entraîner une véritable amélioration de la « réputation funeste » de l’Afrique à sanctionner les violations récurrentes des droits de l’homme[88]. La fusion du contentieux lié aux violations des droits l’homme (qui relevait de la compétence de la CADHP) et du recours institutionnel des États et organes de l’Union (qui relevait de la compétence de la CJUA) par une institutionnalisation de jure entraîne une banalisation de facto de la juridictionnalisation des droits de l’homme, ces derniers ne relevant d’ailleurs que de l’une des deux sections de la nouvelle Cour par le truchement de l’article 16 de son Statut[89].
Si les récurrentes menaces de retrait massif des États membres de l’UA du Statut de Rome[90] pouvaient laisser présager une rapide opérationnalisation de la CAJDH, il n’en a rien été. Il est même paradoxal de constater que l’entrain des dirigeants africains à élaborer ce Protocole de Malabo contraste avec l’état des ratifications. Alors que le Statut de Rome a été ratifié par 34 États africains, le nombre restreint (cinq) des États l’ayant fait pour le Protocole portant Statut de la CAJDH reste peu significatif alors que 15 ratifications sont exigées pour son entrée en vigueur, soit moins du tiers des États membres de l’UA. La lente opérationnalisation de cette juridiction, malgré les demandes d’accélération de la Conférence de l’Union africaine[91], impacte fondamentalement la compétence matérielle très large de la Cour. En sus des crimes sanctionnés par le Statut de Rome à son article 5, le Protocole de Malabo, donne compétence à la Cour pour les crimes relatifs au changement anticonstitutionnel de gouvernement, la piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la corruption, le blanchiment d’argent, la traite des personnes, le trafic illicite de stupéfiants, le trafic illicite de déchets dangereux et l’exploitation illicite des ressources naturelles[92].
L’institution d’une section pénale à la CAJDH soulève néanmoins d’éventuelles questions sur les relations entre cette dernière et la CPI, leur champ de compétence étant quasiment identique. Une concurrence de juridiction n’est en effet pas à exclure dans les situations concernant les États liés à la fois par le Statut de Rome et par le Protocole de Malabo. Ce dernier n’a envisagé que la seule hypothèse d’une relation de complémentarité avec les juridictions nationales et les Cours communautaires africaines[93] et non avec la CPI. La question d’une primauté de compétence de l’une ou l’autre des deux juridictions reste en suspens et crée donc pour les États ayant ratifié les deux statuts une obligation indépendante de coopération. En l’état actuel des textes, il existe un risque d’obligations concurrentes pour les États liés par les deux traités et de compétences concurrentes pour les deux juridictions.
Le volet judiciaire ainsi considéré pourrait raisonnablement accélérer le processus de régionalisation de la gestion des affaires africaines par l’Afrique elle-même et réduire ainsi les critiques liées à l’impérialisme judiciaire. Il faut malheureusement craindre qu’il ne soit limité par une instrumentalisation politique[94] qui permettrait aux dirigeants africains d’échapper à toute justice tout en éliminant leurs adversaires politiques grâce à cette Cour. Cette juridiction souhaitée et le contexte dans lequel son opérationnalisation a été accélérée laissent en effet craindre des motivations troubles des chefs d’État africains et préjudiciables à la lutte contre l’impunité et à la dissuasion judiciaire.
B. Les implications équivoques de la régionalisation de la justice pénale
L’UA n’a pas attendu la création de la CAJDH pour disposer d’une juridiction en charge de la lutte contre l’impunité. Elle disposait déjà en effet d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, même si celle-ci demeurait inopérante. Ce constat posé, malgré la réelle avancée que constitue la création de la CAJDH, le contexte dans lequel cette création a été avancée laisse présager une ineffectivité de la Cour avant même qu’elle ne soit opérationnelle.
Cette création intervient à une période où les relations tendues entre la CPI et l’UA laissent supposer une certaine orientation politique des activités de la Cour. L’UA, encouragée par les autorités kenyanes, a usé de tous les subterfuges pour empêcher toute action de la CPI contre des dirigeants africains. Contestant d’abord l’article 27 du Statut de Rome[95] qui permet à la Cour de mener des enquêtes sans considération du statut officiel des accusés[96], elle a ensuite souhaité le dessaisissement de la CPI au profit des juridictions kenyanes[97]. Les chefs d’État africains n’ont cependant pu obtenir que « la question de l’inculpation des chefs d’État et de gouvernement africains en exercice, par la CPI, et ses conséquences pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans les États membres de l’UA[98] » soit examinée et acceptée par la CPI, fort heureusement[99]. Ils ont néanmoins réussi à inclure cette disposition dans le Protocole portant création de la CAJDH.
Ces affaires ont en effet encouragé les chefs d’État africains à inclure par amendement une disposition spéciale au Statut de la future Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme qui prévoit l’immunité pour les chefs d’État et autres agents gouvernementaux. Absente du Protocole initial de Sharm El-Sheikh, cette disposition prévoit que :
aucune accusation ne sera déposée devant la Cour contre un chef d’État ou de gouvernement de l’Union africaine en exercice, aucune personne exerçant ou autorisée à exercer ces fonctions, ou tout autre haut représentant de l’État sur la base de leurs fonctions, pendant la durée de leur mandat[100].
Outre le fait que cette disposition contrevienne de manière flagrante à l’article 27 du Statut de Rome, qu’elle entraînera inéluctablement des obligations contradictoires pour les États parties au Statut de Rome et ceux qui ratifieront le Protocole de Malabo et qu’elle porte atteinte à l’intégrité de la Cour elle-même[101], elle conduira surtout à une consécration de l’impunité des dirigeants africains. Cette immunité a pourtant soulevé de nombreuses interrogations au cours des débats ministériels qui ont précédé son adoption, notamment en raison de sa non-conformité avec le droit international[102], mais également avec certaines législations nationales.
Qui plus est, cette immunité ne prévalant que pour les autorités exerçant des fonctions étatiques, elle risque d’encourager les chefs d’État en exercice accusés des crimes punis par le Protocole de Sharm El-Sheikh à s’éterniser au pouvoir pour échapper à toute condamnation. C’est d’ailleurs en ce sens que l’on peut interpréter l’une des motivations de maintien au pouvoir de l’ancien président gambien Yaya Jammeh (soupçonné de violations graves de droits de l’homme) malgré son échec aux élections présidentielles de décembre 2016. Son départ après les fortes menaces de la CEDEAO a d’ailleurs permis aux nouvelles autorités gambiennes de réitérer leur attachement à la CPI[103] alors que le gouvernement précédent avait entamé une procédure de retrait le 10 novembre 2016[104]. Convenons avec Mutoy Mubiala qu’il n’est « dès lors, pas exagéré d’affirmer que l’article 46 A bis du Protocole de Malabo comporte des éléments belligènes[105] ».
Au-delà des implications personnelles, la clause d’immunité induit une contradiction avec certains objectifs et principes fondamentaux de l’UA. La protection des droits de l’homme, maintes fois rappelée dans l’Acte constitutif et dans plusieurs autres instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme (notamment dans le préambule et dans les articles 3 (h) ou 4 (m)), serait ainsi réduite en raison de cette clause d’immunité qui empêcherait le déclenchement de la responsabilité pénale de personnalités politiques, nonobstant le fait que le Protocole de Malabo est resté silencieux sur la qualité de « haut représentant de l’État ». Il permet ainsi de soustraire à la dissuasion judiciaire les principaux auteurs de crimes internationaux, à savoir les chefs d’État et leurs principaux opposants (politiques ou militaires). Cette limitation de la compétence ratione personae renvoie, contrairement à l’idée d’un développement de la lutte régionale contre l’impunité, à une instrumentalisation politique qui préserverait les intérêts des dirigeants africains et punirait leurs opposants.
La partialité de la justice pénale internationale semble être un sentiment partagé par les dirigeants africains. L’accumulation des affaires africaines à la CPI alors que le continent est loin de réunir l’exclusivité des situations de violations graves du droit international humanitaire peut d’ailleurs exacerber ce sentiment et accréditer l’idée d’une juridiction au service politique de l’occident et donc à caractère néocolonialiste. Cet argument, s’il en est, doit cependant être nuancé à la lumière des crimes graves commis en Afrique et de l’exonération de responsabilité qui semble motiver les relations tendues entre les dirigeants africains et la Cour. Les mandats délivrés par la CPI restent idéalement des éléments pacificateurs. Quelles que soient les critiques, fondées ou non, à l’encontre de la CPI, il demeure que son activité, voire sa seule existence, apparaît comme dissuasive dans de nombreuses situations. Son seul et véritable écueil en réalité est de se limiter et de se contenter des seules situations africaines. Ces situations n’en sont pas moins condamnables pour autant. Aucune situation africaine soumise à la Cour ne paraît a priori excessive. Cause médiate de l’impunité, l’immunité peut dans certains cas permettre la fin des atrocités commises en cours de conflit. C’est notamment ce qu’affirme le professeur Payam Akhavan : « [t]he assumption is that leaders facing threats of prosecution are more likely to prolong conflicts that keep them in power whereas immunity increases the incentives to end atrocities[106] ». Le manque de coopération des États reste évidemment un problème, mais il n’est pas une objection rédhibitoire à la dissuasion[107]. Même rejetée, l’activité de la Cour aura au moins permis l’instauration d’un meilleur volet judiciaire dans la pacification du continent à une Afrique plus soucieuse des efforts de maintien de la paix. L’impunité suggérée par le Protocole de Malabo au profit des personnes disposant d’une certaine qualité officielle laisse cependant douter de l’efficacité d’une juridiction censée incarner l’africanisation souhaitée de la justice pénale internationale, alors qu’elle est encore ineffective.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].
-
[2]
Dès 1872, Gustave Moynier, l’un des pères fondateurs du Comité International de la Croix Rouge, imaginait à travers un projet la création d’une institution judiciaire internationale qui serait notamment chargée de poursuivre les contrevenants à la toute première Convention de Genève qui accordait notamment la neutralité des personnels sanitaires, des ambulances et hôpitaux de campagne appartenant aux services sanitaires des armées et aux sociétés de secours. À travers cette initiative, il amorcera un long processus qui se concrétisera en 2002 avec la mise en place de la CPI. Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève » (1872) 11 Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés aux pp 122-31; Véronique Harouel-Bureloup, « La préfiguration de la CPI chez Gustave Moynier » (2010) Grotius International, en ligne : Grotius.fr <www.grotius.fr/la-prefiguration-de-la-cpi-chez-gustave-moynier/>; Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Pas de paix sans justice? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, à la p 73 [Jeangène Vilmer].
-
[3]
La compétence universelle est « le système donnant vocation aux tribunaux de tout État sur le territoire duquel se trouve l’auteur de l’infraction pour connaître cette dernière quel que soit le lieu de perpétration de l’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime »; Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal : termes choisis, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, sub verbo « compétence universelle ».
-
[4]
Mutoy Mubiala, « Chronique de droit pénal de l'Union africaine. Vers une justice pénale régionale en Afrique » (2012) 83:3 Rev IDP 547 à la p 548 [Mubiala].
-
[5]
Une seule des dix situations ouvertes devant la Cour est non africaine. Il s’agit de la situation en Géorgie ouverte devant la Cour (8 octobre 2015) par notification de sa procureure Mme Fatou Bensouda dans le cadre des crimes commis durant le conflit armé de 2008 et pouvant entraîner la compétence de la Cour.
-
[6]
Le Statut de Rome créant la CPI a été adopté le 17 juillet 1998 par 120 États et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 avec le dépôt du 60e instrument de ratification. La compétence ratione temporis est évoquée à l’article 11 du Statut.
-
[7]
Statut de Rome, supra note 1, art 5. Il s’agit des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des crimes d’agression. Cette dernière catégorie de crimes ne pourra cependant être connue de la CPI qu’à partir du 1er janvier 2017 (décision prise lors de la Conférence des États-parties à Kampala en 2010).
-
[8]
Neuf des dix situations et les 23 affaires actuellement sujettes aux enquêtes de la Cour portent sur des crimes perpétrés en Afrique par des Africains. CPI, « 24 affaires », en ligne : icc-cpi.int <www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?ln=fr#>.
-
[9]
Statut de Rome, supra note 1 préambule.
-
[10]
Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa, La Cour pénale internationale : Institution nécessaire aux pays des grands lacs africains. La justice pour la paix et la stabilité en R-D Congo, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, Paris, L’Harmattan, 2006.
-
[11]
Par ordre chronologique d’adhésion : Ghana (20 décembre 1989), Mali (16 août 2000), République unie de Tanzanie (20 août 2000), Lesotho (6 septembre 2000), Botswana (8 septembre 2000), Sierra-Léone (15 septembre 2000), Gabon (20 septembre 2000), Afrique du Sud (27 novembre 2000), Nigéria (27 septembre 2001), République centrafricaine (3 octobre 2001), Bénin (22 janvier 2002), Maurice (5 mars 2002), Niger et République démocratique du Congo (11 avril 2002), Ouganda (14 juin 2002), Namibie (25 juin 2002), Gambie (28 juin 2002), Malawi (19 septembre 2002), Djibouti (5 novembre 2002), Zambie (13 novembre 2002), Guinée (14 juillet 2003), Burkina Faso (16 avril 2004), Congo (3 mai 2004), Burundi (21 septembre 2004), Libéria (22 septembre 2004), Kenya (15 mars 2005), Les Comores (1er novembre 2006), Tchad (1er janvier 2007), Madagascar (14 mars 2008), Seychelles (10 août 2010), Tunisie (24 juin 2011), Cap-Vert (11 octobre 2011) et la Côte d’Ivoire (15 février 2013).
-
[12]
Pour les autres États Parties, on compte 19 États d’Asie et du Pacifique, 18 États d’Europe orientale, 28 États d’Amérique latine et des Caraïbes, et 25 États du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États. La liste complète des États membres est disponible sur le site web de la CPI. CPI, en ligne : icc-cpi.int <www.icc-cpi.int/fr>.
-
[13]
Même si la Cour ne peut être entachée à première vue d’une connotation de « justice des vainqueurs », il faut reconnaitre que la date d’adhésion de certains États africains au Statut de Rome coïncide avec des périodes de sortie de crise qui ont permis des changements à la tête des États. Si les trois premiers cas de saisine de la CPI l’ont été par des gouvernements d’États africains (Ouganda et RDC en 2004 et République centrafricaine en 2005), la Côte d’Ivoire en 2013 et la Tunisie (seul État du Maghreb à avoir signé et ratifié le Statut de Rome) en 2011 ont rejoint le contingent des États dont des acteurs vaincus du conflit sont sujets à des poursuites de la CPI.
-
[14]
Les 11 pays africains ayant signé sans ratifier le Statut de Rome au 15 mars 2017 : Algérie, Angola, Cameroun, Égypte, Érythrée, Guinée-Bissau, Maroc, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, Soudan et Zimbabwe.
-
[15]
Les bâtiments et procès de la CPI se tiennent en effet de manière permanente à la Haye aux Pays-Bas conformément aux dispositions de l’article 3 du Statut de Rome.
-
[16]
Exemples récurrents : Joseph Kony, opposant direct au régime ougandais, de Thomas Lubanga ou de Germain Katanga pour la RDC et surtout de Jean-Pierre Bemba opposés au président Joseph Kabila, de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour la Côte d’Ivoire.
-
[17]
La compétence de la Cour est abordée à l’article 13 du Statut de Rome en ces termes : « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 ». Statut de Rome, supra note 1, art 13.
-
[18]
Il faut également signaler qu’en 2012, à la suite de la crise politico-militaire interne qui aurait éventuellement occasionné la commission de crimes de guerre, le gouvernement malien a renvoyé à la CPI l’ensemble de la situation prévalant sur son territoire depuis janvier 2012.
-
[19]
Statut de Rome, supra note 1 art 6.
-
[20]
Ibid, art 7.
-
[21]
Ibid, art 8.
-
[22]
Quant aux crimes d’agression, la Cour n’aura compétence à leur égard qu’à compter du 1er janvier 2017 comme convenu lors de la conférence de révision du Statut de Rome qui s’est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010. En complément de l’article 8 du Statut de Rome, est proposé un article 8 bis rédigé comme suit : « 1. Aux fins du présent Statut, par "crime d’agression" on entend l’organisation, la préparation, le lancement ou l’exécution, par une personne capable d’exercer un contrôle effectif ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par son caractère, sa gravité et son échelle, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies. 2. Aux fins du paragraphe 1, par “acte d’agression” on entend le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou tout autre acte similaire incompatible avec la Charte des Nations unies. On entend par acte d’agression l’un quelconque des actes ci-après, indépendamment d’une éventuelle déclaration de guerre, conformément à la Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l’Assemblée générale des Nations unies : (a) Le fait pour des forces armées d’un État d’envahir ou d’attaquer le territoire d’un autre État, ou d’occuper militairement, peu importe la durée, en conséquence d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou d’annexer par le recours à la force le territoire d’un autre État; (b) Le fait pour des forces armées de bombarder ou de diriger des armes contre le territoire d’un autre État; (c) Le fait pour des forces armées de bloquer les ports ou les côtes d’un autre État; (d) Le fait pour des forces armées d’attaquer les forces de terre, de mer ou de l’air ou les flottes marine ou aérienne d’un autre État; (e) Le fait pour un État d’avoir recours à ses forces armées alors que celles-ci sont stationnées, avec son accord, sur le territoire d’un autre État en violation des conditions prévues par l’accord ou de prolonger sa présence sur le territoire après l’expiration de l’accord; (f) Le fait pour un État de mettre son territoire à la disposition d’un autre État pour que celui-ci commette un acte d’agression contre un État tiers; (g) Le fait pour ou au nom d’un État d’envoyer des groupes armés ou des mercenaires, mener contre un autre État des actes militaires dont la gravité ou les implications sont équivalentes à celles des actes listés ci-dessus ». Coalition for the International Criminal Court, en ligne : <www.iccnow.org/?mod=swgca-proposal>.
-
[23]
Statut de Rome, supra note 1, art 17.
-
[24]
Cette saisine de la CPI par les États est prévue aux articles 13 a) : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 » qui dispose que « Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes ». Statut de Rome, supra note 1, art 13a.
-
[25]
Grégory Berkovicz, La place de la Cour pénale internationale dans la société des États, Paris, L’Harmattan, 2005 aux pp 103-87.
-
[26]
Initiateurs au sein du Conseil de sécurité des Nations unies des juridictions pénales ad hoc, les États-Unis ne rejettent pas en réalité l’existence d’une juridiction pénale internationale permanente. C’est plutôt l’étendue des compétences de la Cour qui, telles qu’élaborées, pourraient s’appliquer aux troupes américaines intervenant à l’étranger, et le pouvoir d’initiative du procureur de la Cour qui de fait échappe au contrôle des États qui ont limité leur volonté d’adhésion. Julien Detais, « Les États-Unis et la Cour pénale internationale » (2003) 3 Droits fondamentaux 31 aux pp 31-50.
-
[27]
Dans certains cas, même lorsque l’État en cause n’est pas partie au Statut de Rome, certains crimes échappant ratione loci à la compétence de la CPI peuvent lui être déférés. Cette possibilité est ouverte à l’article 13b du Statut de Rome, supra note 1.
-
[28]
Statut de Rome, supra note 1, art 13 (b). C’est d’ailleurs sur le fondement de cet article que les situations darfourienne et libyenne ont été déférées au procureur.
-
[29]
Directement créés par le Conseil de sécurité, les tribunaux pénaux internationaux traduisent une certaine orientation politique de la justice pénale internationale voulue par les États membres permanents de cet organe restreint. Créés sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, les juridictions ad hoc que sont les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie témoignent d’une justice orientée (le Statut étant élaboré de manière assez peu démocratique puisque limité à la seule volonté du Conseil de sécurité) et plutôt autoritaire (due à la primauté de compétence de ces TPIs sur les juridictions nationales par une coopération obligatoire).
-
[30]
Charte des Nations unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n°7 [Charte des Nations unies].
-
[31]
Doc off CS, 5519e séance, Doc NU S/RES/1593 (2005) [Résolution 1593].
-
[32]
Doc off CS, 6498e séance, Doc NU S/RES/1970 (2011).
-
[33]
Statut de Rome, supra note 1, art 15.1 : « Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ».
-
[34]
Situation en République du Kenya, ICC-01/09, Décision relative à la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l'article 15 du Statut de Rome (31 mars 2010) (CPI, Chambre préliminaire II), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr#cases>.
-
[35]
Situation en République de Côte d'Ivoire, ICC-02/11-1-tFRA, Décision assignant la situation en République de Côte d’Ivoire (3 octobre 2011) (CPI, Chambre préliminaire II), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/cdi?ln=fr>.
-
[36]
Situation en Géorgie, ICC-01/15-12, Décision relative à la demande du procureur pour une autorisation d'enquête (27 janvier 2016) (CPI, Chambre préliminaire I), en ligne : CPI <www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF>.
-
[37]
Marie Gibert, « La Cour pénale internationale et l’Afrique, ou l’instrumentalisation punitive de la justice internationale? » (2015) 97:1 Revue internationale et stratégique 111 à la p 115, citant David Bosco, Rough Justice. The International Criminal Court in a World of Power Politics, Oxford, Oxford University Press, 2014 à la p 160.
-
[38]
Ibid à la p 116.
-
[39]
Martyna Falkowska et Agatha Verdebout, « L’opposition de l’Union africaine aux poursuites contre Omar Al-Bashir : analyse des arguments juridiques avancés pour entraver le travail de la Cour pénale internationale et leur expression sur le terrain de la coopération » (2012) 45:1 Rev b dr Intern 201 aux pp 201-35.
-
[40]
Résolution 1593, supra note 31.
-
[41]
Paul Tavernier, « Article 27 » dans Jean-Pierre Cot et Allain Pellet, dir, La charte des Nations unies - Commentaire article par article, 3e éd, Paris, Economica, 2005, 935 aux pp 935-57.
-
[42]
UA, Assemblée générale, Session spéciale sur l’examen et le règlement des conflits en Afrique, Renforcer la détermination de l’Afrique et l'efficacité de son action pour mettre un terme aux conflits et promouvoir durablement la paix, Doc off UA SP/ASSEMBLY/PS/RPT(I) (2009) au para 60.
-
[43]
Dandi Gnamou-Petauton, « Les vicissitudes de la justice pénale internationale : à propos de la position de l’Union africaine sur le mandat d’arrêt contre Omar Al-Bashir », dans Jean-François Akandji-Kombé, dir, L’homme dans la société internationale : Mélanges en hommage au Pr Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, 1255 aux pp 1278-83.
-
[44]
Acte constitutif de l’Union africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess (entrée en vigueur : 26 mai 2001) [Acte constitutif].
-
[45]
Charte des Nations unies, supra note 30, art 103.
-
[46]
Jean Ping, l’ancien Président de la Commission de l’UA, s’insurgeait en ces termes, lors du 16e sommet de l’Union tenu à Malabo (Guinée équatoriale) en fin juin et début juillet 2011, soulignant ainsi le « deux poids deux mesures » de l’institution : « […] premièrement nous sommes pour la lutte contre l'impunité, nous ne sommes pas pour l'impunité […]. Pourquoi il n'y a personne d'autre à juger que des Africains? C'est la question que l'on se pose. Il y a eu des problèmes au Sri Lanka, il [le procureur Luis Moreno-Ocampo] n'a pu rien faire. Il n'a pas osé. Il y a eu des problèmes à Gaza (Palestine) comme vous le savez, il n'a pu rien faire, il y a eu des situations comme ce qui se passe en Irak où sur la base de mensonges, il y a eu un demi-million de morts, il n’a rien fait. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue avec lui [Luis Moreno-Ocampo], on dirait que c'est seulement en Afrique qu'il y a des problèmes ». « Justice internationale : le coup de poing de Ping contre la CPI » (22 septembre 2011), Ouestaf News, en ligne : <www.ouestaf.com/Justice-internationale-le-coup-de-poing-de-Ping-contre-la-CPI_a3735.html>.
-
[47]
En l’occurrence, l’article 127 du Statut de Rome ne prévoit qu’un retrait individualisé des États, et cela par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Statut de Rome, supra note 1, art 127.
-
[48]
Notification de retrait du Burundi, notification dépositaire C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10, 27 octobre 2016.
-
[49]
Déclaration de la République sud-africaine sur la décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, notification dépositaire C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10, 19 octobre 2016.
-
[50]
Notification de retrait de la Gambie, notification dépositaire C.N.862.2016.TREATIES-XVIII.10, 10 novembre 2016 [Retrait de la Gambie].
-
[51]
Ce principe de retrait collectif n’a pas pour autant emporté un accord unanime des dirigeants de l’Union. Le Sénégal, dont le ministre de la justice Sidiki Kaba est également président de l’Assemblée des États parties de la CPI depuis 2014, le Nigéria et la Côte d’Ivoire se sont fermement opposés à tout retrait.
-
[52]
C’est d’ailleurs en ces termes que s’est exprimé Sidiki Kaba, président de l’Assemblée des États Parties sur le processus de retrait du Burundi du Statut de Rome. CPI, communiqué, ICC-CPI-20161014-PR1244, « Déclaration du président de l’Assemblée des États Parties relatif au processus de retrait du Burundi du Statut de Rome » (14 octobre 2016), en ligne : Assemblée des États parties presse et médias <asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1244.aspx>.
-
[53]
Philippe Kirsch, « La Cour pénale internationale de Rome à Kampala » (2011) 12 AFRI 1 aux pp 7-15.
-
[54]
Statut de Rome, supra note 1, art 16, sur le sursis à enquêter ou à poursuivre : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »
-
[55]
UA, Conseil de Paix et de Sécurité, 142e réunion, Doc off UA PSC/MIN/Comm (CXLII) (2008).
-
[56]
UA, Conseil de Paix et de Sécurité, 175e réunion, Doc off UA PSC/PR/Comm (CLXXV) Rev. 1 (2009).
-
[57]
D’origine coutumière, l’immunité diplomatique a été formalisée dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
-
[58]
Ce principe a largement été défendu par la Cour internationale de justice dans : Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c Belgique), [2002] CIJ rec 3 au para 54 [RDC c Belgique].
-
[59]
Christian Tomuschat, « La cristallisation coutumière » dans Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, dir, Droit international pénal, 2e éd, Paris, CEDIN, 31 aux pp 31-33.
-
[60]
Coalition pour la Cour pénale internationale, Rapport de la première Conférence de révision du Statut de Rome, 31 mai-11 juin 2010 à la p 4, en ligne : www.iccnow.org/documents/RC_report_fr_web.pdf>.
-
[61]
UA, Conférence de l’Union africaine, 13e sess, Décision sur le rapport relatif à l'utilisation abusive du principe de compétence universelle, Doc off UAAssembly/AU/Dec. 199 (XI) (2009) à la p 2.
-
[62]
UA, Memorandum on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction, document inédit, 2008 [Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction].
-
[63]
Fannie Lafontaine, « La compétence universelle et l’Afrique : ingérence ou complémentarité? » (2014) 45:1 Études internationales 129 à la p 131.
-
[64]
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, 500 RTNU 95 (entrée en vigueur : 24 avril 1964); Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963, 596 RTNU 261 (entrée en vigueur : 19 mars 1967).
-
[65]
UA, Conférence de l'Union africaine, 23e sess, Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (Protocole de Malabo), Doc off UA (2014) [Protocole de Malabo].
-
[66]
Acte constitutif, supra note 44, art 4 (o).
-
[67]
Ibid.
-
[68]
UA, Conférence de l’Union Africaine, 7e sess, Décision sur le procès d’Hissène Habré et l’Union Africaine, Doc off UA Assembly/AU/Dec. 127 (VII) (2006).
-
[69]
Arnaud Bébien, « Union Africaine : une justice continentale en construction » (1er février 2014) Grotius International, en ligne : <www.grotius.fr/union-africaine-une-justice-continentale-en-construction/>.
-
[70]
Anne-Charlotte Martineau, Les juridictions pénales internationalisées : un nouveau modèle de justice hybride?, Paris, Pedone, 2007 à la p 114.
-
[71]
Le préambule du Protocole de Malabo rappelle notamment sur cet aspect sa précédente décision Assembly/AU/Dec.213 (Xll) adoptée par la vingtième session ordinaire de la Conférence à Addis-Abeba (République fédérale d’Éthiopie) en février 2009 portant sur la mise en oeuvre de la décision de la Conférence sur l’abus du principe de compétence universelle. Protocole de Malabo, supra note 65 préambule.
-
[72]
Projet d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République du Sénégal sur la création de Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, Dakar (Sénégal), 22 août 2012.
-
[73]
C’est en effet par sa décision 127 (VII) adoptée lors de sa septième session ordinaire à Banjul (Gambie) du 1er au 2 juillet 2006 que la Conférence de l’Union africaine a décidé du cas judiciaire Hissène Habré. Par cette décision, la Conférence a décidé de faire sien le dossier Hissène Habré et a mandaté la République du Sénégal de le faire juger au nom de l’Afrique, par une juridiction sénégalaise compétente. Voir UA, Decision on the Hissene Habré case and the African Union, Doc. Assembly/AU/Dec. 127 (VII) (2006) 21.
-
[74]
Cette dernière précision a pour but de distinguer le caractère internationalement hybride du TSSL, qui, en sus d’être la résultante d’un accord entre le gouvernement sierra-léonais et les Nations unies (à la suite de la Résolution 1315 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 14 août 2000), est composé de juges internationaux même si la juridiction est intégrée au système judiciaire sierra-léonais.
-
[75]
« 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. 2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. » Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 RTNU 85, art 4 (entrée en vigueur : 26 juin 1987).
-
[76]
Un premier mandat d’arrêt sera délivré le 19 septembre 2005 par les juridictions belges sur le fondement de la compétence universelle dont avaient profité les victimes tchadiennes qui avaient ainsi pu déposer une plainte le 30 novembre 2000. S’en suivront deux autres demandes d’extraditions au cours de l’année 2011, toutes rejetées par les juridictions sénégalaises.
-
[77]
Sur demande de l’ancien président en 2010, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un arrêt en date du 18 novembre 2010 indiquant que « le mandat reçu par le Sénégal de l’UA, lui confère plutôt une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et à faire juger Hissène Habré dans le cadre strict d’une procédure spéciale ad hoc à caractère international tel que pratiquée en droit international par toutes les nations civilisées ». Mamadou c Niger (2010), CEDEAO, décision n°E.C.W/CCJ/JUD/06/10; Kémoko Diakité, La justice pénale internationale en Afrique : Aspects juridiques, défis et perspectives, Paris, L’Harmattan aux pp 60 et s [Kémoko Diakaté].
-
[78]
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), [2012] CIJ rec 422 à la p 422 [Belgique c Sénégal].
-
[79]
Les nombreuses situations africaines se développant au gré de la compétence universelle devant les juridictions d’États européens tels que la Belgique dans l’affaire Yérodia (du nom de l’ancien ministre des affaires étrangères de la RDC) et dans l’affaire Habré. Ces deux situations ont entraîné des différends (entre la Belgique et la RDC pour l’Affaire Yérodia et le Sénégal pour l’Affaire Habré) et donneront d’ailleurs lieu à deux arrêts de la Cour internationale de justice (RDC c Belgique, supra note 58 et Belgique c Sénégal, supra note 78). Dès lors, l’usage abusif de la compétence universelle deviendra un sujet de tension entre l’UA et l’UE au point de faire l’objet d’un mémorandum de l’UA aux Nations unies (Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction, supra note 62) à la suite de la Décision sur le Rapport relatif à l'utilisation abusive du principe de compétence universelle prise par la Conférence de l’Union africaine lors de sa 11e session ordinaire à Sharm El-Sheikh en Égypte du 30 juin au 1er juillet 2008 et d’un Rapport d’experts (« UA-UE : Groupe d’experts techniques ad hoc sur le principe de compétence universelle » (2009) 42 Rev b dr Intern 240); Mutoy Mubiala, « Vers une justice pénale régionale en Afrique », supra note 4 aux pp 548-50.
-
[80]
Kémoko Diakité, supra note 77 aux pp 58-60.
-
[81]
Mutoy Mubiala, « Vers une justice pénale régionale en Afrique », supra note 4 à la p 552.
-
[82]
UA, Conférence de l'Union africaine, 11e sess, Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, Doc off UA (2008).
-
[83]
Elle est compétente pour trancher les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Sa saisine n’est possible que par les États parties et par certains organes et organisations africaines conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples adopté le 10 juin 1998 par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA et entré en force le 25 janvier 2004. La Cour n’est cependant opérationnelle que depuis le début de l’année 2009 et a rendu sa première décision le 15 décembre 2009.
-
[84]
Elle est formée sur le modèle de la Cour internationale de justice. Elle est compétente pour trancher les litiges entre les États parties au Protocole instituant la Cour et ouverte à ces mêmes États et à différents organes de l’Union. UA, Conférence de l’Union africaine, 2e sess, Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine, Doc off UA (2003), art 18 et 19.
-
[85]
Cette fusion avait été envisagée depuis 2004 lors de la 3e session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine qui s’est tenue à Addis-Abeba du 6 au 8 juillet 2004 et par la suite dans la Décision sur la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de l'Union Africaine. Voir UA, Conférence de l'Union africaine, 3e sess, Décision sur les sièges de l’Union Africaine, Doc off UA Assembly/AU/Dec. 45 (2004) ch III au para 4; UA, Conseil exécutif, 7e sess, Doc off UA Ex.CL/195 (VII) (2005); UA, Conférence de l'Union africaine, 5e sess, Doc off UA Assembly/AU/Dec. 83 (V) (2005).
-
[86]
L’article 9.1 prévoit notamment que le Protocole et le Statut annexés « entreront en vigueur, trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) États membres ». Sur les 55 États membres de l’UA, 30 l’ont signé et seulement 5 l’ont ratifié. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Libye et le Mali. Voir UA, Protocole portant sur le statut de la cour africaine de justice et des droits de l’homme, Doc off UA (2008).
-
[87]
Protocole de Malabo, supra note 65, art 15. L’article prévoit son entrée en vigueur ainsi que le Protocole de Sharm El-Sheikh qu’il a amendé le 30e jour suivant le dépôt du 15e instrument de ratification de l’instrument.
-
[88]
Stéphane Doumbé-Billé, « La juridictionnalisation des droits de l’homme en Afrique : "much ado about nothing" », dans Jean-François Akandji-Kombé, dir, L’homme dans la société internationale : Mélanges en hommage au Pr. Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, 693 à la p 705.
-
[89]
Ibid.
-
[90]
Les chefs d’État et de gouvernements africains se sont réunis lors du 15e sommet extraordinaire de la Conférence de l’Union africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba du 11 au 13 octobre 2013 pour discuter d’un retrait massif de la CPI sur demande du Kenya et de l’Ouganda qui n’a pas abouti.
-
[91]
UA, Conférence de l'Union africaine, 24e sess, Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en oeuvre des décisions précédentes sur la Cour pénale internationale, Doc off UA Assembly/AU/Dec.547(XXIV) (2015) aux para 15 et 17(b).
-
[92]
Protocole de Malabo, supra note 65, art 28 (A).
-
[93]
Ibid, art 46 (H).
-
[94]
Ghislain Mabanga, « Union Africaine versus Cour pénale internationale, quand le politique tient le judiciaire en l’état » (2013) Revue des droits de l'homme, en ligne : <revdh.wordpress.com/tag/21e-session-ordinaire-de-la-conference-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-union-africaine/>.
-
[95]
Statut de Rome, supra note 1, art 27 : « Défaut de pertinence de la qualité officielle 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».
-
[96]
UA, Conférence de l’Union africaine, 21e sess, Doc off UA Assembly/AU/ 13(XXI) (2013) au para 4.
-
[97]
Ibid aux para 6-7.
-
[98]
Proposition soumise à la session annuelle de l’Assemblée des États Parties (AEP) au Statut de Rome, 20-28 novembre 2013, La Haye, Pays-Bas.
-
[99]
Si l’article 27 du Statut de Rome est souvent décrit comme sa pierre angulaire, cela aurait enlevé sa raison d’être à la juridiction. Pour Jeangène Vilmer, les crimes dont elle s’occupe (contre l’humanité, de guerre et de génocide) étant souvent commis par l’appareil étatique, ils impliquent donc potentiellement la responsabilité du chef d’État lui-même et, plus largement, des représentants de l’État. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux objections et sortir de la crise » (2014) 45:1 Études internationales 5.
-
[100]
Protocole de Malabo, supra note 65, art 46 A bis.
-
[101]
Mutoy Mubiala, « Chronique de droit pénal de l’Union Africaine. L’élargissement du mandat de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme aux affaires de droit international pénal » (2014) 85:3 Revue internationale de droit pénal 749 à la p 754 [L’élargissement du mandat de la CAJDH].
-
[102]
Outre l’article 27(1) du Statut de Rome qui n’exonère pas de responsabilité pénale les personnes disposant de la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, on peut mentionner la jurisprudence du Tribunal spécial pour la Sierra Léone dans le procès de Charles Taylor qui a mentionné que le « principe semble maintenant établi que l’égalité souveraine des États n'empêche pas un chef d'État d'être poursuivi par une Cour ou un Tribunal pénal international ». Procureur c Charles Ghankay Taylor, SCSL-2003-01-I, Décision sur l’immunité de la juridiction (31 mai 2004) au para 52 (Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Chambre d'appel).
-
[103]
Notification de retrait de notification de retrait de la Gambie, notification dépositaire C.N.62.2017.TREATIES-XVIII.10, 10 février 2017.
-
[104]
Retrait de la Gambie, supra note 50.
-
[105]
L’élargissement du mandat de la CAJDH, supra note 101 à la p 756.
-
[106]
Payam Akhavan, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace? Reconciling Judicial Romanticism with Political Realism » (2009) 31:3 Human Rights Quarterly 624 à la p 625.
-
[107]
Jeangène Vilmer, supra note 2 à la p 86.