Résumés
Résumé
Cette revue critique de l’ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec de Frédéric Lacroix remet en question l’approche ethnicisante et idéologiquement réductrice qu’utilise l’auteur pour analyser les dynamiques linguistiques au Québec. Elle exhorte à mieux réfléchir aux enjeux de la situation actuelle et future de la langue française au Québec en les décrivant dans toute leur complexité et en tenant compte de leurs multiples facettes. Cette revue expose non seulement la fragilité des postulats épistémologiques, méthodologiques et conceptuels sur lesquels s’appuie l’auteur de l’ouvrage pour étayer sa démonstration du caractère catastrophique de la situation actuelle du français au Québec, mais remet également en question le cadre théorique de l’ouvrage, reposant sur le concept de surcomplétude institutionnelle. La note critique propose un regard alternatif qui met en lumière quelques-unes des dimensions et perspectives théoriques et méthodologiques dont ne tient pas compte l’auteur et qui sont pourtant fondamentales si l’on veut faire un examen plus complet des dynamiques et des pratiques qui contribuent à l’évolution de la situation linguistique au Québec.
Mots-clés:
- Québec,
- loi 101,
- démolinguistique,
- dynamiques linguistiques,
- situation du français,
- anglicisation,
- orientation linguistique,
- recensement
Corps de l’article
Publié dans la mouvance politique ayant mené au dépôt du projet de loi 96 (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français) par le ministre Simon Jolin-Barrette, le livre Pourquoi la loi 101 est un échec de Frédéric Lacroix aura été acclamé et recommandé comme lecture essentielle par plusieurs journalistes, chroniqueurs et meneurs d’opinion – sans toutefois faire l’unanimité − afin de mieux comprendre les enjeux entourant la situation actuelle du français au Québec[1].
Cet ouvrage, qui a le mérite d’avoir touché une corde sensible chez plusieurs Québécois à propos du caractère fragile du français dans la province et à Montréal en particulier, s’inscrit dans le courant de la démolinguistique « classique », dont l’univers politico-cognitif est décrit par Prévost et Beaud (2001). Fortement axé sur la situation dans les réseaux collégial et universitaire et celui de la santé – à laquelle sont consacrées la moitié des quelque 245 pages −, l’ouvrage se veut d’abord et avant tout un cri du coeur et un vibrant plaidoyer en faveur de l’adoption de mesures correctives, voire coercitives, pour contrer le recul/la « chute » du français, à Montréal en particulier. L’avant-propos a l’avantage d’être clair sur le ton général de l’ouvrage : non seulement « [a]u Québec, la langue française ne va pas bien » mais « la situation du français […] est catastrophique ». Le livre a donc pour mission « […] d’expliquer la mécanique du recul du français au Québec et, ce faisant, d’illustrer les voies à suivre pour échapper à la louisianisation qui nous guette[2] » (p. 16).
Pour utiles et instructives que soient les diverses statistiques et les renseignements qu’il présente, principalement dans le domaine de l’enseignement, le livre de Lacroix est d’abord et avant tout une démonstration éloquente de ce qui ne va pas dans le discours et la rhétorique alarmiste et catastrophiste actuelle sur la situation du français au Québec.
La présente note critique a comme point de départ les questions suivantes : conscient de la fragilité intrinsèque du fait français en raison de son caractère et de son statut minoritaires au Canada et en Amérique du Nord, peut-on réfléchir aux dynamiques linguistiques au Québec autrement qu’en termes ethnicistes et idéologiquement réducteurs? Peut-on mieux réfléchir aux enjeux de la situation actuelle et future de la langue française au Québec en les examinant dans toute leur complexité et en tenant compte de leurs multiples facettes?
Cette note critique expose dans un premier temps les postulats épistémologiques, méthodologiques et conceptuels sur lesquels s’appuie Lacroix pour étayer sa démonstration du caractère catastrophique de la situation actuelle du français au Québec. Quels sont en effet les concepts, les méthodes et les perspectives utilisés à cette fin et desquels découlent un certain nombre de conclusions, de recommandations et de pistes d’action qui se révèlent fort discutables eu égard à la complexité des réalités et des dynamiques actuelles? Elle remet ainsi en question non seulement l’analyse pessimiste des données sur les langues d’usage à la maison, mais également l’obsession qu’ont plusieurs démolinguistes et analystes des transferts ou substitutions linguistiques et de leur caractère prétendument statique et irréversible, comme si la seule façon d’assurer la pérennité du fait français consistait à l’imposer dans la sphère privée, alors même que la politique linguistique québécoise vise essentiellement la sphère publique.
Dans un deuxième temps, cette revue questionne le cadre théorique de l’ouvrage – le concept de surcomplétude institutionnelle − et son application au domaine de l’éducation et de la santé, à Montréal en particulier, comme illustration de la situation catastrophique du français. La démarche de Lacroix, qui a pour objectif de démontrer que la dynamique linguistique qui y prévaut contribue et témoigne de l’anglicisation galopante qui guette Montréal et le Québec, repose sur ces mêmes postulats épistémologiques et méthodologiques qui sont pourtant de moins en moins adéquats pour cerner et décrire les multiples facettes des pratiques et des choix linguistiques des individus.
Finalement, cette note propose en conclusion un regard alternatif qui met en lumière quelques-unes des dimensions et perspectives théoriques et méthodologiques maintenues dans l’angle mort de l’ouvrage et pourtant fondamentales si l’on veut faire un examen plus complet des dynamiques et des pratiques qui contribuent à l’évolution de la situation linguistique au Québec.
Les postulats épistémologiques et méthodologiques
L’auteur donne le ton de l’ouvrage dans la seconde page de l’avant-propos en affirmant que, de la même façon qu’il faut faire une distinction entre la météo et le climat, comprendre l’état de la langue au Québec requiert que l’on « [passe] par les chiffres », faute de quoi l’on ne se fiera qu’aux impressions. Selon lui, c’est la démolinguistique qui permet d’établir avec rigueur scientifique que la situation du français est catastrophique puisque la réalité n’est rien d’autre que « mathématique ».
Ne s’attardant nullement à examiner la diversité des critères possibles de définitions des groupes linguistiques et les multiples modalités ou déclinaisons de l’appartenance commune à une langue, voire de l’interpénétration des groupes linguistiques (Pagé, 2010), l’auteur s’inspire essentiellement des travaux de Castonguay (2019, 2021) et du discours de sens commun, suivant lesquels un groupe linguistique est défini par le critère de la langue maternelle des individus qui le constituent, c’est-à-dire celle apprise en premier lieu à la maison dans l’enfance. Ainsi, non seulement le Québec est toujours et encore divisé en trois grands groupes supposément homogènes (francophone, anglophone et allophone), mais ceux-ci sont décrits et vus comme ayant des frontières bien délimitées, étanches et immuables (Corbeil, 2020; Prévost, 2011).
La « chute » catastrophique du français désigne ainsi essentiellement la diminution du poids démographique de la population de langue maternelle française − comme si la présence et le statut du français au Québec se limitaient à l’évolution de la population ayant appris cette langue en premier lieu dans l’enfance − et serait principalement attribuable non seulement au nombre trop peu important de transferts ou de substitutions linguistiques du groupe allophone issu de l’immigration en faveur du français, mais également à « l’assimilation » croissante de la population de langue maternelle française à l’anglais. C’est ce qui fait dire à Lacroix que « [l]’orientation du solde général des substitutions déterminera la survie ou la disparition du Québec français ». Qui plus est, la baisse du poids démographique de la population de langue maternelle française (les francophones) est telle que « [p]our le Québec français, la noyade approche ». Rien de moins, et inutile de se perdre dans la nuance...
La focalisation sur la langue maternelle entraîne ce que j’appellerai ici le « syndrome des 8 % », c’est-à-dire la part démographique relative depuis une vingtaine d’années de la population ayant l’anglais (langue que Lacroix qualifie d’« étrangère », p. 240) comme langue maternelle au Québec – ce que d’aucuns nomment la communauté historique de langue anglaise −, part qui, selon les projections démographiques de Statistique Canada (Houle et Corbeil, 2017), pourrait osciller autour de ce niveau au moins au cours des 15 prochaines années. De cette focalisation et de ce syndrome découle la thèse centrale de l’ouvrage, son cadre conceptuel si l’on peut dire, celui de « surcomplétude institutionnelle », dérivé des travaux de Breton (1964). En d’autres termes, selon l’auteur, il est inacceptable et dangereux pour la situation du français que la communauté historique de langue (maternelle) anglaise du Québec dispose de réseaux institutionnels en éducation et en santé dont la part relative en matière de fréquentation, de main-d’oeuvre et de financement soit supérieure à 8 %, voire à 10 % aux fins de simplification. Par exemple, le fait qu’il y ait plus de 10 % des inscriptions dans les institutions d’enseignement postsecondaire de langue anglaise, ou de patients ou de travailleurs dans le réseau de santé de langue anglaise, est une démonstration que la logique qui prévaut au Canada hors Québec peut, si l’on n’y prend garde, préfigurer la réalité québécoise en devenir, voire de sa « louisianisation » (p. 16)!
Selon Lacroix, deux mécanismes expliquent la chute historique de la population de langue maternelle française et celle parlant le français le plus souvent à la maison : les volumes d’immigration (qu’il considère trop élevés) et la dynamique linguistique. Pour ce qui est de l’immigration, il faut pourtant savoir qu’alors que la population québécoise recensée en 2016 constituait 23,2 % de la population canadienne, la part relative de tous les immigrants au pays qui résidaient au Québec se situait à 14,5 %.
Lors du même recensement, environ 70 % des immigrants dénombrés au Québec parlaient une langue maternelle tierce (autre que le français ou anglais), contre 22 % le français et 7,5 % l’anglais. Parmi les quelque 215 000 immigrants récents (arrivés entre 2011 et le jour du recensement), près de 7 sur 10 avaient cependant le français comme première langue (officielle) parlée, généralement un critère qui, au Québec, désigne la langue – le français ou l’anglais – dans laquelle une personne est le plus à l’aise pour communiquer (Houle et Corbeil, 2017, 2021).
La « dynamique linguistique » au Québec, d’après l’auteur (s’inspirant des travaux de Castonguay), se résume essentiellement aux substitutions linguistiques nettes. En d’autres termes, toutes les dynamiques linguistiques observées au Québec reviendraient à comparer l’usage prédominant des langues au foyer en regard de la langue maternelle des individus. Plus spécifiquement, les substitutions de la population de langue maternelle tierce vers le français ou l’anglais se feraient de manière disproportionnée vers cette dernière, sans compter que de plus en plus de personnes de langue maternelle française font une substitution vers l’anglais.
Il faut d’abord souligner ici que de nombreuses études ont déjà démontré le rôle marginal des substitutions linguistiques au foyer dans l’évolution démographique de la population de langue française au pays en regard du rôle des composantes démographiques bien connues des démographes − fécondité, migration interne et internationale − (voir notamment Termote, 2011). Plus précisément, dans les conditions qui prévalent depuis plusieurs décennies, le taux d’accroissement de la population ayant une langue maternelle tierce ou de celle parlant une langue tierce le plus souvent à la maison sera toujours largement supérieur à celui de la population effectuant une substitution linguistique vers le français ou l’anglais une fois arrivée au pays[3]. Par conséquent, si le français pénètre progressivement la sphère privée, ce phénomène est très graduel, prend du temps et ne sera jamais aussi rapide que celui de la croissance de la population de langue maternelle ou d’usage tierce.
Deuxièmement, Lacroix considère que l’un des éléments qui contribuent à la situation « catastrophique » du français est qu’en dépit du fait que la population de langue maternelle anglaise ne représente que 8 % de la population du Québec, la part des substitutions vers l’anglais est disproportionnée, car elle représenterait environ 45 % des substitutions linguistiques. D’une part, il est inacceptable de ne pas préciser, comme c’est l’habitude de nombreux analystes, chercheurs ou chroniqueurs, que l’examen des tendances en matière de substitutions linguistiques en faveur de l’anglais doit prendre en compte la continuation des effets d’avant l’adoption de la Charte de la langue française et des politiques d’immigration qui ont suivi et qui favorisaient la connaissance préalable du français parmi les nouveaux arrivants. En d’autres termes, ceux qui parlaient l’anglais le plus souvent à la maison avant l’adoption de la Charte ont tout simplement transmis cette langue à leurs enfants nés au pays. C’est pourquoi, lors du recensement de 2016, 64 % des 124 000 Québécois de langue maternelle tierce (réponses uniques)[4] nés au pays avaient adopté l’anglais le plus souvent à la maison, contre seulement 33,5 % le français. En revanche, parmi les quelque 233 000 immigrants de langue maternelle tierce, 64,7 % avaient adopté le français le plus souvent à la maison au cours de leur vie contre 33 % l’anglais. Chez les immigrants arrivés depuis 2001, cette proportion est d’environ 75 % en faveur du français.
Troisièmement, il a été démontré à plusieurs reprises, dans le cas des travailleurs de langue maternelle tierce qui parlent leur langue maternelle le plus souvent à la maison, que lorsque ceux-ci y parlent aussi le français ou l’anglais de façon régulière comme langue secondaire, cet usage secondaire est étroitement lié à la langue utilisée de façon prédominante au travail, dans une proportion de 80 % dans le cas du français et de 70 % dans le cas de l’anglais (Houle, Corbeil et Charron, 2012). Cela témoigne généralement du fait que même si le français ou l’anglais est parlé de façon secondaire, cette situation est un indicateur plutôt fiable de l’usage de l’une ou l’autre de ces langues dans l’espace public et de l’influence dynamique bidirectionnelle entre les sphères privée et publique à moyen et à long terme. Il semble donc raisonnable d’en tenir compte lorsqu’on s’intéresse au degré de pénétration de l’une ou l’autre de ces langues, voire des deux, à la maison et de ne pas se focaliser uniquement sur leur usage prédominant.
Alors qu’en 2001 les substitutions complètes ou partielles − que l’on pourrait également nommer « orientation » − d’une langue maternelle tierce vers le français (221 535) ou l’anglais (221 840) étaient au coude-à-coude, excluant leur usage à égalité (graphique 1), 15 ans plus tard elles se situaient à 414 600 et 278 950 respectivement, soit un rapport de 60 % à 40 % en faveur du français. Il est digne de mention qu’au cours de ces 15 années, l’effectif des personnes de langue maternelle tierce ayant adopté le français comme langue prédominante ou secondaire à la maison s’est accru de 87 % comparativement à moins de 26 % en ce qui a trait à l’adoption de l’anglais.
Finalement, il faut noter que la « nouvelle dynamique linguistique » selon laquelle un nombre de plus en plus important de personnes de langue maternelle française adoptent l’anglais comme principale langue d’usage à la maison, un phénomène qui contribuerait à leur « anglicisation », requiert au moins deux précisions importantes. D’une part, bien que cette croissance soit réelle, le constat dépend encore une fois de la façon dont on tient compte des réponses multiples. D’autre part, il importe également de mettre en perspective une telle hausse en examinant son importance relative en pourcentage, non pas seulement en termes d’effectifs puisque l’on compare des populations de taille fort différente. Ainsi, en 2016, si l’on considère tous les cas où le français est mentionné comme l’une des langues maternelles, mais non comme langue parlée le plus souvent à la maison et les cas où l’anglais est mentionné comme l’une des langues maternelles, mais non comme langue parlée le plus souvent à la maison, le premier cas de figure représente 1,5 % de la population de langue française comparativement à 12,6 % de celle déclarant l’anglais comme langue maternelle. Et si l’on ne tient compte que des réponses uniques, les personnes de langue maternelle française qui ont déclaré parler seulement l’anglais le plus souvent à la maison en 2016 et les personnes de langue maternelle anglaise y parlant uniquement le français le plus souvent, ces proportions sont de 1,1 % et de 9,3 % respectivement. Catastrophe? Calamité? Encore une fois, tout est effet de perspective de l’arsenal démolinguistique, d’autant plus qu’une part importante de ces personnes qui parlent l’anglais le plus souvent à la maison utilisent principalement le français au travail ou à égalité avec l’anglais.
Graphique 1
Substitution ou orientation d'une langue maternelle tierce vers le français ou l'anglais parlé à la maison
Démonstration de la situation dramatique du français : la surcomplétude institutionnelle de la population de langue (maternelle) anglaise
L’auteur consacre près de la moitié de son livre aux réseaux de l’éducation postsecondaire et de la santé ainsi qu’au rapport de force entre le français et l’anglais. Il s’attarde tout particulièrement à la croissance de la fréquentation des cégeps et des universités de langue anglaise. Le propos et l’approche rhétorique adoptée agacent quelque peu, notamment l’usage presque abusif de « ratios d’équité »[5]. En matière d’éducation postsecondaire, plutôt que d’adopter une approche purement mathématique ou comptable, qui permet certes de mesurer l’engouement des étudiants de langue maternelle tierce ou française pour la fréquentation d’une institution de langue anglaise, et d’y voir simplement une démonstration de la menace grandissante que représentent ces « foyers d’anglicisation », il eût été pertinent de mieux rendre justice à la complexité et aux multiples dimensions de ce phénomène.
Pourquoi l’auteur semble-t-il minimiser l’évolution de la part des étudiants de langue maternelle tierce qui s’inscrivent dans un cégep de langue française (66 % en 2020, comparativement à 41 % en 1990) sous prétexte que cette tendance ne résulte pas tant des clauses scolaires de la Charte que du changement de composition linguistique du bassin d’étudiants découlant des politiques d’immigration? Faut-il rappeler qu’en 1985, seulement 25 % des nouveaux inscrits de langue maternelle tierce fréquentaient un cégep de langue française (Olivier, 2017)?
Une naïveté certaine transparaît des propos de l’auteur lorsqu’il est question de ces « allophones ». Ainsi, la logique voudrait qu’en « immergeant » plus longtemps des allophones « anglotropes » dans un bain linguistique francophone, soit en étendant les clauses scolaires de la Charte au collégial, on crée plus d’allophones « francotropes ». Une telle situation, aux dires de l’auteur, « serait susceptible de bénéficier substantiellement aux substitutions linguistiques vers le français (p. 90) ». Il est très surprenant de constater à quel point cette croyance est peu remise en question, à savoir qu’après avoir fréquenté l’école primaire et secondaire en français, le fait de prolonger cette exposition à un environnement en français de deux ou trois années entraînerait un tel changement d’orientation linguistique, voire l’adoption du français comme seule langue d’usage au foyer. Une telle idée fait l’économie d’une analyse sérieuse des multiples facteurs de nature sociologique, psychosociologique ou sociolinguistique qui président aux choix de ces jeunes en matière de formation postsecondaire[6].
La « nouvelle dynamique » des langues reposerait notamment sur l’idée selon laquelle la fréquentation des institutions d’enseignement collégial et universitaire de langue anglaise à Montréal serait un vecteur d’anglicisation des francophones[7]. Et qui dit anglicisation dit également assimilation. L’auteur s’appuie sur l’étude de Sabourin, Dupont et Bélanger (2010) pour affirmer que le choix du cégep anglais « constitue un choix de vie définitif et déterminerait l’orientation linguistique et culturelle ultérieure de ceux qui s’y inscrivent ». Le problème que pose une telle affirmation est qu’elle demeure muette sur les motifs qui poussent ces étudiants à vouloir fréquenter un cégep ou une université de langue anglaise et statue que le fait d’opter pour un tel choix entraînera à moyen terme l’anglicisation et la perte du français.
À ce sujet, des données sur les cohortes de diplômés de 2010 à 2015 tirées du Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP) de Statistique Canada, intégrées à celles du recensement de 2016, permettent de jeter un éclairage intéressant sur les étudiants de langue française (comme langue maternelle ou première langue [officielle] parlée) ayant fréquenté une institution postsecondaire de langue anglaise. Par exemple, parmi les quelque 6 000 étudiants de langue maternelle française ayant reçu un diplôme de l’Université McGill au cours des années 2010 à 2015, 80 % ont déclaré parler le français le plus souvent à la maison lors du recensement de 2016 alors que 14 % ont plutôt déclaré parler le français à égalité avec l’anglais ou régulièrement comme langue secondaire[8]. Peut-on alors vraiment parler de la fréquentation de cette institution comme d’un foyer d’anglicisation qui contribuerait au recul du fait français au Québec?
Sans citer aucune source, Lacroix (p. 222) mentionne que selon les linguistes il existerait deux formes de motivation dans l’apprentissage d’une langue : instrumentale et intégrative. Cette dernière désigne une intention d’intégration au groupe qui parle cette langue et pourrait mener, en l’occurrence, à l’anglicisation. La hausse du bilinguisme observée chez les jeunes de langue maternelle française serait selon lui une démonstration éloquente de la place prépondérante que serait en train de prendre cette motivation intégrative. Ce qui l’amène à demander pourquoi un « francophone ressent le besoin d’aller dans un cégep ou une université anglophone pour apprendre une langue qu’il devrait déjà connaître? ». Puisque selon lui les jeunes qui choisissent le cégep anglais sont déjà bilingues, leur motivation ne peut nécessairement qu’être de type intégratif, c’est-à-dire qu’ils veulent « s’intégrer au groupe anglophone […] ». Point de références, point de démonstration.
Certaines études qualitatives portant sur des jeunes issus d’une école secondaire de langue française qui ont poursuivi au niveau collégial en anglais, bien que limitées du point de vue méthodologique en raison de la taille de leur échantillon, ont proposé des pistes d’explication dignes de mention à ce propos. Vieux-Fort, Pilote et Magnan (2020), par exemple, soulignent notamment que les jeunes interviewés « valorisent une francophonie québécoise inclusive des autres langues et […] n’intériorisent pas une idéologie monolingue (p. 136) ». De plus, les résultats de cette étude montrent que le choix du cégep de langue anglaise ne renverrait pas à un désir d’intégration ou d’appartenance identitaire à la communauté anglophone. Les jeunes y associent plutôt un choix « calculateur » (p. 130), une « valeur économique en vue du marché du travail », un choix de « développement personnel » et « une ouverture sociale et un respect des différences ».
Quant au parcours scolaire des jeunes de langue maternelle tierce ayant fait leurs études secondaires en français et leurs études collégiales en anglais, Magnan et Darchinian (2014) soulignent que bien que « la socialisation linguistique en français de ces jeunes semble réussie (p. 393) » au primaire et au secondaire, de nombreuses interactions scolaires ont été vécues dans un rapport « Nous “immigrants”/Eux “francophones québécois” », de sorte que les interactions avec ces derniers sont souvent peu fréquentes (notamment en raison de la forte concentration d’immigrants dans plusieurs écoles de l’île de Montréal), que certains jeunes auraient tendance à se sentir étrangers et que leur sentiment d’appartenance au Québec serait plus faible (p. 394). Au-delà des études quantitatives qui mettent souvent l’accent sur le lien entre la langue maternelle ou la principale langue d’usage et les choix d’orientation linguistique au cégep, les auteurs mettent en lumière une logique économique ou stratégique – souvent renforcée par les parents et les pairs – qui présiderait au choix d’orientation linguistique au niveau postsecondaire. Une telle logique s’articule notamment autour de la valeur et du statut des langues aux niveaux national et international ainsi que de la réputation internationale de l’institution d’enseignement.
Lacroix applique la même rhétorique réductrice du syndrome des 8 % au réseau de la santé. Toutefois, il pousse le raisonnement encore plus loin en donnant allègrement dans l’hyperbole. Ainsi, selon lui, l’anglais serait la « langue reine du réseau de la santé au Québec (p. 215) », la surcomplétude institutionnelle qui y prévaut contribuerait au « saccage de la dynamique linguistique à Montréal (p. 217) », et « le gouvernement du Québec force[rait] un grand nombre de francophones et d’allophones […] à travailler en anglais » (p. 202).
Notons que lors du recensement de 2016, 98 % des travailleurs de la santé de la province déclaraient pouvoir soutenir une conversation en français, 97 % dans la Région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR) de Montréal. De plus, en 2016, 6,8 % de l’ensemble des travailleurs de la santé au Québec ont déclaré utiliser principalement l’anglais au travail, alors que 5,6 % déclaraient l’utiliser à égalité avec une autre langue (essentiellement le français) et 23,7 % régulièrement comme langue secondaire. Pour ce qui est du français, ces proportions sont de 87 %, 5,7 % et 4,9 % respectivement. Fait important à noter, la proportion des travailleurs de la santé qui utilisent principalement l’anglais au travail a diminué de 2001 à 2016 tant dans l’ensemble du Québec que dans la RMR de Montréal, passant de 8,8 % à 6,8 % et de 16,0 % à 12,1 %, respectivement.
Et si l’on pensait les choses autrement
L’ouvrage de Lacroix, comme beaucoup d’autres, aborde l’évolution des dynamiques linguistiques comme un jeu de souque à la corde à somme nulle défini par un rapport de force (p. 75). Pour rétablir un rapport de force favorable au français, il soutient qu’il faut réduire de façon durable l’immigration puisqu’elle contribue à accroître la présence et l’usage des langues tierces et de l’anglais. Or, cette perspective sur le rôle de l’immigration et sur ce que d’aucuns appellent l’intégration linguistique des immigrants fait reposer beaucoup de responsabilités sur les épaules de ces derniers sans que l’on se questionne sur le rôle important de la société dite d’accueil dans ce processus d’intégration pourtant dynamique et bidirectionnel.
Le paradigme ethnicisant et assimilationniste que préconisent Lacroix et plusieurs démolinguistes traditionnels met essentiellement l’accent sur la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison tant pour définir qui est francophone que pour suivre l’évolution des dynamiques linguistiques au Québec (Corbeil, 2020). Même si la ou les langues d’usage privilégiées à la maison sont un choix de la sphère privée dans laquelle l’État n’intervient pas, la focalisation sur les substitutions linguistiques au foyer donne fortement à penser qu’il s’agirait là de l’étalon de mesure dont l’évolution permet de statuer sur l’avenir réel du français. De plus, le paradigme ethnicisant et assimilationniste privilégie le principe selon lequel la présence ou l’usage accru d’une langue signifie nécessairement l’absence ou l’usage moindre de la ou des langues concurrentes.
Or, plusieurs analystes et chercheurs se sont déjà penchés sur les limites fondamentales du caractère univarié des indicateurs linguistiques actuels (voir Piché, 2004; 2011). Le caractère multilingue et plurilingue[9] de la population québécoise et montréalaise en particulier est de plus en plus reconnu et inéluctable et celui-ci exige de repenser les dynamiques linguistiques dans des cadres épistémologiques et conceptuels différents.
La littérature abonde pourtant sur la relation entre, d’une part, le choix des indicateurs ou des variables utilisées pour suivre l’évolution du français au Québec et, d’autre part, leur interprétation politique et idéologique (voir par exemple Piché, 2011; Georgeault et Pagé, 2006; Arel, 2002). De plus, le paradigme ou modèle privilégié d’intégration des nouveaux arrivants au sein d’une société québécoise très diversifiée sur le plan ethnique, linguistique et culturel et dont la politique linguistique vise l’essor du français comme langue commune oriente généralement le choix des indicateurs privilégiés (Piché, 2004; Pagé, 2010).
De même, comme le souligne Georgeault (2006) à la suite de Mackey (2001), ce paradigme associe, dans l’utilisation des données linguistiques du recensement, une entité (le locuteur) à une autre (la langue). La langue n’est cependant pas une entité, mais un comportement dans la mesure où une personne peut parler plus d’une langue selon le contexte et le moment, et une personne n’égale pas forcément une seule langue. Pour le dire à la manière de Georgeault (2006, p. 309), dans le modèle assimilationniste, « le français ne sera jamais langue commune tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas parlé par tous à la maison et seul compte l’usage [prédominant] du français à la maison », lequel sera ensuite transmis aux enfants et aux générations suivantes.
En contraste avec le paradigme ethnicisant et assimilationniste, Pagé définit deux autres modèles : a) le modèle civique traditionnel, selon lequel l’usage du français est purement instrumental et sans dimension identitaire associée à son usage, et b) le modèle intégrationniste, selon lequel c’est l’accent mis sur l’usage du français dans l’espace public qui doit être privilégié avec, à terme, mais pas a priori, une adhésion et une identification aux grandes orientations de base de la société d’accueil. C’est ce dernier modèle ou paradigme qui devrait nous intéresser au premier chef. Celui-ci tient compte non seulement de ce que Létourneau (2010) appelle « la complexité de la montréalité en devenir », mais plus particulièrement du fait que la croissance du plurilinguisme qui y prévaut nous force à repenser le schéma d’analyse de la dynamique des langues, de façon non plus unidirectionnelle, mais interactive et réellement dynamique, et sans que la valorisation, l’usage et le rayonnement du français ne doivent impérativement se concrétiser par la dévalorisation et la baisse du pouvoir d’attraction de l’anglais, ce qui relève de l’utopie. Finalement, comme le souligne Jocelyn Maclure,
Le modèle d’intégration québécois […] a la vertu de permettre une pluralité de rapports à la langue française. Ce modèle exige le respect du statut privilégié du français et, par le fait même, des politiques publiques mises en place pour favoriser son rayonnement, tout en laissant le soin aux individus de déterminer la nature de leur rapport avec la langue publique commune.
Maclure, 2006, p. 167
Une analyse des dynamiques linguistiques, qui prend en compte la complexité et la diversité des rapports à la langue, et ce faisant qui s’éloigne du modèle assimilationniste, doit également favoriser une réflexion sur le besoin de statistiques qui intègrent plus d’un indicateur sur l’évolution de la présence et de l’usage du français. Par exemple, la focalisation sur la seule baisse de 4 points de pourcentage de la population de langue maternelle française ou de celle parlant le français le plus souvent à la maison entre 2001 et 2016 maintient dans l’angle mort la part de la population qui soit parle le français le plus souvent à la maison soit l’utilise le plus souvent ou à égalité avec une autre langue au travail, part qui n’a pourtant fléchi que de 0,4 point de pourcentage au cours de la période, pour se situer 85,7 %.
De plus, comme l’exprimait Piché (2004, p. 18), « il est temps de sortir du carcan liant de façon trop exclusive la problématique de la survie de la langue française à celle de l’immigration ». Et c’est du côté de la société québécoise prise dans son ensemble qu’il nous faut aussi chercher des solutions à la question linguistique. Au-delà du débat entre l’utilisation des indicateurs traditionnels que sont la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison, d’une part, et ceux de l’usage des langues dans la sphère publique d’autre part, Piché souligne le caractère unidirectionnel et insuffisant de ces indicateurs pour rendre pleinement compte de la complexité du processus d’intégration linguistique (Piché, 2004, p. 9). Il propose ainsi le développement d’indicateurs de réceptivité sociale par l’entremise desquels les choix linguistiques des immigrants sont modulés.
Les données du recensement sur l’usage des langues au travail en 2016 permettent d’illustrer la pertinence des éléments soulevés par Piché. Par exemple, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, la proportion des immigrants faisant usage du français et de l’anglais à égalité dans le cadre de leur travail était de 18,4 % comparativement à 5,4 % chez les non-immigrants. Or, phénomène intéressant, on y a constaté une nette sous-représentation des travailleurs issus de l’immigration (1re et 2e génération) au sein des administrations publiques provinciale, régionales ou locales ainsi qu’au sein des sociétés d’État, des milieux de travail où le français prédomine presque complètement. Bien qu’il faille tâcher de comprendre pourquoi cette situation prévaut et les facteurs qui l’expliquent, ce n’est bien sûr qu’un exemple parmi tant d’autres qui permettent de montrer que des éléments contextuels peuvent grandement influer sur les dynamiques linguistiques en milieu de travail.
L’étude de Calinon (2015) sur le regard que portent les immigrants récents au Québec sur les politiques gouvernementales en matière d’intégration linguistique au français fournit également un bon exemple du rôle important que joue la société d’accueil dans ce processus dynamique et bidirectionnel. Ceux-ci tendent en effet à ne pas se considérer comme des locuteurs légitimes du français, notamment parce que d’une part seules les personnes de langue maternelle française sont généralement considérées comme locuteurs légitimes et que le plurilinguisme de ces immigrants récents, qui inclut le français, fait en sorte qu’ils ne se sentent pas nécessairement des « francophones légitimes » en regard des Québécois qui utilisent exclusivement ou majoritairement le français dans leurs interactions quotidiennes.
Finalement, les obstacles actuels, tant matériels que symboliques (discrimination socioéconomique, surqualification systémique, exclusion, déni de la diversité culturelle et linguistique, etc.), auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants, voire les immigrants établis, devraient également nous faire réfléchir quant aux responsabilités qu’impose aux immigrants la société d’accueil en matière d’intégration linguistique, d’attachement de ces derniers à l’idée du français comme langue publique commune et d’identification aux préoccupations légitimes de la majorité linguistique québécoise (Maclure, 2006). D’où l’importance de tempérer les propos d’un ouvrage comme celui de Lacroix qui tend à analyser la situation linguistique au Québec muni d’oeillères bien rigides.
Parties annexes
Note biographique
Jean-Pierre Corbeil est un spécialiste de la statistique linguistique à la retraite. Il a dirigé le programme de la statistique linguistique de Statistique Canada pendant une quinzaine d’années et a été directeur adjoint à la Division de la diversité et de la statistique socioculturelle de l’agence. Diplômé des universités McGill et de Montréal, il a notamment été membre du Comité scientifique de l’Office québécois de la langue française de 2010 à 2013 et est actuellement membre du comité scientifique de l’Organisation internationale de la francophonie à Paris. Parmi ses dernières publications, on compte notamment « Catégories et frontières. Le recensement et la construction sociale, politique et scientifique des groupes ethnolinguistiques au Canada », publié dans Diversité urbaine en 2020.
Notes
-
[1]
Le 13 mai 2021, l’ouvrage de Lacroix s’est notamment vu remettre le prix du livre politique 2021 par l’Assemblée nationale du Québec.
-
[2]
Voir notamment Arrighi et Urbain (2016) sur l’instrumentalisation des communautés francophones en situation minoritaire par le recours abusif aux termes louisianisation et acadianisation comme stratégie rhétorique de revendication politique, notamment pour appuyer la cause souverainiste au Québec et l’idéologie du monolinguisme, et de mobilisation de l’opinion publique devant la menace de « la fin du vivre en français ».
-
[3]
Une enquête menée en 2006 a par ailleurs permis d’estimer que parmi les immigrants adultes de langue maternelle tierce dans la région de Montréal qui avaient effectué un transfert linguistique au cours de leur vie, 62 % des transferts vers le français avaient eu lieu avant l’arrivée au pays comparativement à 47 % de ceux vers l’anglais (Corbeil et Houle, 2014).
-
[4]
Soit le fait de ne déclarer qu’une seule langue à la question sur la langue apprise en premier lieu à la maison dans l’enfance et encore comprise.
-
[5]
En page 54 de son ouvrage, Lacroix décrit le ratio d’équité comme « le rapport de la part du réseau institutionnel accordée à un groupe […] [qui se calcule] en divisant la part institutionnelle relative par le poids démographique relatif de ce groupe.
-
[6]
Voir notamment Lamarre (2013) sur les pratiques langagières de jeunes adultes plurilingues à Montréal.
-
[7]
Selon Olivier (2017), entre 1993 et 2015, la proportion des nouveaux inscrits ayant étudié en français au secondaire et qui ont poursuivi au niveau collégial en anglais a doublé pour se situer à 10,1 %, cette dernière proportion représentant 4 720 étudiants. Castonguay (2017) présente quant à lui le libre-choix au cégep comme un suicide linguistique.
-
[8]
Le lien entre la principale langue d’usage à la maison et le choix de l’institution postsecondaire parmi la population étudiante de langue maternelle tierce fait appel à des dynamiques fort différentes de celles qui prévalent parmi la population de langue maternelle française, notamment l’orientation « naturelle » en amont vers le français ou vers l’anglais qui peut influencer le choix de la langue d’enseignement. Cela dit, il importe de souligner que parmi l’ensemble des diplômés de langue maternelle tierce de l’une ou l’autre des quatre universités montréalaises (McGill, Concordia, UQAM et Université de Montréal) entre 2010 et 2015, 62 % ont obtenu leur diplôme d’une université de langue française, une proportion proche de la part de cette population inscrite dans un cégep ou un collège de langue française. À noter que, lors du recensement de 2016, 51 % de la population de langue maternelle tierce dans la Région métropolitaine de recensement de Montréal parlait uniquement une langue tierce le plus souvent à la maison.
-
[9]
En 2016, 55 % des quelque 1,1 million d’immigrants dénombrés au Québec ont déclaré parler plus d’une langue à la maison.
Bibliographie
- Arel, D., 2002 « Language Categories in Censuses: Backward- or Forward-looking? », dans : D. Kertzer et D. Arel (dir.), Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses, Cambridge, Cambridge University Press.
- Arrighi, L. et É. Urbain, 2016 « “Wake up Québec” : du recours aux communautés francophones minoritaires dans le discours visant l’émancipation nationale du Québec », Francophonies d’Amérique, 42-43 : 105-124.
- Breton, R., 1964 « Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants », American Journal of Sociology, 70, 2 : 193-205.
- Calinon, A. S., 2015 « Légitimité interne des politiques linguistiques au Québec : le regard des immigrants récents », Minorités linguistiques et sociétés / Linguistic Minorities and Society, 5 : 122-142.
- Castonguay, C., 2017 Libre-choix au cégep : un suicide linguistique, Éditions du Renouveau québécois, Montréal.
- Castonguay, C., 2019 « Quebec’s new language dynamic: French fading fast », Language Problems and Language Planning, 43, 2 : 113-134.
- Castonguay, C., 2021 Le français en chute libre : la nouvelle dynamique des langues au Québec, Montréal, Mouvement Québec français.
- Corbeil, J.-P., 2020 « Catégories et frontières. Le recensement et la construction sociale, politique et scientifique des groupes ethnolinguistiques au Canada », Diversité urbaine, 20, 2 : 13-33.
- Corbeil, J.-P. et R. Houle, 2014 « Les transferts linguistiques chez les adultes allophones de la région métropolitaine de Montréal : une approche longitudinale », Cahiers québécois de démographie, 43, 1 : 5-34.
- Georgeault, P., 2006 « Langue et diversité : un défi à relever », dans : P. Georgeault et M. Pagé (dir.), Le français, langue de la diversité québécoise. Une réflexion pluridisciplinaire, Québec Amérique, p. 283-325.
- Georgeault, P. et M. Pagé (dir.), 2006 Le français, langue de la diversité québécoise. Une réflexion pluridisciplinaire, Montréal, Québec Amérique.
- Houle, R. et J.-P. Corbeil, 2017 Projections linguistiques pour le Canada, 2011-2036, Statistique Canada, no 89-657-X2017001 au catalogue.
- Houle, R. et J.-P. Corbeil, 2021 Scénarios de projection de certaines caractéristiques linguistiques de la population du Québec (2011-2036), avec la collaboration de J.-D. Morency, D. Grenier et É. Caron-Malenfant, Montréal, Office québécois de la langue française, 45 p.
- Houle, R, J.-P. Corbeil et M. Charron, 2012 Les langues de travail au Québec en 2006, Montréal, Office québécois de la langue française.
- Lamarre, P., 2013 « Catching “Montréal on the Move” and Challenging the Discourse of Unilingualism in Québec », Anthropologica, 55, 1 : 41-56.
- Létourneau, J., 2010 Le Québec entre son passé et ses passages, Montréal, Fides.
- Mackey, W., 2001 « Prévoir le destin des langues », Terminogramme, 99-100 : 89-108.
- Maclure, J., 2006 « Politique linguistique ou politique d’intégration? La promotion de la langue dans une communauté politique libérale, démocratique et pluraliste », dans : P. Georgeault et M. Pagé (dir.) Le français, langue de la diversité québécoise. Une réflexion pluridisciplinaire, Montréal, Québec Amérique, p. 153-170.
- Magnan, M.-O. et F. Darchinian, 2014 « Enfants de la loi 101 et parcours scolaires linguistiques : le récit des jeunes issus de l’immigration à Montréal », McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, 49, 2 : 373-398.
- Olivier, C.-É, 2017 Langue et éducation au Québec. 2, Enseignement collégial, avec la collaboration de Y. Presnukhina, Montréal, Office québécois de la langue française.
- Pagé, Michel avec la collaboration de P. Lamarre, 2010 « L’intégration linguistique des immigrants au Québec », Étude IRPP, no 3.
- Piché, V., 2004 « Immigration et intégration linguistique : vers un indicateur de réceptivité sociale », Les Cahiers du Gres, 4, 1 : 7-22.
- Piché, V., 2011 « Catégories ethniques et linguistiques au Québec : quand compter est une question de survie », Cahiers québécois de démographie, 40, 1 : 139-154.
- Prévost, J.-G., 2011 « Statistiques linguistiques, rhétorique quantitative et effets de perspective », Sociologie et Sociétés, 43, 2 : 19-40.
- Prévost, J.-G. et J.-P. Beaud, 2001 « Statistical Inquiry and the Management of Linguistic Plurality in Canada, Belgium and Switzerland », Revue d’études canadiennes/Journal of Canadian Studies, 36, 4 : 88-117.
- Sabourin, P., M. Dupont et A. Bélanger, 2010 Le choix anglicisant. Une analyse des comportements linguistiques des étudiants du collégial sur l’île de Montréal, Institut de recherche sur le français en Amérique. [www.irfa.ca/site/publication/le-choix-anglicisant], consulté le 15 avril 2021.
- Termote, M., 2011 Perspectives démolinguistiques du Québec et de la région de Montréal (2006-2056), avec la collaboration de F. Payeur et N. Thibault, Montréal, Office Québécois de la langue française.
- Vieux-Fort, K., A. Pilote et M.-O. Magnan, 2020 « Choisir un cégep anglophone au Québec : l’expérience de jeunes francophones », Éducation et francophonie, 48, 1 : 122-143.
Liste des figures
Graphique 1
Substitution ou orientation d'une langue maternelle tierce vers le français ou l'anglais parlé à la maison


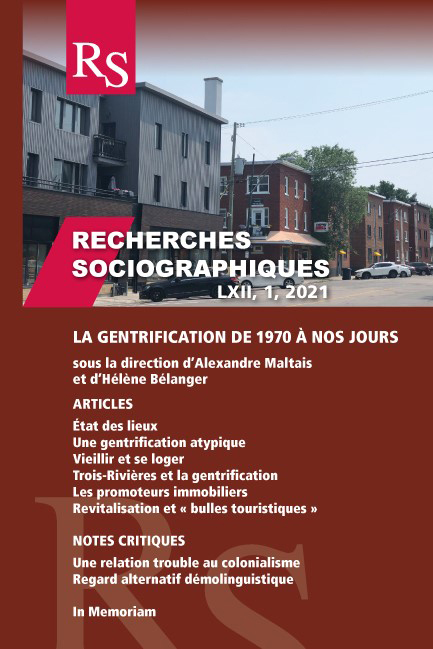

 10.7202/1054037ar
10.7202/1054037ar