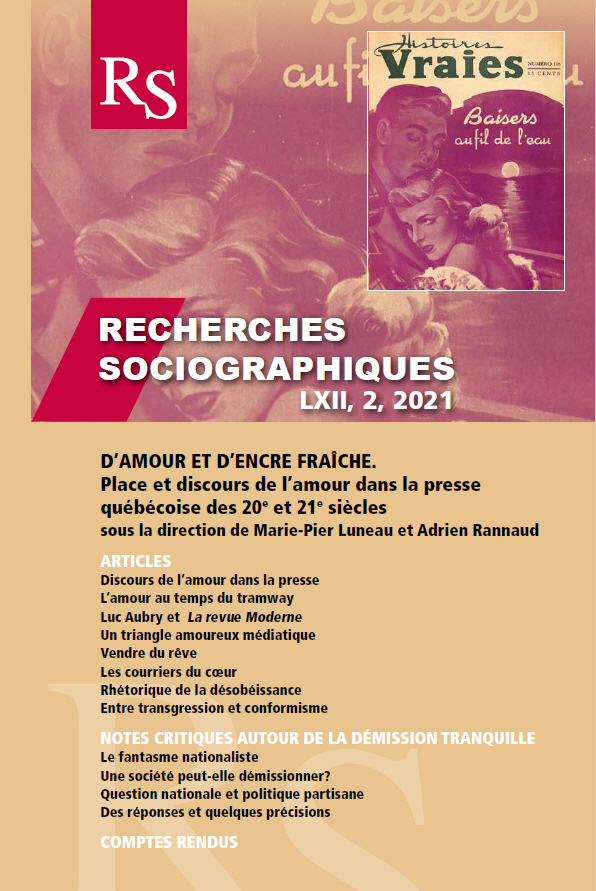Corps de l’article
Au début de son essai Une démission tranquille, Jacques Beauchemin exprime sa consternation face au mode actuel de relecture de « l’histoire du Québec à la recherche des crimes dont se seraient rendus coupables les premiers colons ». Dans une telle lecture, « l’implantation des colons de la Nouvelle-France constitue (…) une forme d’occupation illégitime » et « la ville de Montréal se trouve sur un “territoire non cédé” » (p. 11).
Beauchemin rejette une telle « réorientation de la conscience historique » pour deux raisons. Premièrement, si l’histoire du Canada français et du Québec devient une histoire dans laquelle les colons français et leurs descendants jouent le rôle d’oppresseurs, que restera-t-il de l’histoire nationale plus ancienne, dans laquelle le Canada français joue le rôle de l’opprimé vis-à-vis du Canada anglais – un rôle qui a légitimé la résistance politique du Canada français contre la mainmise des Canadiens anglais sur le projet politique de fonder une confédération d’abord, et le mouvement d’indépendance du Québec ensuite? Deuxièmement, privés de « l’histoire ancienne et valorisante de leur présence en Amérique », les Québécois de demain se trouveront « démunis devant la nécessité (…) de se donner à eux-mêmes une représentation positive de l’aventure qui les a conduits jusqu’ici ». À une époque où tant de « traits de l’identité » traditionnels, ou du moins anciens, disparaissent de la vie des Canadiens français et des Québécois, Beauchemin se demande ce qu’il adviendrait de la nation si elle perdait la représentation traditionnelle qu’elle se fait de son histoire (p. 11-12).
La version de l’histoire nationale que Beauchemin veut préserver est celle qui présuppose l’existence de la nation en tant qu’entité transhistorique cohérente. Le récit et l’entité se justifient l’un l’autre, de façon circulaire : l’existence de la nation (continue, depuis le moment de sa « naissance ») peut être démontrée par l’histoire qu’elle « possède » ; et l’histoire peut être écrite parce qu’il existe un sujet – « la nation » – sur lequel elle porte (Handler, 1988). Mais il existe d’autres façons d’écrire l’histoire des « colons de la Nouvelle-France » (p. 11). David Austin, par exemple, soutient que « le récit-maître du Québec (…) embrasse des notions donquichottesques de pureté raciale » (suggérées par des ethnonymes comme « Québécois de souche ») tout en ignorant « le fait que les Québécois français sont le produit de siècles de cohabitation et de métissage avec les peuples autochtones, ainsi qu’avec les Britanniques, les Écossais, les Irlandais et les Noirs » (Austin, 2010, p. 25). Le récit a également du mal à accepter le fait que plusieurs milliers de colons français et leurs descendants ont émigré du territoire qui est devenu la province de Québec pour s’installer ailleurs au Canada et aux États-Unis. En effet, la deuxième partie d’Une démission tranquille porte sur les possibilités et les dangers politiques du renouvellement des liens entre la nation québécoise et les minorités francophones ailleurs au Canada.
Le récit, dont les nationalistes ont raconté la version classique, revient sans cesse sur la résistance héroïque des Canadiens français contre l’oppression des Canadiens anglais tout en ignorant « les détails sordides » de « la colonisation française des peuples autochtones et la pratique de l’esclavage en Nouvelle-France » (Austin, 2010, p. 25) – ce sont ces détails mêmes que Beauchemin souhaite éluder. Plus près de nous, les tenants du récit préféré de Beauchemin n’ont jamais voulu se confronter à l’antisémitisme virulent de certains de ses plus grands héros, tels que Lionel Groulx et Maurice Duplessis. En effet, les travaux révolutionnaires d’Esther Delisle (1993) sur ce sujet « ont fait d’elle un paria parmi une grande partie de l’élite intellectuelle de la province » et « sa thèse de doctorat a été inexplicablement retardée pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elle soit acceptée à contrecoeur par un jury mécontent mais embarrassé » (Abella, 1994, p. 643). Des travaux comme ceux d’Austin et de Delisle menacent bel et bien cette vision préférée de la nation, mais les ignorer ne les fera pas disparaître.
Quoi qu’il en soit, il est tout à fait curieux pour moi de lire, en cet été 2020, le plaidoyer de Beauchemin en faveur de la préservation de l’orientation historique déjà établie. Aux États-Unis où je réside, le mouvement Black lives matter – de plus en plus attisé par un président nationaliste blanc dont le message politique n’est rien d’autre qu’un discours haineux raciste et xénophobe – a commencé à réorienter la conscience historique d’un grand nombre d’Américains non noirs. Depuis trois ans au moins, les médias font périodiquement état d’une énième manifestation de cette réorientation en même temps qu’un monument érigé à la mémoire d’un héros des États confédérés d’Amérique ou de nos guerres indiennes est renversé par la foule ou retiré par un gouvernement local. Même un Thomas Jefferson, qui est l’un de nos pères fondateurs les plus sacrés, et fondateur également de l’Université de Virginie où j’enseigne, n’est pas à l’abri de cette conscience qui s’éveille (Reed 2018; Mcinnis et Nelson 2019; Taylor 2019). La contradiction chez les hommes qui ont prêché l’égalité dans nos textes sacrés et qui l’ont pourtant refusée à tous, sauf aux propriétaires terriens blancs de sexe masculin, ne saurait être masquée par l’argument selon lequel on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils aient agi selon les sensibilités morales d’aujourd’hui. Peut-être est-ce vrai, répondons-nous maintenant, mais nous ne sommes pas obligés de continuer à vénérer comme héros nationaux ces hommes qui possédaient des esclaves ou qui profitaient de la traite des esclaves.
À l’heure actuelle, il est difficile de prédire si les changements enclenchés seront assez profonds pour permettre de surmonter et de réparer l’injustice raciale qui est le fondement de notre ordre social. Le nationalisme américain s’est construit sur les droits de la personne vue comme une entité indépendante, séparée de la société et primant sur elle. Parmi les droits de l’individu, figure au premier rang le droit d’enclore la « nature » et de la convertir en propriété privée, pour ceux qui avaient le pouvoir de le faire, sans égard pour le coût social subi par ses occupants précédents. En effet, le processus a commencé en Angleterre à la fin de la période médiévale, avec l’obtention par les propriétaires terriens du droit de s’approprier des terres auparavant dévolues à l’usage collectif (Fields, 2017). En parallèle, les colonisateurs anglais et européens ont trouvé utile d’envisager le reste du monde comme un espace sauvage, vide, naturel, dont on peut se servir. S’ils trouvaient des gens sur les terres qu’ils voulaient coloniser, ils les considéraient comme des sauvages, incapables de créer un bien commun (Cronin, 1983), encore moins la propriété privée comme cela se faisait dans les régimes politiques « civilisés ».
La religion de la propriété privée, associée au protestantisme patriarcal et au racisme scientifique, a été utilisée pour justifier la poursuite par les États-Unis naissants de leur « destinée manifeste ». Dans cette trajectoire historique, nos élites ont maintenu et accru leur pouvoir et leur richesse d’abord par le génocide et l’esclavage, puis par la mise en place des lois Jim Crow, les « réserves » pour les Amérindiens, les politiques d’immigration racistes, la violence anti-ouvrière, l’exclusion des femmes de la sphère publique et une vive résistance à tout projet politique visant à redistribuer les ressources sociales pour le bien commun.
Le New Deal du président Franklin Roosevelt, qui a prévalu des années 1930 à la fin des années 1960, a été la tentative la plus récente d’atténuer les pires effets du contrat social américain. Mais ce projet politique – pour une distribution plus équitable des ressources sociales et une définition moins restrictive des catégories sociales autorisées à participer à la vie politique – a finalement été étouffé par l’idéologie néolibérale actuelle. Il en a résulté une augmentation des inégalités économiques, atteignant désormais des niveaux obscènes (Piketty, 2013), la destruction du déjà tristement inadéquat filet de sécurité sociale hérité du New Deal, et de nouvelles formes de répression violente visant les immigrants, les travailleurs, les femmes et les personnes de couleur, en particulier les Afro-Américains, le groupe le plus stigmatisé par l’idéologie raciste américaine (Taylor, 2016; Robinson, 2019). Il va sans dire que les politiques visant à maintenir et à renforcer le pouvoir des élites américaines aux États-Unis ont été étayées par des politiques et des projets ailleurs dans le monde, presque toujours au détriment (et parfois au prix de la vie) des personnes qui en sont victimes.
M. Beauchemin pourrait récuser ma « réécriture accusatrice » (p. 11) de l’histoire de la trajectoire nationale américaine comme une caricature gauchiste et antinationaliste. En tout état de cause, les histoires enchevêtrées du Canada et du Québec sont très différentes de celle des États-Unis. Par exemple, on n’y trouve rien de comparable à la place centrale qu’a occupée l’esclavage dans le développement économique et politique des États-Unis. Mais d’autre part, il existe des zones de chevauchement important, car tous les trois sont des « sociétés de colons » qui actuellement ont bien du mal à faire face aux conséquences de leur traitement passé des Amérindiens. Une orientation historique selon laquelle « la ville de Montréal » est considérée comme un « territoire non cédé » (p. 11) ne peut être balayée du revers de la main comme Beauchemin le souhaiterait.
Étant donné l’intolérance de Beauchemin à l'égard de cette lecture, il n’est pas surprenant qu’il choisisse le modèle historique de la plus récente société de colonisateurs, Israël, pour inspirer un Québec en perte d’orientation nationaliste. D’après lui, « le peuple juif s’est maintenu depuis des siècles grâce à la préservation déterminée de sa culture », ce qui « lui a permis de traverser le temps en dépit des épouvantables malheurs qui l’ont accablé ». En cela, les Juifs ressemblent aux Canadiens français et aux Québécois, tels que décrits par Beauchemin, un peuple qui a perduré parce qu’il s’est raccroché à une conscience historique unifiée et unificatrice. Mais Beauchemin voit aussi ce qui les distingue fondamentalement : contrairement aux Canadiens français et aux Québécois, les Juifs ont franchi le dernier pas, de la culture vers le politique, en fondant l’État d’Israël « dont l’effet a été de donner à sa culture un prolongement politique capable d’assurer la pérennité de la collectivité » (p. 167).
Vue de cette manière, l’histoire du peuple juif et d’Israël pose deux problèmes. Premièrement, il s’agit d’un fantasme historique, comme l’a affirmé de manière convaincante l’historien israélien Shlomo Sand. Il n’est pas plus logique de parler du « peuple juif » – comme s’il avait traversé le cours de l’histoire en tant que collectivité ethnique cohérente pour enfin parvenir à se faire reconnaître comme nation – que de parler du « peuple bouddhiste » ou du « peuple bahaï » (Sand, 2012, p. 12). L’histoire des Juifs dans différentes parties du monde – de personnes qui se sont converties au judaïsme et l’ont abandonné, de personnes qui ont pratiqué une des multiples formes de la religion juive tout en participant à la culture des nombreuses sociétés où elles ont vécu – ne peut pas être transformée par un fiat nationaliste en l’histoire d’une ethnie cohérente et transhistorique. Et tout comme une ethnie juive durable fondée sur la culture n’a jamais existé, il n’y a jamais eu « d’identité génétique commune à toute la descendance juive du monde », aussi ardemment souhaitée soit-elle par les antisémites et les nationalistes juifs (Sand, 2012, p. 13).
En outre, les contours de la terre d’Israël – telle qu’elle avait été créée par les colons sionistes de concert avec la Grande-Bretagne et telle qu’elle est maintenant, élargie par l’État israélien – ne correspondent à aucune patrie historique. Là encore, il ne s’agit que d’un fantasme historique, « présenté comme un territoire défini, stable et reconnu » malgré les preuves bibliques et archéologiques accablantes selon lesquelles « un royaume uni englobant à la fois l’ancienne Judée et Israël n’a jamais existé » (Sand, 2012, p. 26, 24). Il ne peut y avoir de « droit de retour » vers une « terre » qui n’existe pas, encore moins un droit de retour pour expulser les occupants de la terre qui y vivaient depuis des générations. De plus, les Juifs européens qui fuyaient les pogroms du début du 20e siècle ont cherché à se rendre dans des États-nations comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, qui ne voulaient pas d’immigrants juifs et ont élaboré des politiques anti-immigrants pour les tenir à l’écart et pour tenter de les détourner vers le Moyen-Orient. Comme le fait remarquer Sand, « sans cette politique anti-immigration sévère, on peut douter que l’État d’Israël aurait vu le jour » (Sand, 2012, p. 20). Et aujourd’hui, la plupart des quelque cinq à sept millions de Juifs qui vivent aux États-Unis, ainsi que les 400 000 Juifs qui vivent au Canada n’ont aucun désir d’émigrer en Israël, préférant endurer les « tourments » de la vie diasporique que de quitter leur véritable patrie pour une patrie imaginaire (Sand, 2012, p. 21).
Encore plus troublante que l’acceptation par Beauchemin du mythe du peuple juif est sa célébration d’un État qui a construit une société d’apartheid, où les droits humains et politiques de la majorité de la région, à savoir les citoyens arabes d’Israël et les résidents de Cisjordanie et de Gaza, sont impitoyablement bafoués (Makdisi, 2008). (En droit israélien, ces personnes sont désignées comme « arabes » et non « palestiniennes », quelle que soit la façon dont elles choisissent de se définir). Le fantasme du président américain Donald Trump de construire des murs pour empêcher les étrangers indésirables d’entrer dans le pays tout en permettant aux citoyens d’aller et venir à leur guise, s’est vu concrétisé – et reconnu comme légitime par l’administration Trump – dans l’expansion israélienne en territoire palestinien. Ce seul fait devrait faire réfléchir tous ceux qui veulent prendre Israël comme modèle pour l’avenir politique du Québec. Un tel projet est non seulement moralement répréhensible, mais aussi politiquement voué à l’échec. Il a été amplement démontré que le soutien à Israël diminue chez les jeunes Juifs américains qui commencent à discerner les similitudes entre la politique israélienne de répression violente des Arabes/Palestiniens et la brutalité policière qui menace quotidiennement la vie des citoyens noirs des États-Unis (Beinart, 2020). Les mêmes jeunes qui tentent de transformer la conscience historique des États-Unis en une conscience où la vie des Noirs compte seront peut-être les électeurs de demain qui refuseront de cautionner le soutien de l’État américain à l’agression israélienne.
Il est beaucoup trop tôt pour savoir si ces électeurs de l’avenir continueront à considérer l’État-nation défini en termes ethniques comme la forme idéale d’organisation politique pour un monde globalisé – un monde où, de toute façon, le capital multinational compromet gravement la capacité des États à contrôler leur propre destin. Dans un tel monde, on peut affirmer que la question essentielle pour le peuple québécois n’est pas de savoir s’il est organisé politiquement comme une province au sein du Canada ou comme un État-nation indépendant établi sur une base ethnique. Ce qui importe davantage, c’est de savoir si tous les paliers gouvernementaux de l’État canadien (fédéral, provincial, local) peuvent offrir une vie digne à ses citoyens – sans priver aucun d’entre eux, ni personne d’ailleurs, des mêmes avantages. C’est sans doute en ce sens qu’à la fin d’Une démission tranquille, Beauchemin décrit un Québec contemporain à la fois « heureux » et « prospère ». « On peut bien rêver, nous dit-il, que le Québec soit la Scandinavie de l’Amérique et que s’approfondisse ici la culture ouverte et pluraliste qui caractérise les sociétés à l’avant-garde de la modernité ». En effet, il dit qu’une telle société existe déjà dans le « Québec d’aujourd’hui » (p. 204). Il déplore pourtant la perte de son âme nationaliste.
C’est son droit de se désoler ainsi. Pourtant, il existe une vision plus optimiste pour un Québec qui délaisserait le récit nationaliste qui domine depuis deux siècles. Patricia Lamarre a décrit le paysage linguistique de Montréal qui a pris forme dans la foulée de la loi 101 (Charte de la langue française). Une ville qui, dans les années 1960, « semblait en bonne voie de devenir une ville multiculturelle anglophone » est devenue « une ville beaucoup plus française qu’elle ne l’était autrefois, grâce notamment à la politique et à la législation linguistiques » (Lamarre, 2013, p. 42). Dans le même temps, elle est devenue à la fois la seule grande ville canadienne qui fonctionne dans une autre langue que l’anglais et la ville la plus bilingue du Canada. De surcroît, ce bilinguisme diffère de celui du passé, quand les francophones devaient apprendre l’anglais alors que les anglophones pouvaient continuer à faire fi du français : « De l’impulsion donnée dans les années 1970 à la francisation de Montréal et de ses milieux de travail est née une dynamique linguistique plus complexe dans laquelle le bilinguisme est utile à tous » (Lamarre, 2014, p. 132). En raison de l’immigration et de la mondialisation, de nombreux jeunes de Montréal sont trilingues, ils maîtrisent une autre langue mais ils parlent aussi couramment le français et l’anglais.
Tel que décrit par Lamarre, le paysage linguistique de Montréal ressemble à celui de nombreux pays européens. Les citoyens américains qui voyagent en Europe sont souvent étonnés par la facilité linguistique des habitants et pris d’envie mais aussi de colère face à la situation linguistique aux États-Unis, où les langues sont enseignées à tous les niveaux du système d’éducation, mais d’une manière remarquablement malhabile. Notre enseignement des langues semble conçu pour faire en sorte que nous restions monolingues, c’est-à-dire pour enrayer la capacité naturelle qu’a l’humain à être bilingue et même multilingue. Cela ne surprend guère, étant donné que le nationalisme américain s’est obstinément accroché à la notion idiote selon laquelle une société doit être monolingue pour rester unie. Le Canada anglais et le Canada français ont également souffert de nationalismes monolingues, mais la persistance de nationalismes linguistiques concurrents y a conduit au paysage linguistique le plus progressiste, ou avancé – ou simplement le plus gratifiant sur le plan humain – de l’Amérique du Nord, celui du Montréal d’aujourd’hui.
Il reste à voir si le nationalisme québécois du 21e siècle pourra s’accommoder de la ville de Montréal et de son histoire, et si les citoyens américains en viendront à considérer des endroits comme New York comme représentatifs de leur culture nationale et non comme une déviation de celle-ci.
Parties annexes
Bibliographie
- Abella, Irving, 1994 Compte rendu de l’ouvrage d’Esther Delisle, The Traitor and the Jew: Anti-Semitism and the Delirium of Extremist Right-Wing Nationalism in French Canada from 1929-1939, Toronto, Robert Davies Publishing, 1993, Canadian Historical Review, 75, 4 : 642-645.
- Austin, David, 2010 « Narratives of power: historical mythologies in contemporary Québec and Canada », Race and Class, 52, 1 : 19-32.
- Beinart, Peter, 2020 « Yavne: a Jewish case for equality in Israel-Palestine », Jewish Currents, July 7. [https://jewishcurrents.org/yavne-a-jewish-case-for-equality-in-israel-palestine/]. Consulté le 10 juillet 2020.
- Cronin, Willam, 1983 Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England, New York, Hill and Wang.
- Delisle, Esther, 1993 The Traitor and the Jew: Anti-Semitism and the Delirium of Extremist Right-Wing Nationalism in French Canada from 1929-1939, Toronto, Robert Davies Publishing.
- Fields, Gary, 2017 Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror, Los Angeles, University of California Press.
- Handler, Richard, 1988 Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison, University of Wisconsin Press.
- Lamarre, Patricia, 2013 « Catching “Montréal on the Move” and Challenging the Discourse of Unilingualism in Québec », Anthropological, 55, 1 : 41-56.
- Lamarre, Patricia, 2014 « Bilingual Winks and Bilingual Wordplay in Montréal’s Linguistic Landscape », International Journal of the Sociology of Language, 228 : 131-151.
- Makdisi, Saree, 2008 Palestine Inside Out: An Everyday Occupation, New York, W. W. Norton.
- McInnes, Maurie et Louis Nelson (dir.), 2019 Educated in Tyranny: Slavery at Thomas Jefferson’s University, Charlottesville, University of Virginia Press.
- Piketty, Thomas, 2013 Le Capital au XXIesiècle, Paris, Seuil.
- Reed, Isaac, 2018 « Jefferson’s two bodies: interpretations of a statue at the University of Virginia », dans : Chistopher Howard-Woods, Colin Laidely et Maryam Omidi (dir.), #Charlottesville: Before and Beyond, New York, Public Seminar Books, p. 64-84.
- Robinson, Cedric, 2019 On Racial Capitalism, Black Internationalism, and Cultures of Resistance, London, Pluto Press.
- Sand, Shlomo, 2012 Comment la terre d’Israël fut inventée: de la Terre sainte à la mère patrie, traduit de l’hébreu par Michel Bilis, Paris, Flammarion, 2012.
- Taylor, Alan, 2019 Thomas Jefferson’s Education, New York, W. W. Norton.
- Taylor, Keeanga-Yamahtta, 2016 From #BlackLivesMatter to Black Liberation, Chicago, Haymarket.