Corps de l’article
Le livre que nous offre Jacques Beauchemin pose la question du politique sous l’angle de la conscience historique du Québec contemporain. Il soulève l’enjeu de l’articulation entre le nationalisme et les projets politiques qui lui donnent un sens, une orientation, et ultimement des moyens d’action. À cet égard, cet ouvrage me semble emblématique d’une certaine façon de problématiser la question nationale québécoise et de lui assigner une seule finalité, à savoir l’atteinte de la souveraineté, qui sert d’unique point de référence pour évaluer son caractère « politique ».
Le lecteur comprend assez rapidement qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un essai militant. Il propose un état des lieux personnel de l’identité québécoise et nourrit ses réflexions notamment d’une lecture des textes, tout aussi militants, de Pierre Vadeboncoeur, qui avait dressé le même bilan. Bien qu’il ne le formule pas dans ces termes, tout l’argumentaire de l’auteur repose sur un sentiment de désabusement, voire de désenchantement et de désillusion, à l’endroit des Québécois francophones (il n’est jamais question des autres composantes de la société québécoise) qui n’ont pas souscrit au projet indépendantiste plongeant ses racines dans la Révolution tranquille. Dès lors, comme le prétend Beauchemin, « les perspectives émancipatrices que profilait la Révolution tranquille paraissent s’évanouir dans un Québec revenu de l’euphorie qu’avaient suscitée les idéaux enivrants de libération nationale, de décolonisation et d’indépendance politique » (p. 35). L’élan de liberté qui aurait marqué cette période s’est en quelque sorte fracassé sur le double refus des Québécois de former un pays lors des référendums de 1980 et 1995. À la lumière de ce constat, Jacques Beauchemin nous invite à comprendre que le Québec serait entré dans une période de déliquescence marquée par un ensemble de traits tous plus déprimants les uns que les autres : un rapport ambivalent au passé; un refus inconscient de se poser en sujet libre et responsable de lui-même; un rejet de l’agir politique; un recours aux mythes compensatoires – notamment celui du Canada français; un défaitisme larvé; une attitude démissionnaire largement inconsciente; un sentiment d’impuissance; un repli sur la culture comme seule garantie de la survivance; un rétrécissement du projet émancipateur conçu au cours des années 1960; un étiolement de la représentation du sujet politique; une soumission tacite à l’ordre des choses; un repli inquiet sur ce qui avait constitué l’essentiel du parcours historique québécois; une impuissance politique ayant pour conséquence de l’empêcher d’atteindre la souveraineté; une dépolitisation qui renvoie à l’affirmation régressive d’une conception de la collectivité qui la dépeint sous les traits de l’ethnie, de la race ou de la culture; une propension à l’apolitisme; un authentique retour en arrière; un renoncement à l’émancipation politique signe d’un recul et d’une rémanence des illusions de la permanence à la fois consolatrice et paralysante. Pour qui n’aurait pas bien compris le message, il termine en soutenant que « renoncer au statut de sujet politique et accepter la dépolitisation de notre être collectif annonce peut-être la folklorisation de notre collectivité. Un tel pronostic […] pointe en tout cas en direction de ce qui aurait dû être et de ce qui semble nous échapper » (p. 205).
Il y a plusieurs façons de commenter cet ouvrage. J’en retiendrai deux. La première est d’ordre conceptuel. Jacques Beauchemin ne peut que déplorer la « dépolitisation de l’identité québécoise » lorsque cette dernière est définie de la manière dont il le fait. La seconde porte plutôt sur la lecture unidimensionnelle, voire déterministe, des intentions qui ont alimenté la Révolution tranquille.
Sur la « dépolitisation de l’identité québécoise »
Traitons d’abord la question de la dépolitisation. L’auteur l’aborde comme une métaphore (p. 32). Jacques Beauchemin voit dans la dépolitisation une tendance et non pas un authentique retour en arrière. Soit! Il y aurait donc une tendance à une présénescence de la représentation que se fait la communauté politique d’elle-même. Toute métaphorique qu’elle soit, elle constitue pourtant une « régression dans la mesure où il s’agit d’une dynamique qui procède d’un renoncement à l’action, d’une dépossession des moyens que s’était donnés la collectivité afin d’atteindre les fins collectives. Plus fondamentalement encore, elle opère une redéfinition du sujet politique qui le démet de sa capacité à s’inscrire dans le mouvement d’une histoire dont il serait l’auteur » (p. 33). Et cette histoire qui a donné lieu à la constitution d’un véritable sujet politique dans sa plénitude est celle de la Révolution tranquille au cours de laquelle aurait été poursuivi le projet de libération nationale. Énoncée de multiples manières, l’idée avancée est que le non-aboutissement du projet souverainiste démet le sujet politique « de sa capacité à s’inscrire dans le mouvement d’une histoire dont il serait l’auteur » (p. 33). Il ne s’agirait ni plus ni moins que d’une démission qui « annoncerait la destitution, dont nous serions les premiers responsables, de l’acteur historique maître de son destin que nous avons appris à être depuis soixante ans » (p. 198). En d’autres termes, la « politisation » n’est possible que lorsqu’elle se met au service d’un projet, et d’un seul, celui de l’indépendance du Québec. Vu sous cet angle, le déclin de l’option souverainiste ne peut qu’être appréhendé comme la manifestation de cette dépolitisation qui prend la forme d’un défaitisme larvé et suscite une « attitude démissionnaire largement inconsciente » (p. 25).
Cet argument de la dépolitisation ne va pas de soi. D’abord, il fait appel à une interprétation psychologisante qu’il est impossible, me semble-t-il, d’appliquer à une collectivité dans sa totalité. Ensuite, il repose sur une distinction introduite par l’auteur entre l’action et l’agir politiques. La première se présente sous les traits de revendications, d’organisations partisanes ou inscrites dans la société civile, et se déploie dans l’arène politique largement définie. Il s’agit, en d’autres termes, des activités, regroupements, revendications ainsi que des processus et des institutions entourant l’exercice du pouvoir. L’agir politique, quant à lui, suppose l’existence d’un sujet politique unifié, ou unitaire, engagé dans la voie de son émancipation. On comprendra que seul l’agir politique est porteur de sens, tout le reste n’étant qu’agitation et, ultimement, refus du politique. C’est d’ailleurs sur cette base que l’auteur juge le choix de l’électorat d’élire un gouvernement caquiste (il faut rappeler que la CAQ a formé un gouvernement majoritaire en n’obtenant que 37 % des voix en 2018, le plus faible pourcentage depuis 1867) qui ne serait porteur d’aucun projet politique puisqu’il a renoncé à la souveraineté et qu’il se contente d’exprimer une confiance molle en l’avenir (p. 137). Mais ce distinguo entre action et agir politiques ne sert que le propos de l’auteur en ce qu’il repose sur un jugement à la fois normatif et prescriptif et ne trouve aucune assise théorique en sciences sociales. Mais il y a plus.
L’une des idées récurrentes dans les écrits de Jacques Beauchemin est celle de « sujet politique », qui se manifeste, comme il l’a déjà énoncé il y a vingt ans, « dans une certaine unicité fondatrice et nécessaire du sujet politique aux prétentions universalistes » (Beauchemin, 2001, p. 209) ou, dit autrement, comme « un foyer de reconnaissance dans lequel la communauté empirique se reconnaît sous la figure universaliste d’un nous-collectif » (Beauchemin, 2000, p. 32) qui est à la fois synthétique et transcendant. Une autre idée récurrente est celle de conscience historique et d’identité collective comme réalités globales et cohérentes. Le sujet politique québécois est celui qui renvoie à l’existence d’une nation, d’un nous-collectif incarnant un ensemble de valeurs, de préférences et d’un projet de libération qui se sont constitués au fil du temps. Ces deux acceptions posent pourtant toujours problème. Non parce que la nation québécoise n’existe pas, mais parce qu’elle est présentée comme un tout cohérent mû par « une » conscience historique et dont le destin salvateur ne peut se réaliser qu’à travers l’accession à sa pleine souveraineté. Beauchemin a soutenu plus récemment que le sujet politique, porteur du projet souverainiste, était devenu problématique et introuvable (voir Beauchemin, 2015, p. 74). Ces deux idées présupposent une certaine unité autour d’une identité qui serait partagée. Cette dernière est une donnée qui ne saurait être remise en question.
Pourtant, dans son dernier opus, la constitution du sujet politique et de la représentation de la nation ne semble plus être le fruit de débats, de conflits, de luttes autour des paramètres définissant cette représentation collective. Existe-t-il quelque chose comme une conscience historique commune? Nous pouvons penser qu’il existe en effet une conscience historique dominante, ce qui nous éloigne des termes proposés par Jacques Beauchemin. Bien qu’il admette que ces idées ne supposent pas une adhésion unanime, il affirme néanmoins que
toutes les sociétés se rassemblent en un lieu commun où se trouve suspendu pour un temps le conflit social. C’est précisément l’existence du « commun » de la société qui lui permet de se donner un projet et de souscrire à un certain aménagement de l’existence collective. C’est également la raison pour laquelle il est permis d’aborder la conscience historique comme si elle formait un ensemble cohérent dont les effets imprègnent l’ensemble des acteurs sociaux. Les sociétés sont ainsi des communautés en ce sens où elles se reconnaissent toujours dans un au-delà du conflit au sein duquel s’articule une définition des communautés qu’elles forment.
Beauchemin, 2020, p.17
Je ne souscris pas à ce postulat. Le conflit social n’est jamais « suspendu », pas plus qu’il n’existe un ensemble cohérent de représentations partagées par la totalité des acteurs sociaux. Il s’agit là d’un constat propre à toutes les sciences sociales. Le conflit est consubstantiel aux rapports sociaux. Comme l’écrivait Julien Freund, « la caractéristique fondamentale de notre époque réside dans le fait que toutes les activités humaines sont soumises en même temps à la contestation interne et à une critique radicale » (Freund, 1983, p. 9). Même chez les fondateurs de la sociologie comme Max Weber, le choix des acteurs se déroule dans un contexte de lutte (Kuty, 2020, p. 69). Au contraire, les représentations font continuellement l’objet d’affrontements et d’opposition par les individus et les groupes qui s’en trouvent exclus et qui considèrent qu’ils n’occupent pas l’espace qui devrait leur être reconnu. Il me paraît faux de penser que le « lieu commun » serait d’abord constitué en dehors du politique, des rapports de pouvoir, dans un nirvana exempt de tensions, pour y être ensuite réintroduit comme mesure ultime de la (dé)politisation d’une société ou de son identité. Cela dit, je ne soutiens nullement que Jacques Beauchemin ne reconnait pas l’existence des conflits et des luttes sociales, et sa réflexion sur la politisation des identités particularistes, sur la fragmentation sociale à laquelle elle a donné lieu et sur la marginalisation d’une représentation du bien commun et d’un projet collectif d’émancipation reposant sur une communauté d’histoire (Beauchemin, 2004) demeure toujours aussi pertinente.
Jacques Beauchemin compte parmi ceux qui ont fait remarquer que nous assistons, aujourd’hui comme hier, à une remise en question de la conception unificatrice du « commun ». Ce phénomène n’est pourtant pas nouveau. Il y a quelques décennies, c’est la place occupée par la religion, le Canada français étant défini en fonction de sa foi et de sa langue, qui fit l’objet d’une remise en question radicale (Meunier, 2011; Larochelle, 2014). L’identité du Canada français en fut chamboulée. Il en fut de même lorsque les Québécois francophones ont investi le seul espace politique qu’ils étaient en mesure de contrôler, territorialement circonscrit, et ont délesté leur identité canadienne-française (Gagnon, 1992; Pelletier, 1992). Aujourd’hui, la multiplication des référents identitaires (sur la base du genre, de la couleur de la peau, de l’origine ethnique, et même de la religion) contribue à fractionner l’idée que « la communauté que l’histoire a jetée sur les rives du Saint-Laurent », comme il désigne la nation québécoise (Beauchemin, 2020, p. 17), se fait d’elle-même. Cela, Jacques Beauchemin l’a déjà noté dans ses travaux antérieurs, y reconnaissant l’effacement d’un sujet politique prééminent causé par le refus des identités particularistes de s’abolir au profit du sujet politique abstrait, porteur de culture et de mémoire, que constitue la nation. Il a aussi fait remarquer que les francophones québécois sont divisés quant à leur autoreprésentation tout comme sur les objectifs politiques qu’il conviendrait de poursuivre (Beauchemin, 2002, p. 167). Au tournant de ce siècle, il croyait toujours en la possibilité de refonder la communauté politique autour d’un sujet politique (de culture et de mémoire) réconcilié qui souscrirait à un projet de société rassemblant les diverses composantes de la société québécoise. Il admettait que ce projet pourrait être celui de la souveraineté du Québec, tout en reconnaissant que d’autres voies pouvaient aussi être suivies (Ibid., p. 185). Jacques Beauchemin n’en est plus là. Aujourd’hui, le ton est plus pessimiste, une seule option politique s’offre au sujet politique national et ceux qui n’y adhèrent pas se voient accusés d’avoir capitulé et de se complaire dans une action politique stérile plutôt que de choisir l’agir politique émancipateur.
De plus, et c’est là que le bât blesse, il demeure problématique de penser, en amont, le sujet politique en dehors du conflit et de l’y réintroduire au moment de porter un jugement sur un projet politique en lui-même hautement conflictuel, comme si l’indépendance ne se heurtait pas à une forte opposition d’acteurs sociopolitiques au sein même de la société québécoise, y compris parmi les francophones présumés appartenir à ce sujet politique appréhendé comme unifié et cohérent. En d’autres termes, le projet d’émancipation de ce sujet de culture et de mémoire est, in fine, politique quelle que soit la forme qu’il adopte. On ne peut si facilement, comme semble le faire Jacques Beauchemin, disqualifier les porteurs de stratégies d’émancipation qui ne souscrivent pas à l’idée d’indépendance en les considérant comme des tenants de la permanence tranquille (l’est-elle vraiment?), et considérer qu’ils abdiquent « inconsciemment » devant le défi permanent de se poser en sujets libres et responsables, qu’ils ne sont portés que par des stratégies d’évitement et que, ce faisant, ils dépolitisent la représentation de la nation en tant que communauté politique.
Sur les intentions de la Révolution tranquille
Pour Jacques Beauchemin, le moment charnière de la constitution du nouvel espace symbolique de l’identité collective, de la fondation d’un peuple nouveau, de la volonté de maîtriser le destin national, d’embrasser les idéaux de libération nationale, de la rupture avec le lien colonial et de la souveraineté serait celui de la Révolution tranquille. C’est à cette période et aux idéaux qu’elle portait que la société québécoise aurait tourné le dos, conduisant à l’étiolement de son projet national : « Ce que la dépolitisation suppose, c’est une forme de délaissement de la représentation du sujet politique dans la plénitude que lui avait conférée la Révolution tranquille » (Beauchemin, 2020, p. 31). Ce recul identitaire se traduirait par une redécouverte du Canada français, signe de désarroi et d’une illusion, ainsi que d’un repli inquiet sur l’essentiel du parcours historique québécois (Ibid., p. 105).
L’auteur reprend l’idée d’une rupture, idée qui a par ailleurs été remise en question par les historiens depuis au moins quarante ans (et par lui-même soit dit en passant, voir Bourque, Duchastel et Beauchemin, 1994). Leurs travaux ont mis l’accent sur le fait que la Révolution tranquille doit plutôt être appréhendée sous l’angle d’une certaine continuité, que Jacques Rouillard qualifie de tournant. Loin d’être une société où régnerait l’unanimité, la société québécoise est divisée en classes sociales aux intérêts divergents, traversée par une multitude de conflits sociaux et son paysage idéologique est largement diversifié (Rouillard, 1998, p. 25; voir aussi Linteau, 1999). En d’autres termes, les idées et les mouvements sociaux qui ont marqué cette période ne sont pas apparus de manière spontanée et les idéaux partagés par un grand nombre d’acteurs sociaux et d’intellectuels ont pavé la voie aux réformes des années 1960 (Denis, 1988; Bienvenue, 2003; Gauvreau, 2008; Clavette, 2008; Ferretti, 2011; Simard et Allard, 2011; Falardeau, 2016). Si la date de naissance de la Révolution tranquille n’est jamais mentionnée, elle correspondrait néanmoins au début des années 1960. Toutefois, nul ne sait quand elle se termine. Nous pourrions reprendre à notre compte l’interrogation d’Yvan Lamonde : « Quand il s’agit de trouver le terminus ad quem de cette Révolution tranquille : est-elle finie même, s’est-elle close en 1966 avec le retour du refoulé et l’élection de l’Union nationale, en 1970 avec la crise d’Octobre, en 1976 avec l’arrivée au pouvoir du premier parti politique souverainiste, en 1980 ou en 1995 avec les référendums sur la souveraineté ? » (Lamonde, 2011, p. 14-15). La même imprécision caractérise l’essai de Jacques Beauchemin, ce qui lui permet sans doute d’inclure la période au cours de laquelle le Parti Québécois (PQ) était au pouvoir jusqu’au référendum de 1995… et contribue à nourrir son sentiment de désespoir à l’endroit du non-aboutissement de la cause au service de laquelle il met sa plume.
De plus, la Révolution tranquille ne saurait être réduite, voire rabattue, à une seule intention qui serait celle de l’accession à l’indépendance politique. Certes, les bases du mouvement souverainiste ont été jetées au cours de cette période. Toutefois, les années 1960 ont surtout été marquées par une impulsion, celle de la mise en place d’un État interventionniste au diapason de ce qui s’était constitué ailleurs au Canada et dans d’autres sociétés occidentales. Si la Révolution tranquille a tant marqué l’imaginaire québécois, c’est bien parce que cette courte période (1960-1970) est caractérisée par la mise en place, à un rythme sans précédent, d’un grand nombre de réformes qui ont durablement transformé la société québécoise. On associe volontiers le début de celle-ci avec l’élection du Parti libéral du Québec (PLQ) en juin 1960. Les réformes de cette période avaient, pour la plupart, été réclamées par de multiples organisations de la société civile, des syndicats au patronat. Nous avons assisté à un changement de garde politique et de mentalité. La création du Parti québécois marque l’arrivée d’une nouvelle élite politique générationnelle (Lemieux, 2011). Rétrospectivement, la Révolution tranquille a été marquée par une triple volonté : moderniser l’État, appuyer le développement d’une classe d’affaire francophone tout en fournissant les instruments (et la main-d’oeuvre) susceptibles de présider au développement économique et de modifier la place et le statut du Québec au sein (ou hors) du Canada. De nombreuses réformes et projets politiques ont alimenté l’une ou l’autre de ces volontés.
D’abord, la modernisation de l’État s’est effectuée à travers une réforme en profondeur de la fonction publique. Naît une nouvelle technocratie. De nouveaux ministères sont créés. La réforme de l’éducation constitue l’une des principales réalisations de la Révolution tranquille. Tout comme ce fut le cas avec les changements opérés dans le domaine de la santé, elle permet aux « laïcs » d’occuper une place prépondérante dans un secteur jadis dominé par les institutions religieuses. Bien qu’il faille attendre encore quelques décennies avant de déconfessionnaliser totalement le système d’éducation, le principe de la sécularisation de l’éducation s’impose graduellement. Ensuite, d’autres transformations, inspirées d’une nouvelle forme de nationalisme économique, prendront place. L’État devient un intervenant de premier plan dans le développement économique et contribuera à développer les assises d’une nouvelle bourgeoisie francophone – qui se fera le promoteur du Québec Inc. des années 1990 et, retournement de l’histoire, du néolibéralisme contemporain (Brunelle, 1978, Fournier, 1978; Sales, 1979; Gagnon et Paltiel, 1992; Bélanger, 1998).
Cette mobilisation de l’État comme outil de développement collectif marqua aussi la représentation que les francophones québécois avaient d’eux-mêmes. On pourrait parler d’une transformation du rapport au territoire. Le Canada français, lieu de référence symbolique du nationalisme conservateur des élites traditionnelles, allait être remplacé par l’espace québécois. Les frontières politiques, culturelles, sociales et économiques se redessinent à plus d’un niveau. Une nouvelle élite prend les rênes de l’État, investit les institutions publiques et parapubliques.
Cette nouvelle représentation du territoire est au coeur du néonationalisme qui prend son essor au cours de la Révolution tranquille et qui altère la façon dont la relation avec le reste du Canada doit se transformer. Cette dimension est absente de la réflexion de Jacques Beauchemin, comme si l’émancipation du sujet politique québécois n’était pensée au cours de cette période qu’en dehors du régime fédéral. Le gouvernement fédéral voit évoluer la situation avec inquiétude et met sur pied, en 1963, la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme (coprésidée par André Laurendeau et Davidson Dunton) (Lapointe-Gagnon, 2018). Pourtant, le gouvernement du Québec cherche moins à assurer la « bilinguilisation » du Canada et de la fonction publique fédérale qu’à se doter des outils qu’il juge indispensables à l’accomplissement de sa nouvelle mission. C’est ainsi qu’est lancé le débat constitutionnel dès la fin des années 1960, qui ne prendra fin qu’avec l’échec des accords de Meech (1990) et de Charlottetown (1992). Pour le gouvernement du Québec, il s’agissait moins de préserver les juridictions et l’autonomie provinciale, approche si chère à Maurice Duplessis, que de revoir le partage des compétences de façon à transférer vers le Québec des pouvoirs détenus en vertu de la Constitution de 1867 ou exercés par le gouvernement central au nom de son pouvoir de dépenser.
C’est dire que le nationalisme qui s’est imposé au cours de la période de la Révolution tranquille reposait sur le dynamisme de l’action étatique. Il a sans doute contribué à redessiner les contours de l’identité québécoise, comme le soutient Jacques Beauchemin, mais il a surtout été animé par un désir d’émancipation des Québécois francophones au sein du Canada et, pour une minorité agissante, par la constitution d’un État souverain. Le mouvement souverainiste n’en était qu’à ses balbutiements, comme en fait foi le succès relatif du Parti québécois aux élections de 1970 et 1973 où il n’obtient que 23 et 30 pour cent des voix. L’État québécois a cherché à prendre en main le développement économique et social du Québec à travers un ensemble de politiques qui visaient à conférer un nouveau statut aux Canadiens français longtemps relégués aux échelons inférieurs d’une société dont ils constituaient pourtant la majorité. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la croissance de l’interventionnisme étatique et la prise de conscience de la puissance de l’État comme outil de promotion socio-économique aient amené les gouvernements qui se sont succédé à Québec depuis 1960 à réclamer – bien qu’à des degrés variables – plus de pouvoirs pour agir en fonction des intérêts des Québécois, et plus particulièrement des francophones. Il n’est pas surprenant non plus que parmi toutes les options possibles se soient côtoyés dans un rapport concurrentiel des mouvements défendant tantôt l’idée d’un réaménagement en profondeur du fédéralisme canadien, tantôt l’idée de la souveraineté assortie d’une association économique avec le reste du Canada. Ces deux options émanaient d’une même dynamique, bien qu’elles aient présenté des lectures divergentes des voies à suivre pour consolider les fondements économiques, politiques et sociaux de la société québécoise. Il me semble réducteur d’attribuer au seul mouvement souverainiste la paternité de la « politisation » de l’identité québécoise – ou de son agir politique – et de reléguer les demandes de modifications constitutionnelles au rang « d’action politique » délestée de tout projet sociétal émancipateur.
En somme, l’idéologie nationaliste de la Révolution tranquille s’est essentiellement articulée autour de la nécessité pour certaines couches de la société québécoise francophone d’avoir recours à l’outil étatique pour promouvoir leurs intérêts. La nouvelle définition de l’identité québécoise, principalement chez les francophones, s’est donc structurée autour de l’État, vu comme le grand instrument d’émancipation de la nation canadienne-française. Comme le rappelle Yvan Lamonde, le mouvement indépendantiste « est de façon inédite associé à l’État au seuil des années 1960 » (Lamonde, 2011, p. 13). C’est donc dire que cette période a permis de réaliser une jonction entre l’accroissement de l’activité étatique et la consolidation de l’identité collective nationale, et ce aussi bien pour ceux qui prônaient une réforme du fédéralisme que pour les indépendantistes. Ainsi, le mouvement de remise en question de l’État-providence et du projet étatiste qu’il portait, phénomène qui s’est d’ailleurs manifesté dans l’ensemble des pays occidentaux au cours des quatre dernières décennies et qui n’a pas manqué de frapper le Québec, ne pouvait que transformer de manière concomitante le projet nationaliste. Ce mouvement est appuyé aussi bien par un large segment de l’électorat que par l’élite économique. Les principaux bénéficiaires des réformes dans les domaines de l’éducation, de la culture, des affaires sociales et, surtout, de l’économie, ont en quelque sorte tournés le dos aux conditions ayant permis leur réussite.
Jacques Beauchemin néglige de considérer les effets de plus de quatre décennies marquées par la montée, puis par l’hégémonie des idées néolibérales. Celles-ci ont contribué à remettre en question le caractère structurant des États, la notion de bien commun, la nécessité de l’action collective et des références communes. Or, l’idée d’indépendance a été indissolublement liée à celle de la construction de l’État du Québec et du projet collectif qui alimentait ce mouvement. Que ce soit chez les libéraux ou chez les péquistes, cet idéal s’est édulcoré au point que les citoyens, de qui l’État était au service, sont plutôt considérés comme des clients (Rouillard, 2004 et 2008; Hurteau et Fortier, 2015). La remise en question de l’État-providence et du projet étatiste qu’il soutenait se conjugue avec le déclin du projet souverainiste défendu comme la construction d’un État national et progressiste (Dufour et Forcier, 2015, p. 15; Arsenault, 2018). Les valeurs de coopération, de solidarité et de recherche du bien commun, essentielles à la construction d’une collectivité différente en Amérique du Nord, se butent aux valeurs individualistes et matérialistes propres au néolibéralisme.
De la même manière, Jacques Beauchemin passe sous silence le fait que les rapports entre les gouvernements québécois et canadien ont évolué au fil du temps. En fait, l’existence du Canada constitue un angle mort de son analyse, comme si la dynamique politique québécoise se suffisait à elle-même. Cependant, malgré les échecs répétés des pourparlers constitutionnels des années 1980 et 1990 (il faut tout de même souligner que la Constitution canadienne a été modifiée à onze reprises depuis 1983), le système fédéral n’est pas pour autant sclérosé. En 1997, les gouvernements du Canada et du Québec ont procédé à un amendement constitutionnel qui a permis l’instauration de commissions scolaires sur une base linguistique plutôt que religieuse au Québec. Le gouvernement fédéral souscrivit à cette demande, même si cette dernière lui fut soumise par le gouvernement du PQ (Rocher, 2020). Qui plus est, le gouvernement fédéral a répondu à bon nombre de demandes constitutionnelles formulées par le gouvernement du Québec lors des négociations ayant mené à l’Accord du lac Meech de 1987 en adoptant une série de réformes paraconstitutionnelles (Taillon, 2016; Webber, 2018). Bien que l’échec de ces pourparlers ait miné la confiance de nombreux Québécois quant à la volonté des Canadiens hors Québec de souscrire à leur vision du Canada, la classe politique canadienne a adopté un train de mesures s’inspirant des principes du défunt accord, au point que ceux-ci guident maintenant, dans une certaine mesure, la pratique du fédéralisme canadien. La Chambre des communes a entériné une série de résolutions qui reconnaissent le Québec à titre de société distincte (1995) ou le fait que les Québécois forment une nation dans un Canada uni (2006); des ententes ont été conclues en matière d’immigration; le pouvoir fédéral de dépenser est partiellement circonscrit par la possibilité de signer des ententes asymétriques; toute modification à la Constitution canadienne requiert le consentement du Québec à la suite de l’adoption, par le Parlement fédéral, de la Loi concernant les modifications constitutionnelles en 1995. Les capacités d’intervention du Québec (et des autres provinces), à travers une série d’accords intergouvernementaux à caractère asymétrique, ont été substantiellement redéfinies de manière à limiter, autant que faire se peut, les intrusions fédérales.
L’évolution du fédéralisme canadien a donc permis d’atténuer, sans toutefois le faire disparaître, le sentiment d’insatisfaction que bon nombre de Québécois éprouvaient à l’endroit du Canada. En fait, le taux de satisfaction vis-à-vis des orientations prises par le gouvernement fédéral était en 2020 légèrement supérieur à la moyenne canadienne (55 pour cent par rapport à 49 pour cent) et se classait au sommet de toutes les provinces. Le niveau d’insatisfaction de l’Alberta (59 pour cent) était même deux fois plus élevé que celui du Québec (30 pour cent), qui s’avérait être la moins insatisfaite de toutes les provinces canadiennes (la moyenne étant de 41 pour cent) (Environics Institute for Survey Research, 2020a, p. 6). La quête d’affirmation nationale s’est, pendant quelques décennies, cristallisée autour d’enjeux constitutionnels. Les réponses partielles, bien qu’insatisfaisantes à bien des égards, aux demandes formulées par les gouvernements québécois successifs depuis le milieu des années 1960 jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas pris le chemin constitutionnel. Des tensions persistent sur certains enjeux importants, notamment concernant l’imposition d’une interprétation des droits enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés qui s’inscrit dans une tradition juridique anglo-saxonne parfois peu sensible aux défis rencontrés par la nation minoritaire québécoise. Il en est de même de l’inscription dans la Constitution du principe du multiculturalisme qui n’a jamais été populaire auprès des élites politiques québécoises et de bon nombre d’intellectuels qui l’ont durement critiqué. D’une certaine manière, bon nombre de Québécois se sentent, pour reprendre l’expression du politologue Guy Laforest, des exilés ou des étrangers au sein du Canada (Laforest, 2014, p. 22). Toutefois, en dépit des nombreux désaccords, la place du Québec s’est en quelque sorte « normalisée » au sein du Canada.
Comme l’a fait remarquer le sociologue Simon Langlois, le déclin des appuis au projet indépendantiste chez les Québécois francophones, et chez les jeunes en particulier, apporte un certain soutien à la thèse du « mouvement social victime de sa réussite ». Les personnes sur le marché du travail ne rencontrent plus les mêmes obstacles qu’autrefois à leur avancement professionnel et l’anglais est moins perçu comme étant menaçant, mais plutôt vu comme une langue fonctionnelle. L’indépendance nationale ne serait plus considérée comme étant aussi nécessaire qu’auparavant alors que persistaient plusieurs griefs propres aux francophones (Langlois, 2018; Guay, 2017). L’impasse dans lequel se trouve le mouvement souverainiste est difficilement surmontable. La nécessité de l’indépendance est encore moins ressentie chez les personnes nées depuis le milieu des années 1980. Elles n’ont pas connu ou participé au référendum de 1995. Ce groupe représente tout de même près de deux millions de personnes maintenant aptes à voter, soit près de 30 pour cent des électeurs. Les personnes appartenant à ce groupe se montrent généralement moins attachées au Québec ainsi qu’au Canada contrairement à celles appartenant aux générations précédentes. Le conflit Québec-Canada les interpelle dans une moins grande mesure, en partie parce que cette génération n’a pas connu les frustrations ayant marqué leurs aînés. Les millénariaux sont aussi moins favorables à un accroissement des pouvoirs de l’État québécois et à peine plus d’un cinquième d’entre eux considèrent l’enjeu de l’indépendance du Québec comme étant important (Mahéo et Bélanger, 2018, p. 343 et 351-352). Qui plus est, selon les données d’un sondage réalisé en 2020, les jeunes Québécois francophones sont un peu moins susceptibles que leurs pairs plus âgés de s’identifier comme Québécois seulement ou d’abord (61 pour cent par rapport à 71 pour cent pour les francophones de 55 ans et plus), et plus susceptibles de s’identifier comme Canadiens seulement ou d’abord (respectivement, 17 pour cent et 10 pour cent) (Environics Institute for Survey Research, 2020b, p. 7).
Une analyse de sociologie politique s’intéressant plus aux intérêts portés par ce groupe et moins à la transmission des profondeurs de la conscience historique tend à montrer que le projet politique de libération nationale a moins de résonance auprès de cette population simplement parce qu’il lui apparaît moins pertinent pour lui garantir un avenir meilleur, ce qui n’était pas le cas pour une partie des Québécois qui ont connu l’infériorité économique vécue par les Canadiens français avant la Révolution tranquille (Monière, 2001, p. 133; Meunier, 2016, p. 54).
En somme, l’effacement graduel de l’enjeu constitutionnel au Québec, combiné avec le désintérêt, voire l’indifférence, qui s’exprime dans le reste du Canada à son endroit, a fait en sorte que le clivage « souverainiste/fédéraliste » qui opposait traditionnellement le PQ au PLQ est moins pertinent pour une proportion significative de l’électorat. Ce facteur a sans doute joué dans l’intérêt suscité par la création d’un parti politique de centre droit, la Coalition Avenir Québec, qui ne prône ni la souveraineté ni la relance des discussions constitutionnelles avec le reste du Canada, se contentant de réaménager avec beaucoup d’imagination sa Constitution interne. Cela a aussi contribué à ce que les 18-34 ans se reconnaissent en grand nombre au sein du parti Québec solidaire qui place le social avant le national (ou, pour reprendre les termes de Jacques Beauchemin, avant le sujet politique québécois) (Sarra-Bournet, 2019, p. 6). Là encore, n’y voir que de l’agitation politique marquée par un défaitisme larvé, une impuissance politique et une attitude démissionnaire largement inconsciente, c’est ne pas tenir compte de la complexité inhérente à la société québécoise et à la reconfiguration des rapports de force à laquelle nous avons assisté au cours des dernières décennies.
⁂
Il faut nous demander si Jacques Beauchemin ne cherche pas à refaçonner, voire relancer à sa manière, le mythe d’une Révolution tranquille qu’il considère portée exclusivement par un « élan de liberté » qui ne peut trouver son achèvement que dans l’indépendance du Québec. Je reprends ici la riche analyse du mythe que propose Gérard Bouchard qui y voit l’affirmation d’un jeu de représentations qui « fixe des repères à l’identité et une direction à l’action collective, qui s’incarne […] aussi bien dans des objets et des personnages que dans des événements et des récits » (Bouchard, 2005, p. 413). C’est à cet exercice que se prête le livre de Jacques Beauchemin. L’effort n’est pas inutile ni sans pertinence dans une perspective militante. Il doit en revanche se confronter au regard critique de qui voit dans l’histoire du Québec un ensemble de louvoiements marqués par les contingences, les incertitudes et, ultimement, la reconfiguration des rapports de force internes et externes à cette société en fonction des contextes particuliers. Je ne constate là ni évitement ni renoncement ni défaitisme, et encore moins une adhésion à un sentiment de permanence tranquille quant à la place que les francophones occuperont en Amérique du Nord. Mon regard se porte ailleurs. Je constate plutôt que la société québécoise, comme toutes les autres d’ailleurs, est traversée par des contradictions et des tensions qui font en sorte qu’il est impossible de trouver « le » sujet politique unifié, car il n’existe tout simplement pas. Pour cette raison, on ne peut pas lui reprocher de démissionner. L’identité québécoise ne peut pas être autre chose qu’un enjeu politique allergique à la dépolitisation.
Parties annexes
Bibliographie
- Arsenault, Gabriel, 2018 L’économie sociale au Québec : une perspective politique, Québec, Presses de l’Université du Québec. (Coll. Politeia)
- Beauchemin, Jacques, 2000 « La communauté de culture comme fondement du sujet politique chez Fernand Dumont », Bulletin d’histoire politique, 19, 1 : 29-39.
- Beauchemin, Jacques, 2001 « Le sujet politique québécois : l’indicible “nous” », dans : Jocelyn Maclure et Alain-G. Gagnon (dir.), Repères en mutation. Identité et citoyenneté dans le Québec contemporain, Montréal, Les Éditions Québec/Amérique, p. 205-220.
- Beauchemin, Jacques, 2002 L’histoire en trop. La mauvaise conscience des souverainistes québécois, Montréal, VLB éditeur.
- Beauchemin, Jacques, 2004 La société des identités : éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna.
- Beauchemin, Jacques, 2015 La souveraineté en héritage, Montréal, Boréal.
- Bélanger, Yves, 1998 Québec Inc. : l’entreprise québécoise à la croisée des chemins, Montréal, Hurtubise HMH.
- Bienvenue, Louise, 2003 Quand la jeunesse entre en scène : l’Action catholique avant la Révolution tranquille, Montréal, Boréal.
- Bouchard, Gérard, 2005 « L’imaginaire de la grande noirceur et de la révolution tranquille : fictions identitaires et jeux de mémoire au Québec », Recherches sociographiques, 46, 3 : 411-436.
- Bourque, Gilles, Jules Duchastel et Jacques Beauchemin, 1994 La société libérale duplessiste, Montréal, Presses de l’Université de Montréal. (Coll. Politique et économie. Études canadiennes.)
- Brunelle, Dorval, 1978 « Le capital, la bourgeoisie et l’État du Québec, 1959-1976 », dans : Pierre Fournier (dir.), Le capitalisme au Québec, Montréal, Les Éditions coopératives Albert Saint-Martin, p. 79-108.
- Clavette, Suzanne, 2008 Gérard Dion. Artisan de la Révolution tranquille, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Denis, Roch, 1988 « Une révolution pas si tranquille… avant 1960 », dans : Jean-François Léonard (dir.), Georges-Émile Lapalme, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 61-71. (Coll. Les leaders politiques du Québec contemporain.)
- Dufour, Frédérick Guillaume et Mathieu Forcier, 2015 « Immigration, néoconservatisme et néolibéralisme après la crise de 2008 : le nouveau régime de citoyenneté canadien à la lumière des trajectoires européennes », Revue Interventions économiques, 52. [http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2514], consulté le 3 septembre 2021.
- Environics Institute for Survey Research, 2020a Sondage de 2020 auprès des Canadiens sur la Confédération de demain. Perspectives régionales sur l’économie et les changements climatiques. Rapport final, Toronto, The Environics Institute for Survey Research.
- Environics Institute for Survey Research, 2020b 2020 Survey of Canadians. Report 3: Identity, Values and Language, Toronto, The Environics Institute for Survey Research.
- Falardeau, Jean-Charles, 2016 Sociologie du Québec en mutation : aux origines de la Révolution tranquille, (Introduction et choix de textes par Simon Langlois et Robert Leroux), Québec, Presses de l’Université Laval.
- Ferretti, Lucia, 2011 « La “Grande Noirceur”, mère de la Révolution tranquille », dans : Guy Berthiaume et Claude Corbo (dir.), La Révolution tranquille en héritage, Montréal, Boréal, p. 27-46.
- Fournier, Pierre, 1978 « Les nouveaux paramètres de la bourgeoisie québécoise », dans : Pierre Fournier (dir.), Le capitalisme au Québec, Montréal, Les Éditions coopératives Albert Saint-Martin, p. 135-181.
- Freund, Julien, 1983 Sociologie du conflit, Paris, Presses Universitaires de France. (Coll. La Politique éclatée.)
- Gagnon, Alain-G., 1992 Québec au-delà de la Révolution tranquille, Montréal, VLB éditeur.
- Gagnon, Alain-G. et Khayyam Zev Paltiel, 1992 « Devenir “maîtres chez nous” : émergence d’une bourgeoisie balzacienne au Québec », dans : Alain-G. Gagnon et A. Brian Tanguay (dir.), Democracy with Justice: Essays in Honour of Khayyam Zev Paltiel / La juste démocratie : Mélanges en l’honneur de Khayyam Zev Paltiel, Ottawa, Carleton University Press, p. 318-339.
- Gauvreau, Michael, 2008 Les origines catholiques de la Révolution tranquille, Montréal, Fides.
- Guay, Jean-Herman, 2017 L’impasse souverainiste : les hauts et les bas du nationalisme québécois, Repères IRPP n° 17, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques.
- Hurteau, Philippe et Francis Fortier, 2015 « État québécois, crise et néolibéralisme », Revue Interventions économiques, 52. [http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2469], consulté le 3 septembre 2021.
- Kuty, Olgierd, 2020 Les valeurs dans la sociologie de Montesquieu et de Max Weber, OK Éditeur. [http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article3316], consulté le 16 août 2021.
- Laforest, Guy, 2014 Interpreting Quebec’s Exile within the Federation. Selected Political Essays, Bruxelles, Peter Lang.
- Lamonde, Yvan, 2011 « Malaise dans la culture québécoise : les méprises à propos de la Révolution tranquille », dans : Guy Berthiaume et Claude Corbo (dir.), La Révolution tranquille en héritage, Montréal, Boréal, p. 11-26.
- Langlois, Simon, 2018 Refondations nationales au Canada et au Québec, Québec, Éditions du Septentrion.
- Lapointe-Gagnon, Valérie, 2018 Panser le Canada : une histoire intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton, Montréal, Boréal.
- Larochelle, Catherine, 2014 « Le fait religieux au Québec et au Canada : regard critique sur deux historiographies récentes », Revue d’histoire de l’Amérique française, 67, 3-4 : 275-294.
- Lemieux, Vincent, 2011 Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir, Québec, Presses de l’Université Laval. (Coll. Prisme.)
- Linteau, Paul-André, 1999 « Un débat historiographique : l’entrée du Québec dans la modernité et la signification de la Révolution tranquille », Francophonia, 37 : 73-87.
- Mahéo, Valérie-Anne et Éric Bélanger, 2018 « Is the Parti Québécois Bound to Disappear? A Study of the Current Generational Dynamics of Electoral Behaviour in Quebec », Canadian Journal of Political Science, 51, 2 : 335-356.
- Meunier, E.-Martin, 2011 « Mutations culturelles et transformations de la nation québécoise au tournant de la Révolution tranquille », Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 105 : 365-375.
- Meunier, E.-Martin, 2016 « La grande noirceur canadienne-française dans l’historiographie et la mémoire québécoises. Revisiter une interprétation convenue », Vingtième siècle, Revue d’histoire, 129 : 43-59.
- Monière, Denis, 2001 Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Pelletier, Réjean, 1992 « La Révolution tranquille », dans : Gérard Daigle et Guy Rocher (dir.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 609-624.
- Rocher, François, 2020 « Les déterminants politico-institutionnels de la modification constitutionnelle : le cas canadien », dans : Dave Guénette, Patrick Taillon et Marc Verdussen (dir.), La révision constitutionnelle dans tous ses états, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 195-225.
- Rouillard, Christian, 2004 La réingénierie de l’État : vers un appauvrissement de la gouvernance québécoise, Québec, Presses de l’Université Laval. (Coll. L’Espace public.)
- Rouillard, Christian, 2008 De la réingénierie à la modernisation de l’État québécois, Québec, Presses de l’Université Laval. (Coll. L’Espace public.)
- Rouillard, Jacques, 1998 « La Révolution tranquille : Rupture ou Tournant? », Journal of Canadian Studies/ Revue d’études canadiennes, 32, 4 : 23-51.
- Sales, Arnaud, 1979 La bourgeoisie industrielle au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Sarra-Bournet, Michel, 2019 « Les élections provinciales du 1er octobre 2018 », Bulletin d’histoire politique, 27, 2 : 5-9.
- Simard, Jean-François et Maxime Allard, 2011 Échos d’une mutation sociale : anthologie des textes du père Georges-Henri Lévesque, précurseur de la Révolution tranquille, Québec, Presses de l’Université Laval. (Coll. Prisme.)
- Taillon, Patrick, 2016 « Une Constitution en désuétude. Les réformes paraconstitutionnelles et la “déhiérarchisation” de la Constitution du Canada », dans : Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), avec la collaboration de George Azzaria, La norme juridique « reformatée ». Perspectives québécoises des notions de force normative et de sources revisitées, Sherbrooke, Éditions de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, p. 297-355.
- Webber, Jeremy, 2018 « The Delayed (and Qualified) Victory of the Meech Lake Accord: The Role of Constitutional Reform in Undermining and Restoring Intercommunal Trust », dans : Dimitri Karmis et François Rocher, Trust, Distrust, and Mistrust in Multinational Democracies: Comparative Perspectives, Montreal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, p. 166-209.

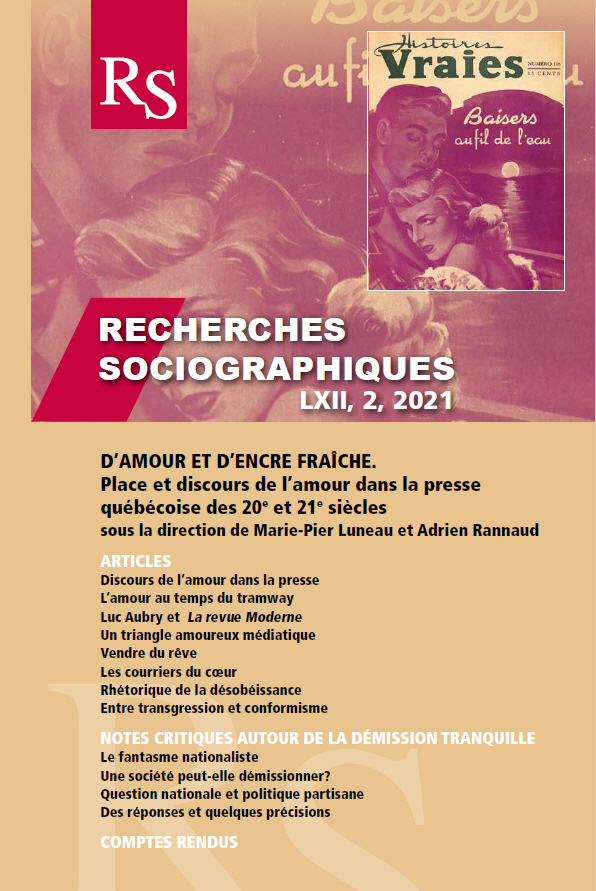
 10.7202/1060425ar
10.7202/1060425ar