Résumés
Résumé
Le 29 janvier 2017, un forcené tire sur une assemblée de fidèles au Centre culturel islamique de la paisible ville de Québec. Le bilan est de six tués, cinq blessés et 35 rescapés choqués. Dans la ville, des familles des victimes et des coreligionnaires sont sous le coup d’un choc émotionnel. Il s’agit d’un acte terroriste ciblé, visant des personnes dans leur identité culturelle et religieuse, et les atteignant dans leur représentation mentale de la sécurité et du bien-être.
Les secours psychologiques s’organisent, avec notamment l’intervention d’une psychologue de même culture et de même langue maternelle que les victimes. Les tableaux cliniques constatés sont d’une part le stress adapté, avec ses symptômes transitoires, et d’autre part le stress dépassé, avec ses symptômes dissociatifs et ses risques évolutifs vers l’état de stress post-traumatique. À signaler aussi des cas de deuil traumatique, compliqués, entre autres, par l’obligation que se font les familles d’aller enterrer les défunts dans leur pays d’origine.
L’intervention psychologique se déroule au domicile des victimes dans un premier temps (les premiers jours) en séances de déchocage (defusing) par groupes familiaux. Puis, la deuxième semaine, elle a lieu en séances de groupes de bilan psychologique d’évènement (debriefing) psychodynamique en clinique (bureau privé). Pour les enfants, on a recours à l’expression spontanée par le dessin. Passé quinze jours, selon les normes établies par l’Ordre des psychologues du Québec, on propose aux victimes qui souffrent encore de venir consulter au cabinet de la psychologue.
Trois mois après l’attentat, les deux tiers des victimes s’en sortent sans séquelles ou avec des séquelles légères. Parmi les autres, qui présentent de la difficulté d’endormissement, des cauchemars et de la phobie de sortir, certaines réactivent leurs symptômes en réaction à la reprise d’actes hostiles envers la communauté musulmane.
Un an après l’attentat, un retour progressif à la normale est de plus en plus perçu pour un grand nombre de victimes. La culture et la religion agissant comme facteurs de protection, notamment la « foi » comme porteuse ultime de résilience. La solidarité sociale et politique contribue à l’apaisement de la douleur chez certains.
Le processus judiciaire laisse place à la parole et à l’expression du ressenti dont ont besoin les victimes. À la base de l’amélioration, inviter la victime à verbaliser l’expérience vécue sensorielle « absurde » du trauma contribue à le résoudre en y apportant du sens.
Nous émettons enfin des recommandations visant à avoir recours, dans la mesure du possible, à un professionnel de la même culture dans le contexte du trauma, ou à être supervisées par ce dernier pour une meilleure connaissance de la culture de la victime ou tout simplement à investiguer le contexte socioculturel et la religion, si celle-ci a un lien étroit avec le contexte du deuil et de la notion de mort de la victime.
Mots-clés :
- attentat,
- stress post-traumatique,
- verbalisation du trauma,
- résilience,
- dimension socioculturelle
Abstract
In late January of 2017, a Québec City-born deranged young man walked into the town’s Great Mosque on Sunday evening during a prayer meeting and opened fire on the group of praying men gathered in the main hall, killing six (6), injuring five (5) of them and leaving thirty-five (35) later “rescued” people—men, women and children—behind, in a state of total shock, a municipal first in that quiet, peaceful city’s history.
The lone gunman’s act was targeting a specific cultural community, attacking them in their religious identity and even reaching them in their sense of security and well-being.
Psychological crisis intervention was quickly organized following the ordeal and through, notably, the rapid intervention of a same culture, same language psychologist. The identified preliminary general crisis picture was then one of “adaptive stress” along with its transitory symptoms and of” exceeded stress” with its unrelated symptoms and carrying the risk of a build-up resulting in the display of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms. A number of survivors also showed signs of “traumatic mourning,” painfully worsened by the burden of having to organize the sending (repatriation) of their deceased loved ones’ remains back to their homeland.
The “native” psychologist began setting up the therapy sessions in the victims’ homes for the first few days, first in the form of using the” defusing” approach during family group meetings and then followed, over the course of the following weeks, by the use of targeted techniques known as” debriefing,” including a psychological assessment of the event, also using psychodynamic means. As for children, their candid expression of feelings through drawing was privileged and as is usually recommended in such circumstances. And beyond the fifteen (15) day therapy period and in accordance with the recommendations of the Order of Quebec psychologists, victims were then offered private sessions at the psychologist’s office.
Three (3) months following the attack, two thirds (2/3) of the victims were progressively coming out of their trauma-related state of mind either without any aftereffect or, for some, only minor ones. For others showing some various degrees of sleep disorders such as recurring nightmares and “going out” phobia, they had actually” reactivated” their original symptoms in reaction to and triggered by inconsiderate social acts committed in their behalf by some local hostile individuals.
Marked improvements were gradually noticeable within the targeted community through encouragement to verbalize their traumatic experience, psychologically identified as “illogical” and in so trying to help them see it as having some form of” meaning.”
One year following the attack, many victims experiment a gradual return to normal functioning levels. Culture and religion act as protective factors, with “faith” being the ultimate contributor to resilience. Group solidarity, as well as social and political support have also helped to ease some of the victims’ pain.
We also address the judicial process that gave the victims the much-needed opportunity to express and share their feelings and reactions about the traumatic experience.
Recommendations are finally made to use as much as possible a professional of the same culture in the context of the trauma; or to be supervised by the latter to acquire a better knowledge of the culture; or to simply investigate the socio-cultural context and religion of the victims, if these are closely related to the context of mourning and their conception of death.
Keywords:
- mass murder attempt,
- post-traumatic stress disorder (PTSD),
- trauma verbalization,
- resilience,
- socio-cultural dimension
Corps de l’article
1. Introduction
Le 29 janvier 2017 à 19 h 45, un forcené perpétrait un attentat antimusulman à la mosquée de Québec, par fusillade, tuant six personnes, en blessant huit autres, dont cinq graves, et provoquant un choc émotionnel chez 35 fidèles rescapés, et leur famille. Étant une des seules psychologues arabophones de la ville de Québec, et une des rares formées à la question du traumatisme psychique, nous avons donc proposé nos services, en passant par l’Ordre des psychologues du Québec. Nous avons pu intervenir dès le lendemain auprès des rescapés et des familles endeuillées.
C’est le compte-rendu de cette intervention que nous présentons ici, en soulignant l’intérêt qu’il y a pour ces victimes directes et/ou indirectes à avoir affaire à une psychologue de même culture ancestrale et de même langue maternelle qu’elles-mêmes.
2. Les faits et leur contexte socioculturel
La ville de Québec (Canada) n’était pas préparée à faire face à des situations de terrorisme. Québec est une ville paisible et tranquille, peuplée de Canadiens francophones et aussi d’immigrés dont certains, venant de pays arabes, ayant fui la violence et l’insécurité de leur pays.
Ainsi, le 29 janvier 2017, vers 19 h 45 (après la dernière prière de la journée, Icha), un forcené tirait sur une assemblée de fidèles à la grande mosquée de Québec. Le bilan était de six morts et huit blessés dont cinq graves. La quarantaine de fidèles présents était choquée. Dans la région, beaucoup de familles et des amis des victimes subissaient aussi un choc émotionnel.
Cette fusillade était dirigée exclusivement contre des fidèles musulmans dans leur lieu de culte, et destinée à effrayer toute la population musulmane résidant à Québec. Il est à noter que la grande mosquée de Québec avait déjà fait l’objet d’actions islamophobes dans les mois précédents. En juin 2016, en plein ramadan (mois sacré de jeûne chez les musulmans), une tête de porc avait été déposée devant cette même mosquée. Quelques semaines plus tard, une lettre islamophobe était distribuée dans son voisinage.
Les personnes tuées étaient des hommes intellectuels bien intégrés et oeuvrant pleinement au développement de leur terre d’accueil. Ils étaient tous dotés d’un certain niveau d’éducation du fait des exigences scolaires et des qualifications professionnelles de haut niveau requises pour l’établissement d’un dossier d’immigration au Canada.
Trente-cinq personnes se trouvant dans la mosquée sortaient indemnes physiquement de l’attaque, mais sur le plan psychique, tout était à faire chez ces rescapés. L’horreur venait de faire effraction dans leur vie paisible et sereine, dans une ville qui l’est tout autant, alors qu’ils n’y étaient pas du tout préparés. « Pas à Québec ! Cette ville paisible » ; « Ailleurs peut-être, mais pas à Québec ! », étant parmi les phrases entendues depuis la fusillade.
Cela donnait lieu, dans l’esprit de ces immigrés, à tout un remaniement des représentations mentales de la sécurité et du bien-être. Et toute la dimension de structure symbolique s’y rattachant devait être revue et repensée ; le processus de reconstruction de cette symbolique décousue et ébranlée devait se remettre en marche avec les acteurs d’intervention psychosociale spécialisée.
Les résultats de certaines études suggèrent que 90 % des gens qui ont vécu un évènement traumatique vont avoir des symptômes de stress post-traumatique par la suite (Brunet, 2014).
Ces rescapés étaient des victimes directes, qui étaient présentes sur le site, et qui ont subi un traumatisme psychique majeur (surprise, effroi, horreur et effraction des défenses psychiques dans cette confrontation inopinée avec la mort) (Lebigot, 2002). Mais, il y avait aussi les victimes indirectes, les familles et les proches, voire tous les coreligionnaires, surpris, choqués, éprouvant du chagrin et se sentant menacés dans leur identité culturelle.
La fusillade, intentionnelle et délibérée, visait ces gens-là dans leur identité profonde. Elle s’attaquait à leurs liens identitaire, social et communautaire, et provoquait une implosion, détruisant leur système de valeurs pour les emporter vers le chemin de l’insécurité et de la méfiance qu’ils n’avaient jamais connu ni pensé un jour vivre à Québec.
3. Préparatifs de l’intervention psychologique
Prise au dépourvu après avoir appris la nouvelle à la télévision le soir même, nous ne savions pas quoi faire ni par où commencer. La seule certitude présente était l’envie impérieuse d’agir. Notre première réaction, au lendemain de l’attentat, a été de passer quelques appels en quête d’un fil conducteur qui pourrait nous guider vers cette intervention. Notre seule assurance d’être autorisée à agir en tant que professionnelle de la santé était de passer par l’Ordre des psychologues du Québec, pour qu’ainsi soit reconnue la conformité de notre action. Nous avons alors constaté être l’une des deux seules personnes à parler la langue des victimes, et l’unique psychologue formée en stress post-traumatique dans cette communauté de la région de Québec, ce qui amplifiait notre désir d’agir rapidement.
Nous avons annulé les rendez-vous de notre clinique avec les patients habituels. Nous leur avons expliqué les raisons de ces reports et ils se sont montrés très compréhensifs, approuvant et encourageant notre initiative.
Nous avons adressé quelques courriels à des organismes impliqués, pour nous permettre de procéder à notre intervention. Nous avons reçu quelques retours de courriels accusant réception de nos messages et d’autres nous communiquant les coordonnées des familles endeuillées. Quelques-uns de nos amis se sont mobilisés pour faire la tournée des familles, notamment des médecins de la communauté, car il s’agissait non seulement de soutenir les nôtres par solidarité et compassion, mais aussi d’apporter les compétences professionnelles dont les familles avaient besoin.
Enfin, nous avons fait quelques emplettes de crayons de couleur, cahiers et petits cadeaux destinés aux jeunes enfants pour lesquels le dessin faciliterait l’ouverture au dialogue (Graham et Cloitre, 2009). Nous nous sommes donc donné comme mission d’aller à la rencontre de l’autre, spontanément et instinctivement, munie de notre disponibilité, de notre souci de leur « bien-être », ainsi que de notre expérience en la matière ; notre devoir étant de soulager non seulement la souffrance physique (des blessures physiques), mais aussi la souffrance psychique des victimes, « blessées psychiques », de leur famille et de leurs proches.
4. Déroulement de l’intervention
Toutes les personnes qui ont été exposées à un évènement « potentiellement traumatisant » ne le vivent pas forcément comme un traumatisme psychique (Breslau et coll., 1998). Certaines vont réagir immédiatement par un stress normal, adaptatif, avec conservation de la lucidité, qui va leur inspirer des comportements de sauvegarde et d’entraide. Il s’agit d’un stress aigu normal, qui est déclenché lors de l’exposition à un évènement menaçant subit et brutal (Lebigot, 2002). D’autres, par contre, parce qu’elles sont plus fragiles ou momentanément plus vulnérables, vont réagir dans l’immédiat par un stress dépassé, traumatique, avec effroi, arrêt de la pensée, « comme un trou noir », incompréhension de la situation, déréalisation, voire dépersonnalisation, donnant lieu à des comportements de sidération, d’agitation incoordonnée, de fuite panique ou d’action automatique (effectuer et répéter des gestes inutiles, sans y penser et sans les mémoriser) (Vaiva et coll., 2008).
Ainsi, les premières peuvent être encore sous le coup de leur stress, qui s’accompagne transitoirement de symptômes neurovégétatifs gênants (tachycardie, poussée de tension artérielle, pâleur, spasmes viscéraux). Elles peuvent être extrêmement peinées, tristes, en colère, et c’est tout à fait « normal ». Elles vont avoir besoin d’écoute, de compréhension et d’empathie, voire de compassion, sans manifester pour autant une symptomatologie psychiatrique. Les secondes, par contre, vont exprimer une souffrance particulièrement intense, avec un cortège de symptômes dissociatifs, anxieux, phobiques, psychosomatiques et des symptômes psychologiques de terreur et d’impuissance (Brillon, 2010). Ces tableaux cliniques peuvent s’avérer handicapants et durables, pouvant les empêcher de poursuivre le cours harmonieux de leur vie. Ces personnes qui réagissent par un stress dépassé ou traumatique ont besoin d’être accompagnées et prises en charge par des intervenants qualifiés et spécialisés dans le domaine du stress post-traumatique. Il s’agit de les sortir de leur sidération, de les informer sur l’évènement, « que s’est-il passé ? », de les ramener à la réalité et de les rassurer.
C’est le temps du déchocage et du désamorçage (Crocq, 2003) – ou defusing en anglais – procédure qui consiste à inciter à la verbalisation de l’émotion et qui détient un effet préventif de l’installation de séquelles psychiques. La victime traumatisée est invitée à exprimer son vécu (elle en ressent d’ailleurs le besoin), pour mettre des mots sur son expérience « insensée », et commencer à en effacer le caractère absurde. L’intervenant en profite pour établir une relation de confiance et renouer le lien social et communautaire provisoirement rompu. La détresse et le désarroi des victimes – directes ou indirectes – sont importants, et ces victimes ressentent un intense besoin d’empathie et de compassion. L’attitude classique de « neutralité bienveillante » qui renvoie le patient à sa réflexion solitaire n’a pas sa place dans ces situations. Elle serait vécue comme une indifférence ou une rebuffade (Crocq, 2012). Le soignant psychologue doit s’armer d’écoute active, comprendre la plainte par empathie, et même manifester de la compassion (en posant sa main sur l’épaule, par exemple, au besoin).
Les tournées aux domiciles des victimes et familles, initialement prévues en équipes d’intervenants, ont fini par se faire individuellement, car les temps d’intervention étaient différents. En ce qui nous concerne, nous avons été appelée à passer plusieurs heures avec la même famille.
Nous nous sommes donc présentée au domicile des familles à J+1. La plupart étaient encore sous le choc. Accordant notre priorité aux plus jeunes, sans négliger pour autant les autres membres de la famille que nous verrions plus longuement par la suite, nous avons pu consacrer à chaque enfant un temps variant de 40 à 60 minutes, ce qui était le strict nécessaire pour qu’il puisse s’exprimer et reprendre confiance. Ceci a fait que nous n’avons pas pu voir plus de deux ou trois familles par jour. Nous avons visité quelques familles et secouru 40 personnes, dont une vingtaine d’enfants, au total. Compte tenu de nos qualités d’arabophone, nous avons pris en charge à peu près 50 % des personnes rescapées et impliquées ; les autres ont été référées aux autres collègues.
Le travail s’est ainsi poursuivi durant une semaine, nécessitant parfois des visites en soirée réclamées par les familles, pour rencontrer les personnes absentes ou occupées.
Après les premiers jours, l’intervention immédiate de déchocage ou de désamorçage (defusing) doit faire place au bilan psychologique d’évènement (debriefing) (Lebigot, 1998), car on entre dans la période post-immédiate qui peut s’étendre sur plusieurs semaines.
L’information s’est vite propagée auprès des services sociaux, du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) qui s’est félicité de l’existence d’une psychologue maghrébine partageant leur culture. Dans ce cas-ci, il est intéressant que le débriefing soit assuré par un professionnel de la même culture que les victimes, pour mieux comprendre leur désarroi et renforcer leur confiance (Johnson et coll., 2009). C’est pourquoi notre intervention psychosociale en post-immédiat a été bien accueillie par les familles et souvent attendue et souhaitée. Cela a constitué notre carburant pour aller de l’avant et poursuivre sur notre élan. Peu à peu le nombre de personnes a augmenté à tel point que nous avons craint de manquer de moyens et de temps.
Nous avons agi, alors, par groupe familial (de quatre à huit personnes) et avons choisi la méthode de débriefing psychodynamique préconisée par le professeur Crocq (2004). Cette méthode, qui donne la priorité à l’expression spontanée, ou plus exactement l’« énonciation » de l’expérience vécue, est préconisée pour le débriefing des victimes. Elle se démarque du débriefing narratif de J. Mitchell, plus directif et codifié, qui convient bien aux sauveteurs, pompiers et policiers, lesquels tiennent à rester sur leur réserve et craignent de paraître faibles aux yeux de leurs camarades. Le professeur Crocq a assigné dix objectifs au débriefing psychodynamique (Crocq, 2004), qui sont : 1/ménager un espace-temps intermédiaire entre le drame et le retour à la vie paisible ; 2/conforter la personne (la rassurer sur le fait qu’elle n’est pas abandonnée, mais qu’elle devra recouvrer son autonomie) ; 3/inciter à la verbalisation du vécu (visée cathartique) ; 4/informer sur les symptômes présents et éventuellement à venir ; 5/faciliter l’identification du sujet aux autres membres du groupe et aux autres victimes ; 6/encourager et renforcer la cohésion du groupe ; 7/aider à réduire les sentiments d’impuissance et de culpabilité ; 8/préparer le sujet à affronter le milieu extérieur (y compris les médias intrusifs) et à reprendre son existence normale ; 9/repérer les sujets fragiles (et, en aparté, leur proposer un soutien) ; 10/inviter les sujets à mettre un point final à leur aventure.
Les débriefings se sont bien déroulés et ont procuré de l’apaisement aux rescapés et aux familles.
La semaine suivante, nous avons senti une accalmie revenir progressivement. Les familles ont dû, pour certaines d’entre elles, rentrer inhumer le corps des défunts au pays d’origine, ce qui a soulevé la question du deuil.
Le deuil est vécu différemment selon qu’il soit éprouvé dans le pays d’origine ou ailleurs. Il est parfois difficilement surmonté, perçu comme une pluralité de pertes éprouvantes (Lussier, 2011). Une première perte a déjà été subie lorsqu’il a fallu quitter le pays d’origine pour émigrer, voire laisser sur place des parents et des amis (Rachédi et Halsouet, 2017). À cela s’est ajoutée la préoccupation de s’adapter au pays d’accueil. Une autre perte a été celle des repères symboliques, et parfois d’identité, de statut socioprofessionnel, relationnel et environnemental. À ces premières pertes vient alors s’ajouter la perte de l’être cher, qui est la « pire » de toutes. Dans ces cas-là, les réseaux de solidarité et les rituels funéraires font office de tuteurs de résilience. « Dans tous les cas, les immigrants se mobilisent grâce à leurs réseaux pour s’entraider et inventent des stratégies pour adapter des rituels funéraires significatifs à l’intérieur du cadre juridique de leur société d’accueil » – dans ce cas-ci celui du Québec (Rachédi et Kalanga, 2017). L’enjeu était donc majeur.
Certaines personnes ont évoqué ce qui avait motivé leur immigration, à savoir la fuite de l’insécurité qui sévissait dans leur pays (plusieurs avaient été directement menacées). Elles étaient venues chercher cette sécurité au Canada. Comme il a été mentionné plus haut, il s’agissait de reconstruire leur représentation mentale du concept de sécurité, de procéder à tout un remaniement de ces représentations avec leur dimension symbolique.
Dans ces cas-là, les intervenants psychosociaux doivent alors remettre en marche le processus de cette reconstruction.
La solidarité exprimée par la population québécoise a été d’une grande aide pour les victimes, de près ou de loin. Chacun faisait et donnait ce qu’il pouvait.
Lors de l’une des interventions de soutien psychologique, une travailleuse sociale s’est rendue au Centre culturel islamique (lieu de l’attentat) avec un foulard cachant ses cheveux. Il n’était, peut-être, pas nécessaire de le porter (puisque parmi les musulmanes, certaines ne le portent pas), mais elle a ainsi exprimé un certain respect envers cette communauté en faisant ce qu’elle a jugé bon de faire dans ces moments d’extrême douleur.
5. Évolution pendant les trois premiers mois
La plupart des victimes ont été suivies à domicile pendant la première semaine. Se posait alors la question de la poursuite du soutien psychologique pour celles qui en ressentaient le besoin. Et ce soutien psychologique devait être effectué désormais en cabinet de consultation. Nous avons donc pris soin de laisser nos coordonnées aux familles afin de leur prodiguer la prise en charge attendue – en particulier pour les familles parties organiser les obsèques des défunts et y prendre part – après leur retour du pays. Nous avons dû, en outre, leur donner des explications déontologiques quant à la difficulté de la prise en charge des autres membres de la famille. En effet, les phases d’urgence, immédiate et post-immédiate, étant résorbées, le code de déontologie et d’éthique des psychologues ne nous permettait plus d’intervenir en dehors de notre bureau. Nous avons toutefois rassuré les personnes intéressées, en leur confirmant, tout au moins en ce qui nous concernait, que cette poursuite de la prise en charge serait offerte gracieusement. Nous avons proposé aussi à certaines d’entre elles des groupes de parole, qui se sont avérés finalement difficiles à mettre en place.
Certaines victimes directes ont traversé des phases dépressives, marquées par un sentiment d’autodépréciation, de perte de confiance, d’insécurité et de culpabilité, celle-ci se trouvant parfois au premier plan du fait d’avoir survécu là où les amis et compatriotes avaient trouvé la mort et d’avoir été dans l’incapacité d’agir (Bélan, 2018).
Beaucoup de victimes ont vu leur état s’améliorer en quelques semaines. Certaines ont même repris leur travail au bout d’une semaine (encore que quelques-unes qui avaient présumé de leur force ont dû se résoudre à demander un arrêt de travail supplémentaire). Beaucoup ne pouvaient pas détacher leurs pensées du souvenir de la fusillade ; plusieurs la revivaient en cauchemars nocturnes, certaines étaient en état d’alerte (critères B, C, D du DSM-5) quand elles sortaient de chez elles et quelques-unes avaient parfois la phobie de sortir. Deux mois après le drame, les caméras de surveillance ont enregistré deux hommes cagoulés qui tournaient autour de la mosquée. Cette vidéo visionnée par les victimes a déstabilisé certaines d’entre elles. Les symptômes qui s’estompaient se sont, dans quelques cas, réactivés plus intensément. D’autres victimes ont même rechuté, avec une reviviscence intense de l’évènement, des flash-back, et l’apparition de nouveaux symptômes qui n’étaient pas présents dans le tableau clinique initial, tels que crises d’angoisse et évitements phobiques (Crocq, 2002).
Beaucoup de victimes éprouvaient de la difficulté à s’endormir le soir, à cause de leurs ruminations mentales sur l’évènement. Un tiers des personnes qui avaient été rencontrées ont dû prendre des somnifères. Enfin, quelques conjoints des défunts ont présenté un deuil pathologique. La poursuite du soutien psychologique devait leur permettre de sortir d’un état de sidération psychique avec fixation au souvenir du trauma, et de reprendre le cours de leur vie ; ce soutien leur apportait, par ailleurs, une formation éducative qui leur permettait de dépasser ce stade, ainsi que l’apprentissage des techniques de gestion des émotions.
En gros, trois mois après l’attentat, les deux tiers des victimes et des personnes impliquées s’en sont sortis sans séquelles ou avec des séquelles légères ; et un tiers a conservé des troubles, nécessitant la poursuite du soutien psychologique, à un rythme variable.
Mais des questions se posent aujourd’hui : « Que peut-on offrir à ces victimes qui perçoivent encore cette menace, qui ne se sentent pas en sécurité ? Comment prétendre affirmer à ces gens-là que cet évènement est isolé et qu’il n’arrivera plus rien ? »
6. Évolution de l’état des victimes un an après
Nous allons appuyer nos observations cliniques sur des facteurs culturels qui semblent être un levier important dans l’évolution de l’état psychologique de nos patients, victimes survivantes de l’attentat à la mosquée, et des familles (victimes directes et indirectes) (Crocq, 2014).
Selon l’UNESCO (2002) : « Toute culture définit des traits qui permettent de lire le monde et de donner un sens aux évènements. » Dans ce contexte, les facteurs culturels constituent parfois des facteurs de protection (Tarquinio et coll., 2017). Prenant en compte qu’un évènement intentionnellement perpétré par un homme aux prises avec une cruauté ciblée et délibérée sera encore plus susceptible de provoquer de la détresse émotionnelle et de l’effroi pour les victimes, la réaction émotive et la menace perçue seront d’autant plus déterminantes dans le développement des troubles de l’ordre de stress post-traumatique chez elles (Rasmussen et coll., 2007). C’est ce qui a été observé, un an après l’attentat, en dépit de la fluctuation de l’état psychologique des victimes. En effet, elles se stabilisaient parfois, retrouvant le rythme de la vie quotidienne, à la faveur des facteurs suivants :
Retour du sentiment de sécurité, considérant l’évènement comme acte isolé de haine ;
Retour au travail (progressif et/ou total) ;
Tentative de reconstruire son avenir, celui de ses enfants et de sa famille ;
Modification des représentations mentales négatives, laissant place à une bonne projection dans l’avenir, en réinvestissant son quotidien (ayant été travaillé en psychothérapie s’appuyant sur la restructuration cognitive issue des thérapies cognitivo-comportementales) ;
Baisse de la symptomatologie d’intrusion « envahissante », de l’évitement, ainsi que de l’hypervigilance et les symptômes neurovégétatifs. (DSM-5, 2013), notamment avec des techniques de pleine conscience ;
Résilience des adultes, blessés psychiques, transmise aux enfants, « Ceux-ci étant très sensibles aux réactions de leurs parents » (Société canadienne de pédiatrie, 2018).
Mais d’autres fois, ces mêmes victimes étaient complètement décontenancées en raison de l’évolution de l’enquête judiciaire et du plaidoyer de non-culpabilité du tueur. De même qu’elles étaient affectées par certaines interventions des médias (qui pourtant, dans ce cas, ont manifesté beaucoup de compassion envers les victimes, mais qui n’ont pu s’empêcher de relater certains faits qui ont été source de souffrance pour ces dernières), sans oublier les effets des réseaux sociaux (commentaires négatifs de la population).
Nous avons constaté que la culture, la religion et les valeurs ont constitué de réels facteurs de protection pour ces personnes, leur attribuant une capacité de résilience sans précédent, celle-ci étant cultivée dans leurs propres perspectives culturelles et ressources religieuses (Berrada, 2010).
D’autres facteurs ont favorisé une bonne évolution des cas, comme :
l’établissement de tout un rituel autour des commémorations du premier anniversaire de l’attentat ;
la présence des deux Premiers ministres, du Canada et du Québec, qui ne fut pas sans apaiser, soulager et donner de l’espoir à la communauté musulmane ;
la justice qui joue souvent un rôle décisif dans l’avenir des victimes et de leur famille.
Le suivi du processus judiciaire apporte, généralement, toute une dimension d’« attente angoissante » et la mobilisation d’affects violents, tels que la peur, la colère, le sentiment d’impuissance et la crainte de l’injustice, ce qui pourrait expliquer son caractère, parfois, dévastateur, voir « un phénomène de survictimisation » pour certains (Pignol et Villerbu, 2014). Nonobstant les victimes qui ont exprimé une préoccupation envahissante et un « stress intense », le processus judiciaire a, notamment, joué un rôle de thérapie et d’espace de verbalisation à visée « cathartique » (Crocq, 2003), procurant un apaisement pour les rescapés de la Mosquée et pour les familles qui ont pu témoigner et exprimer leur ressenti face aux retombées pendant et après le drame.
Cela a, aussi, permis à d’autres de rassembler des « morceaux du puzzle » perdus au fil de l’année écoulée et demeurant obscurs, ceci faisant écho à un vécu subjectif pour reconstruire, par le fait même, l’histoire du drame dont chaque personne possédait « un bout », avec toutes les représentations mentales qui en découlaient ; pour enfin tenter de reconstruire et de rétablir les liens identitaires et communautaires. Ce qui a mis en lumière la difficulté des victimes à affronter leur réalité interne (Damiani, 2003) « trop douloureuse » qu’elles extériorisaient et combattaient à travers leur « désir profond » de témoigner à la cour.
Ce processus venait offrir des réponses à leurs incompréhensions, qui remettaient en cause toutes leurs croyances profondes ébranlées (Pignol et Gouénard, 2007).
7. Commentaire conclusif : la dimension socioculturelle de l’attentat
Le contexte socioculturel nous apparaît évident et primordial dans ce cas de figure d’un attentat contre des fidèles d’une communauté religieuse. De ce fait, il est important que des intervenants locaux de même appartenance communautaire ou connaissant la culture et la réalité sociale des victimes soient dépêchés auprès d’eux pour mieux adapter les interventions (Kendil, 2010).
Dans ces situations de crise et d’extrême violence, les victimes rescapées, les témoins et les familles ont souvent besoin de livrer un contenu (quand ils peuvent le faire) à un intervenant qui est capable d’intégrer leur réalité et leurs représentations intériorisées en lien avec le drame et le statut de la personne. Notamment quand celle-ci est loin de son contexte familial et social d’origine et que l’acte de violence intentionnel la vise tout particulièrement. En fait, il ne s’agit pas de livrer un contenu déjà élaboré et pensé, mais plutôt d’énoncer ce qui monte aux lèvres à partir du chaos intérieur de l’expérience traumatique brute ; cette mise en mots constitue l’amorce d’une identification de sens – sens singulier pour une personne dotée d’une culture et d’un passé – à réinsérer dans la continuité fluide de l’histoire de vie.
Les personnes secourues à la suite de l’attentat perpétré à Québec fin janvier 2017 pouvaient avoir un discours différent, selon qu’elles étaient en présence d’un intervenant partageant leur culture ou non. En ce qui nous concerne, nos interventions étaient spontanées et empathiques, sans condescendance ni arrière-pensée ambiguë. Il fallait « parler le même langage », avec les mêmes modèles de représentation communs à l’intervenant et à son interlocuteur. Il s’agissait pour les victimes d’exprimer des propos et des ressentis qu’elles savaient, d’emblée, compris par celui qui partageait leur culture et leur histoire collective. Cet intervenant était à même de comprendre dans une empathie complète un évènement qu’il aurait lui-même vécu dans un cadre similaire. Cela donne lieu à un sentiment de reconnaissance de la souffrance et de la légitimité du trouble (et sans effort de traduction des pensées spontanées). Ces aspects sont, dans certains cas, incontournables dans l’appréhension du contexte et du vécu de la victime (directe ou indirecte, primaire, secondaire ou même tertiaire). Enfin, le cas échéant, ce partage socioculturel permet de faire un travail de deuil plus adapté et mieux structuré avec un langage commun du vécu.
8. Recommandations
Dans nos recommandations, nous mettons en exergue les conditions et prérequis de l’intervenant comme pratiques gagnantes et nécessaires au mieux-être de la victime et à l’alliance thérapeutique. Nous ne citons que ceux qui semblent fondamentaux et ont été exprimés par la majorité écrasante des victimes dans ce cadre-ci :
1- La connaissance de la culture du patient par les intervenants et professionnels de la santé
Ce critère a fait l’unanimité des patients en termes de besoin essentiel.
Au-delà de l’aspect collectif du drame, la dimension individuelle avec ce qu’elle comporte comme histoire singulière et subjective vient donner un autre sens à l’expérience traumatique dans son aspect « indicible et innommable » (Briole et Lebigot, 1994), qui peut être vécue différemment d’une personne à une autre. Ce qui « nécessite d’intégrer les représentations culturelles du patient » (Vitry et Dessons, 2005), afin de tenter de redonner du sens au non-sens de la sidération et du trauma, en transformant ces souvenirs en représentations acceptables pour le psychisme.
Les intervenants doivent, à cet effet, se prémunir de la bonne connaissance et de la compréhension des différences entre leurs actions, leurs croyances et leurs valeurs culturelles et celles de leurs patients (Kodio, 2009).
Hormis une femme, les 35 blessés « psychiques » et rescapés étaient des hommes. La culture maghrébine faisant en sorte que l’expression de la souffrance psychique passe au second rang, particulièrement chez l’homme (Boucebci, 1993), celui-ci ne se donne le droit que de manifester des symptômes physiques et médicaux – extérieurs, par opposition aux symptômes psychologiques intérieurs – car légitimés par le collectif social. « Toute atteinte ou situation angoissante verra sa cause projetée et attribuée à une cause extérieure. Dans le monde maghrébin traditionnel la prégnance du moi collectif est la donnée capitale… » (Boucebci, 1993). Chidiac et Crocq nous confirment que dans certaines cultures « où l’autocensure réprime l’expression de la souffrance psychique », la plainte somatique reste la voie la plus directe à l’expression d’un mal-être (Chidiac et Crocq, 2011).
2- Le besoin d’exprimer sa souffrance dans sa langue maternelle
Ce critère vient s’appuyer sur le précédent, offrant une autre dimension à l’exposé de la souffrance. La langue est imprégnée par des règles, des représentations de lois (sociales et religieuses) et de valeurs par lesquelles les victimes ressentent la nécessité et la soif de relater dans leurs mots et dans leur langue usuelle. « La culture dépose dans la langue des éléments d’inclusion qui se transmettent de génération en génération » (Bendahman, 2003).
Comme cette petite fille de sept ans, déjà rencontrée, qui nous parla de la perte d’un membre de sa famille et de son apprentissage de la résilience grâce à « Allah » (Dieu des musulmans). Une autre petite âgée de 10 ans l’interpella d’un coup de coude, l’avertissant discrètement de dire « Dieu ». La petite de sept ans rétorqua avec conviction : « Mais non ! Elle est comme nous, elle connaît Allah ! » Ce qui libéra la seconde, émettant un grand sourire et soupir de soulagement…
3- La foi comme facteur de protection et de résilience
La foi en islam revêt une importance des plus fondamentales. Le recueil des actes et paroles du prophète Mohammed explique que le Prophète (que paix soit sur lui) dit : « Tout ce qui peut frapper le musulman, que ce soit la fatigue, la maladie, l’anxiété, la tristesse, la souffrance, le deuil et même la blessure d’épine, est contrebalancé par l’absolution, par Allah, de certains de ses péchés. » Ce qui en découle est que le mal est tempéré par le pardon des péchés. La maladie est vue comme une épreuve que l’on fait subir à sa foi, à travers laquelle la patience et la confiance en Dieu sont appelées pour soutenir dans la détresse (ad-Dab’bagh, 2013). Ces croyances profondes ont servi de béquille et d’échappatoire aux victimes qui, en se pliant aux volontés divines et à leurs convictions profondes, se fortifiaient pour surmonter l’insupportable.
Il s’agit d’examiner le concept de traumatisme non pas en fonction de la sévérité de l’évènement, mais en tenant compte des capacités de résilience du sujet (De Tychey et coll., 2001 ; 2014).
4- Statut de la victime décédée
Un autre élément qu’on pourrait, aussi, associer à la culture religieuse et qui vient soutenir la compréhension et une meilleure prise en charge est le statut héroïque du défunt. Un fidèle musulman décédé dans un lieu sacré, à la guerre ou pour la cause de Dieu (Aggoun, 2006), a le statut de « martyr ». Cette phase fut très aidante et d’un réconfort sans précédent pour les familles, ainsi que pour les enfants qui avaient été renseignés. « Papa est au paradis » nous dira, une petite fille de six ans.
5- Les pratiques gagnantes dans la prise en charge des traumatisés
Mettre l’accent sur la capacité de récupération ; mobiliser les ressources personnelles et offrir de la psychoéducation aux victimes, afin de déboucher sur une meilleure résolution du vécu, du moins, une meilleure compréhension pour une meilleure gestion des émotions et des affects ;
Concevoir des actions qui amènent une collaboration volontaire et proactive du patient. Ce qui contribue grandement à la libération des symptômes après intégration du vécu, et ce, en réactivant les « facultés de coping préexistantes et perturbées par le traumatisme ».
Parties annexes
Bibliographie
- ad-Dab’bagh, Y. (2013). La Foi et la santé mentale en Islam. Les cahiers de l’Islam. Première parution 2001, Nouveau dialogue, 134, 17-19. Récupéré de https://www.lescahiersdelislam.fr/La-Foi-et-la-sante-mentale-en-Islam_a459.html
- American Psychiatric Association (APA). (2013). DSM-5 : Diagnostical and statistical manual of mental disorders (5eédition). Arlington, VA : American Psychiatric Publishing.
- Aggoun, A. (2006). Le Martyr en Islam. Considérations générales. Études sur la mort, 2(130), 55-60. https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2006-2-page-55.htm
- Beiser, M. et Korczak, D. (2018). Santé mentale et développement, Le syndrome de stress post-traumatique. Guide pour les professionnels de la santé oeuvrant auprès des familles immigrants et réfugiées. Soins aux enfants néo-canadiens. Récupéré de https://www.enfantsneocanadiens.ca/mental-health/ptsd
- Bélan, G. (2018). Attentat de Québec. « Pardon, on n’a pas pu l’aider ». LaPresse+. http://plus.lapresse.ca/screens/5b3c6a97-3d39-439a-914d-92b142e74ecf__7C___0.html
- Bendahman, H. (2003). La langue et le corps comme marqueurs identitaires. Questions en vue d’une clinique de la double culture. L’autre, 1(4), 87-97.
- Boucebci, M. (1993). Aspects du développement psychologique de l’enfant au Maghreb. Santé mentale au Québec, 18(1), 163-178.
- Breslau, N., Kessler, R., Chilcoat, H., Schuttz, L., Davis, G. et Andreski, P. (1998). Trauma and postraumatic stress disorder in the community. The 1996 Detroit area survey of trauma. Archives of General Psychiatry, (55), 626-632.
- Brillon, P. (2010). Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique ? Guide à l’intention des thérapeutes. Québec, Canada : Les éditions Québecor.
- Briole, G., Lebigot, F. et coll. (1994). Traumatisme psychique. Rencontre et devenir. Paris, France : Masson.
- Brunet, A. (2014). Stress post-traumatique : revivre continuellement l’évènement. S.A. Blondin, Les éclaireurs. Montréal : Société Radio-Canada. Récupéré à http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_eclaireurs/2014-2015/chronique.asp?idChronique=353235.
- Chidiac, N et Crocq, L. (2011). Le Psychotrauma (III) – Névrose traumatique et état de stress post-traumatique. Annales Médico-Psychologiques, 169(5), 327-331.
- Crocq, L. (2003). Clinique de la réaction immédiate. Le Journal des Psychologues, (208), 48-53.
- Crocq, L. (2002). Expression des émotions et aspect cathartique du debriefing. Dans E. De Soir et E. Vermeiren (dir.), Les debriefings psychologiques en question…., (275) 163-174.
- Crocq, L. (2004). Histoire du debriefing. Pratiques psychologiques, 10(04), 291-318.
- Crocq, L. (2003). L’approche cathartique. Revue francophone du stress et du trauma, 3(1), 15-24.
- Crocq, L. (2004). L’intervention psychologique auprès des victimes en période post-immédiate : La question du debriefing. Le journal des psychologues, (218), 8-14.
- Crocq, L. (2012). Seize leçons sur le trauma. Paris. Odile Jacob.
- Damiani, C. (2003). Comment concilier réalité psychique et réalité judiciaire ? Revue francophone du Stress et du Trauma,3(1), 55-58.
- De Tychey, C. (2001). Surmonter l’adversité : les fondements dynamiques de la résilience. Cahiers de Psychologie Clinique, 16(1), 49-68. doi.org/10.3917/cpc.016.0049
- Graham, R. et Cloitre, M. (2009). Creative Interventions with Traumatized Children. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 19(3), 327-328.
- Guide explicatif concernant le code de déontologie des psychologues du Québec. (Juillet 2008), 13-16. Récupéré à https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/69039/0GuideExplicatif_Web_FR+%281%29.pdf/12ed4bf9-ef2d-485c-9593-42a7ee1c9ff1.
- Johnson, R. L., Bastien, G. et Hirschel, M. J. (2009). Psychotherapy in a culturally diverse world. Dans S. Eshun et R.A.R. Gurung (dir.), Culture and mental health : sociocultural influences, theory, and practice, 115-148. Oxford, UK : Wiley-Blackwell.
- Kendil, N. (2010). Le thérapeute algérien face au trauma : burnout et apprentissage vicariant. (thèse de doctorat non publiée). Université de Metz. France.
- Kodjo, C. (2009). Cultural competence in clinician communication. Paediatr Rev. 30(2), 57-64. Récupéré de http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC2719963&blobtype=pdf
- Lebigot, F. (1998). Le débriefing individuel du traumatisé psychique. Annales médicopsychologiques, 156(6), 417-420.
- Lebigot, F. (2002). L’effroi du traumatisme psychique : le regard en face ou s’en protéger. Revue francophone du Stress et du Trauma, 2(3), 139-146.
- Lee, J. S., Ahn,Y. S., Jeong, K. S., Chae, J. H. et Choi, K. S. (2014). Resilience buffers the impact of traumatic events on the development of PTSD symptoms in firefighters. Journal of Affective Disorders, (162) 128-133.
- Lussier, M. (2011). Terre d’asile, terre de deuil. Le travail psychique de l’exil. Paris : Presses universitaires de France.
- Mekki-Berrada, A. (2010). L’Islam en anthropologie de la santé mentale. Théorie, ethnographie et clinique d’un regard alternatif. A. Mekki-Berrada (dir.). Münster, Allemagne : LIT Verlag.
- Pignol, P. Gouénard, D. (2007). Être victimes. L’accompagnement psychojudiciaire du « travail de victime ». Colloque Temps psychique, temps judiciaire, Rennes, décembre 2001. Presses universitaires de Rennes II. Récupéré de https://www.sites.univ-rennes2.fr/icsh/etre%20victime%20P%20Pignol.pdf
- Pignol, P. Villerbu, L. M. (2014). Le soutien psychologique durant le parcours judiciaire de la victime : deux exemples cliniques. Dans L. Crocq (dir.), Traumatismes psychiques : Prise en charge psychologique des victimes, 2e éd., 336(33), 311-320. Paris, France : Elsevier Masson.
- Rachédi, L. et Halsouet, B. (2017). Quand la mort frappe l’immigrant. Défis et adaptations, Canada : Les Presses de l’Université de Montréal.
- Rachédi, L. et Kalenga, M. R. (2017). Deuils et morts en contexte migratoire au Québec : état des connaissances et pistes pour l’accompagnement des endeuillés, Psychologie Québec. Interculturalités : perspectives psychologiques accepted. Repéré à https://www.ordrepsy.qc.ca/web/ordre-des-psychologues-du-quebec/-/deuils-et-morts-en-contexte-migratoire-au-quebec-etat-des-connaissances-et-pistes-pour-l-accompagnement-des-endeuilles
- Rasmussen, A., Rosenfeld, B., Reeves, K. et Keller, A. (2007). The Subjective Experience of Trauma and Subsequent PTSD in a Sample of Undocumented Immigrants. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195(2), 137-143.
- Tarquinio, C., Houllé,W. A., Silès, J. et Tarquinio, P. (2017). Trauma et culture. Influence des facteurs culturels dans la rencontre traumatique et perspectives psychothérapeutiques. European Journal of Trauma & Dissociation, 1(2). 121-129.
- UNESCO. (2002). « Déclaration universelle sur la diversité culturelle ». Série Diversité culturelle n° 1. Page 4. Document établi pour le Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, 26 août – 4 septembre 2002. Récupéré à https://docplayer.fr/10118214-Declaration-universelle-sur-la-diversite-culturelle.html
- Vaiva, G., Lestavel, P. et Ducrocq, F. (2008). Quand traiter le psychotraumarisme ? La Presse médicale. 37(5) – (2). 894-901.
- Vitry, I. et Dessons, V. (2005). Un tahitien à Avicenne : traumatisme : construction d’un cadre thérapeutique transculturel. Perspectives Psy. 44(1), 44-48.


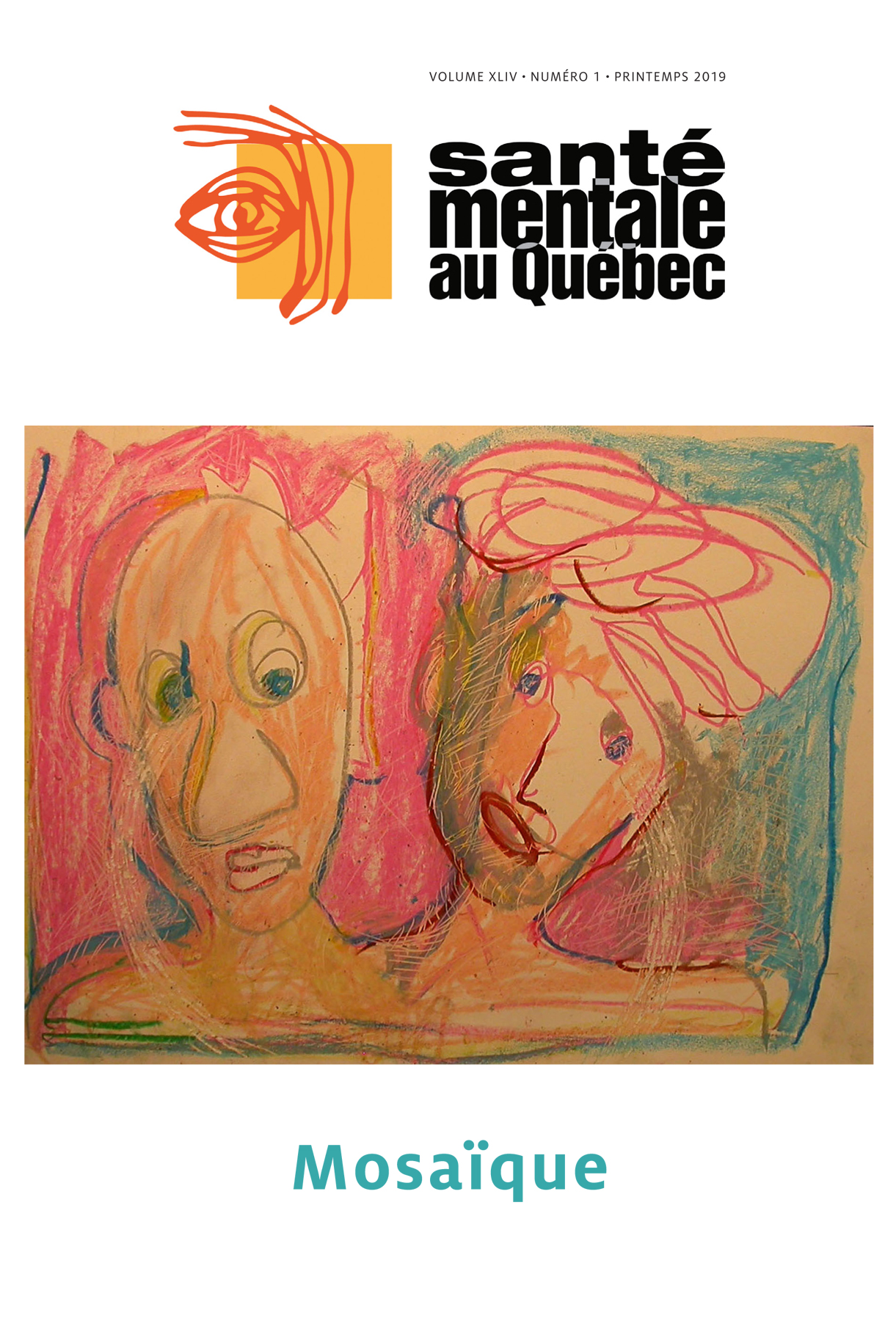
 10.7202/032253ar
10.7202/032253ar