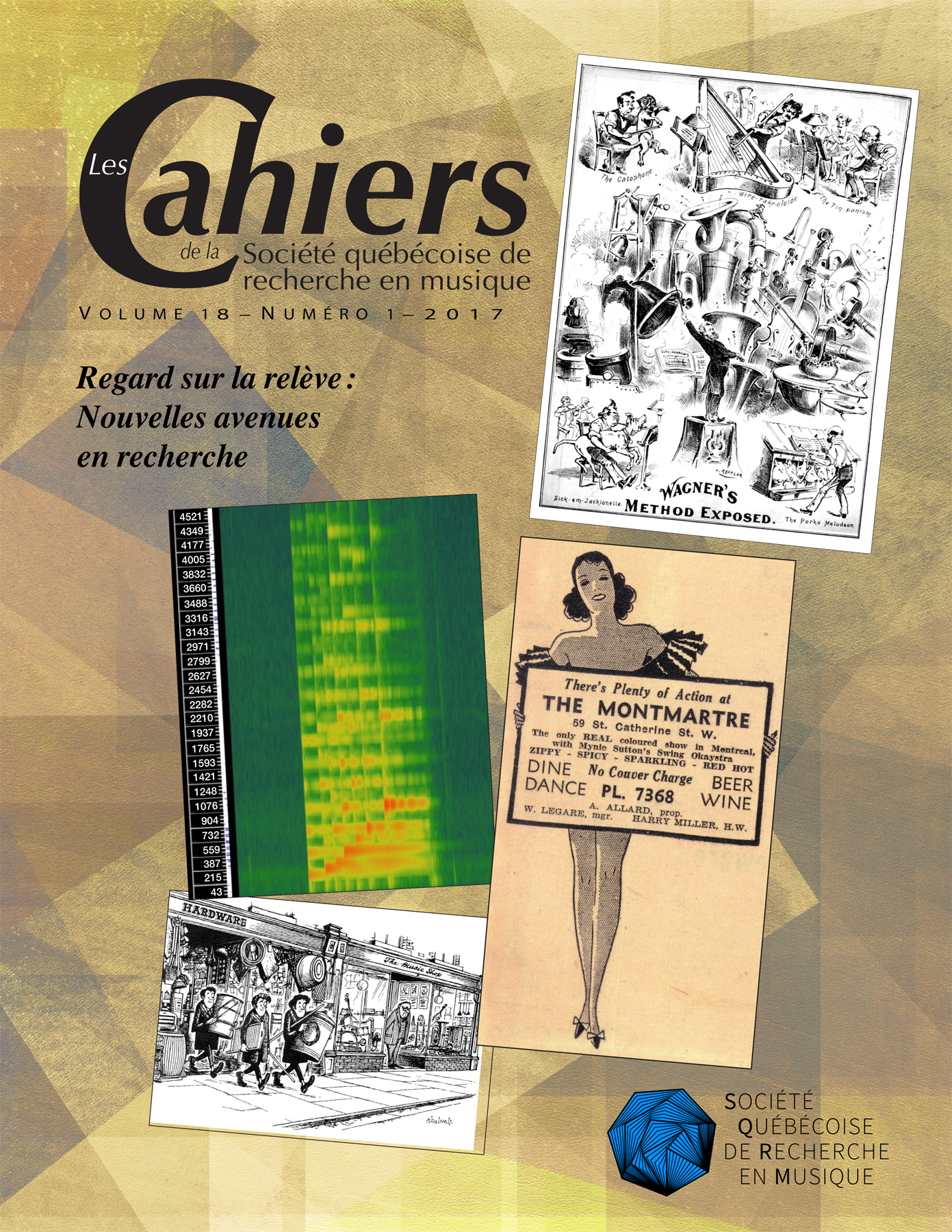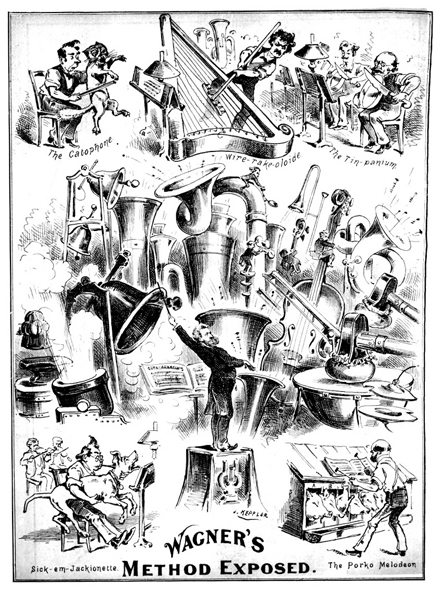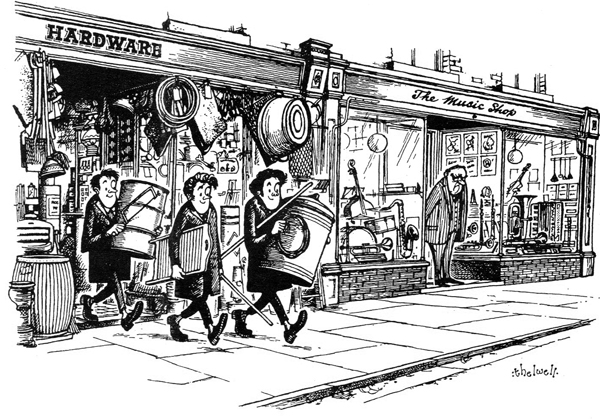Résumés
Résumé
Ce texte propose de repenser l’intégration du bruit en musique, un phénomène trop souvent confiné aux seuls xxe et xxie siècles, à partir des réflexions de Jacques Rancière sur ce qu’il nomme le « régime esthétique » : révolution dans les manières de penser et de sentir qui, propulsée par le romantisme et toujours en cours, dérègle les conceptions de la société et de l’art héritées de la Grèce antique. En matière de création et d’appréciation des oeuvres, l’ère nouvelle se caractérise par un recul de l’idéal classique de l’éloquence, de la forme animée par un contenu à transmettre, au profit du modèle de la « parole muette », de la signification qui échappe au contrôle du maître. Cette dernière, explique Rancière, peut être pensée de deux façons. Comme immanence du logos dans le pathos, elle est le pouvoir expressif des choses muettes elles-mêmes : la signification ou la poésie secrètes des détails sans importance, offertes à qui sait regarder. Comme immanence du pathos dans le logos, à l’inverse, elle est la part de non-sens qui se cache derrière le discours le plus rigoureusement articulé comme dans toute autre construction rationnelle : puissance obscure à laquelle les artistes métaphysiciens ou psychanalystes tentent, tant bien que mal, de donner corps. Si la parole muette et ses deux formes contradictoires peuvent déloger l’éloquence comme principe de la création, c’est parce que le régime esthétique est tout déployé autour de l’idée de l’égalité des contraires : du noble et du vulgaire, de l’actif et du passif, du conscient et de l’inconscient etc. En prenant appui sur ces réflexions, donc, ce texte propose de retracer quelques-uns des discours et des pratiques qui, du romantisme à aujourd’hui, brouillent les frontières entre le sens et le non-sens, l’art et le non-art, la musique et le bruit.
Abstract
This paper proposes to rethink the integration of noise in music, a phenomenon too often confined in the borders of the twentieth and twenty-first centuries, under the light of Jacques Rancière’s reflections on what he calls the “aesthetic regime”: a revolution in the ways of thinking and feeling which, propelled by Romanticism and still ongoing, disrupts the conceptualizations of society and culture inherited from ancient Greece. In terms of artistic creation and appreciation, the new era is characterized by a decline of the classic ideal of eloquence, of the form entirely guided by a content to be transmitted, for the benefit of the more ambiguous model of the “mute speech”, of the signification that is beyond any master’s control. The latter, Rancière explains, can be interpreted in two ways. As the immanence of logos in pathos, it is the expressive power of mute things themselves: the secret signification or poetry of unimportant details, accessible to anyone who knows how to look properly. As the immanence of pathos in logos, inversely, it is the share of nonsense hiding behind the most rigorously articulated speech just as in any other rational construction: an obscure force to which the poet-psychoanalyst or metaphysician tries, somehow, to give voice and body. If the mute speech and its two contradictory forms come to oust the old eloquence as the principle of artistic creation, it is because the whole aesthetic regime revolves around the idea of a radical identity between all opposites: the noble and the vulgar, the active and the passive, the conscious and the unconscious, etc. So, building on these reflections, this paper proposes to retrace some of the practices and discourses which, since Romanticism and up to this day, blur the lines between sense and nonsense, art and non-art, music and noise.
Corps de l’article
En mai 2016, Iggy Pop accompagne le cinéaste Jim Jarmusch sous les feux du Festival de Cannes. Les deux hommes sont invités pour la première de Gimme Danger (2016), un documentaire passionné sur l’histoire chaotique du chanteur et du groupe protopunk qu’il a aidé à fonder, à la fin des années 1960, aux côtés des frères Ron et Scott Asheton et de Dave Alexander : les Stooges. Sans grande surprise, lors de la conférence de presse, le rocker est appelé à se prononcer sur l’état actuel de l’industrie musicale. Maussade, il répond :
C’est différent, aujourd’hui. Tu peux peser sur un bouton et devenir soudainement très riche. Et je pense aussi qu’il y a lieu d’argumenter que l’humanité approche un point où la technologie pourrait bien finir par attraper tout le monde par les épaules pour nous secouer puis nous balancer par-dessus le bord et en finir avec nous[1]
Jarmusch et collab. 2016
Puis, parodiant un rythme techno en martelant sur la table : « Wow ! Vous savez ? Pourquoi ne pas crever sur-le-champ ?[2] » (Jarmusch et collab. 2016). Cette critique, craignant qu’une technologie froide et déshumanisante ne vienne remplacer l’expression chaude et authentique de l’artiste, n’est pas nouvelle. Au tournant du xxe siècle, déjà, le compositeur et chef d’orchestre américain John Philip Sousa ne trouve pas de mots assez durs pour nous mettre en garde contre les « machines infernales » de la phonographie : « Un jour viendra où plus personne ne sera disposé à se soumettre à la noble discipline de l’apprentissage de la musique. Chacun aura sa musique toute faite, piratée çà et là, prête à servir » (cité dans Ross 2015 [2010], 99-100). Plus fondamentalement, peut-être, ces discours quelque peu alarmistes rappellent les diatribes d’une certaine presse réactionnaire qui, bien avant l’ère de la reproduction technique, fustige la « précision presque scientifique » du roman réaliste :
Si l’on forgeait à Birmingham ou à Manchester des machines à raconter ou à analyser en bon acier anglais, qui fonctionneraient toutes seules par des procédés inconnus de dynamique, elles fonctionneraient absolument comme M. Flaubert. On sentirait dans ces machines autant de vie, d’âme, d’entrailles humaines que dans l’homme de marbre qui a écrit Madame Bovary avec une plume de pierre, comme le couteau des sauvages
D’Aurevilly 2004 [1860-1865], 1055, 1048
Si je prends le temps de relever ces ressemblances, c’est que je crois qu’elles témoignent, par la négative, de profondes mutations dans les conceptions et les pratiques artistiques modernes et contemporaines, où le sujet abandonne de plus en plus ses pouvoirs pour laisser parler les objets du monde. C’est-à-dire que, tout en voulant les dénoncer, les critiques de la mécanisation rendent compte de nouvelles formes de création où l’humain embrasse le non-humain, où l’intentionnel cède au non-intentionnel, où la pensée s’ouvre à la non-pensée. Sans le savoir, elles mettent au jour ce grand brouillage des contraires que Jacques Rancière place au coeur du « régime esthétique » : reconfiguration de la pensée et de la sensibilité occidentales qui, exacerbée depuis la révolution romantique, bouleverse les anciennes conceptions de la société et de l’art héritées de Platon et d’Aristote. Un changement de paradigme où, suivant le philosophe, l’on passe de la hiérarchie à l’anarchie des genres, de l’unité organique du poème au modèle du fragment, du règne de l’éloquence à celui de la « parole muette » (Rancière 1998, 17-30, 32, 59).
C’est en m’appuyant sur cette dernière notion, tout particulièrement, que je propose de réfléchir aux redéfinitions de l’audible sous le nouveau régime : de retracer quelques-uns des discours et des pratiques qui, depuis le tournant du xixe siècle, brouillent les définitions de la musique et la font glisser vers le bruit. Le propos s’articulera autour de trois moments. D’abord, j’esquisserai l’émergence du régime de la parole muette ainsi que l’essor de la musique instrumentale qui, à la même époque, permet au « bruit » symphonique de devenir non seulement la source d’un plaisir esthétique légitime, mais un modèle pour la création en général. Ensuite, je retracerai la nouvelle sensibilité au sein de la culture rock qui, avec sa poésie pop crue et ses déflagrations sonores, continue de déplacer les lignes du significatif et d’estomper les frontières du beau. Après quoi je me pencherai sur la musique noise qui, ne serait-ce que de par son appellation, offre un parfait exemple de fusion romantique des contraires. En prenant pour exemple le travail de Sonic Youth, formation parmi les plus influentes à émerger de la scène post-punk new-yorkaise, je tenterai de démontrer que les pratiques bruitistes prolongent et exacerbent ce grand désordre qui, bien que déjà présent dans les premières incarnations du rock, trouve sa véritable origine dans la révolution esthétique de la fin du xviiie siècle.
Les rythmes de la nature et de la vie
Le logos aristotélicien, explique Rancière, est la parole bien maîtrisée : l’élocution déterminée par la raison,
guidée par une signification à transmettre et un effet à assurer. Chez Platon, c’est la parole du maître qui sait à la fois expliciter sa parole et la déposer comme une semence dans l’âme de ceux chez qui elle peut fructifier. Dans l’ordre représentatif classique, cette « parole vivante » est identifiée à la grande parole qui fait acte : la parole vivante de l’orateur qui bouleverse et persuade, édifie et entraîne les âmes ou les corps. C’est aussi, conçue sur son modèle, la parole du héros tragique qui va jusqu’au bout de ses volontés et de ses passions
2001, 34
En aucun cas, ce logos ne doit être confondu avec la simple voix des gens de basses conditions qui, tels des animaux, n’émettent des sons que pour exprimer le plaisir ou la douleur. Or, à cette parole exclusive, qui norme l’entièreté du système représentatif depuis la Grèce classique jusqu’au siècle des Lumières, le romantisme oppose le régime de l’« omni-signifiance » où, suivant Rancière, l’usure d’un bâtiment ou la bouche d’un égout parlent autant, sinon mieux, que le lauréat du concours d’éloquence ou que tout prince de tragédie : parce que, à la différence de ces derniers, elles ne veulent rien dire et que, par conséquent, elles ne peuvent pas mentir (2007, 178). Une « démocratie esthétique » qui, pour ce qui m’intéresse ici, peut être pensée selon deux schémas contradictoires et indissociables, chacun correspondant à l’une ou l’autre forme de ce que le philosophe nomme la parole muette (cité dans Truong 2007, 58). D’abord, il y a le discours que portent les choses muettes elles-mêmes :
C’est la puissance de signification qui est inscrite sur leur corps même, et que résume le « tout parle » de Novalis, le poète minéralogiste. Tout est trace, vestige ou fossile. Toute forme sensible, depuis la pierre ou le coquillage, est parlante. Chacune porte, inscrite en stries et en volutes, les traces de son histoire et les signes de sa destination
Rancière 2001, 35
Le logos, jadis réservé aux seuls hommes d’une certaine qualité, est remis en libre circulation, inscrit jusque dans la moindre manifestation du monde. Il en va de même pour le grand art qui, dorénavant, peut exister en dehors des valeurs éternelles et immuables des académiciens. Gustave Courbet l’énonce clairement lorsque, dans sa « Lettre aux jeunes artistes de Paris » (1861), il écrit :
Le beau est dans la nature, et se rencontre dans la réalité sous les formes les plus diverses. Dès qu’on l’y trouve, il appartient à l’Art, ou plutôt à l’artiste qui sait l’y voir. Dès que le beau est réel et visible, il a en lui-même son expression artistique. Mais l’artiste n’a pas le droit d’amplifier cette expression. Il ne peut y toucher qu’en risquant de la dénaturer, et par suite de l’affaiblir. Le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l’artiste
1986 [1861], 5
Toute forme d’existence devient intéressante, digne de représentation, et n’importe quelle de ses manifestations est également propre à en exprimer le sens ou la poésie cachés (Rancière 2007, 149). Ainsi, pour reprendre les mots de Marcel Proust, Richard Wagner peut faire entrer dans sa musique les « rythmes de la nature et de la vie, du reflux de la mer au martèlement du cordonnier, des coups du forgeron au chant de l’oiseau » (1978 [1921-1922], 1156). Ou, comme au troisième acte de Tristan und Isolde (1865), se dessaisir de sa puissance créatrice et confier « l’expression de la plus prodigieuse attente de félicité qui ait jamais rempli l’âme humaine » à la « maigre chanson » d’un « pauvre pâtre[3] » (Proust 1978 [1954], 69). La musique elle-même, au fait, connaît une fulgurante promotion au xixe siècle : jadis considérée comme un « vain bruit », car ne sachant, sans l’aide de la voix humaine ou d’une note de programme, parler « ni à l’esprit ni à l’âme », elle devient avec la métaphysique romantique de l’art l’expression directe de réalités profondes, inaccessibles à la connaissance ordinaire[4] (D’Alembert 2017 [1759, 1767], 926). Le langage, qui la commande et lui donne sens depuis des siècles, ne parvient plus à la traduire ou à expliquer ses effets. Pire encore : toujours empêtrés qu’ils sont dans les mailles de la raison, les mots empêchent le plein déploiement des « Miracles de l’art musical » (Wackenrdoder et Tieck 2009 [1797, 1799], 210). Un revirement qui, comme on le verra très bientôt, tient peut-être plus de la seconde forme de la parole muette que de la première.
Illustration 1
Wagner : les rythmes de la nature et de la vie (Keppler 1877, 16).
Car l’égalité esthétique, nous dit Rancière, c’est aussi le langage qui se vide de son sens, qui s’abaisse à l’irrationalité des choses quelconques. L’écriture muette, ici, n’est plus la beauté secrète ou le message encodé dans le sensible, mais « la parole sourde d’une puissance sans nom qui se tient derrière toute conscience et toute signification, et à laquelle il faut donner une voix et un corps » (Rancière 2001, 41). L’artiste n’est plus, comme dans la section précédente, l’explorateur qui sillonne le bas monde et qui rend leur valeur aux détails sans importance. Plutôt, il est la figure orphique qui « s’enfonce dans le pur non-sens de la vie brute ou dans la rencontre avec les puissances des ténèbres » (Rancière 2001, 33). La poésie de l’ordinaire ne l’interpelle pas tant que la voix, insaisissable et insensée, de la vie même. C’est le contre-mouvement emprunté par Wilhelm H. Wackenroder quand, dans les Fantaisies sur l’art (1799), il s’en prend aux hommes de science qui, trop souvent dans leur noble quête de vérité, ne font que réduire l’existence à d’austères systèmes d’idées :
Les sages voudraient refaire le monde selon le modèle calculé et mesuré de la raison, en suivant un ordre des choses sérieux et spirituel. Mais qu’est-ce que la terre sinon un son de l’harmonie secrète des sphères, parvenant à notre oreille ? Un éclair fugitif, visible à nos yeux, surgissant des nuages obscurs cachés de l’univers ? Et nous, que sommes-nous ? Ce flux et ce reflux puissants des choses terrestres […] ne me semblent rien sinon que la pulsation caractéristique et mystérieuse, la respiration terrible et incompréhensible de la créature terrestre[5]
2009 [1797, 1799], 180
Un chemin repris, peu de temps après Wackenroder, par Arthur Schopenhauer et le jeune Friedrich Nietzsche qui, chacun à sa façon, se détournent des belles apparences de la raison pour se perdre dans les profondeurs insondables de la Volonté et du dionysiaque[6]. Or, chez le premier comme chez les deux autres, la musique occupe une place privilégiée : par son immatérialité et sa résistance au concept, elle offre un accès direct à l’essence secrète des choses. Autrement dit, les attributs qui en font un langage déficient sous le régime précédent — son abstraction, son imprécision sémantique, son incapacité à bien nommer les choses — la rendent, à l’époque du romantisme, supérieure à toute autre forme d’expression. Une langue « plus riche » que celles des littéraires, écrit Hector Berlioz, « plus variée, moins arrêtée et, par son vague même, incomparablement plus puissante » (1990 [1839], 3). « Voilez-vous la face, pauvres grands poëtes anciens, pauvres immortels ; votre langage conventionnel, si pur, si harmonieux, ne saurait lutter contre l’art des sons. Vous êtes de glorieux vaincus, mais des vaincus ! » (Berlioz 2013 [1862], 60). Bien qu’un tel renversement de situation eût pu provoquer une levée de boucliers de la part des littérateurs, plusieurs poètes et romanciers de l’époque, et non des moindres, s’entendent pour reconnaître leurs limites face au mystère musical. Thomas Moore, par exemple, écrit dans ses Irish Melodies (1807-1834) : « Oh divine musique ! Le langage impuissant et faible se retire devant ta magie ! Pourquoi le sentiment parlerait-il jamais, quand tu peux seule exhaler toute son âme ? » (cité dans Berlioz 1996, 68). Honoré de Balzac, au fil de ses correspondances avec la comtesse Ewelina Hańska, en vient également à s’incliner. Dans une lettre de novembre 1837, il admet que Ludwig van Beethoven est le seul homme à lui faire connaître la jalousie. À peine remis de la Cinquième Symphonie (1808), entendue la veille au Conservatoire de Paris, il poursuit : « Dans son finale, il semble qu’un enchanteur vous enlève dans un monde merveilleux, au milieu des plus beaux palais qui réunissent les merveilles de tous les arts […] et vous laissent apercevoir des beautés d’un genre inconnu » (Balzac 1990 [1967], 419). Vient, alors, l’aveu d’impuissance : « Non, l’esprit de l’écrivain ne donne pas de pareilles jouissances, parce que ce que nous peignons est fini, déterminé, et ce que vous jette Beethoven est infini » (Balzac 1990 [1967], 419).
Que des poètes s’avouent incapables de bien traduire les effets de la musique, cela indique, sans contredit, un profond changement dans les conceptions esthétiques dominantes. La parole n’est plus, comme aux temps d’Aristote ou des Lumières, le modèle infaillible vers lequel toute création devrait tendre. Au contraire, à l’heure où plusieurs s’éprennent de métaphysique romantique, le sens étroit et terrestre des mots passe pour une contrainte. La musique, en revanche, apparaît comme l’organe privilégié de l’indicible. Elle est « la plus merveilleuse de toutes les inventions », écrit Wackenroder, « une langue que nous ignorons dans la vie courante, et dont nous ne savons pas où ni comment nous l’avons apprise, une langue que seule on pourrait tenir pour le langage des anges » (2009 [1797, 1799], 213). Ainsi libérée du logos, du devoir ancestral de se plier à un discours préétabli, la musique peut exister et être appréciée en elle-même. Pour ses « formes sonores en mouvements », écrit l’esthéticien et tourmenteur de Wagner Eduard Hanslick[7] (1986 [1854], 94). Pour sa façon de vous frapper « au creux de l’estomac plutôt que dans le cervelet », soutient la critique rock[8] (Foege 1995 [1994], 61). Et c’est ce vers quoi je vais, dès à présent, me tourner.
Moments de brillance inexplicable dans un brouillard de stupidité, ou vice versa
La parole muette, écrivais-je plus haut, est d’abord la puissance de signification rendue aux choses sans intérêt. Elle est la parcelle d’histoire ou de poésie contenue dans les marchandises disparates d’un étalage de magasin ou dans un geste répété mille fois et qui doit être ramenée à notre conscience par un double travail de déchiffrement et de réécriture (Rancière 2001, 41). « C’est le modèle romantique de la pensée qui va de la pierre et du désert à l’esprit, explique Rancière, de la pensée déjà présente dans la texture même des choses, inscrite dans les stries du rocher ou du coquillage et s’élevant vers des formes toujours plus explicites de manifestation » (1998 [1996], 533). Rien n’est insignifiant : tout est également porteur de sens, digne d’intérêt et de représentation. Les rêves de la fille de paysan et la misère des casseurs de pierres, les motifs du papier peint et les formes sinueuses de l’urinoir, le grésillement de la radio à transistors et les scories de l’impression mécanique. En bon héritier du blues et des musiques country, le rock n’est certainement pas insensible à la poésie du banal : il démontre, comme pour répondre à la critique de S. I. Hayakawa, une « force de caractère […] une détermination, souvent absente des chansons populaires, à rendre compte des faits de la vie[9] » (1955, 93). Au moment de publier Le regain américain (1970), hommage à chaud et candide au mouvement hippie, le juriste et activiste Charles A. Reich déclare au Rolling Stone :
La toute première chose qui a commencé à se produire quand le rock est entré dans la culture de masse a été de dire « on se sent seuls et aliénés et effrayés », et la musique n’avait jamais dit ça auparavant. Le blues l’a toujours dit […] Mais les Blancs se faisaient raconter combien joyeux, combien romantique, combien beau, combien agréable était le monde. Et ça ne reflétait pas la vérité. Soudain arrive Elvis Presley chantant à propos d’un « Heartbreak Hotel » rempli de personnes seules, et il disait peu importe que ça soit plein, quand on arrive là on est seul […] Donc la première vérité du rock, le premier gros message, c’était de dire les choses ne vont pas si bien. […] Vient ensuite un second type de chansons qui commencent à faire l’éloge de la débauche et du sexe — et c’est une autre vérité que personne ne disait[10]
cité dans Rinzler 1971, 32
À présent, la culture rock ne s’attache pas aux seuls travers et bas instincts de la bête humaine. Seulement, elle embrasse la réalité dans toute son hétérogénéité[11]. « Car la poésie vraie », pour reprendre la formule de Victor Hugo, « la poésie complète est dans l’harmonie des contraires. Puis, il est temps de le dire hautement, […] tout ce qui est dans la nature est dans l’art » (2009 [1827], 39). Le rock ne dit rien d’autre : Little Richard chante autant le gospel du dimanche matin que la débauche du samedi soir, Bob Dylan poétise les gros titres comme les petites conversations, Jim Morrison cite Sophocle aussi bien que les pubs de détersifs[12]. Une attitude qui s’observe, déjà, chez le « premier poète rock en Amérique[13] » : Chuck Berry qui, dès ses débuts, confond le grand amour et la mécanique automobile, qui évoque Vénus aux côtés de Jackie Robinson, qui renverse Beethoven au profit de l’illettré Johnny B. Goode[14] (Goldstein 1969 à[1968], 2). Souvent, ses chansons sont si encombrées d’objets que les histoires qu’elles devraient nous raconter passent presque au second plan, semblant n’être que des prétextes à énumérer les babioles. En témoigne l’inventaire des biens qui troue le récit du couple de « You Never Can Tell » (1964) : deux jeunots se marient, meublent un appartement à leur goût et revisitent, pour souligner quelque anniversaire, les lieux de leur union. « C’est la vie[15] », dit le refrain : « On ne sait jamais comment ça va tourner ». Des mots fort à propos, considérant que l’auditeur ne connaît à peu près rien des mariés et de leur histoire : comment ils se sont rencontrés, s’ils ont des enfants, en quoi consiste le boulot qui permet « les petites rentrées d’argent ». En revanche, il est bien informé qu’ils possèdent un frigo « bourré de plats congelés et de sodas gingembre », une chaîne stéréo hi-fi pour jouer leurs « sept cents petits disques » ainsi qu’une voiture retapée : « une 1953 rouge cerise[16] ». Les accessoires ont autant d’importance, sinon plus, que les personnages et l’action. Le décor est tiré à l’avant-scène, pour ainsi dire. Et le moindre objet, bien qu’il n’apporte rien au récit, est essentiel. Comme l’écrit le journaliste et auteur Nik Cohn, dans ce qui est souvent considéré comme la première histoire écrite du rock :
Au fond, ce sont les détails qui comptent. La plupart des auteurs pop auraient écrit You Never Can Tell en énumérant des généralités et ça n’aurait même pas existé. Mais Chuck était obsessionnel, il était passionné de voitures, de rock et de ginger ale et il fallait absolument qu’il les place dans sa chanson. Ce sont les petites touches comme la Jidney [sic] de 1953 rouge cerise ou le coolerator [sic] qui font toute la différence
2013 [1969], 51
Ou, pour utiliser les mots de Rancière : « Le tout est maintenant dans les détails » (2014, 34). Le contenu essentiel ne réside pas nécessairement dans le « tableau général », dans quelque idée centrale ou principe structurant autour desquels s’articulerait la chanson : une histoire à raconter, une morale à transmettre, une émotion à déclencher. Il peut tout aussi bien se trouver dans les « petites touches » : dans les parcelles de réalité ordinaire, écrit Cohn, dans les mots et les objets de la vie courante qui font irruption dans les paroles. Un nivellement des hiérarchies que décrit bien le critique Greil Marcus quand, dans son introduction aux Aesthetics of Rock (1970) de Richard Meltzer, il écrit :
Le rock est une totalité : il contient, ou laisse croire qu’il peut contenir, toutes les variétés d’expérience. […] Les plus « triviaux, médiocres, banals, insipides » des éléments de l’art et de la vie deviennent intéressants, et mystérieux : le choix d’un mot plutôt qu’un autre, les tournures de phrases, les pochettes de LP (qui ne sont qu’une autre version des pubs TV, des panneaux-réclame, des images socialement codées auxquelles nous répondons ou desquelles nous nous détournons), les cris, les silences, des moments de brillance inexplicable dans un brouillard de stupidité, ou vice versa[17]
1987 [1970], xxii-xxiii
Les derniers mots sont intéressants. La « totalité rock », avance Marcus, admet qu’il puisse y avoir de l’intelligence à l’oeuvre derrière ce qui semble insignifiant. Ou, inversement : de la bêtise sous le voile de la brillance. Ce qui nous ramène, en douce, vers la seconde forme de la parole muette : celle qui, plutôt que de donner sens aux choses muettes, injecte du silence dans les produits de la raison. Voix de l’Autre qui, pour filer la métaphore géologique, « renvoie l’esprit à son désert » (Rancière 1998 [1996], 533).
Illustration 2
Le skiffle : tout ce qui est dans la nature est dans l’art (Thelwell 1957, 92).
Dès ses débuts, le rock est perçu par une part considérable du public comme une forme de régression insidieuse. Rien de moins qu’un « vaudou de frustration et de défiance[18] », estime un prêtre (Shannon 1956, 1). Une redoutable « menace à la vie, à la santé, à la décence et à la morale », vocifère un autre, tandis qu’un psychiatre s’inquiète de cette nouvelle « maladie contagieuse[19] » poussant les adolescents à adopter des comportements déviants (cités dans Stearn 1956a, 3). La presse musicale n’est pas plus tendre, décrivant tantôt un « retour à des rythmes de la jungle » incitant la jeunesse à se commettre en « des orgies de sexe et de violence (comme son modèle le faisait chez les sauvages eux-mêmes) », tantôt une forme exacerbée de « pollution acoustique » contaminant aussi bien les ondes que les bonnes moeurs : « Est-ce vraiment le progrès ?[20] » (Stevens 1958, 3 ; Hanson 1962, 2). Une perspective parfaitement renversée par les adeptes de la nouvelle musique qui, eux aussi, y voient une sorte d’atavisme ou de réversion. Non pas dans un sens négatif, cependant, mais comme un retour à quelque chose d’essentiel, la résurgence salutaire d’un aspect oublié de la nature humaine. C’est le chanteur folk Butch Hancock qui le résume le mieux quand, se rappelant les premières apparitions d’Elvis à la télévision, il lance : « Ouais, c’était la danse que tout le monde avait oubliée. C’est que la danse était si forte qu’il a fallu une entière civilisation pour l’oublier. Et dix secondes du “Ed Sullivan Show” pour s’en rappeler[21] » (cité dans Ventura 1986 [1985], 156). Au début des années 1960, c’est un critique du Time qui, transporté par un concert de Ray Charles, rapporte que des « spiritualistes du sud » disent avoir entendu le soul man parler la « langue inconnue[22] » (« That’s All Right » 1963, 52). Quelques années plus tard, l’article inspire à un jeune Richard Meltzer de développer sa propre théorie, aussi confuse que divertissante, du rock comme parole hermétique. Seulement, admet aujourd’hui le critique, certaines de ses réflexions sont
à ce point sous-articulées (inarticulées ?) qu’il faudrait une visite guidée (ou une cassette d’accompagnement) pour clarifier, ou simplement suggérer, ce que j’aurais bien pu tenter d’« exprimer » à l’époque. […] Après, il y a des bouts, des paragraphes si droguément opaques, ésotériques, abstrus qu’aucune assistance auctoriale — je connais mes limites ! — n’est à ce stade même hypothétiquement envisageable[23]
Meltzer 1987 [1970], vii
Plus convaincante est la thèse de l’auteur et cinéaste Michael Ventura, selon laquelle le rock n’est rien de moins que la survivance, en sol américain, de cultes religieux et païens importés d’Afrique et d’Europe avec le commerce triangulaire :
Ce qui ne veut pas dire que le rock ’n’ roll est du vaudou. Bien sûr qu’il ne l’est pas. Mais il garde intacts certains traits de la métaphysique africaine et les restitue avec une telle puissance qu’il génère inconsciemment les mêmes danses, agit comme un redoutable antidote à la séparation [judéo-chrétienne] du corps et de l’esprit et utilise des techniques dérivées de la possession vaudoue comme source, pour les musiciens aussi bien que pour les spectateurs, d’une incroyable énergie[24]
1986 [1985], 156
Tout aussi intéressante est la proposition de l’artiste conceptuel Dan Graham qui, dans son brillant essai vidéo Rock My Religion (1983-1984), trace une filiation entre les séances de danses extatiques des Shakers et les concerts débridés des hippies et des punks :
Dans le rituel de la performance rock, la combinaison des effets hypnotiques de la musique et des drogues psychédéliques conduit les interprètes et leur public à un « voyage », au-delà de la Vieille Conscience dans la psyché profonde. Comme l’invocation délibérée du Diable par les Shakers qui vise la purification de la communauté et la communion avec Dieu, le performeur tente de libérer des propriétés archaïques[25]
1982, 328
Ce que suggèrent de telles généalogies, c’est que le rock, un peu comme la musique absolue au cours du xixe siècle, peut constituer une forme d’expérience religieuse. Ou, du moins, une pratique extatique à travers laquelle le sujet s’évade de l’existence ordinaire. Dans la rencontre avec les puissances célestes, par une sorte d’élévation mystique, ou dans la régrédience[26], par un retour à l’animal. Dans un cas comme dans l’autre, le rock apparaît comme une sortie brutale du logos. « Je pense que le langage est presque obsolète de toute façon », résume Patti Smith au moment de sortir Easter (1978) : « La barrière de la langue sera brisée non pas par l’esperanto, non pas par quelque nouveau langage néo-intellectuel, mais à travers le rock ’n’ roll, à travers le son. Quelque chose d’aussi commun et dirt cheap que le rock ’n’ roll[27] » (citée dans Robertson 1978, 17).
L’avili et le sacré
Les prophéties beat de la poétesse rock et ses appels à faire sauter le langage trouvent un écho particulièrement sonore chez la jeune génération post-punk d’alors, à qui l’on doit des slogans tels que « Renversez l’évolution » (1976 ?), « Déchirez tout et recommencez à zéro » (1982) et « Arrêtez de faire sens » (1984)[28]. Ou, dans les mots choisis par Sonic Youth : « Le chaos est l’avenir et au-delà se trouve la liberté/La confusion est proche et juste après vient la vérité[29] ». Paroles que l’on retrouve sur le premier album du groupe, Confusion Is Sex (1983), sorti deux ans après sa formation officieuse au Noise Fest de 1981. Flirtant avec l’underground new-yorkais, Sonic Youth est à l’origine très proche de l’anti-scène no wave, « sous-genre cacophonique et confrontant du punk rock », explique un journaliste du New York Times, « dadaïste dans le style et nihiliste dans l’attitude. Ça a commencé en 1976 et, en l’espace de quelques années, la plupart des formations originales s’étaient dissoutes[30] » (Sisario 2008, E1). Dans un esprit un peu moins table rase que la no wave, peut-être, le groupe manifeste dès le départ un penchant pour l’expérimentation et la transgression : performances violentes, exacerbation du bruit, intégration de matériaux non-conventionnels. Avec les années, les membres affinent leur art et développent une identité forte qui leur vaut une grande popularité dans les circuits indépendants ainsi que, après dix années de travail sous-terrain, un fructueux contrat de DGC Records : jeune firme fondée par David Geffen, alors en voie de devenir l’un des plus gros joueurs de la scène alternative avec des artistes comme Nirvana, Weezer et Beck. À sa séparation, à l’hiver de 2011, Sonic Youth a plus d’une trentaine d’albums à son catalogue et fait figure de pilier du noise rock. Dans un essai sur le sujet, le théoricien culturel Torben Sangild écrit :
Le terme « noise rock » […] désigne une partie de la scène post-punk qui émerge des cendres du punk à la fin des années 1970. […] Le post-punk tente […] de se distancier de la joyeuse insouciance de la pop, sans toutefois rejeter ses qualités mélodiques. Un des meilleurs moyens pour accomplir cette tâche est le recours au bruit. Le noise rock n’est pas un style cohérent, mais un terme général pour désigner les différentes formes que peut prendre l’esthétique du bruit à l’intérieur de l’idiome post-punk[31]
2002 [1996-1997], 13
Défini en ces termes, le genre rappelle la « forme informe » du roman qui, au xixe siècle, vient ruiner le système hiérarchique des belles-lettres (Rancière 2009, 142). Ce qui ne doit pas nous faire oublier que le rock lui-même, à la base, constitue un phénomène protéiforme. Une « totalité », suggère Greil Marcus : une forme ouverte qui, dans son libre déploiement, peut emporter toute chose et son contraire[32]. Seulement, vingt-cinq ans après ses premiers scandales — les déhanchements obscènes d’Elvis au Ed Sullivan Show en 1956, les paroles inintelligibles des Kingsmen (1963) placées sous enquête par le FBI en 1964, le commentaire de John Lennon sacrant les Beatles plus populaires que Jésus-Christ en 1966 — le rock est une tradition aussi bien définie que solidement implantée dans la culture dominante : avec ses héros et son répertoire, ses codes et ses clichés, ses rituels et ses institutions. De plus, ses formes d’expression dominantes oscillent entre diverses tendances au repli et à la rationalisation : la standardisation des formats radiophoniques, le retour à l’essentiel des punks, les sonorités bien ordonnées de la synth pop, etc. Le noise, en revanche, se présente comme un retour en force du refoulé, embrassant les genres tenus à l’écart — de la musique concrète au hip-hop en passant par le free jazz et le hardcore — et mettant de l’avant les impuretés gommées par les studios professionnels : les fausses notes, les défectuosités du matériel, les sons ambiants, etc. Il réintroduit de la saleté dans la « pollution » rock, pour ainsi dire. Un travail de récupération « sauvage[33] » qui s’exprime, dans la littérature noise, à travers la figure récurrente de l’ordure.
Au temps de l’éclectique Whitey Album (1989), où les membres de Sonic Youth[34] aidés de quelques collaborateurs se permettent deux reprises de Madonna ainsi qu’une version karaoké d’« Addicted to Love » (1986) de Robert Palmer, la bassiste Kim Gordon affirme : « Nous sommes comme le gros camion poubelle qui trace sa route, ramassant les déchets de la pop » (citée dans Foege 1995 [1994], 150). La formule est caricaturale, bien entendu, mais elle paraît assez proche de la réalité quand on observe tout le bric-à-brac mobilisé, au fil des années, par le groupe : de la perceuse amplifiée qui ouvre « The Burning Spear » (1982) à la lime à métaux qui clôt « Calming the Snake » (2009), du réfrigérateur grondant de « Freezer Burn » (1983) à la boîte vocale distordue de « Providence » (1988), de la tuyauterie qui tinte sur « She Is Not Alone » (1982) à la ferraille indistincte de « Teknikal Illprovisation[35] » (2002). Bien qu’il ne fasse pas directement référence à ce type de détournements, parlant plutôt de la fascination du groupe pour la culture de masse et sa camelote, ses produits jetables et ses icônes interchangeables, le journaliste David Browne puise, lui aussi, dans le registre de l’ordure :
Le récent (et parfois aggravant) engouement pour tout ce qui est kitsch [trouve] en partie sa source dans la façon dont Sonic Youth a longtemps embrassé la télé et les films de seconde zone ou les vieux succès sirupeux du Top 40 — la façon dont le groupe a, comme Quentin Tarantino, rendu la junk respectable[36]
Browne 2008, 389
Pour sa part, adoptant un point de vue plus général, Sangild suggère qu’il est un trait dominant du noise rock et du post-punk dans son ensemble de réemployer ce que la culture grand public préfère laisser de côté. Empruntant à l’écrivain Georges Bataille, il parle d’un penchant pour l’« hétérogène » (Sangild 2002 [1996-1997], 13). Le terme, cher à l’auteur de La part maudite (1949), trouve sa première définition dans un article de 1933 :
Ce sont les produits d’excrétion du corps humain et certaines matières analogues (ordures, vermine, etc.) ; les parties du corps, les personnes, les mots ou les actes ayant une valeur érotique suggestive ; les divers processus inconscients tels que les rêves et les névroses ; les nombreux éléments ou formes sociaux que la partie homogène est impuissante à assimiler : les foules, les classes guerrières, aristocratiques et misérables, les différentes sortes d’individus violents ou tout au moins refusant la règle (fous, meneurs, poètes, etc.)
Bataille 2009 [1933], 20
Au plus court, l’hétérogène renvoie à « tout ce que la société homogène rejette soit comme déchet, soit comme valeur supérieure transcendante » (Bataille 2009 [1933], 20). À l’avili et au sacré, donc. Dans tous les cas, l’élément hétérogène est radicalement autre, « différence non explicable[37] » : sa réalité, semblable à celle de l’inconscient, échappe à toute saisie complète par la raison (Bataille 2009 [1933], 18). Sous cet angle, les artistes noise ne ressemblent plus tant au « poète minéralogiste » qui fait parler la pierre et les débris de la civilisation. Plutôt, ils rejoignent la lignée des chercheurs d’ombre qui, de Wackenroder aux pionniers du rock ’n’ roll et de Patti Smith à la no wave, pétrifient la parole humaine et embrassent le pur pathos de la vie nue ou s’élancent, pour les plus aventureux, vers les forces primordiales qui s’agitent derrière le monde phénoménal.
Je me suis intéressé, plus haut, à l’idée du rock comme expérience transcendante[38]. Dans les deux principaux argumentaires retenus, la violence sonore occupe une place centrale. Selon Michael Ventura : « Le vacarme du rock a été nécessaire pour traverser la croûte de conscience accumulée depuis ces trois mille dernières années. De sorte qu’une région endormie depuis longtemps en nous se réveille[39] » (1986 [1985], 48). Pour sa part, Dan Graham déclare : « J’ai toujours pensé — particulièrement parce que j’écoutais du hardcore — que le rock ’n’ roll revenait à utiliser le bruit et le pouvoir destructeur du son, à en faire une expérience extatique, d’où il devenait possible d’entrer en contact avec Dieu[40] » (cité dans Hilde Neset 2009, 3233). L’on ne s’étonne pas, du coup, que l’essai-vidéo de l’artiste s’appuie sur une bande son assourdissante, où s’appellent et se répondent chants de travail et guitares no wave, danses de possession et concerts punk, fiddles grinçants et jams psychédéliques. Le tout fondu dans un flot sonore continu d’où émergent, tout particulièrement, la voix éraillée et nasillarde de Smith, les drones caverneux de Glenn Branca et ceux, spécialement abrasifs, de Sonic Youth. Ce dernier fait est d’autant plus intéressant que le couple fondateur du groupe, Gordon et le guitariste chanteur Thurston Moore, a droit à une mention spéciale au générique de fin. Aux côtés d’une certaine Kirstin Lovejoy, les deux sont remerciés pour leur contribution aux « idées importantes » du film. Une mention qui, lorsque mise en lien avec certaines déclarations du groupe prélevées dans la littérature, donne à penser que les membres de Sonic Youth partagent les thèses de Graham sur les pouvoirs transcendants du rock. En 1986, par exemple, Moore affirme :
Pour moi, c’est plus une sorte de croyance personnelle. […] [Le rock] est une façon de communiquer avec moi-même et d’autres gens […], ce qui à mon avis définit toute religion, une entière communication de la conscience avec les autres et soi-même, physiquement et spirituellement[41]
cité dans Sweezy 1986, 30
Illustration 3
Sonic Youth : bricoleurs noise (Hellman 2015 [1992]).
Dans ses récents mémoires, Gordon se rappelle de la version en concert de « Shaking Hell » (1983) comme d’une élévation
presque chamanique, […] j’étais parcourue de frissons, dans un état chaotique, surtout quand la musique se calmait pour ne plus devenir qu’un grondement sourd pendant les « Shake, shake, shake » de la fin. J’avais l’impression que la terre se dérobait sous mes pieds et que je flottais, jusqu’à ce que ma voix s’élance et me porte. J’avais envie d’emmener le public avec moi, ce public qui voulait croire en moi, en nous, qui étions en train de créer quelque chose de nouveau
2015, 171
Dans un esprit similaire, le guitariste Lee Ranaldo déclare :
On tend à voir la musique comme exultationnelle, ou quelque chose dans le genre ; comme une catharsis. Quand ça marche bien, qu’on soit juste nous quatre dans une pièce, ou quelques milliers dans une salle, les bons soirs quand tout est correctement aligné, tu décolles, il y a un côté transcendant à tout ça où tout le monde est impliqué et il se passe quelque chose de symbiotique entre l’audience et le groupe sur scène[42]
cité dans Stearns 2007, 21
Communication sans parole, états indescriptibles, élévations quasi mystiques : des thèmes familiers pour quiconque s’intéresse à l’idée de la musique absolue. Mais c’est Sangild, sans doute, qui emprunte le plus ouvertement à la métaphysique romantique de l’art. Reprenant le couple théorique cher au jeune Nietzsche, il parle d’une « esthétique dionysiaque » où « l’individualité est transgressée au profit d’une identification avec la volonté universelle — une expérience aussi terrible qu’exaltante[43] » (Sangild 2002 [1996-1997], 25). Dans ses moments les moins conciliants, à savoir quand il ne cherche pas à dissimuler ou à adoucir ses aspects les plus rébarbatifs sous de beaux arrangements apolliniens, le noise fonctionne comme « une confrontation directe avec l’horrible tréfonds de l’être, avec l’absurde volonté qui nous conduit dans nos existences insignifiantes[44] » (Sangild 2002 [1996-1997], 25). L’on peut reconnaître, ici, la seconde forme de la parole muette, qui revient de l’ordre rationnel et esthétique du monde à l’incompréhensible de la vie nue et au chaos des forces élémentaires. Ailleurs, alors qu’il tente de caractériser le « maelstrom de bruit » dans lequel s’embourbent plusieurs des pièces de Sonic Youth — que l’on pense à l’intermède hurlante de « Silver Rocket » (1988), au magma sonore qui engloutit plus de la moitié de « Mote » (1990), à la lente dissolution de tout à la fin de « Small Flowers Crack Concrete » (2000) — Sangild décrit un moment de disruption qui « est à la fois une explosion d’énergie et une implosion de la signification, se détournant du distinct et du sémantique pour verser dans le sublime et l’extatique[45] » (2002 [1996-1997], 15). Un tourbillon qui, pour conclure, pourrait bien avoir son origine dans « la source sacrée et fraîche » où Wackenroder et ses successeurs romantiques aiment tant à se plonger la tête, qui n’est rien d’autre que le torrent insensé de la vie même : un déferlement que la parole humaine ne nomme et ne décrit que misérablement, « à l’aide d’une matière étrangère », tandis que « la musique, au contraire, nous présente le fleuve lui-même » (2009 [1797, 1799], 211, 230).
Tais-toi donc esprit humain !
J’évoquais, en introduction, les inquiétudes d’Iggy Pop devant l’actuel tournant numérique de l’industrie musicale et son éventuel effet sur la création : là où le bon vieil enregistrement analogique revient à « lancer un ampli dans l’âme humaine[46] », la composition assistée par ordinateur menace de mettre un disque dur à sa place (Jarmusch et collab. 2016). Des craintes qui ont de quoi surprendre venant d’un chanteur qui, d’une part, accumule les collaborations avec des artistes électroniques — de New Order à Underworld en passant par Norman Cook et WestBam — et qui, d’autre part, trouve son inspiration première dans le tapage machinique des usines de montage automobiles de Ford, dans son Michigan natal : « Quand j’étais à l’école primaire, on avait fait une sortie au complexe industriel de Rouge [River]. Il y avait une machine qui déchargeait des plaques de métal : WHOOSH !! Je voulais faire de la musique. Je me suis dit que ça devrait sonner comme ça[47] » (cité dans Whalley 2008, 43). Ou qui, lors de cette même conférence à Cannes mentionnée plus haut, se souvient : « Le génie de Ron Asheton, avec sa guitare, était de la brancher à l’ampli et de monter le volume. Puis il écoutait la guitare et l’ampli parler. Il les écoutait tout simplement parler ![48] » (Jarmusch et collab. 2016). Sous cet éclairage, le chanteur semble plus proche de John Cage, de Marcel Duchamp ou de l’auteur « de marbre » de Madame Bovary (1857) que des critiques du réalisme et de la mécanisation de l’art. En fait, il résume très efficacement le double mouvement de la parole muette qui, au grand déplaisir de ces derniers, fige l’expression humaine pour mieux donner vie aux choses sans raison. Réaffirmant, par là, ce grand principe au fondement de la religion romantique de l’art : « Tais-toi donc esprit humain, et vous, esprits pieux, laissez-vous enchanter par la splendeur exubérante et sublime ! » (Wackenroder et Tieck 2009 [1797, 1799], 181). Donnant, du même coup, un sens nouveau et on ne peut plus littéral au « rock » qui, dorénavant, apparaît comme une extension contemporaine et pop de la « pétrification » littéraire entamée un siècle avant lui.
Parties annexes
Note biographique
Daniel Frappier est doctorant en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal. Sa thèse porte sur les jeux d’influences entre la peinture et la musique, du romantisme à aujourd’hui, pensés à travers la notion de « devenir-passif » de l’art proposée par Jacques Rancière : tendance, chez les créateurs des deux derniers siècles, à se dessaisir de leurs pouvoirs pour laisser parler la matière. À ce jour, ses travaux ont reçu les appuis du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et du Fonds de recherche du Québec. Son mémoire de maîtrise, dont les grandes lignes sont ici reprises, s’est mérité le Prix des professeurs du département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal.
Notes
-
[*]
Cet article est une version abrégée et légèrement repiquée de mon mémoire de maîtrise, réalisé sous l’aimable direction de Michèle Garneau du département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Une première ébauche a été présentée lors de la trente-neuvième assemblée de l’American Comparative Literature Association, tenue dans les locaux de l’Université Harvard en mars 2016. Pour une réflexion plus approfondie, voir Frappier 2016.
-
[1]
« It’s different, now. You can push a button and get rich quick. And I think also that there’s an argument to be made about the human races approach [sic] to the point where the technology gets to the point [sic] where it’s going to grip everybody by the shoulders and shake us and then throw us down and get rid of us ». Toutes les traductions sont les miennes, sauf mention contraire.
-
[2]
« WHOA! You know? Why don’t I just die now? »
-
[3]
Voir Bedriomo 1984, 37 et 74. C’est de cet auteur que je tiens les citations de Proust.
-
[4]
Un retournement brillamment décrit tout au long de l’ouvrage de Dahlhaus : « Ce qui paraissait auparavant comme un manque de la musique instrumentale, son absence de concept et d’objet propre, fut alors déclaré comme un avantage. On peut parler sans exagération d’un “changement de paradigme” dans l’esthétique musicale, d’un renversement des conceptions esthétiques fondamentales » (2006 [1978], 14). Pour une version plus courte, voir Dahlhaus 2015 [1967], 68-80.
-
[5]
L’emphase est dans le texte original.
-
[6]
Voir Le monde comme volonté et comme représentation (2004 [1819]), pour la métaphysique de Schopenhauer, ainsi que La vision dionysiaque du monde (2010 [1870]) et La naissance de la tragédie (2014 [1872]), pour l’interprétation de Nietzsche. Pour un compte rendu à la fois général et incroyablement nuancé de la conversion épistémologique qui s’opère au xixe siècle, consulter Gusdorf : « Le conflit entre Lumières et Romantisme exprime l’antagonisme de deux spiritualités dans le contexte d’une crise de civilisation, écrit le philosophe. Il ne s’agit pas de refuser la science, mais de l’empêcher d’occuper la totalité du domaine culturel ; la science galiléenne impose à la conscience un régime de fermeture qui la condamne à l’étouffement. L’imagination n’est pas la soeur inférieure de l’intelligence, comme le prétendent les esprits positifs ; elle revendique le rôle de ferment d’une connaissance nouvelle, non pas en deçà, mais au-delà de l’intellect » (1993 [1982-1983], 218-219). Ainsi : « Une seconde lecture de la réalité surcharge et dénie la lecture première de l’expérience scientifique et du positivisme au jour le jour. Sous les chaînes bien ordonnées des phénomènes, un autre ordre se laisse pressentir, comme une récurrence de l’ontologie oubliée » (Gusdorf 1993 [1982-1983], 194).
-
[7]
Excédé du sentimentalisme débridé des romantiques, qui empêche toute analyse objective, le théoricien défend une approche scientifique suivant laquelle la véritable valeur d’une composition est à chercher non pas dans ses contenus émotionnel ou discursif, mais dans ses qualités formelles. « On s’est habitué, écrit-il, à considérer le sentiment éveillé par une oeuvre musicale comme le sujet, l’idée, le contenu spirituel de cette oeuvre, et à ne voir dans les combinaisons sonores traitées artistiquement que la simple forme, l’image, le vêtement matériel d’un élément suprasensible. Mais c’est précisément la partie spécifiquement musicale qui constitue la création de l’artiste ; c’est en elle que l’esprit qui a créé et l’esprit qui contemple s’unissent ; c’est là, dans ces formes sonores et précises, que réside le contenu spirituel de la composition, et non dans la vague impression d’ensemble d’un sentiment abstrait. La forme, par opposition au sentiment, est le vrai contenu, le vrai fond de la musique, elle est la musique même : le sentiment provoqué en nous ne peut s’appeler ni fond ni forme, il n’est qu’un effet, qu’une résultante » (Hanslick 1986 [1854], 135). Les emphases sont dans le texte original.
-
[8]
Ce sont les mots du critique Mark Coleman, dans ce qui semble être la première revue de concert entièrement consacrée à Sonic Youth. Pour des propos similaires, au sujet d’artistes différents, voir Williams 1967, 45-46 et Salewicz 1979, 18. Mais la plus méritante — et parfois irritante, avec tous ses coups de gueule et sa mauvaise foi — des défenses du rock comme expérience physique provient de Carducci (2005 [1990]). Contrairement à ce que laissent penser la plupart des images véhiculées par les médias, par l’industrie du divertissement aussi bien que par la critique « sérieuse » et pétrie de sciences sociales, le rock n’est pas un mode de vie, une attitude ou un style vestimentaire. Pas plus qu’il n’est un son précis, que l’on peut se contenter de dupliquer ou d’acheter au commerce. La signification profonde du rock, insiste l’auteur, est dans l’effort palpable de quelques musiciens jammant de tout leur être : dans la tension contagieuse produite par l’interaction en temps réel d’un guitariste, d’un bassiste et d’un batteur cherchant la communion à travers une musique bruyante. Voir Carducci 2005 [1990], surtout 13-59.
-
[9]
Dans un article de 1955, le célèbre linguiste explore la « considerable tough-mindedness » caractéristique du blues — « a willingness, often absent in popular songs, to acknowledge the facts of life ».
-
[10]
« The very first thing that began to happen when rock came in on a mass cultural level was it started to say “we feel lonely and alienated and frightened” and music had never said that before. Blues always said it […]. But white people were told how happy, how romantic, how nice, how smooth the world was. And that didn’t reflect the truth. Then all of a sudden there was Elvis Presley singing about “Heartbreak Hotel” full of lonely people, and he said no matter how full it is, when you get there you’re lonely. […] So the first truth of rock, the first big communication, was to say things aren’t that good. […] Then along comes a second kind of song that begins to acknowledge the glories of lust and sex—and that’s another truth that nobody had been telling ». Voir Hamm 1995, 41-54. C’est de lui que je tiens les références à Hayakawa et à Reich.
-
[11]
Voir Chastagner 1995, 108-109 et 1998, 9.
-
[12]
Richard, qui dans ses premières performances de « Tutti-Frutti » (1955) chante « si ça n’entre pas, ne force pas — Tu peux l’huiler, mais vas-y mollo », se tourne vers les chants religieux à la fin des années 1950, avec deux disques de Pray Along (1960a ; 1960b) suivis de The King of the Gospel Singers (1961), avant de revenir au rock ’n’ roll et de trouver un compromis avec le « message spirituel » électrifié de Lifetime Friend (1986) (cité dans White 1990 [1984], 63, 214). En ce qui concerne Dylan, je pense à l’hymnique « Masters of War » (1963), écrite en réaction à la course aux armements nucléaires pendant la Guerre froide, et à l’intimiste « On a Night like This » (1974). Pour ce qui est des Doors, voir « The End » (1967) et « Touch Me » (1969).
-
[13]
« America’s first rock poet ».
-
[14]
Les pièces auxquelles je fais référence sont « Maybellene » (1955), « Brown Eyed Handsome Man » (1956a), « Roll Over Beethoven » (1956b) et « Johnny B. Goode » (1958).
-
[15]
En français dans la chanson.
-
[16]
Pour les paroles complètes en langue originale, voir : http://www.chuckberry.com/lyrics, consulté le 29 mars 2019.
-
[17]
« Rock is a totality: it contains, or implies that it can contain, all varieties of experience. […] The most “trivial, mediocre, banal, insipid” elements of art and life become interesting, and mysterious: a choice of one word over another, turns of phrase, lp covers (which are versions of TV commercials, billboards, of the coded social pictures to which we respond or from which we turn away), screams, silences, moments of inexplicable brilliance in a fog of stupidity, or vice versa ».
-
[18]
L’auteur cible Elvis et son « voodoo of frustration and defiance ».
-
[19]
Une « menace to life, limb, decency and morals », affirme le premier. Une « communicable disease », s’inquiète le second. Voir Stearn 1956b, pour la suite de l’article.
-
[20]
L’éditeur d’un mensuel musical voit dans le rock ’n’ roll un « throw-back to jungle rhythms » qui menace d’entraîner la jeunesse dans des « orgies of sex and violence (as its model did for the savages themselves) », tandis que le directeur de la très prestigieuse Eastman School of Music tourne en dérision cette nouvelle « acoustical pollution » avant de demander : « This is progress? »
-
[21]
« Yeah, that was the dance that everybody forgot. It was that the dance was so strong it took an entire civilization to forget it. And ten seconds on “The Ed Sullivan Show” to remember ». L’emphase est dans le texte original.
-
[22]
Des « Southern spiritualists » évoquent l’« unknown tongue ».
-
[23]
Certaines idées paraissent « so subarticulate (inarticulate?) that it would take a guided tour (or a supplemental voiceover cassette) to clarify, or even hint at, what I might conceivably have been trying to “express” in the first place. […] Then, likewise, there are passages, paragraphs so druggardly opaque, arcane, abstruse that no authorly assistance—I know my limits!—is at this stage even hypothetically feasible ».
-
[24]
« That is not to say that rock ’n’ roll is Voodoo. Of course it’s not. But it does preserve qualities of that African metaphysic intact so strongly that it unconsciously generates the same dances, acts as a major antidote to the mind-body split, and uses a derivative of Voodoo’s techniques of possession as a source, for performers and audiences alike, of tremendous personal energy ».
-
[25]
« In the ritual of the rock performance, the combination of the music’s hypnotic qualities and psychedelic drugs, leads performers and audiences on a “trip”, beyond the edge of the Old Consciousness into the inner psyche. Like the Shakers’ deliberative evocation of the Devil in order to purify their community and communion with God, the performer tries to unleash archaic qualities ». Il me faut mentionner, ici, que le texte à la base de Rock My Religion existe sous une déroutante variété de titres et de formats, pour la plupart recensés dans le catalogue de Brouwer et Anastas (2001). J’utilise ce qui semble être la première version imprimée qui, à en croire Anne Langlais, est elle-même la refonte d’un essai antérieur : la réécriture d’une conférence non-publiée de 1979, accompagnée de diapositives et d’extraits musicaux (Graham 1993, 279).
-
[26]
La régrédience, suivant le sociologue Michel Maffesoli, est un « retour aux formes archaïques que l’on avait crues dépassées » : « Elle renvoie à l’animalité et au primitif qui structure l’homme » (cité dans Mombelet 2005, 46).
-
[27]
« I think that language is almost obsolete anyway. […] The language barrier will be broken not by Esperanto, not by any new neo-intellectual language, but through rock ’n’ roll, through sound. Something as common denominator and dirt cheap as rock ’n’ roll ».
-
[28]
« Reverse Evolution » : devise ironique des ingénieurs fous de Devo, appliquée sur diverses marchandises du groupe dès le milieu des années 1970. « Rip It Up » est une chanson d’Orange Juice, parue sur l’album du même nom et rendue doublement célèbre avec la publication de l’ouvrage de Reynolds (2007 [2005]). Stop Making Sense (1984) est un film concert des Talking Heads, réalisé par Jonathan Demme et nommé en référence aux paroles de la chanson « Girlfriend Is Better » (1983).
-
[29]
Sur « Confusion Is Next » (1983). Pour les paroles complètes en langue originale, voir : http://www.sonicyouth.com/archives/lyrics/next.html, consulté le 29 mars 2019.
-
[30]
Un « cacophonous, confrontational subgenre of punk rock, Dadaist in style and nihilistic in attitude. It began around 1976, and within four years most of the original bands had broken up ».
-
[31]
« The term “noise rock” […] denotes a part of the post-punk scene rising from the ashes of punk in the late 70s. […] Post-punk […] tries to distance itself from the smoothness and cheerfulness of pop, though mostly without discarding its melodic qualities. One of the important ways to achieve this is by using noise. Noise rock is not a coherent style, but a loose term for quite different approaches to a noise aesthetic within a post-punk idiom ».
-
[32]
Voir Goldman 1968, 127-128 et Rouby 2003, 99.
-
[33]
Empruntant à Claude Lévi-Strauss, Rudy et Citton opposent le « bricoleur » des musiques noise et lo-fi à l’« ingénieur » de l’enregistrement professionnel (2014, 110). La démarche du premier est décrite comme une « réappropriation “sauvage” » des moyens de production et de la « crasse » sonore rejetée par le second : un acte de résistance contre l’aseptisation croissante de toutes choses matérielle et symbolique, contre l’aspiration générale à une perfection inhumaine, contre la consommation rapide et la fausse transparence du médium (Rudy et Citton 2014, 118). Voir, également, Citton (2007).
-
[34]
Il est à noter que le groupe se rebaptise Ciccone Youth, pour l’occasion. En hommage à la « material girl » : Madonna Louise Ciccone de son nom complet. Pour ce qui est du titre de l’album, il fait bien entendu référence au célèbre disque blanc des Beatles (1968). Voir Foege 1995 [1994], 126-127, 149.
-
[35]
Cette dernière pièce apparaît sur la bande originale du film Demonlover (2002), d’Olivier Assayas, aux côtés de sept autres titres composés pour l’occasion — ainsi que de quelques morceaux préexistants de Goldfrapp, Death in Vegas, Dub Squad et Soulfly.
-
[36]
« The newfound (and sometimes aggravating) appreciation of all things tacky [has] some of its roots in the way Sonic Youth had long championed trash TV and movies or particularly cheesy Top 40 oldies—the way they, like Quentin Tarantino, made junk seem respectable ». Pour la traduction de Hervé Landecker, de laquelle je m’écarte considérablement, voir Browne 2013 [2008], 570.
-
[37]
Les emphases sont dans le texte original.
-
[38]
À ce sujet, voir Cohen 2016, Mombelet 2005 et Fowles 2010 [2008].
-
[39]
« Rock’s noise has been necessary to break through the crust of self-consciousness accumulated over these last three thousand years. So that a place long asleep in us would wake ».
-
[40]
« I always thought—particularly because I was listening to Hardcore—that rock ’n’ roll comes very much out of using noise and the destructiveness of noise and sound, making it into something ecstatic, where you can get in touch with God ».
-
[41]
« To me, it’s more sort of a personal belief. […] It’s a way to communicate with myself or other people […], which to me is what religions always are, a total communication of awareness with others and yourself, physically and spiritually ».
-
[42]
« We tend to see music as exultational, or something like that; as cathartic. When it’s working well, whether it’s just the four of us in a room, or it’s in a room with a couple thousand people, on the right night when everything’s aligned correctly, you’re lifting off, there’s a certain transcendent quality to it that everyone’s involved with and there’s a symbiotic thing between the audience and the performers ». L’emphase est dans le texte original.
-
[43]
Une « Dionysian aesthetics » où « individuality is transgressed in favor of identification with the universal will—a frightening yet blissful experience ». Pour différents points de vue sur le dionysiaque dans le rock, voir Breene 1968 ; Palmer 1996, 147-155 et Padel 2000, 227-244.
-
[44]
Une « direct confrontation with the terrible foundation of being, an absurd will driving us all in our meaningless lives ».
-
[45]
Le « maelstrom of noise », écrit-t-il, « is at the same time an explosion of energy and an implosion of meaning, turning away from the distinct and semantic into the sublime and ecstatic ». L’emphase est dans le texte original.
-
[46]
La vieille technologie est comme « throwing an amp into the spirit of man ».
-
[47]
« When I was in elementary school, we had a field trip to the Rouge industrial complex. There was a machine that would just drop a piece of sheet metal: WHOOSH!! I wanted to make music, I thought it should sound like that ».
-
[48]
« Ron Asheton’s genius, on his guitar, was that he would plug it into the amp and turn it up and he listened to the guitar and the amplifier talk. He just let them talk! »
Bibliographie
- Artistes variés (2002). Bande originale du Film Demonlover, Paris, Labels.
- Balzac, Honoré de (1990) [1967]. Lettres à Madame Hanska, tome i, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », édition établie par Roger Pierrot.
- Bataille, Georges (2009) [1933]. La structure psychologique du fascisme, Paris, Nouvelles Éditions Lignes. Postface de Michel Surya.
- Bedriomo, Emile (1984). Proust, Wagner et la coïncidence des arts, Tübingen et Paris, Gunter Narr Verlag et Jean-Michel Place, coll. « Études littéraires françaises ».
- Berlioz, Hector (1990) [1839]. New Edition of the Complete Works, vol. 18, Cassel, Bâle, Londres, New York et Prague, Bärenreiter-Verlag. Edited by D. Kern Holoman.
- Berlioz, Hector (1996). Critique musicale, vol. 1, Paris, Éditions Buchet/Chastel. Édité sous la direction de H. Robert Cohen et Yves Gérard.
- Berlioz, Hector (2013) [1862]. À travers chants, Lyon, Symétrie. Préface d’Emmanuel Reibel.
- Berry, Chuck (1955). Maybellene, Chicago, Chess Recording Corp.
- Berry, Chuck (1956a). Brown Eyed Handsome Man, Chicago, Chess Recording Corp.
- Berry, Chuck (1956b). Roll Over Beethoven, Chicago, Chess Recording Corp.
- Berry, Chuck (1958). Johnny B. Goode, Chicago, Chess Recording Corp.
- Berry, Chuck (1964). St. Louis to Liverpool, Chicago, Chess Recording Corp.
- Breene, Walter (1968). « Apollo and Dionysus », Crawdaddy!, no 18, septembre, p. 11-15.
- Brouwer, Marianne et Rhea Anastas (éds.) (2001). Dan Graham, Paris, Paris-Musées. Traductions : Peter Ingham et collab.
- Browne, David (2008). Goodbye 20th Century, Boston, Da Capo Press.
- Browne, David (2013) [2008]. Sonic Youth, Rosières-en-Haye, Camion Blanc. Traduit de l’anglais (américain) par Hervé Landecker.
- Carducci, Joe (2005) [1990]. Rock and the Pop Narcotic, Centennial, Redoubt Press.
- Chastagner, Claude (1995). « Rock : le paradoxe », dans Marie-Claire Rouyer (dir.), Le corps dans tous ses états, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, p. 107-114.
- Chastagner, Claude (1998). La loi du rock, Castelnau-le-Lez, Éditions Climats.
- Ciccone Youth (1989). The Whitey Album, Londres et Culver City, Blast First et Enigma Records.
- Citton, Yves (2007). « Le percept noise comme registre du sensible », Multitudes, vol. 1, no 28, printemps, p. 137-146.
- Cohen, Jonathan D. (2016). « Rock as Religion », Intermountain West Journal of Religious Studies, vol. 7, no 1, automne, p. 46-86.
- Cohn, Nik (2013) [1969]. Awopbopaloobop Alopbamboom, Paris, Éditions Allia. Préface de Greil Marcus. Traduit de l’anglais par Julia Dorner.
- Courbet, Gustave (1986) [1861]. Peut-on enseigner l’art ?, Caen, L’Échoppe.
- D’Alembert, Jean Le Rond (2017) [1759, 1767]. Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle 2 ». Édition de Martine Groult.
- D’Aurevilly, Jules A. Barbey (2004) [1860-1865]. Oeuvre critique, tome i, Paris, Les Belles Lettres. Sous la direction de Catherine Mayaux, avec introduction générale de Pierre Glaudes et contributions de Joël Dupont et collab.
- Dahlhaus, Carl (2006) [1978]. L’idée de la musique absolue, Genève, Éditions Contrechamps. Traduit de l’allemand par Martin Kaltenecker.
- Dahlhaus, Carl (2015) [1967]. L’esthétique de la musique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « essais d’art et de philosophie ». Traduit et annoté sous la direction de Julien Labia par Julien Farges et collab. Introduction de Julien Labia, postface d’Antonia Soulez.
- Demme, Jonathan et Talking Heads (1984). Stop Making Sense, New York, Talking Heads Films Inc.
- Doors, The (1969). The Soft Parade, New York, Elektra Records.
- Doors, The (1967). The Doors, New York, Elektra Records.
- Dylan, Bob (1963). The Freewheelin’ Bob Dylan, New York, Columbia.
- Dylan, Bob (1974). Planet Waves, New York, Asylum Records.
- Foege, Alec (1995) [1994]. Chaos imminent, Nancy, Camion Blanc. Préface de Thurston Moore. Traduction : Sébastien Razier. Nancy : Camion blanc.
- Fowles, Ian W. (2010) [2008]. A Sound Salvation, Huntington Beach, Sonic Mystic.
- Frappier, Daniel (2016). « “Ici rien n’est silencieux” : reconfigurations de l’audible sous le régime esthétique des arts », mémoire de maîtrise, département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, Université de Montréal.
- Goldman, Albert (1968). « The Emergence of Rock », New American Review, no 3, avril, p. 118-139.
- Goldstein, Richard (éd.) (1969) [1968]. The Poetry of Rock, Toronto, Bantam Books.
- Gordon, Kim (2015). Girl in a Band, Marseille, Le Mot et le Reste. Traduction de Suzy Borello.
- Graham, Dan (1982). « My Religion », Museumjournaal, vol. 27, no 7, p. 324-329
- Graham, Dan (1983-1984). Rock My Religion, New York, Electronic Arts Intermix.
- Graham, Dan (1993). Rock My Religion, Villeurbanne et Dijon, Le Nouveau Musée et Les presses du réel, coll. « Écrits d’artistes ». Traduit de l’anglais par Patrick Joly, Sylvie Talabardon. Sous la direction de Xavier Douroux et Franck Gautherot avec le concours de Maryvonne Bégon. Introductions des textes par Anne Langlais.
- Gusdorf, Georges (1993) [1982-1983]. Le romantisme, tome I, Paris, Éditions Payot et Rivages, coll. « Grande bibliothèque Payot ».
- Hamm, Charles (1995). Putting Popular Music in Its Place, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Le Cap, Singapour et São Paulo, Cambridge University Press.
- Hanslick, Eduard (1986) [1854]. Du beau dans la musique, Paris, Christian Bourgeois Éditeur, coll. « Musique/passé/présent ». Traduction de l’allemand par Charles Bannelier revue et complétée par Georges Pucher, précédé d’une introduction par Jean-Jacques Nattiez.
- Hanson, Howard (1962). « The Challenge of the Modern Role of Arts », American String Teacher, vol. 12, no 4, automne, p. 1-2.
- Hayakawa, Samuel I. (1955). « Popular Songs vs. the Facts of Life », ETC., vol. 12, no 2, hiver, p. 83-95.
- Hellman, Danny (2015) [1992]. [Sans titre], Danny Hellman Illustration, 18 septembre, Accessible en ligne : http://dannyhellman.tumblr.com/post/129392248582/im-pretty-sure-this-sonic-youth-illo-was-for, consulté en janvier 2019.
- Hilde Neset, Anne (2009). « All Shook Up », The Wire, no 304, juin, p. 30-33.
- Hugo, Victor (1985) [1827]. Préface de Cromwell, Paris, Larousse, coll. « Petits classiques ». Édition présentée, annotée et commentée par Évelyne Amon.
- Jarmusch, Jim (2016). Gimme Danger, New York et Santa Monica, Low Mind Films Inc. et New Element Media.
- Jarmusch, Jim et collab. (2016). « Conférence de presse/Press Conference », Gimme Danger - Festival de Cannes, entrevue réalisée le 19 mai 2016, https://www.festival-cannes.com/fr/films/gimme-danger, consulté le 29 mars 2019.
- Keppler, Joseph (1877). « Wagner’s Method Exposed », Puck, vol. 1, no 1, 14 mars, p. 16.
- Kingsmen, the (1963). The Kingsmen in Person, New York, Wand Records.
- Meltzer, Richard (1987) [1970]. The Aesthetics of Rock, Boston, Da Capo Press. New Foreword by Richard Meltzer. New introduction by Greil Marcus.
- Mombelet, Alexis (dir.) (2005). Sociétés, vol. 2, no 88, avril et juin.
- Nietzsche, Friedrich W. (2014) [1872]. La naissance de la tragédie, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio essais ». Texte, fragments et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari. Traduit de l’allemand par Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy.
- Nietzsche, Friedrich W. (2010) [1870]. La vision dionysiaque du monde, Paris, Éditions Allia. Traduit de l’allemand et présenté par Lionel Duvoy.
- Orange juice (1982). Rip It Up, Londres, Polydor Ltd.
- Padel, Ruth (2000). I’m a Man, Londres, Faber and Faber.
- Palmer, Robert (1996). Dancing in the Streets, Londres, BBC Books.
- Proust, Marcel (1978) [1921-1922]. À la recherche du temps perdu, tome ii, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ». Édition établie et présentée par Pierre Clarac et André Ferré.
- Proust, Marcel (1978) [1954]. Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ». Édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre.
- Rancière, Jacques (1998) [1996]. « Existe-t-il une esthétique deleuzienne ? », dans Éric Alliez (dir.), Gilles Deleuze, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », p. 525-536.
- Rancière, Jacques (1998). La parole muette, Paris, Hachette.
- Rancière, Jacques (2001). L’inconscient esthétique, Paris, Éditions Galilée, coll. « La philosophie en effet ».
- Rancière, Jacques (2007). Politique de la littérature, Paris, Éditions Galilée, coll. « La philosophie en effet ».
- Rancière, Jacques (2009). Et tant pis pour les gens fatigués, Paris, Éditions Amsterdam.
- Rancière, Jacques (2014). Le fil perdu, Paris, La Fabrique éditions.
- Reynolds, Simon (2007) [2005]. Rip It Up and Start Again, Paris, Éditions Allia. Traduit de l’anglais par Aude de Hesdin et Etienne Menu.
- Richard, Little (1955). Tutti-Frutti, Hollywood, Specialty Records, Inc.
- Richard, Little (1960a). I’ll Never Walk Alone, New York, Goldisc Records Inc.
- Richard, Little (1960b). I Believe, New York, Goldisc Records Inc.
- Richard, Little (1961). The King of the Gospel Singers, Chicago, Mercury Records. Accompanied by The Quincy Jones Orchestra with The Howard Roberts Chorale.
- Richard, Little (1986). Lifetime Friend, Burbank et New York, WEA Records Ltd.
- Rinzler, Alan (1971). « A Conversation with Charles Reich – Blowing in the Wind », Rolling Stone, no 75, 4 février, p. 31-34.
- Robertson, Sandy (1978). « Behind the Wall of Sleep », Sounds, 25 mars, p. 16-18.
- Ross, Alex (2015) [2010]. Listen to This, Arles, Actes Sud. Traduit de l’américain par Laurent Slaars.
- Rouby, Bertrand (2003). « Le Rock à l’épreuve du canon », Études britanniques contemporaines, no 24, juin, p. 97-109.
- Rudy, Dario et Yves Citton (2014). « Le lo-fi : épaissir la médiation pour intensifier la relation », dans Estelle Deléage et Guillaume Sabin (dir.), Écologie et Politique, vol. 1, no 48, p. 109-124.
- Salewicz, Chris (1977). « Oy Lemmy, Is It True You Were a Hippie?? », New Musical Express, 25 août, p. 18-21.
- Sangild, Torben (2002) [1996-1997]. The Aesthetics of Noise, Datanom.
- Schopenhauer, Arthur (2004) [1819]. Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige ». Traduit en français par A. Burdeau. Édition revue et corrigée par Richard Roos.
- Shannon, William J. (1956). « The Presley Plague », The Catholic Sun, 25 octobre, p. 1.
- Sisario, Ben (2008). « A Brief, Noisy Moment that Still Reverberates », The New York Times, 12 juin, p. E1, E8.
- Sonic Youth (1982). Sonic Youth, New York, Neutral.
- Sonic Youth (1983). Confusion Is Sex, New York, Neutral.
- Sonic Youth (1988). Daydream Nation, Londres et Culver City, Blast First et Enigma Records.
- Sonic Youth (1990). Goo, Los Angeles, The David Geffen Company.
- Sonic Youth (2000). NYC Ghosts and Flowers, Santa Monica, Geffen Records.
- Sonic Youth (2009). The Eternal, New York, Matador Records.
- Stearn, Jess (1956a). « Rock ’n’ Roll Runs into Trouble—Disgusted Adults Battling Music of Delinquents », Daily News, 11 avril, p. 34.
- Stearn, Jess (1956b). « Rock ’n’ Roll Runs into Trouble—More Youngsters Ignore That Primitive Beat », Daily News, 12 avril, p. 42.
- Stearns, Matthew (2007). Daydream Nation, New York, Continuum, coll. « 33 ».
- Stevens, Ruth W. (1958). « Editorially Speaking… », Music Journal, 1er février, p. 3.
- Sweezy, Stuart (1986). « Sonic Youth – The Sound and the Fury », Option, no G2, mars et avril, p. 29-31.
- Talking Heads (1983). Speaking in Tongues, New York, Sire Records Company.
- « That’s All Right » (1963). Time, 10 mai, p. 52.
- Thelwell, Norman (1957). [Sans titre], Punch, vol. ccxxxiii, no 6100, 24 juillet, p. 92.
- Truong, Nicolas (2007). « Il n’y a jamais eu besoin d’expliquer à un travailler ce qu’est l’exploitation », Philosophie Magazine, no 101, juin, p. 54-59.
- Ventura, Michael (1986) [1985]. Shadow Dancing in the USA, Los Angeles, Jeremy P. Tarcher, Inc.
- Wackenroder, Wilhelm H. et Ludwig Tieck (2009) [1797, 1799]. Épanchements d’un moine ami des arts suivi de Fantaisies sur l’art, Paris, Librairie José Corti, coll. « Domaine romantique ». Traduction de l’allemand, introduction et notes par Charles Le Blanc et Olivier Schefer.
- Whalley, Ben (dir.) (2008). Motor City’s Burning, Londres, BBC.
- White, Charles (1990) [1984]. La rockambolesque histoire de Little Richard, Levallois-Perret et Paris, Comité de Liaison des Amateurs de Rhythm ’n’ Blues et Editions No 1. Traduit de l’anglais par Pierre Daguerre.
- Williams, Paul (1967). « Rock Is Rock—A Discussion of a Doors Song », Crawdaddy!, no 9, mai, p. 42-46.
Liste des figures
Illustration 1
Illustration 2
Illustration 3