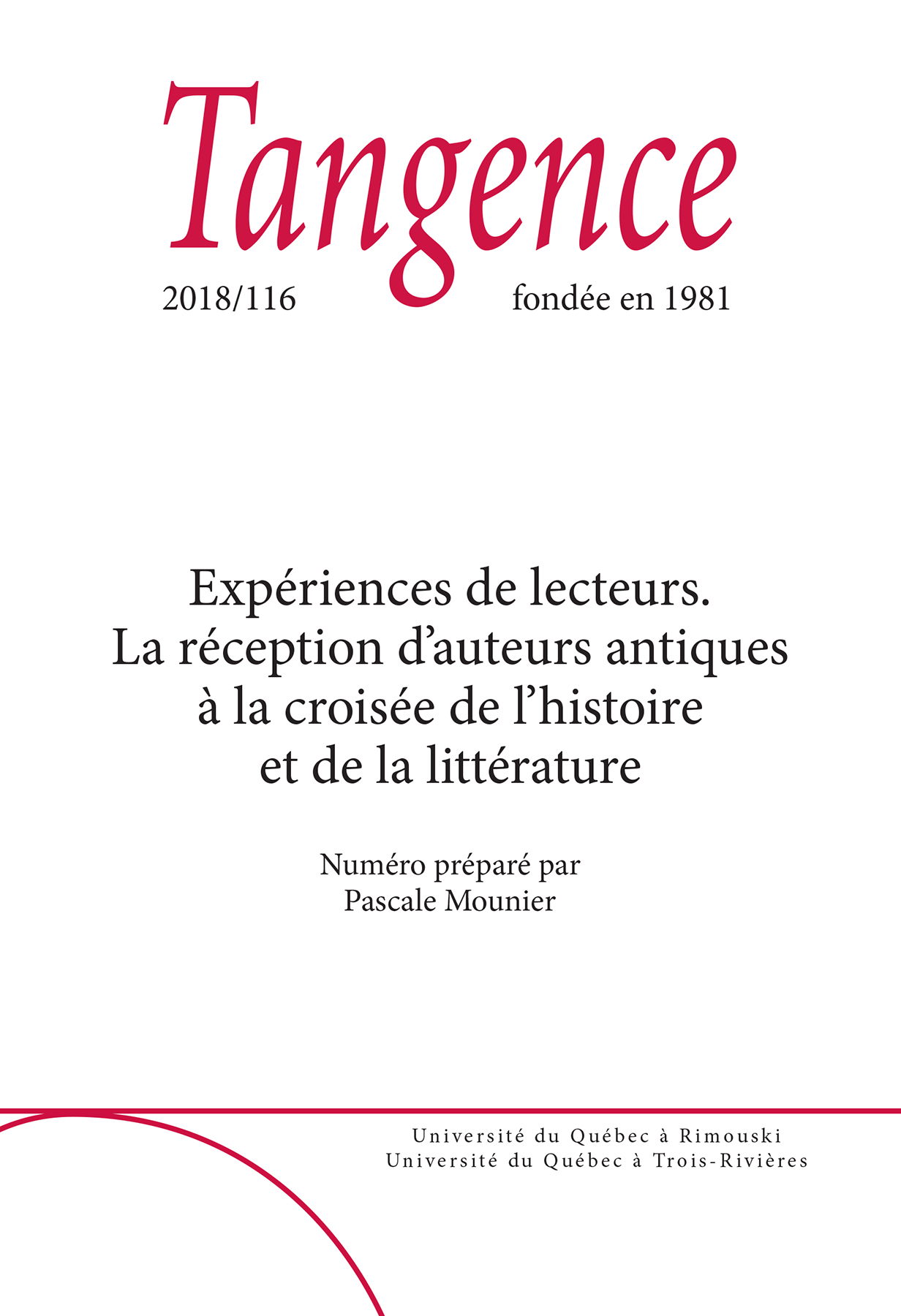Résumés
Résumé
Judas est le traître par excellence. Protagoniste de nombreuses créations littéraires du xxe siècle, ce personnage est utilisé le plus souvent pour explorer les enjeux de la trahison, comme le montre même le dernier roman d’Amos Oz, Judas, où paradoxalement l’apôtre est innocenté. L’historien qui s’attache à l’étude d’un personnage de la mythologie chrétienne doit prendre un tout autre chemin, comme le fait Giacomo Todeschini dans Come Giuda. Ce travail explore la genèse du personnage depuis les premières exégèses patristiques jusqu’au xve siècle, où il devient le miroir identificatoire du menu peuple, catégorie à marginaliser car considérée comme dangereusement incapable de comprendre les règles des échanges matériels. Dans la culture chrétienne, Judas apparaît en effet d’abord comme l’homme qui, incapable de reconnaître la valeur infinie de Jésus, le vend pour une somme dérisoire. Cette interprétation du personnage nous est devenue étrangère, de même que la logique de l’économie charismatique qui l’a produite et représente le référent « réel » des constructions fictives successives du Judas médiéval. Si le théologien et l’artiste cherchent à imaginer « qui était Judas », nous montrons que l’historien s’interroge plutôt sur ce que, à une certaine époque, l’on a pu nommer à travers l’invention de Judas.
Abstract
Judas is the archetypal traitor. The protagonist of numerous twentieth-century literary creations, his character is most often used to explore the issue of treason, as seen most recently in Judas, Amos Oz’s latest novel, where, paradoxically, the apostle is presumed innocent. A historian examining this character from the perspective of Christian mythology, however, must offer quite a different interpretation, as does Giacomo Todeschini in Come Giuda. This article analyzes the origins of the Judas character from the first patristic exegesis until the 15th century, when he becomes the identifying mirror of the common people, a category created to marginalize a group viewed as dangerously incapable of understanding the rules of material exchange. In Christian culture, Judas is, first and foremost, the man who betrayed Jesus for a pittance because he was unable to recognize the Saviour’s infinite value. This interpretation of the character of Judas is alien to us; also alien is the logic of the charismatic economy that produced it and represents the “real” point of reference for successive fictional constructions of the medieval Judas. Whereas theologians and artists try to imagine “who Judas was”, we argue that historians focus, rather, on what the invention of Judas may have signified at a given period of time.
Corps de l’article
Judas, entre histoire et fictions
Évoquer Judas dans une conversation suscite aujourd’hui une curiosité étrange mêlée d’un certain intérêt pour cette figure qui demeure, au fond, énigmatique. Notre connaissance lacunaire des récits de l’Évangile ne nous empêche pas d’avoir une image très précise de celui qui incarne la figure du traître par excellence. Symbole antisémite des « Juifs[1] », Judas maintient une présence forte dans notre imaginaire, ravivée par les nombreuses expressions qui, dans les langues des cultures chrétiennes, évoquent son nom. En français, un « judas » c’est un traître ou le nom d’une petite ouverture pratiquée dans une porte pour voir sans être vu. L’on pourrait multiplier les exemples de cette transformation en nom commun de ce prénom, que personne n’utiliserait pour désigner par exemple un enfant[2].
Ce personnage, dont il ne subsiste aucune trace de l’existence réelle[3], est le produit d’une construction textuelle complexe, élaborée par les théologiens, canonistes, juristes et hagiographes chrétiens, dont nous ne retenons qu’une seule dimension symbolique liée à la trahison. Pour nous, Judas évoque la transgression du lien de fraternité réunissant une communauté et l’atteinte à son principe d’unité. C’est en tant que traître qu’il est exploité dans de nombreuses fictions littéraires du xxe siècle, parmi lesquelles on peut citer l’exemple révélateur et paradoxal du dernier roman de l’écrivain israélien Amos Oz, Judas[4]. À Jérusalem, en 1959, Shmuel Ash, après avoir abandonné la rédaction de sa thèse sur Jésus, vue dans une perspective juive, est embauché par un vieil érudit, M. Wald, qui vit avec sa belle-fille, Atalia. Entre ces personnages se noue un dialogue sur l’histoire de la création de l’État d’Israël et du mouvement sioniste dont le père d’Atalia, Abravanel, était membre. Ce dernier avait quitté le mouvement en raison de son désaccord avec Ben Gourion prônant la création d’un État juif. Le lecteur peut ainsi suivre les débats sur les choix opposés de Ben Gourion et Abravanel. Qui des deux avait trahi la cause sioniste ? Était-ce trahir que d’avoir su modifier ses convictions après avoir pris conscience de la présence des Palestiniens dans le territoire du futur État israélien ? Ces questionnements font surgir dans la narration les problématiques de la thèse de Shmuel, en particulier celle qui concerne l’enquête sur la signification de la trahison de Judas. En s’appuyant sur divers textes exégétiques juifs, Oz parvient à innocenter Judas, qu’il décrit comme le plus fidèle des apôtres de Jésus, l’ayant livré aux prêtres du Temple parce qu’il le croyait vraiment le fils de Dieu, venu réformer les institutions religieuses[5]. Dans le contexte du débat sur les choix des dirigeants sionistes, le lecteur est mis en position de juge qui peut être convaincu par ce blanchissement de Judas, de même qu’il peut considérer les choix de Ben Gourion ou d’Abravanel comme une trahison de l’esprit sioniste. Le roman laisse en effet la question ouverte. Cependant, en innocentant Judas, l’objet de la fiction qui adopte son prénom comme titre, demeurent la trahison et le jugement moral sur celle-ci : la faute est transposée soit sur Ben Gourion soit sur Abravanel, en fonction de l’interprétation du lecteur. Ainsi le personnage-titre Judas définit-il le cadre du pacte fictionnel sur la base de l’image stéréotypée de l’apôtre traître, qui est maintenue et exploitée pour représenter les enjeux d’une réalité historique contemporaine.
Dans une perspective historiographique, la réception d’un personnage tel que Judas présuppose un cadre épistémologique fort différent. L’historien ne construit pas son récit en exploitant le contenu stéréotypé du personnage mais en le déconstruisant, c’est-à-dire en analysant la stratification des discours et récits qui ont permis de formaliser le personnage en tant que construction fictionnelle, révélatrice d’une représentation normalisée du « réel ». L’analyse contextualisée des récits et des lexiques qui ont produit le personnage permet d’identifier le soubassement non-narratif du symbole, c’est-à-dire le contenu référentiel externe, l’ensemble des pratiques et des transformations historiques qui ont accompagné sa structuration et en fonction desquelles ce personnage a acquis une valeur heuristique spécifique et historiquement déterminée[6].
À cet égard, l’étude de l’historien médiéviste Giacomo Todeschini, Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna[7], est un exemple très précieux et innovant du point de vue de la méthodologie historiographique ainsi que de ses contenus. Partant des sources théologiques, hagiographiques, juridiques, historiographiques, littéraires et iconographiques, Todeschini reconstruit la genèse du personnage de Judas qui a fait de lui une figure symbolique contenant une représentation normative du fonctionnement sociopolitique des échanges économiques. Cette fonction du personnage se définit à partir du travail exégétique de la patristique, qui la première a commencé à réélaborer l’image du Judas de l’Évangile en réfléchissant sur les caractéristiques ontologiques de l’homme qui vendit Jésus aux prêtres du Temple pour la somme dérisoire de trente deniers. Ce détail, auquel nous ne prêtons plus d’attention, est devenu l’axe central de l’élaboration de l’identité ou du « caractère » de Judas, c’est-à-dire de sa construction fictionnelle à la fois en tant que personne et personnage à l’époque prémoderne[8]. Les exégètes médiévaux ont en effet cherché à définir « qui était Judas » à partir de la recherche du sens de sa transaction criminelle l’ayant conduit à échanger la valeur incommensurable de Jésus pour une somme dérisoire. Cette démarche visant la reconstruction de l’identité de Judas est analogue à celle des artistes, quels qu’ils soient, qui (ré) inventent l’identité d’un personnage en l’intégrant dans un récit fictif sous forme textuelle ou en images.
En laissant aux créateurs de fictions et aux théologiens l’interrogation sur « qui était Judas », l’historien cherche à comprendre « de quoi Judas est le nom », quelle construction du « réel » ce personnage rend visible et organise. Ainsi, partant de la reconstitution de la longue chaîne textuelle ayant produit cette fiction de Judas en tant qu’incarnation de comportements économiques aberrants, Todeschini met en évidence la valeur heuristique du personnage en tant que forme qu’illustre l’évolution des conceptions et des normes des échanges jusqu’au xvie siècle. Avec la transformation du cadre épistémique de rationalisation de la sphère économique, lié à la sortie de l’ordre hétéronome médiéval[9], la logique prémoderne des échanges nous est devenue étrangère. En effet, la figure de Judas semble avoir perdu toute pertinence dans la description des faits économiques pour ne plus signifier que la dépravation morale de la trahison[10]. La transformation du cadre épistémique qui structure la représentation moderne de l’ordre économique, liée au réagencement du politique et du religieux et à la crise de l’ordre hétéronome médiéval, a modifié le sens du personnage.
Comme le souligne Todeschini dans l’ensemble de son oeuvre, il faut bien distinguer nos formes de conceptualisation de la sphère des échanges — ce que nous appelons le « marché » — de celles de la période prémoderne. Même si nous employons encore les lexiques économiques élaborés durant le Moyen Âge, leur signification s’est modifiée. D’où l’attention du spécialiste d’histoire économique à la redéfinition du sens des mots décrivant les échanges matériels ainsi que l’ordre politique[11].
Nous pouvons rappeler ici quelques aspects de cette réflexion pour mieux saisir les enjeux du personnage de Judas. Dans le cadre d’une société structurée en fonction du principe hétéronome, le politique est subordonné au religieux et détermine l’organisation hiérarchisée de la société orientée vers le Salut. Toute activité, y compris les échanges, est perçue et évaluée en fonction de sa possibilité de contribuer au maintien de l’ordre social qui garantit à l’humanité le chemin vers le Salut. Différemment « enchâssée », selon le mot de Karl Polany[12], par rapport au politique de notre modernité, l’économie médiévale n’est pas conçue comme un domaine défini en termes abstraits, à l’instar de notre notion de marché, régi par des lois « scientifiques », auquel tout sujet peut participer au nom du principe égalitaire. Todeschini emploie la définition de « marché initiatique » ou d’« économie charismatique » pour désigner la vision médiévale des échanges, s’effectuant sur « les marchés » — les lieux concrets des transactions — dont les normes et les valeurs sont décidées par les autorités de la comunitas christiana ayant les « qualités » aptes à guider vers le Salut. Il en résulte que la possibilité d’agir légitimement dans la sphère des échanges, indifférenciée de la sphère politique et religieuse, est une prérogative réservée au sommet de la hiérarchie sociale, c’est-à-dire aux autorités charismatiques qui garantissent l’ordre social. Ce cadre évolue tout au long de la période médiévale, conformément à la redéfinition interne des institutions ecclésiastiques à partir du moment où elles entrent dans la confrontation, dès le ixe siècle, avec les autorités politiques émergentes — les pouvoirs impériaux et territoriaux — et puis, à partir du xiiie siècle, avec les nouvelles oligarchies marchandes nées de l’intensification et de l’internationalisation des commerces.
Todeschini réfute l’idée selon laquelle la pensée économique serait née à l’époque moderne, au moment où, en s’affranchissant des interdits de l’Église et de sa vision morale négative de l’enrichissement, la bourgeoisie aurait « découvert » le marché. Comme Todeschini l’a démontré dans une grande partie de son oeuvre, dès les premières phases d’institutionnalisation du christianisme, on retrouve au coeur de la culture ecclésiastique une réflexion complexe sur la production et la circulation de la richesse[13].
Pour comprendre la vision médiévale de l’économie, il est ainsi nécessaire de suspendre la validité de nos conceptions abstraites et « scientifiques » du monde des échanges et de reconstituer à l’intérieur du cadre épistémique médiéval le sens des mots et des lexiques qui décrivent le fonctionnement des marchés. C’est ce que fait Todeschini dans l’ensemble de son oeuvre, partant d’une conception spécifique du marché, indispensable pour relativiser et historiciser notre vision de l’économie. Le marché doit, à ses yeux, être vu
comme un métalangage ou une méta-institution : c’est-à-dire comme un ensemble qui se réfère constamment à d’autres discours et à d’autres réalités. […] Les langages qui qualifient [le système des échanges] et qui le font fonctionner, peuvent aussi être interprétés comme un code qui renvoie au contexte des relations sociales, affectives, religieuses, culturelles au sein desquelles se situe le système d’échange.
CG, p. 12
On l’aura compris, Judas est l’un de ces codes.
Traître pour trente deniers
Dans l’Évangile, le personnage de Judas apparaît essentiellement dans le cadre de la Passion du Christ. Malgré l’importance de son action, il est décrit de manière assez fragmentaire, voire contradictoire. Matthieu, Luc et Marc citent Judas uniquement au moment où il négocie avec les prêtres du Temple sa récompense et au moment où il livre Jésus. Tandis que Marc et Luc ne parlent pas de la mort de Judas, Matthieu cite son suicide par pendaison en se différenciant ainsi du récit des Actes des Apôtres, où il est dit que Judas, après avoir acheté un champ avec le salaire du crime, est tombé, a vu son corps coupé par le milieu et ses entrailles répandues[14]. C’est dans l’Évangile de Jean que l’on en apprend plus sur Judas, décrit comme l’administrateur des apôtres et ne figurant plus seulement dans le cadre de la Passion mais aussi dans l’épisode où Marie-Madeleine parfume la tête de Jésus avec une huile très précieuse et coûteuse. Signe de la reconnaissance de la valeur incommensurable de Jésus, ce geste de la riche patricienne provoque la rage de Judas, qui considère cet acte comme un gaspillage inutile. L’apôtre est nommément désigné par Jean. Tandis que Marc et Matthieu n’indiquent pas lequel des apôtres critique le geste de Marie-Madeleine, Luc attribue la réaction de désapprobation à un autre personnage, le pharisien Simon.
À l’exception des textes de Jean, où l’on trouve une description assez approfondie de Judas, dans l’Évangile, cette figure demeure un « non-personnage », comme le remarque Todeschini. Les intentionnalités le poussant à la trahison ne sont pas vraiment explicitées et son « caractère » est à peine esquissé. Dans le texte sacré, Judas apparaît comme le support d’une action fondamentale dont le récit explicite essentiellement les conséquences, laissant la construction du caractère du personnage à l’interprétation du lecteur[15]. Or précisément, le personnage de Judas va naître avec la réception du texte sacré, à partir des premières élaborations des Pères de l’Église et dans une longue chaîne de réélaborations intertextuelles, que Todeschini reconstruit et qu’avec lui nous allons passer en revue.
Jean Chrysostome, puis surtout Ambroise et Augustin, commencent le travail de caractérisation de Judas. Partant du récit de Jean, ils décrivent Judas comme une « personne », un être humain sans esprit, à l’instar des animaux, rustre et bête qui, ne comprenant pas l’incommensurable valeur de Jésus, livre ce dernier pour une somme dérisoire. À l’instar de Simon le Magicien, voulant acheter les pouvoirs charismatiques de Pierre, c’est-à-dire le pouvoir de faire des miracles, Judas ne comprendrait pas les règles d’échange des biens matériels et des biens sacrés. Ne sachant pas reconnaître la Vérité, étranger à toute forme de spiritualité, Judas est ici à la fois bête et infidèle ainsi qu’entièrement tourné vers une matérialité qui explique son avidité, son avarice, ses instincts bestiaux l’amenant à réaliser son marché criminel — et par ailleurs infructueux — avec les prêtres du Temple. Dans les commentaires d’Augustin[16], sans cesse repris par la tradition, on trouve une synthèse des caractérisations de Judas : fur, raptor, avarus, perfidus, dispensator oeconomus, mercator pessimus. Voleur, homme perfide et avare, mauvais commerçant, Judas est un administrateur malhonnête. Ce n’est pas tant l’intervention du diable qui l’aurait amené à la trahison que sa nature avare et perfide, illustrée par sa mauvaise gestion des biens des apôtres, bien avant la transaction avec les prêtres juifs. Ces derniers sont d’ailleurs comparés à Judas par Augustin, qui définit ainsi une association qui deviendra un lieu commun de l’antisémitisme moderne[17]. Marqués par l’infidelitas, la carnalitas et par l’odium qui caractérisent Judas, les « Juifs » n’accèdent pas à la « Vérité » et à la dimension spirituelle de l’existence. Bêtes et agressifs, attachés à la matérialité, infidèles, ils ne seraient pas dignes de confiance, qualité fondamentale dans le domaine des échanges, selon un principe qui va progressivement subordonner l’aptitude à agir correctement dans la sphère des échanges à l’appartenance à la comunitas christiana. Dans le domaine des échanges, la fiabilité est liée à la foi : les infidèles, ne l’ayant pas, ne seraient pas fiables et devraient être exclus des marchés. En reprenant les commentaires de l’Évangile de Jean rédigés par Ambroise, Augustin propose Marie-Madeleine comme exemple positif de la rationalité des échanges basée sur la foi. La riche patricienne se convertissant à Jésus est prête à donner son bien le plus cher, l’huile précieuse, prouvant ainsi sa foi. Tout au contraire, Judas incarne l’incompétence économique due à l’absence de foi. Faux apôtre, Judas serait en effet un infiltré dans la communauté sainte : il suivrait Jésus « avec son corps mais pas avec son esprit » et dissimulerait son infidelitas pour commettre son crime. D’où la nécessité pour les croyants de se méfier de tous ceux qui ne prouvent pas leur vraie foi, qu’il s’agisse d’infidèles ou hérétiques déclarés ou bien de faux chrétiens. Tout en construisant Judas en tant que « personne », en tant qu’individu criminel d’exception, Augustin pose les conditions pour exploiter cette figure comme modèle permettant d’identifier diverses catégories de sujets — les mauvais administrateurs et « tous ceux qui volent les biens de l’ecclesia[18] ».
Voleur de biens sacrés, avant de devenir traître, le Judas de la tradition patristique apparaît comme une « archive » (CG, p. 87) de caractéristiques individuelles négatives permettant de représenter diverses formes de la criminalité contre les institutions sacrées. Il n’est plus seulement un personnage historique d’exception : il est devenu le « code sémantique[19] » pour déchiffrer l’agir économique.
En arrivant au ixe siècle, on entre dans la phase complexe de confrontation entre les institutions ecclésiastiques, dont la réorganisation interne s’est stabilisée avec la réforme grégorienne (xie siècle), et les pouvoirs impériaux et les autorités territoriales émergeants, cherchant eux-mêmes à se légitimer en tant que pouvoirs charismatiques. Toute la sphère de l’autorité, qu’elle soit religieuse ou politique, se définit à travers le langage et les catégories de la sacralité. D’où la complexité de concepts tels que « bien sacré », « bien public », « bien commun », « ecclesia », dont le sens originel se modifie progressivement dans leur usage à l’intérieur de textes visant soit à revendiquer les prérogatives des institutions ecclésiastiques, soit à définir l’autorité de l’État, cherchant à spécifier et différencier leurs identités.
C’est dans le cadre de cette révolution lexicale que la figure de Judas commence à être utilisée à plein titre comme personnage ou forme identificatoire collective. Dans l’ouvrage De corpore et sanguine domini de Paschase Radbert (790-865), où est élaborée la théorie de la présence réelle dans l’eucharistie qui devient le critère fondamental d’appartenance à l’ecclesia, Judas devient le modèle de tous les faux fidèles qui s’approchent de l’autel de manière sacrilège. Mauvais administrateur, Judas est aussi l’alter ego de tous ceux qui cherchent à s’approprier indûment la gestion ou la propriété des biens ecclésiastiques, comme le souligne l’évêque Agobard de Lyon (769-840) dans des écrits visant à protéger l’autonomie des institutions ecclésiastiques de toute ingérence des empereurs.
Entre le xe et le xiie siècle, dans des textes conçus dans le cadre de la querelle des Investitures opposant le Saint-Empire romain germanique à la papauté au sujet des nominations des évêques (1075-1112) ainsi que dans celui de la lutte contre les simoniaques, coupables de faire commerce des charges ecclésiastiques, la figure de Judas se précise ultérieurement en tant que modèle de tous ceux qui s’emparent des biens sacrés et publics pour en faire un usage « privé », c’est-à-dire pour leur enrichissement personnel ou familial aux dépens du bien commun. La figure de Judas sert ainsi à faire fonctionner dans les discours des notions qui sont en cours de définition, comme l’assimilation des biens sacrés aux biens publics ainsi que les modalités d’usage de ces biens. Ces usages de l’apôtre perfide, représentant toute personne s’appropriant des biens sacrés, remarque Todeschini, produisent une « dilatation sémantique » de la figure de Judas : progressivement le personnage ne désigne plus seulement le moine ou l’évêque avide de biens sacrés ; il est utilisé pour stigmatiser d’autres membres du corps politique, ce qui explique un changement du genre des narrations qui en diffusent l’image.
Dès le xie siècle, Judas peut sortir des écrits doctes et être diffusé à travers des légendes telles que la Légende de Judas (xie siècle), la Navigation de Saint Brendan (xiie siècle) et la Légende dorée de Jacques de Voragine (xiiie siècle)[20]. Loin des descriptions elliptiques des Évangiles, ces textes donnent à Judas une histoire personnelle et lui font même prendre la parole. On lui attribue une origine familiale à l’image de celle d’Oedipe ; on le montre fils incestueux et père de famille, prêt à voler et à tromper ceux pour qui il travaille pour enrichir sa famille. Dans ces légendes, la figure de Judas sert à mettre en garde un public bien plus vaste que celui des lecteurs de traités de théologie contre les mauvais usages de biens, c’est-à-dire leur usage privé. Souvent Judas apparaît comme le serviteur d’un seigneur, ce qui indique que l’on commence à l’utiliser comme miroir de toute une vaste humanité qui travaille au service d’autrui, en position de dépendance et d’infériorité ontologique, privée de liberté et donc de responsabilité, qui est la prérogative ou la qualité de celui qui exerce l’autorité. Cette forme de dévalorisation du travail dépendant, conforme à la logique hiérarchique de la société médiévale, permet de considérer les serviteurs comme indignes de confiance, donc à priori comme susceptibles de commettre des crimes analogues à ceux de Judas.
Durant la période de diffusion de ces légendes sur Judas, dans les traités théologiques, les sermons ou les textes juridiques, le faux apôtre est systématiquement associé aux simples voleurs, dont le crime, considéré comme une atteinte au bien commun, est sanctionné par la pendaison, comme l’a subie Judas. Ce personnage, diffusé dans des récits destinés à des publics de plus en plus vastes, dont il devient le miroir, semble servir de moyen de redéfinition des formes de contrôle de l’autorité religieuse sur les pouvoirs citadins et territoriaux en cours de renforcement.
Au début du xiiie siècle, dans le sermon du célèbre prédicateur dominicain Giordano de Pise, c’est à Judas que sont comparés les chefs des familles florentines et pisanes accusés de ne songer qu’à leur enrichissement privé : « [A]ujourd’hui n’importe quel homme est pire que Judas. Car Judas vendit [Jésus] pour trente deniers mais vous le vendez tous les jours pour beaucoup moins[21] ». Ayant trahi le Christ, Judas est désormais le traître du bien commun : il représente tous ceux qui, incapables de distinguer entre la vraie valeur et les valeurs de l’ici-bas, ne songent qu’à leur profit immédiat et privé, contribuant ainsi à la destruction du bien commun. Le sens de l’avarice de Judas se précise non plus comme trait de caractère, mais comme caractéristique ontologique de tous ceux qui n’accèdent pas à la Vérité et qui de ce fait n’ont pas les qualités sociales et cognitives pour participer à l’accroissement du bien commun en vue du Salut.
L’identification à Judas des couches sociales plus démunies se précise dans les réflexions sur la pauvreté se développant au moment de la transformation majeure du bas Moyen Âge, liée à la révolution des commerces (fin du xiiie siècle). L’internationalisation des commerces entraîne le plein essor de l’économie du crédit, qui accélère l’enrichissement des grandes familles de l’Europe occidentale ainsi que la naissance d’une puissante oligarchie économico-politique, dont ni les États et ni l’Église n’ont ensuite pu se passer. La réflexion autour de cette première société marchande, de ses nouvelles figures sociales, tels que le grand marchand international et le banquier, et des transformations politiques qu’elle comporte, se développe à l’intérieur du cadre épistémique chrétien qui fournit les concepts et les lexiques à travers lesquels la nouvelle réalité des échanges peut être pensée et intégrée dans la logique du Salut. C’est en particulier dans la réflexion sur la pauvreté menée par les Ordres Mendiants, et tout particulièrement les Franciscains[22], que la nouvelle rationalisation du système d’échange des biens et de circulation de la richesse ainsi que les notions économiques clé — propriété, usage, biens nécessaires ou superflus, usure, crédit, risque, etc. — sont réélaborées. Naît une nouvelle modalité d’objectivation des identités et des rôles sociaux et politiques des acteurs économiques.
Dans les discours théologiques, en tant que forme supérieure de l’imitatio Christi, la pauvreté choisie est bien distincte de la pauvreté de fait, qui est une contrainte obligeant les plus démunis à ne se soucier que de leur subsistance privée et familiale. De ce fait, par rapport à ceux qui, à l’image de François d’Assise, fils d’un riche marchand, choisissent la pauvreté au bénéfice du bien de la comunitas christiana, les paupers, mercenarii, c’est-à-dire tous les petits travailleurs dépendants — serviteurs, artisans, journaliers, etc., sans oublier les femmes —, sont dévalorisés dans la mesure où ils ne contribuent pas au bien commun. Assimilés à des analphabètes économiques, incapables de comprendre la vraie finalité des échanges, les membres du menu peuple doivent faire l’objet d’un contrôle accru. Toute la légitimité de l’agir économique revient à ceux qui ont les qualités pour intervenir dans ce « marché initiatique » (CG, p. 177-189), c’est-à-dire les grands marchands et banquiers. Ces derniers savent faire circuler les richesses sans les enfermer dans le simple usage privé et contribuent ainsi au bien commun par leur activité ainsi qu’en finançant l’Église ou en administrant les biens ecclésiastiques. Seules ces catégories de fidèles donnent les garanties de fiabilité qui les autorisent à agir sur les marchés, c’est-à-dire dans la sphère économique qui est entièrement orientée vers le Salut. L’appartenance à la cité est par ailleurs subordonnée aux mêmes conditions, repoussant aux marges de la société tous ceux qui, « infidèles », comme les « Juifs », ou inaptes à en comprendre les normes, comme les paupers, sont vus comme des transgresseurs en puissance de l’ordre parfait de la société[23].
Comme l’écrit Todeschini,
Pouvoir dépenser, savoir dépenser, être capable de gagner et puis de consommer, en investissant et même en dilapidant ses richesses sans tenir compte de l’utilité plus évidente et immédiate, distinguaient le droit d’être riche de celui qui était une personne importante dans la ville et pour la ville de l’impéritie économique de celui qui voulait gagner de l’argent et peut-être même accumuler des richesses pour soi et sa propre famille.
CG, p. 199
Les deux visions de l’agir économique, l’une « authentique » et l’autre « fausse », l’une conforme à la foi et l’autre criminelle, seraient, on l’a vu, exemplifiées métaphoriquement par deux personnages : Judas, incarnant la masse des analphabètes économiques et faisant un usage privé — donc avide et antisociale — des richesses, et Marie-Madeleine, modèle de l’oligarchie marchande dont l’usage normé des richesses prouve la foi et l’autorité publique. Marie-Madeleine, dont le culte élaboré depuis le xie siècle se diffuse entre le xiiie et le xvie siècle, sous l’impulsion des Franciscains, est exaltée en tant que figure du bon usage des richesses qui sait reconvertir la valeur des biens, même accumulés de manière douteuse, en les offrant sans limites à Jésus et à l’Église. Symbole de l’« économie authentique » (CG, p. 167), modèle de sanctification des oligarchies citadines, l’élaboration de la figure de Madeleine rend visibles les stratégies d’intégration de l’Église qui, à rebours d’un lieu commun historiographique, ne s’est jamais limitée à condamner la richesse et l’univers marchand. Elle a plutôt élaboré un système normatif permettant d’intégrer les nouvelles économies marchandes et laïques dans le circuit vertueux ecclésiastique. Judas, symbole de l’« économie fausse » (CG, p. 233), serait au contraire la figure qui renvoie à toute la masse des démunis qui peuplent les campagnes d’Europe, s’entassent aux abords des villes, travaillent pour autrui pour assurer leur propre subsistance : une masse d’avares et d’infâmes, de criminels et de voleurs en puissance, poussés par l’envie d’enrichissement personnel et déliés de tout pacte de solidarité avec le bien commun.
Le regard de Judas
L’étude de Todeschini s’achève avec la réception iconographique des textes sacrés et des différentes interprétations théologiques, fictionnelles et politiques qu’ils ont reçues. Des fresques de Giotto à celles d’Andrea del Sarto, en passant par les oeuvres de Pietro Lorenzetti, Ghirlandaio, Andrea del Castagno, Juste de Gand, Jean Fouquet et du Pérugin, on assiste au passage progressif d’une représentation allégorique de Judas à une construction narrative beaucoup plus réaliste du personnage, favorisant l’identification à ce dernier et l’intériorisation de ses émotions par les spectateurs[24].
Tout en gardant les codes iconographiques traditionnels définis pour Judas (le manteau jaune — la couleur de la trahison, les cheveux roux, la sacoche avec l’argent à la main ou accrochée à la ceinture, accompagné du diable ou bien d’un animal le représentant, un chat ou un chien), les peintres du xve siècle modifient un certain nombre de détails. Dans La Cena d’Andrea del Castagno, au Cenacolo de Sant’Apollonia de Florence (1450) ou dans celle peinte par Domenico Ghirlandaio au couvent des Franciscains Ognissanti à Florence (1480)[25], Judas n’est plus assis à côté des apôtres et de Jésus, face au spectateur. Il est peint de dos, faisant face à ses commensaux, comme un accusé en train d’être jugé. Cet isolement met en exergue l’individualité du personnage qui a été ultérieurement accentuée par sa gestuelle peinte de manière réaliste, comme dans la Cena d’Andrea del Sarto peinte dans le réfectoire du couvent San Salvi à Florence (1527), où son visage laisse apparaître toute sa colère, son agitation intérieure, son angoisse. Tandis qu’auparavant Judas ne se démarquait pas physiquement des apôtres, au xve siècle, il est peint de manière à ressembler aux serviteurs, personnages collatéraux qui s’ajoutent à la scène. Non seulement Judas est assimilé au menu peuple, illustrant ainsi ce que les prédicateurs continuent depuis un siècle à répéter, mais il est aussi intégré dans une scène aussi solennelle que la Cène, métaphore de l’Église et de l’eucharistie, où des représentants du petit peuple trouvent ainsi à la fois une codification visuelle de leur marginalité dans le cadre de la communauté ainsi que leur image identificatoire de référence.
Rigoureusement contrôlée par l’autorité ecclésiastique, toute cette iconographie ne cherche pas à fournir simplement des modèles d’identification empathique momentanée. Elle agit plus en profondeur, en impliquant de manière dynamique les émotions du spectateur au-delà de la rationalité consciente. Elle est destinée à produire l’intériorisation d’un doute — le doute de pouvoir agir comme Judas en détruisant le bien commun — et à faire ainsi accepter la soumission à l’autorité qui « protège » de ce risque. C’est le sens que Todeschini attribue à une fresque du Pérugin, qui inaugure une nouvelle modalité de représentation de Judas. Dans la Cena peinte pour le Couvent de San Onofrio delle Contesse de Florence (vers 1495)[26], Judas est assis tout seul sur le banc en face des apôtres. À la différence de ses prédécesseurs, le Pérugin ne le montre plus de dos mais le peint retourné vers le spectateur, comme si le personnage cherchait à en croiser le regard. Judas est devenu « le miroir qui met en garde ceux qui l’observent » (CG, p. 294) et qui peuvent se reconnaître dans sa posture et son aspect de personnage humble, perdu, étranger à la noblesse de la scène. Judas, par ce regard porté sur le public, est devenu un « masque », un personnage fictif qui définit l’espace de subjectivation du petit peuple en fonction de son assignation à la marginalité. Ce Judas du Pérugin n’incarne plus la marginalité du criminel d’exception mais représente la catégorie même d’exclusion, fondée sur le critère « économique », qui nous est encore bien familière. Judas, comme le souligne Todeschini, est l’un des éléments unificateurs et l’un des traits caractéristiques de la culture économique de l’Europe chrétienne (CG, p. 18).
Le romancier et l’historien contemporains s’emparent donc du mythe de Judas à partir de démarches profondément différentes. Amos Oz maintient le mythe en tant que forme de la trahison dont il redéfinit le contenu en puisant dans l’histoire récente d’Israël. L’élaboration fictionnelle d’un Judas innocent se structure parallèlement à une relecture de la fondation d’Israël qui tente de dépasser les récits mythologiques du premier sionisme en faisant surgir la question politiquement brûlante d’une éventuelle trahison à la base de la naissance de l’État hébreu. Cet événement récent est mis en relation avec l’histoire ancienne de la Palestine, selon le récit néotestamentaire dont Oz renverse le sens en innocentant Judas. Comme le soulignait Roland Barthes, « le mythe prive l’objet dont il parle de toute Histoire. En lui l’Histoire s’évapore[27] ». Dans le roman de Oz, la mise en fiction du mythe semble ainsi permettre de réinscrire celui-ci dans le mouvement critique de l’histoire, tout en en maintenant la dimension atemporelle comme gage de l’adhésion empathique du lecteur.
À l’opposé de cet usage anachronique et poétique du mythe, l’historien travaille à la déconstruction sémiologique de contenus dont il s’agit de reconstituer le sens en relation à leurs contextes historiques de production. Todeschini envisage Judas comme « un édifice textuel » (CG, p. 30) de part en part inscrit dans le mouvement de l’histoire, dont il s’agit de déchiffrer le sens et la fonction. En éclairant le processus d’accumulation primitive de sens du mythe de Judas, auteur de la vente aberrante du Christ, Todeschini peut montrer la redéfinition progressive des contenus d’ordre économique qui font de ce personnage l’un des ressorts du système de contrôle du menu peuple ainsi que l’une des matrices de la rationalité de l’Occident chrétien. En retrouvant les mots qui donnaient un sens précis à la figure de Judas dans le passé, en rendant visible le réel que ce mythe était censé saisir, l’historien plonge le lecteur dans un dépaysement qui est l’effet de la rencontre avec l’altérité du passé. Todeschini congédie celui-ci en lui soumettant le regard du Judas du Pérugin qui sollicite l’émotion en suggérant un élément de continuité, un résidu ayant traversé les siècles du mythe formé autour du personnage. Il y a là une invitation à nous laisser questionner, encore aujourd’hui, par ce regard.
Parties annexes
Note biographique
Docteure en histoire et depuis 2004 enseignante-chercheuse au département d’études italiennes de l’Université de Nantes, Anna Mirabella est membre du laboratoire de recherche l’Amo de l’Université de Nantes (lamo.univ-nantes.fr/_Anna-Mirabella). Ses recherches portent sur l’usage et la réinvention de l’histoire des fictions théâtrales et romanesques contemporaines (« La religion populaire médiévale comme fiction historique dans le Mistero Buffo (1969) de Dario Fo » (Studi culturali, à paraître), ainsi que sur les nouveaux enjeux de la transmission du savoir historique à travers le roman. Un premier travail sur les polars italiens et américains ayant comme protagoniste Dante Alighieri a été présenté à l’Université de Grenoble en janvier 2016 et un article sur les fictions de la résistance italienne depuis Italo Calvino et Beppe Fenoglio jusqu’aux derniers romans du collectif italien Wu Ming sera publié en 2017 dans la revue en ligne Atlantide (atlantide.univ-nantes.fr).
Notes
-
[1]
Nous employons les guillemets pour ce terme quand il indique les Juifs en tant que catégorie discriminée dans les discours antisémites.
-
[2]
En allemand, « Judasreck » indique une tache de rousseur, comme d’ailleurs en français l’expression « bran de Judas ». « Judaslohn » indique une dette, tandis qu’en hollandais « Judaskneep » désigne une dent cariée et « Judaskold » est une expression danoise utilisée pour décrire un grand froid. Au contraire, en italien, on blasphème au nom de Judas et des économistes américains ont parlé « d’économie de Judas », pour indiquer les formes hautement spéculatives et inégalitaires de systèmes économiques occidentaux ; voir W. Wolman et A. Colamosca, The Judas Economy. The triumph of Capital and the Betrayal of Work, Reading (Mass.), Addison Wesley, 1977. Pour une analyse des usages idiomatiques de Judas, voir Wayland D. Hand, « A Dictionary of Words and Idioms associated with Judas Iscariot », University of California in Modern Philology, n° 24, 1942, p. 289-356.
-
[3]
Sur l’absence de preuves de l’existence historique de Judas et sur l’origine midrashique de son élaboration néotestamentaire, voir la mise au point de Simon Claude Mimouni, « La question de la trahison de Judas », dans Simon Claude Mimouni et Pierre Maraval (dir.), Le christianisme des origines à Constantin, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », 2006, p. 120-121. Voir aussi Régis Burnet, L’Évangile de la trahison. Une biographie de Judas, Paris, Seuil, 2008.
-
[4]
Amos Oz, Judas, trad. de Sylvie Cohen, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 2016. Pour un approfondissement sur l’approche littéraire de la figure de Judas, voir Pierre-Emmanuel Dauzat, Judas. De l’Évangile à l’Holocauste, Paris, Bayard, 2006.
-
[5]
Si le stéréotype de Judas comme traître est très bien installé dans notre imaginaire, depuis le début du xxe siècle, dans la théologie catholique et réformée se sont affirmées des interprétations relativisant cette image de Judas. Voir les analyses de Régis Burnet, L’Évangile de la trahison, ouvr. cité.
-
[6]
Sur l’importance de la dimension référentielle du récit historique en tant que base de sa fonction critique et non empathique, qui caractérise, par contre, les fictions historiques, voir Monica Martinat, Tra Storia e fiction. Il racconto della realtà nel mondo contemporaneo, Milan, Et al. edizioni, 2013.
-
[7]
Giacomo Todeschini, Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, Bologne, Il Mulino, 2008. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle CG, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte. Nous citerons le texte en français dans une traduction personnelle. Professeur à l’Université de Trieste, Todeschini est spécialiste de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Pour une analyse critique de son oeuvre très vaste et innovante, voir Valentina Toneatto, « La richesse des Franciscains. Autour du débat sur les rapports entre économie et religion au Moyen Âge », Médiévales, no 60, printemps 2011, mis en ligne le 19 janvier 2012, consulté le 20 août 2016, URL : http://medievales.revue.org/6220.
-
[8]
Pour les exégètes, Judas est une personne dont on cherche à déduire le caractère expliquant ses actes. En dehors de cette perspective de croyance, Judas ne peut être envisagé qu’en tant que personnage fictif dont on « construit » les caractéristiques, sans pouvoir les « déduire », de même que l’on ne peut pas deviner les pensées d’Hamlet.
-
[9]
Pour une analyse des enjeux de la structuration hétéronome du politique, voir Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985.
-
[10]
La même évolution caractérise la figure de Marie-Madeleine, véritable alter ego de Judas qui incarnait la compréhension parfaite des jeux d’échanges et des valeurs, dont le culte se développe à partir du ixe siècle par la volonté des moines de Cluny, avant d’être diffusé entre les xiiie et xve siècles en particulier par les Franciscains. Dès le xive siècle, Marie-Madeleine commence à être reconnue en tant que sainte protectrice des femmes perdues, des voleurs, des prisonniers, etc. Todeschini consacre des pages très éclairantes à cette figure (CG, p. 83-93 et p. 201-231).
-
[11]
Sur la méthodologie historiographique de Todeschini, voir Giacomo Todeschini, « Oeconomica franciscana i. Proposte di una nuova lettura delle fonti dell’etica economica medievale », Rivista di storia e letteratura religiosa, n° 12, 1976, p. 15-77 et « Oeconomica franciscana ii. Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell’etica economica medievale », Rivista di storia e letteratura religiosa, n° 13, 1977, p. 461-494.
-
[12]
Karl Polany, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, trad. de Maurice Angeno et Catherine Malamoud, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1983.
-
[13]
Voir Giacomo Todeschini, Il Prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Rome, Nis, 1994.
-
[14]
Actes des Apôtres, 1, 18.
-
[15]
Sur cette caractéristique propre des textes sacrés, nécessitant toujours un travail interprétatif et la construction de ce que Erich Auerbach appelle l’« arrière-plan », voir en particulier Erich Auerbach, « Fortunata », dans Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, trad. de Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1968, p. 35-60.
-
[16]
Voir en particulier le commentaire à l’Évangile de Jean, où Augustin élabore son image de Judas : Augustin, In Iohannis evangelium tractatus cxxiv, éd. R. Willems, Turnhout, Brepols, 1954.
-
[17]
Tout au long de son travail, Todeschini démontre que les « Juifs » ne sont pas la seule catégorie construite à des fins discriminatoires à travers l’association à Judas. Cette association, qui nous est familière du fait de son usage dans l’antisémitisme du xixe et du xxe siècle, jusqu’au seuil de l’époque moderne, est essentiellement utilisée pour identifier négativement une autre catégorie, comme on va le voir.
-
[18]
C’est la définition de Judas qu’Augustin intègre dans son commentaire de l’Évangile de Jean : « qui aliquid de ecclesia furatur, Iudae perdito comparatur ». Cette formule sera largement exploitée dans les siècles suivants par les juristes, canonistes et théologiens cherchant à défendre l’autonomie des biens sacrés contre les ingérences des pouvoirs politiques (CG, p. 45 et p. 65-67).
-
[19]
Giacomo Todeschini, « Judas, mercator pessimus. Ebrei e simoniaci dal xi al xiii secolo », Zakhor. Rivista degli ebrei d’Italia, no 1, 1997, p. 11-23.
-
[20]
Paull Franklin Baum, « The Medieval Legend of Judas Iscariot », Publications of Modern Language Association, vol. 31, 1916, p. 481-632. Voir aussi Régis Burnet, L’Évangile de la trahison, ouvr. cité, p. 184-193. Jacques de Voragine, La légende dorée, éd. Alain Boureau et Monique Goullet, Paris, Gallimard, 2004.
-
[21]
« Ogni uomo è oggi peggio di Giuda, pero’che Giuda lo vendette xxx denari, ma voi lo vedete continuamente per minor pregio », cité dans CG, p. 136.
-
[22]
En effet, comme le souligne Todeschini, la plupart des théoriciens des échanges de cette époque appartiennent aux Ordres Mendiants. Sur les enjeux de la réflexion sur la pauvreté volontaire, voir Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, trad. de Nathalie Gailius et Roberto Nigro, Paris, Verdier, 2008. Voir aussi du même auteur, I mercanti e il tempio : la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 2002.
-
[23]
Si la foi et l’appartenance politique conditionnent l’intégration dans les marchés, l’on comprend les fondements de la marginalisation des « Juifs » dans la sphère économique, qui aboutit dès le xive siècle, dans l’Italie qui invente le système bancaire, à la création des ghettos. La non-appartenance à la communauté politique du fait de la différence confessionnelle, rend impossible la participation au bien collectif de ces sujets qui ne sont vus que comme des acteurs visant l’enrichissement personnel et familial. D’où la violente offensive contre les formes de crédit à intérêt pratiquées par la communauté juive parallèlement à l’autorisation à plein titre des crédits des grands marchands chrétiens, considérés comme fiables serviteurs du bien commun. Figure stéréotypée de l’abjection économique, l’usurier est un vendeur public d’argent qui, sans prendre aucun risque, gagne des sommes qui ne sont destinées à fructifier que dans l’espace circonscrit de son usage privé et familial. Contrairement à une image convenue, ce n’est pas le prêt d’argent en lui-même qui pose problème aux gardiens de la foi mais les conditions d’usage du crédit, qui est en soi largement autorisé aux grands marchands et financiers du xive siècle au nom du risque encouru dans leurs pratiques commerciales. Même lorsque les richesses de ces derniers sont accumulées de manière douteuse, elles peuvent être blanchies à travers les dons à la Ville ou à l’Église. Un exemple très connu de cela est celui de la famille de créditeurs de Padoue, les Scrovegni, qui ont financé avec les bénéfices de l’usure la construction au sein de l’église de la ville de la chapelle peinte par Giotto, qui porte leur nom. Quant à la violente polémique contre l’usure, organisée par les prédicateurs franciscains et autres ordres mendiants, tout en étant l’un des chapitres fondamentaux de l’antisémitisme chrétien, elle vise aussi la masse du petit peuple, qui représentait la clientèle principale des prêteurs juifs. Pour un approfondissement de ces thèmes, qui sont au coeur des recherches de Todeschini, voir les indications bibliographiques de la note 22. Sur la naissance concomitante des banques italiennes et du ghetto, invention tout aussi italienne, voir Giacomo Todeschini, La Banca e il ghetto. Una storia italiana, Bari, Laterza, 2016.
-
[24]
Sur la question de la fonction du réalisme dans l’introspection émotionnelle chez le lecteur-spectateur, voir Erich Auerbach, Mimesis, ouvr. cité.
-
[25]
Pour des reproductions des fresques de Domenico Ghirlandaio et d’Andrea del Castagno, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Cenacolo_de_Domenico_Ghirlandaio_(Ognissanti)#/media/File:Domenico_ghirlandaio,_cenacolo_di_ ognissanti_01.jpg, consulté le 20 août 2016 et https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Castagno#/media/File:Andrea_del_castagno_C%C3%A9nacle_de_SantApollonia_Florence.jpg, consulté le 20 août 2016.
-
[26]
Pour une reproduction de la fresque, voir : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cenacolo_di_Fuligno_di_Pietro_Perugino.JPG, consulté le 20 août 2016.
-
[27]
Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 239.