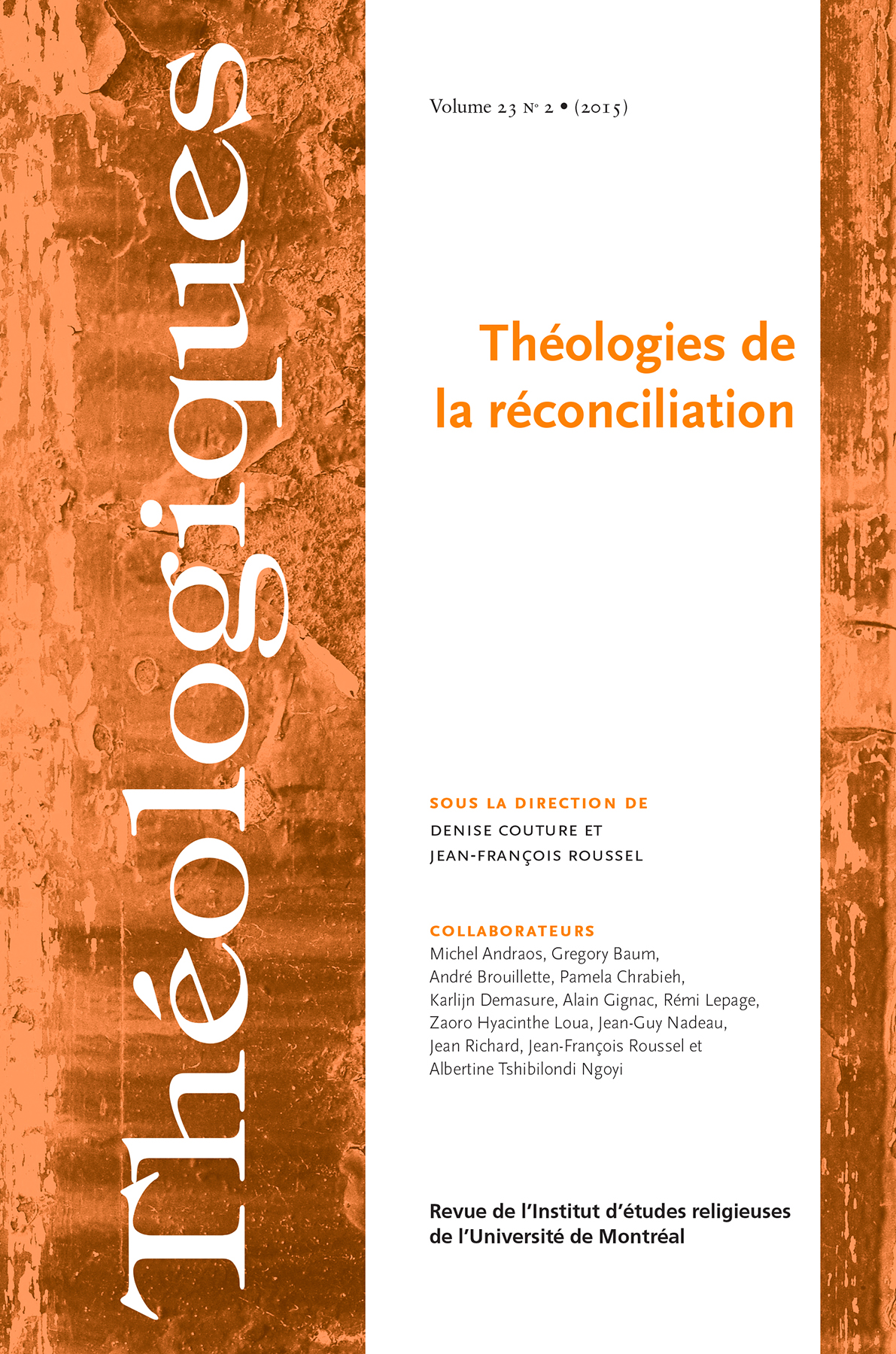Résumés
Résumé
L’article traite de notre réconciliation avec les Premières Nations du Canada. Nous nous situons là du côté de l’offensant face à l’offensé. Une première partie se réfère donc à Karl Jaspers dans son opuscule sur La culpabilité allemande, où il montre comment l’ouverture de la conscience à la culpabilité amorce un processus de purification et de réconciliation. D’un point de vue théologique, il en va de même chez Paul Tillich, où la conscience de l’aliénation conduit à la réconciliation avec Dieu dans le Christ. Ce qu’on trouve, chez saint Paul, appliqué à la réconciliation des deux peuples, les Juifs et les Grecs. Dans une troisième partie, l’article fait voir comment le conflit entre « Blancs » et « Amérindiens » consiste dans la polarité entre l’enracinement communautaire et l’universalisme des Lumières. La réconciliation souhaitée devra donc se faire par l’union de ces deux pôles dans toute existence humaine, communautaire aussi bien que personnelle. Une dernière partie porte sur la polarité et la réconciliation des deux types de religions : religion cosmique et religion de l’alliance avec un Dieu personnel.
Abstract
The article is about our reconciliation with the First Nations of Canada. In the conflict, we situate as offenders against offended. So, the first part refers to the Karl Jaspers lecture on the German culpability, where he shows how the guilt consciousness opens one to purification and reconciliation. From a theological view-point, Paul Tillich affirms likewise that consciousness of alienation leads to reconciliation with God in Christ. In saint Paul, the idea applies to the reconciliation between Jews and Greeks. In the third part, the article shows how the conflict between « Whites » and « Amerindians » is about the polarity of the community roots and the rational universalism. The reconciliation then consists in the union of both poles in personal and communal existence. Likewise, the last part is about the polarity and reconciliation of both types of religions : cosmic religion and religious covenant with a personal God.
Corps de l’article
Il me faut immédiatement apporter quelques précisions sur la théologie chrétienne de la réconciliation dont j’entends parler. D’abord, faire théologie, ce n’est pas parler en l’air. La théologie ne parle pas d’une autre réalité que celle de notre monde. Il n’y a pas d’autre réalité que celle-là. Par ailleurs, ce monde qui est le nôtre comporte une dimension de transcendance, une dimension divine, et c’est cela qui constitue le fondement réel du discours théologique, du discours sur Dieu.
Ce caractère « réaliste » de la théologie signifie en même temps un élargissement et un rétrécissement du champ théologique. Il y a élargissement puisque tout ce qui est réel peut faire l’objet d’une considération théologique, pour autant que toute réalité comporte cette dimension d’auto-transcendance et de profondeur divine, qu’il s’agisse de la réalité cosmique, anthropologique, culturelle ou politique.
Mais cela signifie aussi un rétrécissement du champ théologique. Par exemple, la théologie peut et doit parler des réalités éthiques et politiques. Elle doit cependant le faire selon sa compétence propre, au niveau de la transcendance divine de ces réalités. Il faudra voir ce qu’on entend par là. Pour l’instant, qu’il suffise de nous prémunir contre le danger de traiter les questions qui nous occupent aux simples plans éthique et politique, ce que d’autres que nous, théologiens, peuvent faire beaucoup mieux que nous.
Autre considération générale sur l’acte théologique. Dans la perspective qui est la nôtre, il ne suffit pas qu’un tel discours soit réaliste, qu’il porte sur des réalités bien concrètes ; il doit aussi revêtir un caractère existentiel. C’est dire que le discours théologique doit procéder d’un enracinement, d’un engagement et d’un questionnement personnels. C’est ainsi que je comprends l’enracinement de la théologie dans la foi : la théologie comme intelligence de la foi. Il s’agit, bien concrètement, de la compréhension d’une expérience de foi, laquelle n’est rien d’autre que la dimension transcendante et divine d’une expérience humaine marquante du sens de la vie et de l’histoire.
1. La réconciliation avec les Premières Nations du Canada
1.1 La réconciliation entre offensés et offensants
J’en viens maintenant à la question qui nous occupe, celle de la réconciliation et, plus précisément, de la réconciliation avec les Premières Nations du Canada. Précisons encore en distinguant deux types de réconciliation. Ce peut être la réconciliation d’un simple désaccord, d’une simple divergence d’opinions. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici, mais de la réconciliation d’un véritable conflit, qui implique une offense et, par conséquent, l’opposition de l’offensé et de l’offensant.
Dans ce cas, le théologien ne peut se situer au-dessus du conflit, en considérant de haut la situation. Il doit s’impliquer ; plus précisément, il doit reconnaître son implication dans le conflit. Dans le cas qui nous occupe, il n’est pas difficile de constater où nous nous situons, nous, Canadiens et Canadiennes, Québécoises et Québécois. Nous sommes du côté des accusés, des offensants. Par conséquent, au point de départ de notre réflexion, la position existentielle, le sentiment qui est le nôtre est celui de la culpabilité nationale.
1.2 Quatre types de culpabilité
J’en arrive là au terme de la lecture d’un petit ouvrage qui m’a beaucoup impressionné, celui du philosophe allemand Karl Jaspers, sur La culpabilité allemande (Jaspers 1948). Il s’agit d’un cours donné par Jaspers à Heidelberg durant l’hiver 1945-1946, donc quelques mois à peine après la guerre. L’auteur analyse la situation avec une lucidité dramatique, ne laissant aucune esquive, aucune excuse possible à tous les Allemands qui, d’une façon ou d’une autre, ont été pris dans le conflit.
Ce qui est tout particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c’est la distinction que fait Jaspers entre quatre types de culpabilité : la culpabilité criminelle, la culpabilité politique, la culpabilité morale et ce qu’il appelle la culpabilité métaphysique. La culpabilité criminelle est établie par l’instance juridique compétente. Dans le cas de la culpabilité allemande, c’était l’affaire du procès de Nüremberg. La culpabilité politique est celle des injustices que comportent les législations de l’État. Elle se trouve alors partagée par tous les citoyens de cet État : « Chaque individu porte une part de responsabilité dans la manière dont l’État est gouverné. » (Jaspers 1948, 59) Cette culpabilité politique entraîne la responsabilité pénale et, par conséquent, les réparations pour les injustices commises (Jaspers 1948, 68). Quant à la culpabilité morale, c’est celle des individus dans leur for intérieur. C’est la conscience d’une conduite personnelle injuste ou encore la conscience d’une participation personnelle, active ou passive, aux législations injustes de l’État.
Il nous faut réfléchir maintenant sur le dernier type de culpabilité mentionné par Jaspers, la culpabilité métaphysique, un concept qui concerne de près la théologie. C’est une culpabilité qui comporte un caractère universel, qui découle de la solidarité de tous les humains : « une solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis dans le monde. » (Jaspers 1948, 60-61) Une telle solidarité n’est perçue qu’en prenant conscience de l’absolu du bien et de la vérité, de l’absolu de la justice et de l’amour. On prend par là même conscience de sa propre culpabilité, car le mal, l’injustice, le mensonge et la haine sont partout présents dans le monde, et nous en sommes tous responsables en raison de cette solidarité humaine qui nous unit dans une même destinée[1]. En langage religieux, on dira que c’est la culpabilité humaine devant Dieu. Faisant allusion au tribunal devant lequel une telle culpabilité devient consciente d’elle-même, Jaspers écrit : « L’instance compétente, c’est Dieu seul. » (Jaspers 1948, 62) À travers ce langage philosophique abscons, on reconnaît alors un thème religieux plus familier, celui du « péché originel ». À propos de la culpabilité métaphysique, Jaspers parle, en effet, de « la culpabilité de la condition humaine[2] ». Il écrit encore, dans le même sens : « Si nous, les hommes, nous pouvions nous délivrer de la culpabilité métaphysique, nous serions des anges. » (Jaspers 1948, 64)
Nous ne pouvons pas nous délivrer de cette culpabilité métaphysique, pas plus que nous pouvons nous libérer de notre condition humaine. Cela ne signifie pas cependant que nous soyons enfermés dans la culpabilité sans aucune issue possible. Tout au contraire — et c’est là le plus merveilleux dans la pensée de Jaspers —, la conscience de la culpabilité métaphysique ouvre le chemin d’une « transformation de la conscience que l’homme a de lui-même devant Dieu », une transformation qui « peut faire jaillir une source neuve de vie active[3] ». Et lorsque Jaspers ajoute que « dès lors l’humilité rend l’homme modeste devant Dieu » (Jaspers 1948, 69), on peut comprendre, sans trahir le philosophe, que l’être humain, en se reconnaissant coupable devant Dieu, s’ouvre par là même à la grâce divine, créatrice de vie nouvelle.
1.3 La réconciliation comme purification transformatrice
Le dernier chapitre de l’ouvrage élabore cette pensée de la transformation intérieure, qui s’énonce alors en termes de « purification » : « Pour ce qui concerne la culpabilité, les réflexions exposées jusqu’ici ouvrent un chemin possible vers la purification. » (Jaspers 1948, 221) Il s’agit toujours là d’une transformation et d’un renouvellement intérieurs[4]. Cette purification transformatrice s’accomplit par « une action intérieure », répète souvent Jaspers, ce qu’il ne faudrait surtout pas entendre au sens du « salut par les oeuvres ». Notre auteur rejette explicitement l’idée que ce pourrait être l’effet d’une « volonté judicieuse », c’est-à-dire, d’un apprentissage spirituel quelconque[5]. Il faut plutôt l’entendre au sens d’une action où se conjuguent liberté humaine et transcendance divine. L’ouverture de la conscience à l’absolu produit en même temps le sentiment de culpabilité et le processus de purification divine.
Quelques remarques encore pour conclure cette section sur Jaspers. Notons d’abord que la purification dont il parle implique elle-même la réconciliation. Grâce à cette transformation intérieure, en effet, « nous devenons capables de lutter fraternellement, avec amour, les uns avec les autres, en cherchant la vérité, et de nous unir tous ensemble en elle. » (Jaspers (1948, 219)
Notons que, en nous conduisant ainsi jusqu’au seuil de la transcendance, Jaspers situe la question de la culpabilité au plan proprement ontologique. Si nous acceptons d’aller jusqu’au fond de notre conscience coupable, alors nous nous engageons dans la voie de la transformation ; la recherche de Dieu s’éveille en nous et l’être se révèle à nous[6]. Telle est l’ouverture, la révélation ontologique à laquelle donne accès la vraie conscience de la culpabilité. Ce n’est pas une révélation purement spéculative de l’être, mais une révélation bien enracinée, existentiellement, dans un contexte déterminé. Pour Jaspers, c’est la révélation de l’être, de l’âme et de l’esprit allemands. Et c’est précisément en cheminant en toute loyauté vers le fond de son être particulier que chacun accède à la révélation de l’être dans sa plénitude. Qu’on me permette de citer encore ce passage de l’introduction du volume, qui va dans le sens d’une ontologie existentielle :
La question de notre culpabilité nous est posée par les autres, mais plus encore c’est une question que nous nous posons à nous-mêmes. Selon la réponse que nous lui donnerons tout au fond de nous, notre conscience actuelle de l’être et de nous-mêmes sera différente. Elle est, pour l’âme allemande, une question vitale. Il faut lui avoir donné une réponse si l’on veut que puisse se produire une conversion capable de nous renouveler à la source même de notre être. […] La philosophie et la théologie ont la tâche d’éclairer le problème de la culpabilité dans sa profondeur.
Jaspers (1948, 55-56)
On aura noté ces derniers mots où Jaspers lui-même nous invite à un approfondissement philosophique et théologique du problème de la culpabilité. C’est ce que je tenterai de faire maintenant, en choisissant cette fois pour guide un autre penseur allemand luthérien, le théologien philosophe Paul Tillich.
2. Aliénation et réconciliation
2.1 L’aliénation du péché
Tillich a ceci de particulier qu’il analyse au plan ontologique des concepts qui ont d’abord une signification éthique, qui désignent d’abord un agir humain. Le cas le plus célèbre est sans doute son analyse du Courage d’être (Tillich 1999). Le premier chapitre s’intitule justement « Être et courage ». Tillich y précise son intention :
Certes, le courage appartient à l’éthique, mais il s’enracine dans la totalité des dimensions de l’existence humaine et, en dernière analyse, dans la structure de l’être-même. Il convient de le considérer d’abord d’un point de vue ontologique si l’on veut le comprendre d’un point de vue éthique.
Tillich 1999, 3
Il en va de même dans une autre série conférences, parue deux ans plus tard, en 1954, sous le titre Love, Power and Justice (Tillich 1964). Là encore, dès le premier chapitre, Tillich déclare son intention d’analyser ces concepts sur un plan ontologique : « C’est ontologiquement que nous nous demanderons quel est le sens premier d’amour, de pouvoir, et de justice. Ce faisant, nous avons une chance de découvrir non seulement leur sens particulier, mais aussi les relations de structure qu’ils ont entre eux et avec l’être en tant que tel. » (Tillich 1964, 9)
Il importe de voir ce que cela signifie pour la théologie. Je formule l’hypothèse que c’est grâce à la médiation ontologique qu’il devient possible de traiter théologiquement des réalités éthiques et politiques. Il faut pour cela s’élever à un niveau transcendant, méta-éthique et métapolitique, le niveau qui est précisément celui de l’ontologie. Il devient possible alors de faire la corrélation avec les symboles religieux, puisqu’on est au même niveau, puisqu’on parle de la même chose en termes différents, philosophiques d’une part, théologiques d’autre part.
C’est précisément ce qu’on peut observer dans la troisième partie de la Théologie systématique de Tillich, intitulée « L’existence et le Christ » (Tillich 2006). Philosophiquement parlant, il s’agit de la corrélation entre l’existence aliénée et l’existence réconciliée. En termes théologiques, c’est le rapport entre le péché et le salut.
Le péché, qu’on entend habituellement au sens d’une faute morale, se trouve alors approfondi sur le plan d’une aliénation ontologique. Tillich fait bien la distinction entre « les péchés », au sens de transgressions morales, et « le péché » au plan théologique. Sur ce plan plus profond, on parlera, en termes bibliques, de la rupture de l’Alliance avec Dieu, qui entraîne elle-même la rupture avec les autres et avec soi-même[7]. Tillich se réfère alors à saint Paul, ce qui montre bien que tout son discours sur l’aliénation et la réconciliation est fortement paulinien dans son inspiration[8]. En somme, ce qui porte la notion de péché au plan proprement théologique, c’est le rapport personnel à Dieu qu’elle implique. Ainsi, le péché n’est pas conçu d’abord comme transgression d’un commandement divin mais comme rupture d’alliance avec Dieu. Les commandements de Dieu n’ont de sens qu’en tant que clauses de l’Alliance.
Si on transpose maintenant ce discours théologique sur le péché en termes ontologiques, il sera question d’aliénation existentielle : « L’existence et l’aliénation sont un seul et même état. L’homme est aliéné d’avec le fondement de son être, d’avec les autres êtres et d’avec lui-même. » (Tillich 2006, 77) Tel est le sens premier, étymologique, de l’aliénation, ce que le Petit Robert définit bien comme « tout processus par lequel l’être humain est rendu comme étranger [alienus] à lui-même ». Tillich, pour sa part, approfondit cette notion d’aliénation jusqu’au plan ontologique. Devenir étranger au fondement de son être équivaut à la séparation d’avec Dieu, auquel nous appartenons essentiellement[9].
L’existence (réelle, concrète) se démarque donc de l’essence (idéale). Tillich en parle comme du passage de l’essence à l’existence. Il a recours alors à l’expression mythologique de la « chute de l’âme » chez Platon[10], pour interpréter ontologiquement le récit biblique de la « chute d’Adam » — le péché originel[11]. S’il importe tellement de reconnaître le caractère mythologique de ce récit, de voir qu’il s’agit du symbole universel de la condition humaine et non pas d’un événement historique quelconque, c’est précisément pour situer cette doctrine du péché originel au plan de la structure ontologique de l’être essentiel et existentiel, non pas au plan éthique d’un quelconque agir fautif, d’une quelconque transgression d’un précepte moral.
Ce caractère ontologique et universel de la chute étant bien acquis, on doit tout aussi fortement insister sur la culpabilité qui s’ensuit, c’est-à-dire sur l’implication de la liberté humaine dans ce passage de l’essence à l’existence. Il est vrai que le « péché originel » est le lot de tous les humains ; mais je ne peux pas dire pour autant que « ce n’est pas ma faute ». Tillich exprime cela en parlant de la dualité paradoxale de la culpabilité personnelle et de la tragédie universelle[12]. Voilà pourquoi il veut maintenir le mot « péché », qui exprime mieux l’aspect personnel de l’aliénation universelle, la culpabilité personnelle qu’elle implique[13].
Au terme de cette réflexion sur le péché comme aliénation chez Tillich, le lien apparaît assez manifestement avec la notion de culpabilité métaphysique chez Jaspers. Il s’agit, dans les deux cas, d’une culpabilité personnelle d’envergure universelle. Il en va ainsi parce que, dans les deux cas aussi, la réflexion s’approfondit au plan de l’absolu de l’être, de l’absolu du bien, de la justice et de la vérité. Jaspers en parle comme du plan métaphysique et Tillich, comme du plan ontologique, mais il s’agit bien de la même chose.
Notons aussi la complémentarité entre ces deux approches. Tillich procède de façon plus spéculative, de haut en bas, des « analyses ontologiques » aux « applications éthiques », comme il l’exprime dans le sous-titre de son ouvrage sur Amour, pouvoir et justice. On vient de voir aussi qu’il procède de l’aliénation ontologique à la culpabilité personnelle. La pensée de Jaspers est elle-même plus inductive et existentielle, à partir de la culpabilité morale personnelle, jusqu’à cette culpabilité transcendante qui affecte tout le monde. Tillich fait mieux voir la structure ontologique de l’aliénation ; Jaspers montre mieux son enracinement dans la situation existentielle et dans la conscience qu’on en prend. En ce sens, nos deux auteurs sont vraiment complémentaires ; ils s’éclairent l’un l’autre.
2.2 Réconciliation et salut
Dans ce contexte d’une réflexion sur l’aliénation ontologique existentielle, l’idée de réconciliation prend tout son sens. On peut dire alors que la réconciliation est à l’aliénation ce que le renouement de l’Alliance est à la rupture de cette même Alliance. En termes équivalents, Tillich parle lui-même de séparation et de réunion. C’est par là qu’il interprète la foi chez saint Paul et l’amour dans les évangiles : « Dans la foi et dans l’amour, le péché est vaincu parce que la réunion l’emporte sur l’aliénation[14]. »
De cette réunion (ou réconciliation), il faut affirmer maintenant ce que nous avons dit de l’aliénation : elle se situe et se réalise sur un plan proprement ontologique. Ce n’est pas une simple conversion morale, un simple retournement de la volonté ou changement d’esprit. Il s’agit d’un véritable changement d’être, un passage de l’être ancien à l’être nouveau : « L’Être Nouveau est l’être essentiel dans les conditions de l’existence ; il comble le fossé entre l’essence et l’existence[15]. »
On voit bien l’enracinement biblique de la pensée de Tillich. On pourrait tout aussi bien parler d’un commentaire théologico-ontologique du donné biblique. Il fait bien ressortir, en effet, qu’il ne s’agit pas là d’une simple conversion morale, où la volonté exercerait une pleine maîtrise sur l’orientation de sa vie, de son existence. Il s’agit plutôt d’une création nouvelle de Dieu en l’être humain. Cette nouvelle orientation de l’existence implique donc en même temps l’action divine de la grâce et celle de la liberté humaine[16]. Tillich renvoie à ce verset de saint Paul : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là » (2 Co 5,17). Cette création nouvelle en l’être humain consiste donc en une participation ontologique à l’être même du Christ[17]. Tillich indique aussi comment la même idée se trouve dans les évangiles :
Selon la théologie des synoptiques, dans la mesure où Jésus le Christ est une création de l’Esprit divin, de même celui qui participe au Christ se transforme en une nouvelle créature par l’Esprit. L’aliénation de son existence par rapport à son être essentiel est vaincue en principe, ce qui signifie en germe et en puissance.
Tillich 2006, 191
L’idée du salut comme réconciliation prend alors tout son sens. Tillich rappelle d’abord la signification étymologique du mot « salut », qui vient de salvus, « être guéri ». Les évangiles parlent le plus souvent du salut en ce sens, à propos des guérisons et des exorcismes opérés par Jésus. Mais ce ne sont là encore que des signes de la vie éternelle, de la guérison opérée au plus profond de l’être humain. Sur ce plan ontologique, la guérison est celle du mal de l’existence qui est l’état d’aliénation. Elle consiste donc en la réunion de ce qui est aliéné. C’est la réconciliation de la rupture avec Dieu, avec le monde et avec soi-même ; c’est la réconciliation de notre être divisé[18]. Et voilà précisément ce que signifie l’Être Nouveau : c’est l’être réconcilié.
2.3 Réconciliation et expiation
Une question souvent disputée se présente alors : qu’en est-il de la conception du salut en tant qu’expiation (atonement), en tant que fruit de la souffrance expiatrice du Christ sur la croix ? On peut aisément faire le lien avec le thème de la réconciliation si l’on se rappelle la dynamique de l’Alliance. Elle a été rompue par la désobéissance de l’être humain ; elle est restaurée par l’obéissance du Christ, une obéissance indéfectible jusqu’à la fin : « Il s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix » (Ph 2,8).
Tillich suit pourtant une autre voie pour intégrer dans sa théologie le thème de l’expiation du Christ. Même s’il n’y fait pas explicitement référence, on voit qu’il se fonde alors sur ce verset de saint Paul : « Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5,18). Ainsi, l’initiative ne vient pas du Christ, qui serait comme notre délégué pour apaiser la colère de Dieu son Père. Tout au contraire, « quand Dieu supprime la culpabilité et le châtiment qui le séparent de l’homme, il ne dépend pas du Christ, mais le Christ comme porteur de l’Être Nouveau médiatise l’acte de réconciliation de Dieu envers l’homme. » (Tillich 2006, 267-268) C’est donc Dieu lui-même qui, dans le Christ, se réconcilie l’humanité. Tillich s’oppose ainsi à toute conception qui fait dépendre Dieu du Christ pour son activité salvatrice, comme s’il avait besoin de lui pour être réconcilié :
On aboutit à ces doctrines de l’expiation pour lesquelles c’est Dieu qu’il faut réconcilier. Mais le christianisme annonce que Dieu, qui est éternellement réconcilié, veut que nous nous réconcilions avec lui. Dieu se révèle à nous et nous réconcilie avec lui grâce au médiateur. Dieu est toujours celui qui agit et le médiateur celui à travers qui Dieu agit.
Tillich 2006, 262
Telle est l’interprétation que fait Tillich de l’expression de saint Paul : « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ ». Cela signifie : « Dieu nous a réconciliés avec lui dans le Christ. »
En poursuivant cette ligne de pensée, nous sommes amenés à dire, avec Tillich, que Dieu nous réconcilie avec lui dans le Christ, en souffrant dans son Fils la mort de la croix. Nous en arrivons ainsi au thème typiquement luthérien du « Dieu crucifié ». Il ne faut pas l’interpréter comme une simple identification du Christ avec Dieu, ni comme une simple conséquence de l’union hypostatique des deux natures du Christ. Il s’agit plutôt de la présence réconciliatrice de Dieu dans le Christ crucifié.
Mais Tillich va plus loin encore, en attribuant à Dieu dans le Christ une participation à l’aliénation existentielle des humains :
Dieu exerce son activité expiatrice en participant à l’aliénation existentielle et à ses conséquences autodestructrices. S’il ne peut pas supprimer ces conséquences, parce que sa justice les implique, par contre il peut les prendre sur lui en y participant et en les transformant pour ceux qui participent à sa participation.
Tillich 2006, 269
Notons surtout deux choses à cet égard. D’abord, la mort sur la croix est interprétée comme la conséquence autodestructrice de l’aliénation humaine. Ensuite, en assumant cette aliénation (cette culpabilité) humaine, Dieu la transforme, il la surmonte dans le sens de la réconciliation.
On entrevoit là une ontologie toute différente de celle de « l’acte pur » aristotélico-thomiste. Chez Tillich, comme en général dans la philosophie allemande d’inspiration luthérienne, l’être est dynamique ; il est vie et mouvement. Ce qui suppose qu’il comporte une certaine négativité, une négativité qui cependant doit être surmontée. La différence entre Dieu et le monde ne consiste pas alors dans le fait que cet élément de négativité, présent dans le monde, serait absent en Dieu. La différence consiste plutôt dans ce que la négativité est toujours surmontée en Dieu, alors qu’elle ne l’est pas dans le monde. Et cela vaut aussi bien pour la négativité de l’aliénation existentielle que pour celle de la finitude essentielle. Le mystère du salut, le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, constitue ainsi la révélation par excellence du mystère de la vie divine. On ne sera donc pas étonné de voir que Tillich nous renvoie alors à son traité de la vie divine, pour y trouver les principes de son ontologie théologique[19].
2.4 L’Être Nouveau dans le Christ
Tillich a bien élaboré la doctrine paulinienne de la réconciliation. Cela m’encourage à faire de même avec lui, en développant sa pensée sur l’Être Nouveau dans le Christ. Je prétends donc qu’on ne doit pas entendre le passage de l’être ancien à l’être nouveau, de l’être aliéné à l’être réconcilié, comme si toute trace du premier était disparue dans le second. Là encore, il nous faut concevoir l’Être Nouveau de façon dynamique et dialectique. L’Être Nouveau dans le Christ comporte encore les vestiges de l’être aliéné, de l’aliénation humaine. En ce sens, le Christ a vraiment assumé tous les aspects de notre condition humaine, sans exclure l’aliénation existentielle sans laquelle on n’est plus dans le monde humain. La spécificité de son être consiste alors dans le fait qu’en lui l’aliénation est surmontée dans une parfaite réconciliation avec Dieu son Père.
Cette conception n’est pas sans difficulté cependant, car elle implique que le Christ est lui-même soumis à la culpabilité, qu’il est solidaire de la culpabilité humaine. Or cela semble contredire l’affirmation fondamentale selon laquelle il est sans péché. Ainsi Jean 8,46 : « Qui de vous me convaincra de péché ? » Ou encore 1 Jn 3,5 : « Il n’y a pas de péché en lui. »
La solution de cette difficulté se trouve, il me semble, dans la distinction que fait Jaspers entre la culpabilité morale et la culpabilité métaphysique. Bien sûr, le Christ est sans péché au sens de la culpabilité morale, personnelle. Mais cela n’exclut pas chez lui ce que Jaspers appelle « la culpabilité métaphysique ». Il la définit précisément par la « solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis dans le monde. » (Jaspers 1948, 60-61) Or telle est précisément la solidarité du Christ avec les humains, solidarité non seulement avec les conséquences destructrices du péché mais avec la culpabilité humaine elle-même. On peut ainsi accorder sa pleine signification à la parole du prophète Isaïe, à laquelle nous réfère saint Luc : « Avec les pécheurs il s’est laissé recenser, puisqu’il a porté, lui, les fautes des foules » (Is 53,12 ; voir Lc 22,32). Les commentateurs ont raison alors d’indiquer comme texte parallèle le passage où Jean le Baptiste présente Jésus comme « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). Il l’enlève non pas de l’extérieur, comme avec une pincette pour ne pas se salir ; il l’enlève en le prenant sur lui et en le surmontant dans l’amour et le don de lui-même.
On a vu aussi chez Jaspers que la conscience de la culpabilité métaphysique ouvre le chemin d’une transformation de la conscience que l’humain a de lui-même devant Dieu, une transformation qui peut faire jaillir une source neuve de vie active (Jaspers 1948, 68-69). Les dernières pages de son volume portent précisément sur le « chemin de la purification ». Ce chemin passe par l’élucidation, c’est-à-dire par la prise de conscience de notre culpabilité : « Élucider notre culpabilité, c’est du même coup élucider notre vie nouvelle et ses possibilités. » (Jaspers 1948, 218) Cette prise de conscience provoque alors un ébranlement intérieur qui est ouverture à une vie nouvelle. Celle-ci, la vie de l’Être Nouveau, n’est pourtant pas une vie céleste, celle d’une béatitude et d’une sérénité ingénues. Voici comment la décrit Jaspers : « Le bonheur, lorsqu’il nous est accordé, […] nous pouvons bien le saisir, mais il ne remplit plus la vie ; il apparaît, sur un fond de tristesse, comme une aimable figure magique. Dans son essence la vie n’est plus permise que si on se laisse dévorer par une tâche. » (Jaspers 1948, 218-219) Voilà bien le sentiment, la lucidité profonde d’un survivant de la guerre, de quelqu’un qui, en toute solidarité avec son peuple, est descendu jusqu’au fond de l’enfer. Mais notons aussi que telle est précisément la conception dynamique de la réconciliation que nous avons vue chez Tillich. On ne passe pas, d’un coup et sans reste, d’un pôle à l’autre, de l’aliénation à la réconciliation. La réconciliation est toujours en marche ; c’est un processus constant. De même, le salut est un constant processus de guérison. Ce n’est pas le passage subit du mal au bien, de la maladie à la santé, de la mort à la vie.
Une autre remarque de Jaspers mérite d’être signalée. Elle concerne le signe auquel nous pouvons reconnaître cette pureté intérieure, fruit de la conscience de notre culpabilité :
Quand nous n’avons pas conscience d’être coupables, notre réaction à toute attaque est la contre-attaque. Mais quand nous avons éprouvé cet ébranlement intérieur, alors l’attaque venue de l’extérieur ne fait plus que nous effleurer superficiellement. Elle peut encore nous faire souffrir et nous blesser, mais elle ne pénètre plus dans la profondeur de l’âme.
Jaspers 1948, 222
Nous avons là, il me semble, la clé d’interprétation du silence de Jésus durant sa Passion. C’est, pour lui, l’heure des ténèbres, l’heure du déchaînement des puissances du mal. À ce moment-là, il prend pleinement conscience du péché du monde, du péché de son monde, dont il se sent lui-même pleinement solidaire[20]. Dans ce sentiment de solidarité, il se tourne vers Dieu son Père et s’ouvre à son amour : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Rempli de l’amour, de la vie et de la puissance de Dieu, il demeure alors imperturbable devant toutes les attaques dont il est victime. Chacune est surmontée dans la force de cette vie intérieure, de cette vie divine qui triomphe de toute négativité. Et en raison de cette même solidarité, le « péché du monde » est lui-même surmonté, pardonné. Cela est tout différent de la contre-attaque de Dieu qui écrase le méchant.
3. Notre réconciliation avec les Premières Nations
3.1 Universalisme républicain et enracinement communautaire
Nous avons jusqu’ici exploré le sens du thème biblique de la réconciliation dans le Christ. La question qui reste est la principale : comment réaliser, comment accomplir cette réconciliation du salut dans les conflits personnels et collectifs qui sont les nôtres aujourd’hui ? Je me limiterai aux conflits causés par le contexte du colonialisme dans la situation des Premières Nations du Canada.
Je répète qu’une approche théologique de ces conflits doit être existentielle ; elle doit être ancrée dans la situation concrète de celui ou celle qui parle, qui fait théologie. Quand il s’agit de conflits qui nous concernent, cela signifie que nous devons prendre conscience de notre situation dans le conflit. Dans le cas des conflits avec les Autochtones, nous nous situons manifestement du côté des offensants plutôt que des offensés. Cela ne doit pas s’entendre à propos des débats juridiques sur les droits des uns et des autres. Il s’agit de quelque chose de plus immédiat, soit le sentiment de l’offense : d’une part, le sentiment d’être offensé, d’être traité injustement, auquel correspond, d’autre part, le sentiment d’avoir offensé quelqu’un, un individu ou une collectivité.
Un tel sentiment d’avoir offensé est précisément le sentiment de culpabilité d’où nous sommes partis et d’où nous repartons dans cette troisième partie de notre réflexion. Évidemment, la culpabilité canadienne dont il s’agit est différente de la culpabilité allemande dont parle Karl Jaspers. Les « réserves » destinées aux autochtones du Canada ne sont tout de même pas des camps d’extermination. Mais il y a un moyen terme entre ces deux cas de culpabilité : c’est la culpabilité européenne face au phénomène de la colonisation.
Dans sa récente autobiographie, Luc Ferry rappelle que les intellectuels de gauche des années 1960-1970 parlaient couramment des deux catastrophes majeures du siècle, qu’avaient été le nazisme et la colonisation (Ferry 2011, 134). D’après lui, « le seul point commun indiscutable entre les mouvements gauchistes qui animaient Mai 68 demeure l’anticolonialisme et le soutien aux luttes de libération nationale. » (Ferry 2011, 75)
Cette idéologie de la colonisation, on la voyait alors comme émergeant directement de l’esprit des Lumières. On soupçonnait l’universalisme des droits de l’homme d’avoir débouché sur l’européocentrisme (Ferry 2011, 75). Ce « premier humanisme », comme l’appelle Ferry, l’humanisme hérité des Lumières, « était un humanisme de la raison, il était aussi un humanisme de la nation et de la civilisation au singulier, identifié à la seule culture européenne » (Ferry 2011, 109). S’ensuivait logiquement « un humanisme de la colonisation et de “l’éducation” du genre humain par les nations éclairées » (Ferry 2011, 109). Telle était aussi, on peut bien supposer, l’idéologie à la base de la politique des Écoles résidentielles destinées aux Autochtones du Canada.
Mais le plus intéressant est sans doute la problématique que dégage Luc Ferry du débat entre partisans et critiques de la raison des Lumières. Celle-ci est universaliste ; elle aspire à une conception universelle des choses, du monde, des droits humains. Pour cela, elle doit se dégager de tout ce qui la restreint à un lieu ou à une époque particulière :
Pour les Lumières […], l’humanitas de l’homme ne se définit pas par l’enracinement, mais par l’arrachement : c’est par sa capacité à ne pas se laisser enfermer dans une détermination particulière […] que l’homme accède à son humanité. C’est dans la mesure où il peut se distancier de son histoire ou de sa nature, pour les considérer pour ainsi dire du dehors, que l’être humain, homme ou femme, peut prétendre à une vie authentiquement humaine.
Ferry 2011, 213
Ferry en conclut : « On retrouve ici le geste républicain par excellence d’une abstraction par rapport à la communauté d’origine, d’où la notion d’humanisme abstrait. » (Ferry 2011, 213) Or c’est précisément ce qui deviendra la cible de la contre-révolution, s’identifiant elle-même à « l’aspiration des colonisés à une singularité bafouée par l’impérialisme européocentriste » (Ferry 2011, 213). On peut ainsi déterminer plus précisément les termes du conflit en cause : « C’est au fond le conflit entre arrachement républicain universaliste et enracinement communautariste qui se voit remis en scène par les rénovateurs. » (Ferry 2011, 167)
3.2 La voie de la réconciliation
Il me semble que nous avons en cela une expression assez juste de ce qui nous a opposés aux Premières Nations. C’est l’opposition de l’enracinement communautaire et de l’arrachement universaliste. Sous-jacente à cette alternative, il y a celle de l’individualisme et du communautarisme. L’arrachement universaliste signifie, bien concrètement, l’arrachement de l’individu aux liens qui l’enserrent dans sa communauté d’origine. Tout le mouvement moderne issu des Lumières va, en effet, dans le sens de l’émancipation, de la libération. Plusieurs ajouteraient même : dans le sens de la civilisation, puisque la civilisation consiste en un arrachement aux liens de la nature. Ce qu’on appelle aujourd’hui la politique d’assimilation des autochtones dans les Écoles résidentielles devait être considéré alors comme un projet de libération, dans le contexte de l’idéologie colonialiste.
J’ose croire que nous n’en sommes plus là, que nous avons fait, nous aussi, notre contre-révolution. Nous ne considérons plus les autochtones avec mépris ou avec pitié, comme des arriérés, des gens d’ancien régime, non évolués. Nous n’en sommes plus là, sans doute, mais ne devons-nous pas avouer que nous les considérons encore comme des étrangers (alieni, en latin) : étrangers sans doute quant à leur habitat, sur des terres éloignées des nôtres, mais étrangers aussi et surtout quant à leur culture, qu’ils aiment bien d’ailleurs nous présenter dans ce qu’elle a de plus différent, de plus étrange pour nous.
C’est à ce point précis que me semble apparaître la voie de la réconciliation avec les autochtones. À ce point précis où apparaît aussi le plus manifestement l’aliénation qui nous sépare. Il importe alors de se référer au concept d’aliénation ontologique que nous avons repéré chez Paul Tillich. Quand il en vient à l’analyse de l’aliénation, il le fait en montrant le conflit des bipolarités ontologiques dans l’état d’aliénation : comment la liberté s’y trouve séparée de la destinée, la dynamique séparée de la forme, l’individualisation séparée de la participation (Tillich 2006, 103-110). C’est la structure même de l’être qui se trouve disloquée.
Dans son ouvrage sur la christologie, Parler du Christ, André Gounelle a repris cette analyse en indiquant différentes tensions dans la structure de l’être, telles la relation et la solitude, l’aventure et la sécurité, la passion et la raison, l’avoir et le manque. Quand ces tensions se trouvent à l’état de rupture, l’être est déchiré dans la contradiction avec lui-même et avec son monde. Quand la rupture est surmontée et les tensions réconciliées, apparaît alors l’humain authentique, l’image de Dieu, l’Être Nouveau tel que révélé dans le Christ (Gounelle 2003, 97-112).
La dimension ontologique de la réconciliation qu’est le salut apparaît de façon manifeste. Mais il s’agit alors d’une analyse existentielle, qui se rapporte directement à l’individu dans son existence personnelle, selon qu’il se trouve dans un état d’aliénation (de péché) ou de réconciliation (de salut). Du coup, la question qui se pose est celle de savoir si une telle analyse ontologique ne pourrait pas se faire également au plan de la structure sociale de l’être. Il me semble que c’est précisément à cela que font allusion les théologiens de la libération quand ils parlent d’un « péché structurel ». Il me semble aussi que c’est de cela qu’il s’agit quand Tillich, dans les années 1920-1930, parle des deux pôles de la pensée politique.
Le premier pôle est celui de l’origine, qui exerce son attraction dans tous les domaines de la vie : « On peut à partir de là rendre compte des rapports inviolables liant l’homme et la terre, les générations présentes et passées, les maîtres et les sujets, et liant aussi entre elles les communautés fondées sur le sang, l’ethnie et la race. » (Tillich 1992, 171) Cette attitude d’attachement à la terre est typique de la paysannerie, mais elle se retrouve et doit se retrouver dans toute structure sociale[21].
À l’autre pôle des tensions sociales se trouve l’orientation, non plus vers l’origine mais vers l’avenir, en vue de la transformation du monde. Telle est l’attitude rationnelle et critique, propre à la modernité des Lumières. On se trouve alors sollicité par l’exigence du droit, de la forme rationnelle, qui détache de l’origine pour projeter en avant. On néglige l’être déjà donné pour se concentrer sur le devoir-être. Mais ce faisant, on risque de perdre la substance spirituelle de l’être et de se trouver avec une forme rationnelle vide, sans contenu spirituel. D’après Tillich, cette seconde attitude est caractéristique de la mentalité urbaine, « où a lieu un déracinement à l’égard de la terre[22] ».
On vient de décrire l’état d’aliénation, celui où les deux pôles de la structure et de la conscience sociales se trouvent séparés, dans un état conflictuel l’un par rapport à l’autre. La réconciliation de ce conflit se trouve alors dans ce que Tillich appelle « l’attitude prophétique » :
Celle-ci unit et élève à une forme supérieure les deux tendances précédentes. Prenant appui sur le sacré déjà donné, une requête est posée en faveur du sacré tel qu’il devrait être. […] La prophétie appréhende ce qui vient, ce qui doit être, grâce à sa vivante participation au présent, au donné.
Tillich 2006, 173
Il ressort de cette analyse que l’enracinement dans l’origine et le détachement critique par rapport à cette même origine constituent deux éléments de l’esprit humain dans sa dimension sociale. L’un n’est pas étranger à l’autre ; les deux pôles s’appellent l’un l’autre. Il est tout naturel que certaines collectivités se distinguent par l’accent porté sur un pôle ou l’autre, mais elles ne deviennent pas pour autant étrangères l’une à l’autre.
Nous avons ainsi, il me semble, un premier pas vers la réconciliation avec les autochtones. Ce type d’analyse sociale, qui montre la structure bipolaire de notre être social, fait voir en même temps quelles sont les racines de nos divisions et quelles sont les voies de la réconciliation. Il s’agit de reconnaître que nous ne sommes pas des peuples étrangers puisque nous retrouvons en nous-mêmes ces différences qui nous distinguent. L’aliénation qui nous sépare, qui va parfois jusqu’au mépris mutuel, vient en effet de ce que nous identifions l’autre à un seul des deux pôles mentionnés. Par exemple, les autochtones seront considérés sans plus comme des aborigènes et des traditionalistes, des gens arriérés, non évolués. Et on nous considérera nous-mêmes comme des conquérants, des colonisateurs, des exploiteurs.
Cette voie de la réconciliation me semble être aussi celle du dépassement de la culpabilité. Celle-ci n’est que le reflet du sentiment d’aliénation qui nous oppose les uns aux autres comme des peuples étrangers. Or l’analyse de cette aliénation nous a fait voir qu’elle ne se produit pas seulement avec les autres mais aussi et d’abord à l’intérieur de nous-mêmes. Il n’y aura donc de réconciliation possible avec les Amérindiens que si nous nous réconcilions d’abord avec nous-mêmes, que si nous réconcilions en nous-mêmes le pôle de l’enracinement dans la tradition et celui du déracinement rationnel, moderne. En ce sens, la rencontre avec les autochtones pourrait nous aider à voir plus clair en nous-mêmes et à avancer sur la voie de la transformation dont parlait Karl Jaspers.
4. L’aspect théologique de la réconciliation
4.1 L’Esprit transpersonnel et le Dieu personnel
Nous avons jusqu’ici considéré l’aspect anthropologique et philosophique de la réconciliation avec les autochtones. Voyons maintenant l’aspect religieux et théologique de la question, celui des religions amérindiennes, qui nous semblent, de prime abord, si différentes du christianisme. Comme projet de réconciliation, j’emprunterai une voie analogue à celle suivie dans ce qui précède. Au lieu de comparer point par point, les éléments spécifiques des deux types de religion, je tenterai de montrer comment ces deux types se retrouvent déjà dans le christianisme, selon une bipolarité où l’un des deux pôles se trouve plus accentué que l’autre.
Pour cette dernière section de mon exposé, je me réfère à Achiel Peelman, qui est sans doute, chez nous, celui qui s’est le plus engagé et qui a le plus réfléchi à tout ce qui concerne nos rapports religieux avec les Amérindiens. J’adopte d’abord sa suggestion de commencer par la polarité de Dieu et de son Esprit, ce qui présente le grand avantage d’adopter au point de départ une vision universaliste et pluraliste des religions. Puisque c’est le même Esprit qui les anime toutes, aucune religion ne nous est complètement étrangère (voir Peelman 2004, 98-101).
Ce double principe théologique, Dieu et son Esprit, représente aussi une autre polarité en phénoménologie des religions : celle du personnel et du transpersonnel. Peelman note bien qu’en christianisme « l’Esprit n’est pas une personne comme le Père ou le Fils[23] ». On doit plutôt le dire transpersonnel, puisqu’il représente la présence diffuse du divin dans toute la création. Or tel est précisément le trait spécifique de la spiritualité amérindienne :
Le dieu amérindien est perçu et vénéré comme la grande puissance invisible qui se trouve à l’origine de tout ce qui existe. Il est Wakan Tanka, le mystère par excellence, le Grand Esprit. En même temps, ce dieu transcendantal est aussi perçu et vénéré comme la véritable énergie vitale de tout ce qui existe.
Peelman 2004, 100
Ce dieu amérindien ne nous est donc pas totalement étranger. On le reconnaît aisément en partant de notre notion chrétienne d’Esprit saint, l’Esprit divin répandu dans le monde.
Dans cette perspective, la réconciliation avec la pensée religieuse amérindienne peut se faire sans difficulté. Il y a plus cependant. Cette dimension spirituelle, transpersonnelle, de la foi chrétienne semble devenue, depuis quelque temps, l’aspect le plus valorisé, le plus accentué du christianisme occidental. Cela, non seulement à cause de ce qu’on a appelé le « retour de l’Esprit », dans les mouvements pentecôtiste et charismatique, mais aussi et d’abord en raison de la crise religieuse que nous vivons actuellement. Car la religion a toujours été plus ou moins identifiée à la croyance en un Dieu personnel. Or c’est précisément cette croyance théiste en un Dieu créateur qui fait difficulté aujourd’hui, avec la montée de l’athéisme et de l’indifférence religieuse. Par contre, le chrétien et la chrétienne d’aujourd’hui ne peuvent que se réjouir quand ils entendent Peelman affirmer que « la spiritualité amérindienne est une spiritualité “pan-en-théiste” » (Peelman 2004, 100).
Mais alors, la rencontre du christianisme avec les religions amérindiennes pourrait fort bien provoquer chez nous une réaction tout à fait différente de ce qu’on a connu jusqu’à présent. On pensait d’abord à l’inculturation, à l’adaptation du christianisme à ces autres cultures et religions. Face à la spiritualité amérindienne, l’interpellation que nous ressentons maintenant semble plutôt être celle-ci : en quoi le christianisme se distingue-t-il vraiment, en quoi consiste sa spécificité ? Et ce ne serait pas un mince profit si la spiritualité amérindienne pouvait nous stimuler en ce sens, en nous invitant à repenser notre foi au Dieu personnel, au Dieu Père de Jésus le Christ et notre Père.
Retrouver le sens chrétien de la foi au Dieu Père, cela signifie d’abord retrouver son premier contexte, qui est celui de l’histoire biblique du salut racontée dans le cadre de l’Alliance de Dieu avec son peuple. Le Dieu Père, c’est le Dieu de l’Alliance : l’Alliance d’abord avec son fils Israël, puis avec son fils David, enfin avec son Fils Jésus. La foi biblique au Dieu personnel, au Dieu Père, est donc l’expression d’une conscience historique plutôt que d’une conscience cosmique. Elle se distingue ainsi des religions amérindiennes, qui sont axées sur la nature plutôt que sur l’histoire.
Il est intéressant de noter qu’on retrouve ainsi, au plan religieux cette fois, la même polarité que nous avons signalée sur les plans anthropologique et philosophique. Peelman dit bien que « la spiritualité amérindienne est intimement liée à la terre. Elle est une véritable spiritualité de la nature » (Peelman 2004, 103). On retrouve ainsi l’idée des « rapports inviolables [sacrés] liant l’homme et la terre » (Tillich 1992, 171). Mais cette « conscience mythique originelle » n’est pas la seule. Car « l’homme ne fait pas que se trouver comme une réalité déjà là […]. Il fait l’expérience d’une exigence qui le détache de ce qui est purement déjà là et le contraint à ajouter à la question de la provenance cette autre question : “pour quoi” ? » (Tillich 1993, 28) Or cette exigence inconditionnée est celle de la justice, qui ne devient elle-même concrète que dans la rencontre du « Je et Tu[24] ». On voit mieux ainsi le sens de la rencontre du Dieu personnel. Le Dieu de l’Alliance est le Dieu de la justice, qui commande, qui interpelle, qui oriente vers l’avenir. C’est tout différent du Dieu cosmique, le Dieu de l’origine. Et pourtant, toute religion authentique doit, de quelque façon, comporter ces deux pôles.
4.2 Le Christ cosmique et le Messie de l’Alliance
J’ai parlé jusqu’ici de la religion en général, à propos du Dieu personnel et de l’Esprit transpersonnel. J’aborde à présent le point de vue spécifiquement chrétien, en introduisant le Christ dans cette problématique du salut et de la réconciliation. Et nous revenons au coeur même du thème théologique qui nous concerne : « Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5,18). Telle est, on pourrait dire, la dimension verticale de la réconciliation, soit la réconciliation avec Dieu, « qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes » (2 Co 5,19).
Mais il y a aussi ce qu’on pourrait appeler la dimension horizontale de la réconciliation, soit la réconciliation avec les autres. On pense alors plus particulièrement à Éphésiens 2,11-22, où il est question de la réconciliation des juifs et des païens dans le Christ. Grâce à cette réconciliation, les païens ne sont plus des étrangers (alieni) ; ils sont devenus concitoyens des saints. Eux qui étaient loins sont devenus proches par le sang du Christ : « C’est lui, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité » (Ep 2,14).
Je me risque maintenant à interpréter ce passage d’Éphésiens 2, d’après le schéma proposé plus haut. Les païens représentent le pôle de l’origine, celui des puissances cosmiques. Paul affirme, en effet, qu’ils sont asservis aux éléments du monde, aux forces qui régissent l’univers, observant religieusement les jours, les mois, les années (Ga 4,3.9-10 ; Col 2,8.20). Ils sont ainsi sans messie, étrangers aux alliances, sans espérance (Ep 2,12). C’est une excellente expression du contraste qui, dans l’esprit de Paul, oppose les religions païennes à la religion d’Israël, d’où émerge le Christ Jésus. Les religions païennes sont des religions cosmiques, expressions d’une conscience cosmique axée sur les éléments de la nature. Par contre, la religion juive est le fruit d’une conscience historique, une conscience axée sur l’histoire en tant que processus d’asservissement et de libération. Les éléments de ce processus de libération sont ceux mentionnés par saint Paul : les alliances, les promesses, l’espérance qu’elles suscitent et finalement le Messie, le libérateur, le sauveur attendu. On reconnaît donc le deuxième pôle dont nous avons parlé : le pôle critique et prophétique, celui qui arrache à l’origine et oriente vers l’avenir.
Voyons maintenant, d’après le même schéma, comment cette réconciliation des deux pôles, et partant des deux peuples, peut se réaliser dans le Christ. Il est lui-même l’Être Nouveau, l’être réconcilié. Ainsi en est-il pour nous quand nous sommes en lui : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5,17-18).
Quant à ces deux pôles dont il a été question, ne pouvons-nous pas les reconnaître dans les deux types de christologie qu’on a, depuis longtemps, signalés dans le Nouveau Testament : la christologie des évangiles synoptiques, qui est, comme on a dit, une christologie d’en bas, une christologie axée sur la figure du Messie glorifié ; et la christologie johannique, une christologie d’en haut, la christologie du Verbe incarné. Ce sont là deux figures du Christ, bien différentes en principe mais parfaitement réconciliées dans les évangiles. Or il est assez manifeste que l’évangile du Verbe incarné a des connotations cosmiques et universalistes bien marquées. C’est le Verbe, par qui tout a été fait (Jn 1,3), qui demeure la vraie lumière du monde (Jn 1,9). Et il est tout aussi manifeste que le Christ Jésus des synoptiques constitue le centre d’une histoire du salut, qui va du commencement à la fin du monde. En somme, le Verbe johannique est l’expression privilégiée d’une conscience cosmique de la création, tandis que le Christ des synoptiques exprime au mieux la conscience historique et prophétique du salut.
S’il en est bien ainsi, je propose que la réconciliation de nos deux peuples, Amérindiens et Blancs, peut se concevoir selon les paramètres que je viens d’indiquer. Les Amérindiens représentent le pôle cosmique, les Blancs, le pôle historique de la religion, et ces deux pôles se trouvent pour nous réconciliés dans le Christ. Pour vérifier cette hypothèse, je me réfère au grand ouvrage d’Achiel Peelman sur le Christ amérindien, et plus spécialement à son chapitre sur « Le Calumet sacré et le Christ » (Peelman 1992).
La comparaison directe entre le Calumet sacré et la figure du Christ ne me paraît pas très convaincante. Par contre, l’analogie entre la cérémonie amérindienne du Calumet et la célébration chrétienne de l’eucharistie me semble fort pertinente. Il faut voir le caractère sacramentel du Calumet sacré. On dit que c’est « d’abord et avant tout un puissant moyen de communication avec Wakan Tanka, le Grand Mystère. » (Peelman 1992, 198) Et on ajoute que « aux yeux de beaucoup d’autochtones, le Calumet sacré possède une puissance spirituelle comparable aux sacrements chrétiens. » (Peelman 1992, 202) Pas surprenant alors que le Père Paul Hernou commence souvent « la célébration eucharistique avec une cérémonie du Calumet sacré. » (Peelman 1992, 213) Lui-même commente : « Pour moi, le Calumet sacré et le Christ sont désormais inséparables. De fait, je ne célèbre pas deux cérémonies, mais une seule. L’Eucharistie fait partie de la cérémonie du Calumet sacré. » (Peelman 1992, 213-215)
Tout autant que l’analogie et la compatibilité des deux symbolismes, il nous faut voir aussi leur différence. Encore une fois, je suis porté à l’exprimer dans les termes de la polarité mentionnée plus haut : le Calumet sacré se comprend dans le contexte d’un symbolisme cosmique, tandis que l’eucharistie, en tant que célébration du mystère pascal, n’a de sens que dans le contexte d’une histoire du salut. On peut lire chez Peelman que le « bourrage rituel [du Calumet] signifie la rencontre ou la mise ensemble de toutes les forces spirituelles qui se trouvent sur la terre, dans le ciel et dans la personne humaine. Le Calumet sacré est considéré comme le sacrement ou la voix de ces puissances spirituelles. » (Peelman 1992, 203) Peelman a lui-même participé à une cérémonie du Calumet sacré qui « reflétait la même cosmologie que celle des Lakota, avec son insistance particulière sur le symbolisme des quatre points cardinaux de l’univers et les puissances spirituelles qui s’y trouvent. » (Peelman 1992, 216) Il ne fait donc pas de doute que ces religions amérindiennes centrées sur le rituel du Calumet sacré soient vraiment des religions de type cosmique.
On ne peut alors manquer de noter aussi l’analogie entre ces croyances et celles que saint Paul attribue aux païens qu’il fustige en tant qu’asservis aux éléments du monde, aux forces qui régissent l’univers (Col 2,8.20). Peelman écrit à ce propos : « Victime du langage théologique de son époque, [le Père Roger] Vandersteene utilise encore les termes “superstition” et “paganisme” quand il présente l’univers spirituel des Cris[25]. » Chacun de ces deux termes mérite cependant une appréciation différente. Toute religion peut être accusée de superstition, pour autant qu’elle oublie le caractère symbolique, autotranscendant, de ses croyances et de ses rituels. Cependant, attribuer un caractère sacré à des objets ou à des phénomènes cosmiques n’a, en soi, rien de superstitieux, si on ne s’arrête pas à eux, mais si, à travers eux, on « intuitionne » le mystère du monde. Et on a vu que, pour les Amérindiens, « le Calumet sacré est, d’abord et avant tout, un puissant moyen de communication avec Wakan Tanka, le Grand Mystère. » (Peelman 1992, 198) Il n’y a là, en principe, rien de superstitieux.
Il en va autrement du paganisme. Il faut protester contre l’acception purement négative de ce terme chez saint Paul, comme si le paganisme était l’équivalent du démonique. Toute religion peut se pervertir et devenir démonique, mais le paganisme n’est pas comme tel démonique. Le paganisme devrait plutôt se définir positivement comme religion de la terre, comme religion cosmique. Il devient alors un élément essentiel de toute religion : c’est l’instance du sacré. Rappelons-nous la polarité du sacré des origines et du prophétisme. La religion cosmique représente l’instance du sacré, tandis que le judéo-christianisme se situe au pôle de la critique prophétique. Le sacré des origines, le sacré cosmique, doit passer au creuset de la critique prophétique, qui le juge selon les critères de la justice et de la vérité. Par ailleurs, il est tout aussi nécessaire que le judéo-christianisme garde sa base sacrée, religieuse et cosmique. Une religion purement critique se dévore elle-même en tant que religion.
S’il en est bien ainsi, je conclus en disant que notre tâche ne devrait pas être celle d’une conversion du paganisme autochtone au prophétisme judéo-chrétien. Il faudrait plutôt viser, en nous-mêmes d’abord, la réconciliation de ces deux pôles essentiels de toute religion authentique.
Parties annexes
Note biographique
Jean Richard est professeur émérite à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (Canada). Il est aussi le codirecteur de l’édition francophone des « Oeuvres de Paul Tillich ».
Notes
-
[1]
Jaspers (1948, 63) : « En ont le plus profondément conscience ceux qui ont atteint une fois le domaine de l’absolu et qui ont par là même fait l’expérience de leur échec : ils n’ont pas su rester fidèles à cet absolu à l’égard de tous les hommes. »
-
[2]
Jaspers (1948, 64-65) : « C’est la fatalité attachée au destin de tout homme, qu’il se trouve pris dans des rapports de forces qui le font vivre. Telle est la culpabilité inévitable de tous, la culpabilité de la condition humaine. »
-
[3]
Jaspers (1948, 68-69) : « La culpabilité métaphysique a pour conséquence une transformation de la conscience que l’homme a de lui-même devant Dieu. L’orgueil est brisé. Cette transformation de soi, résultant d’une action toute intérieure, peut faire jaillir une source neuve de vie active, mais qui restera liée irrémédiablement à un sentiment de culpabilité. »
-
[4]
Jaspers (1948, 189) : « Traitant de la culpabilité, nous avons de bonnes raisons de parler de purification. Nous devons, dans la mesure du possible, nous purifier de la culpabilité telle que chacun la trouve en lui-même, en réparant, en expiant, en nous renouvelant et nous transformant intérieurement. »
-
[5]
Jaspers (1948, 220) : « Il ne s’agit pas ici d’un but défini, qui puisse être atteint par une volonté judicieuse, mais de quelque chose qui s’accomplit par une action intérieure tendant à une transformation de soi. »
-
[6]
Jaspers (1948, 215-216) : « Nous, Allemands, nous sommes placés devant une alternative : ou bien nous assumons la culpabilité […] et alors notre âme s’engage dans la voie de la transformation ; ou bien nous nous laissons tomber jusqu’au niveau d’une vie moyenne, indifférente, qui n’est plus que la vie, sans rien qui la dépasse. Alors aucune véritable recherche de Dieu ne s’éveillera plus parmi nous ; alors l’être ne nous révélera plus ce qu’il est véritablement ; alors nous n’entendrons plus le sens transcendant de ce qu’il y a de plus haut dans notre poésie, notre art, notre musique, notre philosophie ».
-
[7]
Tillich (2006, 80) : « Si on parle de “péchés” pour des actes particuliers considérés comme mauvais, on doit toujours avoir conscience que les “péchés” manifestent le “péché”. Un acte n’est pas un péché parce qu’il transgresse une loi, mais parce qu’il manifeste l’aliénation par rapport à Dieu, par rapport aux hommes et par rapport à soi. »
-
[8]
Tillich (2006, 80) : « C’est pourquoi Paul appelle péché tout ce qui ne vient pas de la foi, de l’unité avec Dieu. »
-
[9]
Tillich (2006, 77-78) : « L’homme tel qu’il existe n’est pas ce qu’il est en son essence ni ce qu’il doit être. Il est aliéné de son être véritable. Le terme d’“aliénation” a une grande profondeur, parce qu’il implique une appartenance d’essence à ce dont on est aliéné. L’homme n’est pas étranger à son être véritable, car il lui appartient. Cet être le juge, mais même s’il lui est hostile, il ne peut pas s’en séparer complètement. L’hostilité de l’homme envers Dieu prouve indiscutablement qu’il lui appartient. Là où existe la possibilité de haïr, et là seulement, existe celle d’aimer. »
-
[10]
Tillich (2006, 53) : « Lorsque Platon décrit le passage de l’essence à l’existence, il a recours à une forme d’expression mythologique : la “chute de l’âme”. Il sait que l’existence ne relève pas d’une nécessité essentielle. Elle est un fait et, par conséquent, la “chute de l’âme” est une histoire qu’il faut raconter avec des symboles mythiques. Pour Platon, l’existence elle-même aurait été essentielle, s’il en avait fait une implication logique de l’essence. En langage symbolique, le péché aurait fait alors partie de la création et aurait été une conséquence nécessaire de la nature essentielle de l’homme. Mais le péché n’est pas créé et le passage de l’essence à l’existence est un fait, une histoire qu’on raconte et non un mouvement dialectiquement déductible. On ne peut donc pas le démythologiser complètement. »
-
[11]
Tillich (2006, 52) : « Le symbole de la “chute” joue un rôle décisif dans la tradition chrétienne. Bien qu’on l’associe habituellement au récit biblique de la “chute d’Adam”, sa signification dépasse ce mythe et a une portée anthropologique universelle. […] La théologie doit souligner clairement et sans ambiguïté que la “chute” est un symbole universel de la situation humaine et nullement le récit d’un événement qui serait arrivé “une fois il y a longtemps”. »
-
[12]
Tillich (2006, 77) : « Le passage de l’essence à l’existence débouche sur une culpabilité personnelle et une tragédie universelle. »
-
[13]
Tillich (2006, 77) : « Néanmoins, on ne peut pas abandonner le mot “péché”. Il exprime quelque chose que n’implique pas “aliénation”, à savoir l’acte personnel par lequel on se détourne de ce à quoi on appartient. Il insiste plus sur l’aspect personnel de l’aliénation que sur son côté tragique. Il met en valeur la liberté et la culpabilité personnelles en contraste avec la culpabilité tragique et la destinée universelle de l’aliénation. »
-
[14]
Tillich (2006, 80) : « Un acte n’est pas un péché parce qu’il transgresse une loi, mais parce qu’il manifeste l’aliénation par rapport à Dieu, par rapport aux hommes et par rapport à soi. C’est pourquoi Paul appelle péché tout ce qui ne vient pas de la foi, de l’unité avec Dieu. Dans un autre contexte (selon Jésus), toutes les lois se résument dans la loi de l’amour qui surmonte l’aliénation. L’amour est la force qui conduit à la réunion de ce qui est séparé ; il s’oppose donc à l’aliénation. Dans la foi et dans l’amour, le péché est vaincu parce que la réunion l’emporte sur l’aliénation. »
-
[15]
Tillich (2006, 190) ; voir aussi Tillich (2006, 191) : « Nous utilisons ici l’expression “Être Nouveau” pour renvoyer directement au fossé entre l’être essentiel et l’être existentiel. […] Il s’agit d’un être nouveau en ce qu’il manifeste sans le déformer l’être essentiel à l’intérieur et dans le cadre des conditions de l’existence. […] Tout en étant réel, il triomphe de l’aliénation de l’existence réelle. »
-
[16]
C’est ainsi que nous avons interprété l’expression de Jaspers : « une action intérieure tendant à une transformation de soi ».
-
[17]
Tillich (2006, 190-191) : « Paul exprime la même idée [celle de l’Être Nouveau] en parlant de “nouvelle créature” ; il appelle “nouvelles créatures” ceux qui sont “en” Christ. La préposition “en” indique la participation : celui qui participe à la nouveauté de l’être qui est en Christ devient une nouvelle créature, ce qui advient par un acte créateur. »
-
[18]
Tillich (2006, 257-258) : « En tenant compte à la fois du sens originel du mot (il vient de salvus “guéri”) et de notre situation présente, il semble adéquat de comprendre le salut comme une “guérison”, ce qui correspond à la principale caractéristique de l’existence, à savoir l’état d’aliénation. En ce sens, guérir signifie réunir ce qui est aliéné, donner un centre à ce qui est divisé, surmonter la rupture entre l’homme et Dieu, entre l’homme et son monde, entre l’homme et lui-même. Le concept de l’Être Nouveau naît de cette compréhension du salut. Le salut fait sortir de l’être ancien et entrer dans l’Être Nouveau. »
-
[19]
Tillich (2006, 269-270) : « Il faut nous référer à ce que les sections sur “Dieu comme vivant” disent de l’élément de non-être qui est éternellement surmonté dans la vie divine. Cet élément de non-être, vu de l’intérieur, est la souffrance que Dieu prend sur lui en participant à l’aliénation existentielle ou à l’état où la négativité n’est pas surmontée. Ici, la doctrine du Dieu vivant et celle de l’expiation coïncident. »
-
[20]
Kierkegaard aurait dit quelque part que le Christ était coupable d’en avoir rendu d’autres coupables. C’est, au fond, la même idée, mais je préfère la formulation proposée ici, inspirée de Jaspers.
-
[21]
Tillich (2006, 172) : « Il ne fait pas de doute qu’aujourd’hui encore de vastes groupes, en l’occurrence ceux de la paysannerie, partagent cette inconscience de l’histoire, et que la situation spirituelle sacramentelle fondée sur l’attachement à la terre est sans cesse confortée, en dépit de l’influence de l’esprit critique toujours si énergique. »
-
[22]
Tillich (2006 172) : « L’attitude rationnelle-critique rejette tout sacré qui ne comporte pas justesse et forme. L’esprit s’oriente vers la forme, et perd de ce fait la présence du sacré ; il se distance du donné, quel qu’il soit, devenant vide et sans contenu ; il poursuit jusqu’à l’infini la forme pure et inconditionnelle, sans pouvoir la trouver. Cet esprit critique-rationnel est l’héritage authentique de l’instinct nomade ancestral, et il apparaît principalement dans certains contextes sociaux, telles les colonies et les villes, où a lieu un déracinement à l’égard de la terre. »
-
[23]
Peelman (2004, 101) : « Dans l’ensemble, nous trouvons suffisamment d’éléments pour conclure qu’il est possible de présenter l’Esprit comme une personne. Cependant cet Esprit n’est pas une personne comme le Père et le Fils. Le terme “personne” s’applique, de façon analogique, plus facilement au Père et au Fils, car ils sont des personnes qui parlent et qui communiquent entre elles. L’Esprit n’intervient jamais comme un tiers dans le dialogue entre le Père et le Fils. »
-
[24]
Tillich (1933, 30) : « L’homme ne reçoit une exigence inconditionnée que d’autrui. C’est dans la rencontre du “Je et Tu” que l’exigence devient concrète. […] L’exigence qui nous arrache à l’origine ambiguë est l’exigence de justice. »
-
[25]
Peelman (1992, 211). Dans un courriel daté du 22 novembre 2011, Achiel Peelman m’écrit : « Comme missionnaire, Vandersteene était peu préoccupé par la sacramentalisation mais plutôt par le dialogue spirituel. » Peelman ajoute alors, ce qui laisse entendre que le dialogue devait être souvent traversé de malentendus : « Quand les missionnaires oblats utilisaient le terme “Superstition” (en anglais) dans leur conversation avec les Amérindiens, ceux-ci (par exemple les Denés de l’Alberta) traduisaient ce terme dans leur propre langue Dené par l’expression “les réalités dans lesquelles nous croyons vraiment”. »
Bibliographie
- Ferry, L. (2011), L’Anticonformiste. Une autobiographie intellectuelle, entretiens avec Alexandra Laignel-Lavastine, Paris, Denoël.
- Gounelle, A. (2003), Parler du Christ, Paris, Van Dieren.
- Jaspers, K. (1948), La culpabilité allemande / trad. par J. Hersch, Paris, Éditions de Minuit.
- Peelman, A. (1992), Le Christ est amérindien. Une réflexion théologique sur l’inculturation du Christ parmi les Amérindiens du Canada, Ottawa, Novalis.
- Peelman, A. (2004), « La mission universelle de l’Esprit », L’Esprit est amérindien. Quand la religion amérindienne rencontre le christianisme, Montréal, Médiaspaul.
- Tillich, P. (1964), Amour, pouvoir et justice. Analyses ontologiques et applications éthiques, traduction de Théo Junker, Paris, Presses universitaires de France.
- Tillich, P. (1992), « Les principes fondamentaux du socialisme religieux. Une esquisse systématique » (1923), dans Christianisme et socialisme. Écrits socialistes allemands (1919-1931) / trad. par N. Grondin et L. Pelletier, Paris / Genève / Québec, Cerf / Labor et Fides / Presses de l’Université Laval.
- Tillich, P. (1994), « La décision socialiste » (1933), dans Écrits contre les nazis (1932-1935) / trad. par L. Pelletier, Paris / Genève / Québec, Cerf / Labor et Fides / Presses de l’Université Laval.
- Tillich, P. (1999), Le courage d’être (1952) / trad. par J-P. LeMay, Paris / Genève / Québec, Cerf / Labor et Fides / Presses de l’Université Laval.
- Tillich, P. (2006), Théologie systématique, tome III, L’existence et le Christ / trad. par A. Gounelle, Paris / Genève / Québec, Cerf / Labor et Fides / Presses de l’Université Laval.