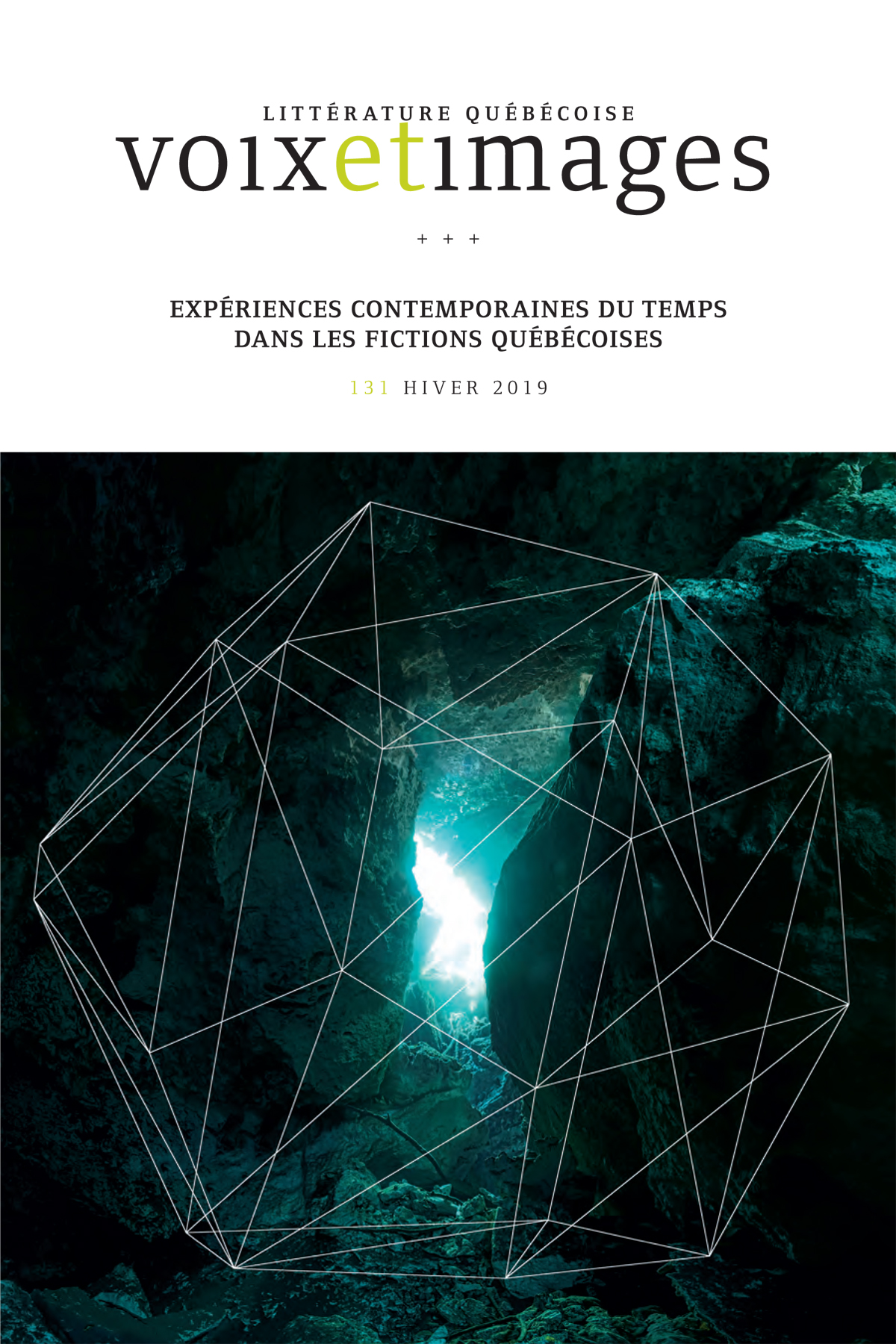Résumés
Résumé
Dans un contexte où l’écrivain contemporain accorde de plus en plus d’importance aux « vies minuscules » et aux personnages non romanesques, il est difficile d’envisager qu’il existe une forme de « héros » contemporain. Mais peut-être est-ce parce que notre conception du héros romanesque emprunte encore trop au régime moderne d’historicité, c’est-à-dire à ce temps où il était encore possible, justement, de croire à la grandeur d’une personnalité capable d’imprimer sa marque sur l’Histoire et sur le temps ? Or, si l’individu contemporain et son avatar fictionnel sont privés des repères, des forces et des certitudes qui motivaient l’individu moderne, sont-ils pour autant dépourvus de grandeur ? C’est en partant de cette interrogation et à partir de l’exemple de Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier (Alto, 2008) puis d’Immobile de Ying Chen (Boréal, 1998) et de La respiration du monde de Marie-Pascale Huglo (Leméac, 2010) que l’auteure pose l’hypothèse que, si une telle figure existe, c’est dans son rapport particulier au temps qu’elle est le plus susceptible de se révéler. On verra que c’est surtout dans un rapport antagonique avec la figure du héros moderne qu’un certain héroïsme peut se révéler, mais plus précisément dans ce que l’auteure appelle le temps « immobile » qui lui est particulier, temps de la résistance qui s’oppose au temps futuriste d’autres personnages.
Abstract
As contemporary writers give more and more importance to “vies minuscules” and non-novelistic characters, it is hard to imagine that some kind of contemporary “hero” may exist. Is this because our conception of a novelistic hero is still too much indebted to the modern regime of historicity, meaning that time when it was still possible to believe in the greatness of a personality that could leave its mark on History and time? But if contemporary individuals and their fictional avatars are deprived of the reference points, strengths, and certainties that motivated modern individuals, does that mean that they are necessarily without greatness? Using this question as a starting point, and basing herself on the examples of Du bon usage des étoiles by Dominique Fortier (Alto, 2008), Immobile by Ying Chen (Boréal, 1998) and La respiration du monde by Marie-Pascale Huglo (Leméac, 2010), the author frames the hypothesis that if such a figure does exist, it is most likely to be revealed through a specific relation to time. A certain heroism is chiefly able to assert itself through an antagonistic relation to the figure of the modern hero, but this takes place in what the author describes as the “motionless” time characteristic of the contemporary hero—a time of resistance that contrasts with the futuristic time of other characters.
Resumen
En un contexto en el cual el escritor contemporáneo otorga cada vez más importancia a las ‘vidas minúsculas’ y a los personajes no novelescos, resulta difícil considerar que exista una forma de ‘héroe’ contemporáneo. ¿Pero tal vez sea porque nuestra concepción del héroe novelesco aún extrae demasiado del régimen moderno de historicidad, es decir, de aquellos tiempos en que todavía era posible, precisamente, creer en la grandeza de una personalidad capaz de transmitir su marca en la Historia y el tiempo? Pues bien, si el individuo contemporáneo y su avatar ficcional carecen de referencias, fuerzas y certidumbres que motivaban al individuo moderno, ¿estarán por ello desprovistos de grandeza? A partir de esta interrogación y del ejemplo de Du bon usage des étoiles (Del buen uso de las estrellas), de Dominique Fortier (Alto, 2008), y luego Immobile (Inmóvil), de Ying Chen (Boréal, 1998), y La respiration du monde (La respiración del mundo), de Marie-Pascale Huglo (Leméac, 2010), cómo la autora plantea la hipótesis de que, si tal figura existe, es en su relación particular con el tiempo y es lo más susceptible de revelarse. Se verá que es sobre todo en una relación antagónica con la figura del héroe moderno que cierto heroísmo se puede revelar, pero más precisamente en lo que la autora denomina el tiempo ‘inmóvil’ y le es particular: el tiempo de la resistencia que se opone al tiempo futurista de otros personajes.
Corps de l’article
Dans une de ses chroniques de Voix et Images, Michel Biron souligne que « l’écrivain contemporain aime les “vies minuscules” (Pierre Michon) plus que les vies de héros. Il s’intéresse à cette part de l’humain qui traîne à nos pieds sans qu’on s’en rende compte[1] ». À l’instar de Biron, on ne saurait nier qu’un des grands fondements de la littérature contemporaine (depuis 1980 environ) aura été de donner une voix aux « petits », aux « minuscules », tout autant qu’aux oubliés de l’Histoire, bien souvent des « personnages secondaires » pour emprunter à la perspective de Carl Leblanc dans son récit sur James Richard Cross[2]. Parallèlement à ce phénomène, on ne saurait nier non plus la présence, dans la littérature romanesque actuelle, de personnages qui, dans la foulée des romans minimalistes, sont dits « inactifs, déconnectés, ordinaires voire effacés[3] », ou encore non romanesques ou non fiables[4]. Dans un tel contexte, il semble difficile d’imaginer qu’on puisse encore parler d’une figure de « héros » contemporain — en dehors bien sûr du sens « fonctionnel » qu’on peut donner au mot[5]. En effet, alors que, de façon schématique, le héros romanesque « traditionnel » est celui qui a un caractère hors du commun et qui se démarque par ses faits et gestes[6], le personnage contemporain aurait certainement du mal à prétendre à un tel statut d’exemplarité, d’autant plus que, en règle générale, il ne le recherche pas vraiment. Plutôt, il apparaît davantage être celui qui incarne l’incertitude du monde et du langage, voire de la narration dans des univers textuels et romanesques de plus en plus fragmentés et éclatés, ou encore celui dont on se moque (et qui parfois s’en moque), ou bien encore, en tant que « personnage secondaire », il est celui qui, bien souvent, subit l’Histoire plutôt que de la faire. Carl Leblanc le dit lui-même avec une touche d’ironie : « Le personnage secondaire ne peut pas faire un blockbuster[7]. » Cependant, cette façon de concevoir la figure du héros — au sens « axiologique » cette fois — pourrait être réductrice, reposant trop sur une conception du héros romanesque qui emprunte essentiellement au régime moderne d’historicité tel que l’a défini François Hartog[8], alors qu’il était encore possible de croire aux grands récits de l’Histoire, de la littérature et des sciences tout comme à leur linéarité et leur chronologie rassurantes, alors qu’il était encore possible, justement, de croire à la grandeur d’un être capable d’imprimer sa marque sur sa société, sur l’Histoire et sur le temps — le Héros étant dès lors l’être du progrès, de l’avant-garde, celui qui se distingue et qui mérite qu’on lui consacre un récit.
Or, si l’individu contemporain et son avatar fictionnel, le personnage contemporain, sont privés des repères, des forces et des certitudes qui motivaient l’individu moderne, sont-ils pour autant dépourvus de grandeur et d’héroïsme ? Ne serait-ce pas, justement, au coeur du chaos, de l’éclatement, de l’incertitude, du vide ou de l’absence qu’ils seraient le plus aptes à révéler leurs véritables forces ? Autrement dit, le personnage contemporain est-il seulement victime de son manque d’envergure et des effets pervers du présentisme (celui-ci l’empêchant de rêver à un quelconque avenir glorieux pour lui-même et ses semblables, englué qu’il est dans un présent trop présent[9]), ou bien n’existerait-il pas encore des personnages capables de susciter l’admiration du lecteur par des gestes héroïques en minuscule et qui, ce faisant, mériteraient le statut — même fragile — de héros ? C’est en partant de cette interrogation et à partir principalement de l’exemple de Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier[10], puis d’Immobile de Ying Chen[11] et de La respiration du monde de Marie-Pascale Huglo[12] que j’aimerais poser l’hypothèse que, si une telle figure existe dans la littérature québécoise actuelle, c’est dans son rapport particulier au temps qu’elle est le plus susceptible de se révéler. D’un point de vue strictement méthodologique, j’aimerais surtout tenter de comprendre ce qui pourrait caractériser le héros « contemporain » en le définissant dans un premier temps par rapport à ce contre-modèle qu’est le héros moderne, non pas tel qu’il a pu réellement exister dans la littérature antérieure, mais tel qu’il se retrouve dans le roman de Fortier, et pour qui l’expérience du temps et de l’Histoire est assurément différente. On verra que c’est dans ce rapport antagonique, qui permet de confronter deux expériences du monde et du temps, qu’un certain héroïsme se révèle, soit celui d’une expérience de « l’immobilité » qu’il s’agira, dans un deuxième temps, de caractériser à l’aide des romans de Chen et de Huglo.
À LA RECHERCHE DE POINTS DE REPÈRE
Racontant, en alternance, l’aventure désastreuse de l’expédition Franklin à la découverte du mythique passage du Nord-Ouest ainsi que la vie des femmes restées en Angleterre (la femme de Franklin, lady Jane, et sa nièce, Sophia, de qui Francis Crozier, second de John Franklin, est secrètement amoureux), le roman Du bon usage des étoiles est d’abord remarquable par son usage de la fragmentation narrative. En effet, il mélange plusieurs modalités énonciatives et plusieurs formes génériques (récit, poèmes, journaux, théâtre, partitions de musique, etc.), entremêlant ainsi les récits et les discours, qu’ils soient réels ou fictionnels, scientifiques ou populaires. Cependant, même si Fortier nous donne à voir plusieurs de ses sources, tant à même la trame romanesque que dans la « note de l’auteur » placée à la toute fin, elle ne cherche pas à asseoir son autorité en tant que romancière de l’Histoire ou à nous faire croire à la vérité de sa fiction. Plutôt, cette exhibition des sources participe, dans une logique tout à fait contemporaine, d’une remise en question de l’Histoire comme récit totalisant, récit objectif, capable de saisir LA vérité dans un récit unifié. Autrement dit, l’éclatement narratif de ce roman donne à voir les archives et les documents comme autant d’artéfacts de l’aventure racontée, mais aussi du mythe qu’elle constitue désormais dans l’imaginaire. En ce sens, le roman de Fortier se situe du côté du roman historique proprement « contemporain » — et non pas du côté du roman historique traditionnel qui, pour emprunter à la distinction proposée par Pierre-Paul Ferland, « entend être jugé entre autres pour la part qu’il donne à son exactitude factuelle[13] », à sa capacité à rendre l’Histoire vivante tout en respectant le matériau de base. Plutôt, il « va chercher […] à scander, au moyen d’artifices ludiques, la fragilité, voire l’obsolescence de ce savoir soi-disant objectif sur lequel les nations fondent leur unité grâce à divers mythes fondateurs[14] ». Ainsi, Du bon usage des étoiles se situe à mi-chemin entre l’Histoire et la littérature, mais, comme j’ai tenté de le montrer ailleurs, c’est le jeu littéraire qui prédomine sur l’ensemble[15].
Par ailleurs — et il s’agit là de la deuxième caractéristique notable du roman —, cette reprise du mythe du passage du Nord-Ouest est appuyée par la réactivation de modèles littéraires anciens, soit le roman d’aventures et le roman de moeurs, eux-mêmes caractéristiques du xixe siècle et ici teintés d’un imaginaire britannique parfois stéréotypé. Cependant, ces modèles, qui appellent l’action et la transformation des personnages au fil du temps et de l’intrigue, se voient contredits par l’épisode historique mis en scène qui, lui, appelle une fin suspendue, peu caractéristique des modèles revendiqués. Ainsi :
[L]a rencontre des genres littéraires à laquelle donne lieu le roman de Fortier ne les dissout pas tout à fait ; elle conduit à un mélange narratif singulier où le mouvement, propre au récit de voyage et à l’univers masculin, s’entremêle à l’immobilité du roman de moeurs et de l’univers féminin, jusqu’à se contaminer : les hommes se retrouvent finalement prisonniers des glaces et condamnés à occuper leur quotidien, pendant que les femmes multiplient les déplacements et les activités, compilent les lettres, cartes géographiques, plans et croquis destinés au récit de l’expédition[16].
Autrement dit, l’action romanesque typique fait place ici à l’absence et au vide, au silence et à l’attente, au blanc et à l’immobilité qui finira tout de même par caractériser les deux volets de l’intrigue — les femmes s’étourdissant davantage qu’elles ne s’engagent dans un réel mouvement, prises qu’elles sont par la circularité du temps qui caractérise l’univers féminin, et cela tant que la présence masculine ne viendra pas s’y inscrire de manière significative (retour de l’expédition et mariage). Bref, c’est l’envers de l’aventure qui est raconté, nous faisant passer du temps historique de la conquête du territoire à un temps suspendu, perdu dans la froideur de l’Arctique et l’insignifiance des salons mondains, nous aiguillant sur un temps de l’absence et de la disparition — cela étant d’autant plus tragique que les quelques traces témoignant de la vie de ces hommes sacrifiés risquent de se fondre à jamais dans le blanc polaire.
Conséquemment, l’aventure, dans ce roman, s’avère surtout introspective, tant du côté de l’exploration que du côté de la société des femmes ; c’est à un « voyage immobile[17] », un voyage à l’intérieur de soi que sont conviés les protagonistes. Chacun doit dès lors tenter de donner un sens à sa vie, même si les éléments qui devaient d’abord lui donner ce sens, comme la découverte du passage du Nord-Ouest ou le mariage pour Sophia, sont un échec complet. Aussi, comme le souligne Josée Marcotte, « l’éclatement textuel et sa narrativité déroutante participent grandement de cette logique éclatée, où les individus représentés cherchent des points de repère », au même titre que le lecteur doit « vogu[er] sur les pages à la recherche de ses propres points de repère, où les éclats textuels incarnent autant de vagues[18] ». Points de repère, ajouterais-je, que les personnages, au contraire du lecteur, ne peuvent trouver qu’en eux-mêmes ou dans les menus objets et menus signes qui les entourent. C’est ainsi, par exemple, que lady Jane, la femme de Franklin, trace des cartes sur lesquelles se retrouvent des « fleuves, montagnes, détroits, lacs et rivières, côtes, îles et péninsules réels ou imaginaires » (DBU, 336), et qu’Adam, un matelot, se lance dans une vaste quête de connaissances livresques alors qu’il est piégé au coeur de l’immensité glaciaire (DBU, 133-136). C’est que, comme le souligne cette fois Mathieu Bélisle, « la romancière conçoit pour ses personnages une horizontalité chimiquement pure […], à l’intérieur de laquelle ils se verront peu à peu privés de tous les repères qui leur permettent de se définir et de se situer[19] ». D’ailleurs, lorsque les derniers survivants décident d’abandonner les navires, ils voudront emporter avec eux autant d’objets qu’il leur est possible, puisque, au milieu de cet horizon blanc à perte de vue, il s’agit des derniers éléments qui les rattachent au monde connu :
Au fil des jours, Crozier voit s’accumuler, sur la banquise, un invraisemblable bric-à-brac […]. S’y entassent, baroques, stupéfiants, une foule d’objets dépareillés dont la seule présence au milieu de cet univers de glace est un défi à l’entendement. Passant en revue ces absurdes monticules, il doit étouffer une quinte de rire nerveux, mais il ne peut pour autant se résoudre à ordonner aux hommes hagards et exsangues dont les yeux fiévreux le hantent de laisser derrière eux cet ultime lien qui les rattache au monde qui a été le leur et à l’existence duquel ils tentent de toutes leurs forces de continuer à croire. Ces monceaux de colifichets domestiques sont autant de grigris, c’est l’Angleterre tout entière qu’ils tireront derrière eux, le poids de leur pays dût-il les mener droit à la mort.
DBU, 315
Tout en demeurant conscient que ces hommes font l’expérience du vertige absolu, on peut se demander s’il est possible de voir dans la situation des divers personnages de Fortier, hommes ou femmes, un écho de la condition contemporaine de l’individu, figé lui aussi dans un présent qui lui accorde toute la place sans pourtant lui en assigner une de façon claire, le condamnant, en quelque sorte, à s’occuper en attendant une transcendance qui n’arrive pas ; un monde où les grands points de repère — tels les grands récits dont parle Jean-François Lyotard[20] — qui permettent de structurer et d’orienter les existences individuelles ont disparu. Dans ce contexte, le véritable héros ne serait-il pas celui ou celle qui est capable de trouver du sens au coeur du vide et de l’immobilité (et malgré ce vide et cette immobilité), celui qui est capable de trouver de nouveaux points de repère qui iraient au-delà d’un attachement excessif, voire dangereux, à des symboles devenus désuets ? À cet effet, la scène entre Crozier et Sophia, dans laquelle il lui confie que, enfant, il inventait des constellations à partir « d’un vieil ouvrage d’astronomie […] auquel il manquait la moitié des pages » (DBU, 201), paraît significative, car elle révèle la véritable force de Crozier, capable, justement, de faire preuve d’imagination et d’inventer ses propres points de repère en dehors des données scientifiques et des consensus sociaux — capable de combler les « vides », les pages arrachées. C’est dans le même esprit, sans doute, qu’il s’aménage, à travers l’écriture de son journal, un espace dans lequel il puisse exister pleinement, hors des conventions sociales. Il n’est donc pas surprenant qu’il refuse, lors de leur ultime tentative pour trouver du secours, d’« abandonner au froid des navires désertés [ou encore] au feu [le] cahier qui est [s]on confident et qui [lui] semble parfois être la seule raison qui explique [qu’il n’ait] point encore perdu la raison » (DBU, 318-319). Sans le rendre héroïque, ce sont tout de même ces divers gestes qui font du personnage de Francis Crozier le point de repère essentiel du roman de Fortier.
HÉROS MODERNE ET HÉROS CONTEMPORAIN : FRANKLIN ET CROZIER
L’éclatement textuel, symbolisé par les étoiles qui donnent son titre à l’ouvrage, se voit donc contrebalancé tant par le projet narratif basé sur un épisode réel de l’Histoire jalonné de faits chronologiques (départ de l’expédition, trois années de recherche et tribulations de personnages interreliés, échec de l’entreprise par les glaces arctiques, etc.) que par la possibilité pour le lecteur et pour les personnages de créer des constellations qui vont donner du sens à l’oeuvre ou aux existences isolées — tel ce « S » que Crozier trace dans le ciel pour séduire sa belle (DBU, 202). Cet éclatement est aussi compensé par l’intervention d’un narrateur omniscient qui n’est pas sans rappeler les romans du xixe siècle et qui, par sa tonalité à la fois ironique, ludique et poétique, donne sa couleur particulière à l’oeuvre. Ce narrateur joue plus spécifiquement un double rôle : il brosse, d’une part, un « tableau foisonnant des lubies de la société victorienne[21] » et permet, d’autre part, de départager les héros des antihéros. Je ne peux ainsi m’empêcher, en grande partie grâce à l’intervention de ce narrateur, de lire également dans le roman de Fortier une forme de critique de la Modernité et de ses idéaux [22]; en effet, comment ne pas voir, dans le drame que constitue l’expédition Franklin, une foi naïve et trop grande dans les progrès de la science et dans la marche des empires ? Certes, la préparation de l’expédition ne s’est pas faite à la légère, avec ses navires plus solides que jamais et ses provisions pour trois ans, mais tout cela devient rapidement dérisoire lorsqu’on l’oppose à la nature indomptable que représente l’Arctique — imagée lors de l’abandon des navires évoqué plus haut : « Parmi ces tas s’empilent [des objets qui] tous proclam[ent] avec éloquence la primauté de la civilisation sur la nature sauvage. » (DBU, 315) Ainsi, cette vanité de l’Empire britannique, éminemment moderne, de vouloir conquérir le temps et l’espace, de vouloir trouver en premier le passage du Nord-Ouest, conduit non seulement à un désastre humain, mais empêche au surplus l’Amirauté de tenter la moindre expédition de secours. Face aux suppliques de lady Jane, nous informe le narrateur,
[l]’Amirauté ne bronche pas. L’expédition n’est pas en danger ; l’expédition ne peut pas être en danger. La fine fleur de la marine britannique n’est pas près de rester prisonnière d’un territoire d’où le premier baleinier venu s’extirpe les doigts dans le nez. Quant aux précédents échecs, si tant est que l’on puisse parler d’échecs, ils sont autant de jalons marquant le progrès de la conquête de ce dernier pan de globe échappant à l’emprise de la Couronne, et il est inconcevable que les erreurs commises au cours des siècles derniers ou des décennies passées soient répétées : indiquant les dangers qui guettent et les écueils à éviter, elles sont, au contraire, semblables à des bouées avertissant de la présence de hauts fonds, garantes du succès de l’entreprise. Il est donc ridicule de songer à dépêcher une expédition de secours. On ne va pas au secours des héros.
DBU, 311 ; souligné dans le texte
En bref, à travers ce portrait des « lubies » victoriennes, qui se dessine tant sur le plan de l’histoire que sur celui de la textualité même de l’oeuvre (exhibition des sources et documents à l’état brut, telle la désormais célèbre recette de plum-pudding), se profile aussi une critique stéréotypée mais efficace de la vanité moderniste, illustrée par « le décalage démesuré entre les exigences d’une entreprise aussi périlleuse […] et le raffinement victorien que John Franklin a tenu à entretenir, même prisonnier des glaces, décalage certainement responsable en bonne partie de l’échec de la mission[23] ».
Par ailleurs, ce narrateur omniscient, jamais totalement objectif, valorise certains personnages au détriment des autres, jouant ainsi, comme je l’ai souligné, un rôle significatif dans la répartition des héros et des antihéros[24]. Car le thème de la vanité et de l’ego moderniste, en plus de sous-tendre l’ensemble du roman, permet d’opposer différents personnages, mais en particulier sir John Franklin, le capitaine et héros historique (celui dont l’Histoire a retenu le nom), et Francis Crozier, son second — personnage secondaire de l’Histoire celui-là. Bien que le respect entre les deux hommes soit mutuel, les divergences s’observent d’abord dans leur personnalité et leurs manières, ainsi que dans leurs échanges et dans leur façon d’appréhender le monde. S’illustre ici aussi un décalage évident : Franklin « est présenté dans le roman comme un noble seigneur au port altier qui, sûr de sa réussite et habité par les exploits de ceux qui l’ont précédé, se comporte sur les mers de l’Arctique comme s’il se trouvait dans quelque manoir de la campagne anglaise[25] », tandis que Crozier est un « personnage discret et sans panache, maladroit en société et sans talent pour le commerce amoureux[26] ». Les divergences entre les deux hommes s’observent ensuite dans la façon qu’a le narrateur de se moquer du premier et d’épargner le second, comme s’ils étaient, le narrateur et Crozier, les deux seules entités du roman capables d’avoir une vue en surplomb sur le monde qu’ils racontent. Finalement, le roman insiste sur leur opposition en mettant en parallèle les journaux des deux hommes, créant là aussi un effet comique qui tend à désavantager Franklin. Ainsi, alors que Crozier peut prendre la parole pour lui-même dans un journal qui occupe d’ailleurs une large part du roman, sir John est beaucoup plus laconique dans son écriture et ne peut noter que les faits, ce qui laisse toute la liberté au narrateur pour saisir l’homme sous un autre angle :
Terror et Erebus ont levé l’ancre du port de Greenhithe le 20 Mai pour un Voyage entrepris par ordre de l’Amirauté dans le but de découvrir et de naviguer un Passage menant de l’Océan Atlantique à celui du Pacifique. 129 hommes à bord des deux Navires. Les pages qui suivent sont le Journal de bord du capitaine sir John Franklin, Commandant en chef de l’Expédition.
Satisfait, sir John relut ce qu’il venait d’écrire sans trop se soucier de l’orthographe ou de la grammaire, qui l’avaient toujours passablement ennuyé, mais en y allant de sa plus belle calligraphie. Cela lui semblait une entrée en matière tout à fait convenable, qui se comparait avantageusement à celles des récits de Parry, de Ross et de tous les autres explorateurs qui avaient — malheureusement — échoué là où il entendait bien réussir. Il regrettait certes un peu d’avoir si longtemps attendu avant de prendre la plume, mais il avait été par trop occupé, et puis, leur spectaculaire départ excepté, rien ne s’était encore produit qui méritât qu’on le consignât.
Il avait longuement discuté avec sa femme de la teneur de ce journal de bord qui deviendrait vraisemblablement un document précieux pour les géographes, marins, commerçants, militaires et scientifiques contemporains aussi bien que pour la postérité. […] De toute manière, dès son retour, lady Jane reprendrait le texte pour le polir phrase par phrase, comme elle avait l’habitude de le faire pour les missives que rédigeait son mari et, avec l’accord de celui-ci, elle donnerait au document ce souffle et cette envergure auxquels on reconnaît les récits des grands découvreurs.
DBU, 23-24 ; souligné dans le texte
Puis, un peu plus loin :
Sir John relut une deuxième fois les mots qu’il avait tracés et il éternua, ce qui fit un petit pâté sur la page. Il songea à retranscrire le tout sur une nouvelle feuille, mais se dit qu’on ne pouvait, que diable, s’attendre à ce qu’un journal rédigé en haute mer, dans des conditions souvent pénibles, voire au milieu d’intempéries redoutables, soit aussi propre qu’une lettre qu’on écrit tranquillement chez soi les pieds devant l’âtre. Il reposa sa plume et fit craquer ses doigts.
DBU, 24-25
On voit bien, dans cet extrait, que c’est davantage le geste symbolique de prendre la parole pour un public qui motive le personnage Franklin que le geste de l’écriture lui-même, comme c’est le cas chez Crozier, plus introverti. Les journaux de Franklin sont d’ailleurs destinés à devenir des documents précieux, dédiés à la fois aux scientifiques et aux grands hommes, tout autant qu’à la postérité. Ainsi, alors que le véritable sir John Franklin est un personnage de la grande Histoire, un héros de la Modernité, il incarne, dans la vision de Fortier, l’Angleterre victorienne dans toute sa magnificence, dans ce qu’elle a de plus éblouissant mais aussi de plus colonisateur et, partant, de plus futile. Autrement dit, en tant qu’homme de la Modernité, le personnage Franklin est incapable de toute véritable introspection ou de la moindre remise en question du monde et du Progrès (entendu ici comme idéologie), ou encore de la moindre ouverture aux autres cultures. Dès lors, il s’inscrit, tout comme il inscrit ses écrits à venir, dans le temps historique, qui est un temps long, futuriste et glorieux, par opposition au temps de l’écriture du journal, qui est davantage un temps court, immobile et intime, qui appartient à l’ordre du privé et dans lequel Crozier excelle.
À l’inverse, Francis Crozier est un personnage modeste, un homme plus simple et plus discret et, surtout, plus disposé à remettre en question l’ordre du monde et sa vision des choses — un homme qui ne s’intéresse pas à la gloire future mais aux nécessités de son présent. Dans ces conditions, il est celui qui est capable de s’adonner à l’introspection et dont le journal permet de préserver un équilibre, même au plus fort de la nuit polaire. Il est également celui qui a le plus conscience de la précarité de leur entreprise, bien qu’il ne puisse réellement intervenir sur le cours de l’Histoire, faute de réels pouvoirs. Il est, ainsi, un éternel second malgré ses qualités évidentes, car Franklin a un avantage indéniable sur lui ; en tant que héros vivant de la Modernité, il a déjà été mis en récit, et c’est donc à lui que vont l’admiration et la confiance des Grands comme des Petits, qu’il s’agisse de l’Amirauté britannique ou des marins. Dans son journal, Crozier note :
La mer est calme et les navires sont sûrs. Le Terror est mon plus vieil ami, mon seul ami, peut-être, dans ce voyage où je ne peux compter sur la présence de Ross avec qui j’ai franchi les frontières de l’Antarctique et entre les mains de qui j’aurais accepté sans hésiter de mettre ma vie encore une fois. En vain j’ai insisté pour que nous ayons à bord quelques-uns de ces baleiniers qui connaissent mieux que n’importe quel lieutenant de la marine britannique les eaux traîtresses de l’Arctique, braves hommes auxquels on doit la plupart des découvertes de ce pays de glace.
Malheureusement, l’équipage constitué par Fitzjames est à l’image de celui qui l’a choisi : élégant, enthousiaste, sûr de lui, mais cruellement dénué d’expérience. […] Les plus curieux ne connaissent l’Arctique, Dieu ait pitié de nous, que par ce qu’ils en ont lu dans les récits de Parry et de Franklin, dont ils récitent des passages avec la même ferveur que s’il s’agissait de versets de l’Évangile. Ils sont excités comme des écoliers qu’on amène au cirque.
DBU, 13-14
Et, un peu plus loin, il ajoute : « La plupart nourrissent […] une admiration sans borne pour sir John, le héros de l’Arctique, dont le récit des hauts faits a bercé leur enfance, l’homme qui a mangé ses souliers et, contre toute attente, réussi à survivre seul dans une nature sauvage et hostile. » (DBU, 15 ; souligné dans le texte) Ce serait donc en grande partie sur la foi aveugle autant dans l’idée de progrès que dans les récits héroïques de Franklin et de ses prédécesseurs que se bâtit la nouvelle mission, d’où, selon la version qu’en présente Fortier (et Crozier), son échec. Cet échec est d’autant plus tragique que le regard de Franklin et de ses acolytes est teinté de préjugés à l’égard de la culture inuite qui représentait pourtant leur unique chance de salut. De ce point de vue, une scène où les officiers discutent « des tares et des mérites des peuples sauvages » apparaît particulièrement ironique. En effet, alors que l’un d’eux déclare que les Esquimaux « ne connaîtront jamais le progrès et continueront pour toujours à arpenter la banquise vêtus de peaux de bêtes alors que nous avons conquis le globe », Crozier, toujours isolé même en groupe, fait remarquer que le fait qu’ils savent survivre dans des conditions hostiles est une preuve de leur ingéniosité, argument que les autres s’acharneront à démolir, stipulant que « la civilisation ne consiste pas à se soumettre aux caprices de la Nature […], mais à la forcer à se plier à nos besoins, à la maîtriser et à la contraindre » (DBU, 116-122). On peut difficilement faire plus « moderne » dans sa vision du monde…
Ainsi, dans ce roman typiquement contemporain, le héros de l’Histoire et de la Modernité, sir Franklin, est devenu ridicule, il se voit déboulonné, si on veut, de telle sorte qu’il représente un antihéros, un homme vaniteux et fat duquel tout le roman ne cesse de se moquer, jusqu’à sa mort silencieuse et absurde, dans sa cabine. En revanche, Crozier apparaît comme le plus sympathique des protagonistes, en grande partie, comme je l’ai souligné, parce que la narration ne le ridiculise pas, mais aussi parce qu’il est doté d’une certaine sensibilité contemporaine ; il est celui qui doute et qui est en même temps capable de s’ouvrir aux autres cultures, celui qui est en mesure — comme le matelot Adam qui pense à apporter des tringles à rideaux qui serviront de paratonnerre sur la banquise (DBU, 316) — de donner un sens nouveau aux choses et aux objets, en dehors des catégories convenues, celui qui peut recycler les déchets d’un petit pan de civilisation en déroute. Son temps à lui est manifestement le temps court, le temps de l’écriture de soi et de l’immobilité, le présent du récit et de l’histoire qu’il est train de vivre et d’écrire. C’est, pourrait-on dire, le héros de l’aventure immobile, même s’il demeure un héros modeste, incapable de conquérir à temps le coeur de sa belle et encore moins de sauver son équipage de la catastrophe.
Cette dynamique particulière héros/antihéros n’est d’ailleurs pas sans rappeler un grand nombre de fictions biographiques contemporaines, où les figures des grands hommes sont ramenées à de plus petites proportions et où l’homme « ordinaire » se voit au contraire promu par l’écriture[27]. Ce qui est plus rare, me semble-t-il, est de rencontrer ces deux figures au sein d’un même récit, si bien qu’ici, comme le remarque à juste titre Mathieu Bélisle, Crozier devient une « sorte de Sancho », « placé dans la position de subalterne, évoluant dans l’ombre (ou dans l’orbite) de son maître », mais c’est en partie par son regard que le monde nous est donné à voir. Pour Bélisle, le fait qu’il soit « l’homme du commun essentiellement doué pour la vie ordinaire » le rendrait typiquement québécois[28]. Pour ma part, je vois essentiellement en lui un personnage tout à fait contemporain, justement en raison de ce « grandissement », mais aussi de son rapport particulier au temps et de sa façon d’être en avance sur celui-ci, puisqu’il est le seul capable, par exemple, de déceler les impensés de sa propre historicité, cette dernière n’étant au fond qu’une vision occidentale difficilement exportable :
Les icebergs qui dérivent lentement au large forment un décor mouvant […]. Ce paysage arctique a ceci de paradoxal que c’est nous, qui le regardons, qui demeurons le plus souvent immobiles, emprisonnés par les glaces, tandis que lui avance, recule, se déploie et se resserre en une continuelle métamorphose, comme s’il était de quelque mystérieuse manière plus vivant que nous. Il me semble impossible, en contemplant ces forteresses de neige et de glace, de ne pas être pénétré du sentiment de sa propre insignifiance, de ne pas se savoir minuscule et superflu au milieu de tant de beauté majestueuse et sauvage. J’ai pourtant du mal à trouver chez les officiers l’écho de ce sentiment, puisqu’ils semblent pour la plupart insensibles à cette nature qui nous entoure, et dont ils ne parlent que comme si elle était quelque animal particulièrement rusé que l’on s’efforce de déjouer et de prendre au piège. Je ne peux m’empêcher de songer aujourd’hui que, s’il y a vraiment un chasseur et une proie en ce pays de glace, c’est bien davantage nous qui sommes le gibier, traqués, pris au piège, aux abois.
DBU, 41-42
Ainsi, alors que le héros aurait dû être Franklin — qu’il l’eût été dans un roman typique de la Modernité si celle-ci n’avait pas échoué dans ce projet grandiose —, Crozier est ici « l’âme du roman », sa sensibilité et sa grandeur, parce qu’il est capable de voir « les failles dans le raisonnement de son chef[29] », mais aussi de concevoir « l’immobilité » tout autant que sa propre insignifiance, sans pour autant en être écrasé ni faire de sa lucidité le lieu d’une supériorité sur les autres personnages, sur la nature et les autres cultures. Dès lors, la conscience de n’être « rien […] est encore quelque chose, […] un repère fragile qui permet au personnage de situer son expérience dans un cadre plus général[30] » qui échappe pourtant à ses compagnons. Sa fragilité même fonde sa grandeur et, à la différence des personnages qu’on dit « déconnectés » ou « plats[31] » qui peuplent la littérature contemporaine française et québécoise, il est capable de porter cette aventure humaine et littéraire jusqu’au bout, de lui insuffler un semblant de sens, tant par l’écriture que par la sagesse qui le guide et en fait le dernier à disparaître. C’est grâce à ce personnage que l’on peut comprendre l’absurde derrière cette tragédie historique.
IMMOBILES
Il resterait sans doute à déterminer en quoi l’expérience du temps immobile que fait Crozier serait typiquement contemporaine et permettrait d’y déceler un certain héroïsme qui s’appliquerait à d’autres figures. À ce sujet, Michel Biron, dans une autre de ses chroniques, parle justement d’un « temps suspendu » propre à nombre de personnages contemporains, temps, dit-il, « à l’intérieur duquel rien jamais ne peut advenir sauf dans les souvenirs ou dans l’imaginaire ». Il ajoute :
En cela, ce sont bien des romans contemporains au sens le plus fort du terme : les personnages y sont soumis à une simultanéité qui exclut d’avance tout espoir de durée. Ils ne font pas que marcher tranquillement avec leur temps : ils sont littéralement enchaînés à ce temps trop présent, épais comme un mur[32].
Dans son étude sur les personnages du roman réaliste, Isabelle Daunais parle elle aussi d’un « temps suspendu et évanescent » qui caractériserait les « héros captifs de la vie moderne[33] ». À première vue, donc, l’expression pourrait être un synonyme, un écho des thèses d’Hartog qu’on trouverait disséminé à travers le roman depuis longtemps, mais ce serait peut-être trop vite faire l’économie des temps intérieurs divers, des rythmes autres que certains personnages contemporains parviennent à se créer malgré tout. Car les personnages dont parlent Biron et Daunais n’ont rien d’héroïque, et l’idée d’« immobilité » signifie plutôt, dans mon esprit, que les héros contemporains ne sont immobiles qu’en regard d’un monde qui tourne autour d’eux à une vitesse folle et étourdissante, menaçant sans cesse de les happer. Autrement dit, tandis que les personnages réalistes des xixe et xxe siècles, tels qu’on les retrouvait chez Flaubert par exemple, rêvaient à un certain héroïsme qui les distinguerait de la masse et les élèverait — ou leur permettrait de ne pas s’ennuyer ou de ne pas être inquiétés — sans avoir les moyens de leurs ambitions, le personnage contemporain, lui, ne recherche pas cette distinction ; il se sait différent, mais ne fait pas de cette différence un signe de supériorité, dans la mesure où c’est cette différence même qui l’exclut du groupe — comme c’est le cas de Crozier, dont la sensibilité ne trouve écho chez aucun autre personnage.
En ce sens, l’héroïne du roman Immobile de Ying Chen m’apparaît comme un autre exemple de marginalité qui se caractérise par une forme de résistance à un ordre du temps moderne, imposé par les autres, et qui ne répond pas au rythme intérieur de la protagoniste. Projetée et réincarnée malgré elle dans un monde nouveau, elle en décèle aussitôt les failles :
Hormis quelques changements apparents qui ne touchent pas le moi profond […], j’ai l’impression de n’avoir rien perdu ni rien gagné sur le chemin de mon retour. J’ai perçu le grand mensonge que fabrique la machine de l’histoire. L’illusion collective. Les quelques siècles de vicissitudes racontées dans d’innombrables livres égalent le néant que j’ai traversé en un clin d’oeil. Personne ne veut l’avouer. C’est pourtant facile à constater. On aime tant la fiction. On ignore le vide. Tout le monde vient du vide et personne ne s’en souvient. Mais moi j’ai de la mémoire. Je la fortifie en chantant.
I, 123-124
Bien sûr, la narratrice innommée de ce roman n’est pas tout à fait un alter ego de Francis Crozier, dans la mesure où elle porte en elle la mémoire de ses vies anciennes et qu’elle est ainsi saturée de souvenirs et de passé (I, 119). En revanche, elle se définit entièrement dans son opposition avec le monde moderne, ce monde qui n’est que mouvements, autoglorification, abolition du passé et fabrication artificielle d’avenir. Elle ne reconnaît ainsi plus le monde ancien qui était le sien dans sa vie précédente et le souligne avec une pointe d’ironie et de désenchantement :
Les frustes villages que j’avais l’habitude de traverser […] ont fait place à des villes prospères. Le triomphe du métal est irrévocable, de même que la défaite de la terre. Je vois les traces de destruction et l’évidence de la prospérité. Non seulement le monde tourne, dit-on, mais il avance. L’histoire est une valse où les danseurs ne comptent pas. Alors je chante. Ma voix danse. Elle va et vient. Avance et recule.
I, 123 ; je souligne
Qui plus est, le monde moderne s’incarne dans la figure de son mari A…, un archéologue dont la grande force, tel un Franklin, est de ne jamais douter : « C’est un professionnel, un scientifique, il sait exercer son métier de façon impersonnelle, se protéger contre les doutes qui ne cessent d’émerger de sa recherche quotidienne. » (I, 58) Ce qu’il attend d’elle, tout aussi ironiquement, c’est qu’elle soit une « femme moderne » qui répond également aux stéréotypes de la féminité moderne poussés jusqu’au ridicule :
La tension devient énorme entre nous depuis que je lui ai avoué mes extractions antérieures, qu’il aurait préféré ignorer. Et surtout, mon envie de devenir moins femme, de m’élever un peu sur cette échelle infiniment longue qui mène au paradis des hommes. Il n’arrête plus de faire des commentaires sur ma manière d’être. Son inquiétude est telle qu’il me faut désormais fournir les preuves de ma parfaite pudeur et de mon incontestable féminité, et ce à tout moment et dans toutes les circonstances. Je n’ai plus le droit, pour m’asseoir, d’écarter les genoux. Et quand je prends n’importe quel objet, que ce soit une feuille ou une brique, je ferais mieux de me servir de trois doigts au lieu des cinq. En cas de nécessité, je peux avoir recours aux trois autres doigts de l’autre main — il adore cela — mais jamais davantage. Il me faut surtout manger modérément, parler avec retenue, porter des jupes courtes, faire attention à ma coiffure, en un mot, vivre avec élégance.
I, 11 ; je souligne
On comprend aisément, ici, que la Modernité est avant tout le temps des « hommes » et que c’est à celui-ci que la narratrice cherche aussi à échapper. D’ailleurs, A… a, comme Franklin, son « grand récit », son mythe fondateur qui lui permet de fonctionner sereinement dans le monde qui est le sien : il s’agit d’un livret généalogique, d’où, bien sûr, les femmes sont exclues (I, 9), et qui sert de fondement à sa mémoire et à son identité. Ainsi, alors que la narratrice est sans origine, sans ascendance et sans héritage, A… peut brandir à la face du monde une pléthore d’ancêtres et clamer qu’il appartient au temps long de l’Histoire. Dans ce contexte, si la narratrice ne veut pas réellement se défaire de son passé et de ses souvenirs, même traumatiques, c’est assurément parce qu’elle a le sentiment qu’elle doit expier sa faute (celle commise dans son autre vie, la trahison de son amant), mais aussi parce qu’ils sont, en quelque sorte, sa seule identité, sa seule origine et son seul héritage. Ici, certes, le Moderne s’oppose à l’Ancien, à la vie antérieure et non au contemporain, mais peut-être est-ce justement l’appartenance à des âges différents et le fait de ne pas être de la Modernité pure et simple, réduite à son expression stéréotypée, qui donneraient son caractère original au héros contemporain ?
Dans cette optique, le personnage de Mrs Greens dans La respiration du monde de Marie-Pascale Huglo apparaît lui aussi comme une héroïne de la résistance à la Modernité. Dans ce roman en « mode mineur », tout repose en fait sur la capacité de cette vieille femme à faire tenir — littéralement et symboliquement — le cottage qu’elle a transformé en pension à la mort de son mari, alors même que le village côtier où elle vit a été abandonné et que sa fille Elisa a déserté. Nous sommes cette fois dans un monde de l’entre-deux, sans repères temporels précis, mais il s’agit tout de même d’un monde « contemporain » où les ruines et les débris sont présents partout (sur la côte comme à la ville [LRM, 52], « là où ça se passe ! » [LRM, 48]), avec un passé qui ressurgit sans cesse dans la mémoire de la vieille femme, un présent inquiet dans lequel il faut se réfugier et un futur plus qu’incertain : « Aujourd’hui âme du logis, demain elle ne serait plus rien. » (LRM, 66) Le drame de cette vie de femme abandonnée est minuscule, le seul rêve qu’elle se permette étant de réunir la communauté du cottage autour d’un ragoût qu’elle a longuement préparé — ce qui n’arrivera finalement pas. Cependant, son héroïsme se dessine paradoxalement dans sa force de résistance aux vents violents, dans sa capacité à s’adapter à la vie rude et à tenir tête en quelque sorte à la modernité envahissante qui voudrait bien la voir disparaître, et cela sans jamais céder à la mélancolie ni à un immobilisme total :
Mrs Greens faisait corps avec les pierres, les poutres, les planches. De s’être enracinée ici — elle pourtant née ailleurs — la prenait à la gorge quand le tapage de la tempête approchante secouait les murs, l’atteignait dans sa chair, pénétrait jusqu’aux os. Mais à sa porosité de vieille souffrant de symbiose aiguë avec le monde autour, ballottée entre émerveillement et anxiété selon le temps, l’état, la lumière, à ces fluctuations faisant de sa vie une modulation infinie de gestes, d’inflexions de voix et de bruissements variables dont elle ne se lassait pas, à tout ce menu va-et-vient correspondait une exaltation excessive quand, passé le cap de la peur, montait l’envie de danser, de se jeter dans le vent comme elle se jetait, enfant, dans la gueule de la nuit.
LRM, 91
Dans ce roman, le contraste entre « l’ordinaire » et la nature sauvage (le paysage à la fois âpre et familier qui a façonné cette femme et qui reprend de plus en plus ses droits) met en relief la beauté et la richesse de la vie intérieure des personnages ainsi que celles des gestes familiers, répétitifs, qui sont comme la « respiration du monde » — mouvements souvent imperceptibles mais nécessaires, telle « la cime des grands pins du presbytère en ruine » (LRM, 9) qui oscille au gré de cette respiration. Ici aussi, la nature a refusé de se laisser dompter, de se plier à « nos » besoins, et Mrs Greens, tout comme Crozier, est la dernière survivante au milieu des ruines.
En somme, le héros contemporain pourrait bien être celui qui, en quelque sorte, se construit tout seul, avec quelques débris de mémoire et de signes, non pas parce qu’il tourne le dos à la famille et à l’amour, mais bien parce que c’est sa condition, d’être seul, de n’avoir que lui-même pour seule ressource et seul point de repère, lui-même et sa capacité d’introspection, sa capacité à remettre en cause l’ordre du monde et l’ordre des choses, sa capacité à réinvestir les signes autrement, à les recycler, et à faire preuve d’imagination. Ce héros, en revanche, n’est pas héroïque au sens traditionnel du terme, surtout que la vie et le destin se jouent souvent de lui et qu’il a très peu la possibilité d’agir sur le monde. C’est pourquoi, me semble-t-il, son temps est celui de l’immobilité, mais d’une immobilité physique ou symbolique à laquelle il oppose toujours le mouvement de son esprit, de ses mains ou encore de sa plume — il se différencierait ainsi des personnages littéralement immobiles, tels ceux de Jean-Philippe Toussaint en France[34]. De même, si l’individu moderne (ou l’un de ses prolongements, le personnage réaliste) avait perdu ses repères, c’est que son individualité ne comptait pas tellement face à la marche de l’Histoire et du Progrès (« L’histoire est une valse où les danseurs ne comptent pas », dit la narratrice d’Immobile), sauf s’il arrivait justement à imprégner sa marque sur cette Histoire. Pour l’être contemporain, cette échappée n’est plus réellement possible quand elle n’est pas tout bonnement dérisoire ; le culte du présent, le « triomphe du métal » sur la terre, l’emprise de l’immédiat, les succès éphémères et la succession constante des images (ou bien métaphoriquement : la neige et la glace, la ville, le vent) effacent sans cesse ses traces et lui font douter de sa propre présence et de son identité.
Là où ce personnage triomphe, cependant, c’est dans sa fidélité à lui-même et dans les actes de résistance qu’il oppose aux bêtises d’une modernité sans jugement et aux héros qu’elle se donne. C’est dans sa capacité à se rendre réellement présent au monde qui est le sien, à faire corps avec lui, à constater les failles de son régime d’historicité et à trouver de nouveaux points de repère dans un monde désormais vidé de sens. Il écrit ou invente des constellations, comme Crozier, ou bien il chante comme la narratrice d’Immobile dans l’espoir d’être entendu, ou bien encore il habite son temps immobile en occupant ses mains comme Mrs Greens (« Tant que ça ne m’empêche pas de vaquer », dit-elle lorsqu’elle est prise de vertiges [LRM, 81]), en emplissant le quotidien de menus faits et gestes qui lui permettent de tenir — littéralement et symboliquement. Ce faisant, il n’est sans doute pas faux de voir dans ces caractéristiques que j’attribue au héros contemporain des traits du présentisme tel que l’a défini Hartog, mais il s’agit à coup sûr d’un présentisme conscient de lui-même, qui cherche des solutions dans l’écoute intérieure, la fidélité à soi, ainsi que dans le récit qu’il peut fournir du monde, aussi minime soit-il — ce serait alors le versant plus positif de cette « immobilité » et de cet « effacement » que plusieurs commentateurs de la littérature actuelle remarquent. Sur le sujet, Daniel Letendre suggère que le personnage contemporain se définit désormais moins par son agir que par sa prise de parole. Il propose : « Celui qu’on croyait inapte à s’engager dans le monde s’est plutôt décidé à le raconter[35]. » Dans ces conditions, ajouterais-je, il s’ancre dans le présent de l’écriture et de la parole, seuls points de repère pensables, même si ce présent menace autrement de l’écraser ; il s’obstine aussi à laisser des traces qui, même insignifiantes, témoignent de sa présence dans un monde hostile. Et ce serait peut-être, finalement, dans le sacrifice que ces personnages doivent faire d’eux-mêmes pour que la marche du monde continue que quelque chose d’héroïque se dessine véritablement. La narratrice d’Immobile accepte ainsi que son immobilité physique soit la cause de sa destruction :
Je préfère traîner mes jours indignes et vains, dans les ténèbres de la mémoire, loin de lui, loin de tout espoir de guérison, afin que tout s’achève naturellement. Alors je reste là, immobile et sans défense. Comme un rocher. Un rocher parmi d’autres que la ville décidera de réduire en poussière pour quelque cause urgente, et sans doute grandiose.
I, 155 ; je souligne
Car, ne l’oublions pas, notre contemporain, tout irrigué de présentisme qu’il soit, est encore, malgré tout, « brutalement moderne[36] » : il croit encore dans la marche des empires et du Progrès, en la soumission intempestive et déraisonnée de la Nature, en l’homogénéisation des cultures ; il promeut l’individualité sans chercher pour autant le bien-être des individus, l’humanisme perdant toujours du terrain. Dans ces conditions, sans doute sommes-nous tous immobiles, voués à la disparition dans un monde qui tourbillonne sans cesse, mais nous pouvons encore résister chacun à notre façon. Créer nos propres rythmes plutôt que de s’étourdir, ou encore faire de Francis Crozier et de Mrs Greens des héros dignes d’être racontés.
Parties annexes
Note biographique
MANON AUGER est agente de recherche et chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal. Elle a fait ses études à l’Université Laval puis à l’UQAM, où elle a collaboré à de nombreux projets avec Robert Dion. Sa thèse, parue aux Presses de l’Université de Montréal sous le titre Journaux intimes et personnels au Québec : poétique d’un genre littéraire incertain (2017), s’est mérité le prix Jean-Éthier-Blais de la critique en 2018. Manon Auger a également publié plusieurs articles sur divers journaux intimes québécois dans Voix et Images, @nalyses, Tangence et Oeuvres & Critiques, ainsi qu’un collectif, Entre l’écrivain et son oeuvre, avec la collaboration de Marina Girardin, aux éditions Nota bene (2008). Ses champs de spécialité sont la littérature québécoise, les écritures (auto)biographiques, ainsi que les enjeux de la littérature et de la création littéraire contemporaines.
Notes
-
[1]
Michel Biron, « Il a plu hier », Voix et Images, vol. XXVIII, no 3, printemps 2003, p. 151.
-
[2]
Carl Leblanc, Le personnage secondaire, Montréal, Boréal, 2006, 245 p.
-
[3]
Dominique Raymond, « Brèves. Personnage peu marquant, lecteur peu marqué », Penser la narrativité contemporaine [blogue, entrée du 14 mai 2013], en ligne : http://penserlanarrativite.net/archives/739 (page consultée le 3 décembre 2018).
-
[4]
Pour un aperçu des études sur le personnage contemporain, voir entre autres : Michel Biron, « L’effacement du personnage contemporain : l’exemple de Michel Houellebecq », Études françaises, vol. XLI, no 1, 2005, p. 27-41 ; Oana Panaïté, « Poétiques du personnage contemporain », Françoise Lavocat, Claude Murcia et Régis Salado (dir.), La fabrique du personnage, Paris, Honoré Champion, coll. « Colloques, congrès et conférences. Littérature comparée », 2007, p. 499-510 ; Nicolas Xanthos, « Raconter dans le crépuscule du héros. Fragilités narratives dans le roman d’enquête contemporain », Frances Fortier et Andrée Mercier (dir.), La transmission narrative. Modalités du pacte romanesque contemporain, Québec, Nota bene, coll. « Contemporanéités », 2011, p. 111-125 ; le dossier intitulé « Le roman contemporain au détriment du personnage » dirigé par René Audet et Nicolas Xanthos, L’esprit créateur, vol. LIV, no 1, printemps 2014, p. 1-149.
-
[5]
L’acception du terme est effectivement double : « Le héros littéraire est le personnage dont la reconnaissance procède à la fois d’une définition fonctionnelle — il est le personnage principal, souvent éponyme de l’oeuvre — et d’une caractéristique axiologique — il est celui qui porte […], défend ou remet en cause les valeurs dominantes de la société. » Florence De Chalonge, « Héros et antihéros », Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala (dir.), Le dictionnaire du littéraire, avec la collaboration de Marie-Andrée Beaudet, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 273.
-
[6]
Pensons par exemple à la fonction de « héros » dans le célèbre schéma actantiel de Propp, ou aux héros de la littérature populaire, mais aussi aux « premiers » héros de la littérature du xviie jusqu’au début du xixe siècle. Sur le sujet, Isabelle Daunais explique : « En venant au monde, le héros réunit en une seule action son arrivée dans le temps terrestre, et donc la démarcation entre un avant et un après, la singularité et l’exemplarité qui expliquent que cette venue au monde mérite d’être racontée. » Isabelle Daunais, Frontière du roman. Le personnage réaliste et ses fictions, Montréal/Saint-Denis, Presses de l’Université de Montréal/Presses universitaires de Vincennes, coll. « Espace littéraire », 2002, p. 31.
-
[7]
Carl Leblanc, Le personnage secondaire, p. 138.
-
[8]
Régime essentiellement prospectif qui « prend forme autour de 1789 » avec la Révolution française et qui perd « de son évidence » autour de 1980 avec, entre autres, la montée des crises écologiques et économiques et les contrecoups des deux Guerres mondiales, nous plongeant alors dans un régime d’historicité présentiste que j’associe pour ma part à l’étiquette « contemporain », qui englobe ce phénomène sans s’y résumer. Voir François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2003, p. 112 et p. 152.
-
[9]
François Hartog, Régimes d’historicité. Voir également l’introduction du présent dossier : Manon Auger et Marion Kühn, « Expériences contemporaines du temps dans les fictions québécoises », Voix et Images, vol. XLIV, no 2, hiver 2019, p. 7-12.
-
[10]
Dominique Fortier, Du bon usage des étoiles, Québec, Alto, coll. « Coda », 2010 [2008], 340 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle DBU suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[11]
Ying Chen, Immobile, Montréal, Boréal, 1998, 155 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle I suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[12]
Marie-Pascale Huglo, La respiration du monde, Montréal, Leméac, 2010, 165 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LRM suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[13]
Pierre-Paul Ferland, « Un mythe canadien ? », Salon double. Observatoire de la littérature contemporaine, 14 septembre 2013, en ligne : http://salondouble.contemporain.info/lecture/un-mythe-canadien (page consultée le 3 décembre 2018). L’auteur souligne.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
Manon Auger, « Tordages de siècles et autres jeux avec l’histoire : quelques nouvelles voix féminines du roman contemporain », Québec français, no 175, juin 2015, p. 90-93.
-
[16]
Robert Dion et Andrée Mercier, « Introduction. La littérature québécoise est-elle une insondable nébuleuse ? », Robert Dion et Andrée Mercier (dir.), Que devient la littérature québécoise ? Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990, Québec, Nota bene, 2017, p. 22-23.
-
[17]
Josée Marcotte, « L’imagination en matière de navigation », Salon double. Observatoire de la littérature contemporaine, 23 avril 2009, en ligne : http://salondouble.contemporain.info/lecture/limagination-en-matiere-de-navigation (page consultée le 3 décembre 2018).
-
[18]
Ibid.
-
[19]
Mathieu Bélisle, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, Montréal, Leméac, coll. « Phares », 2017, p. 204.
-
[20]
Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1979, 128 p.
-
[21]
Quatrième de couverture de la première édition [2008].
-
[22]
Si, comme le remarque Hartog, « le 20e siècle est celui qui a le plus invoqué le futur, le plus construit et massacré en son nom, qui a poussé le plus loin la production d’une histoire écrite du point de vue du futur, conforme aux postulats du régime moderne d’historicité » (Régimes d’historicité, p. 201), le xixe siècle a beaucoup contribué à mettre en place ces idéaux futuristes.
-
[23]
Raymond Bock, « Le vieux et le neuf », Québec français, no 175, 2015, p. 96.
-
[24]
Mathieu Bélisle affirme pour sa part « qu’il est clair qu’il [le narrateur] a choisi de maintenir la même position de neutralité vis-à-vis de tous les personnages » (Bienvenue au pays de la vie ordinaire, p. 202), affirmation avec laquelle je ne suis pas d’accord. Il me semble en effet que la profonde sympathie que l’on éprouve pour Francis Crozier et le matelot Adam est en partie attribuable au fait qu’ils sont exemptés du ton satirique du narrateur auquel aucun autre personnage n’échappe.
-
[25]
Ibid., p. 201-202.
-
[26]
Ibid., p. 202.
-
[27]
Illustration parfaite du carnaval, selon Blanche Cerquiglini, puisque « les petits deviennent des grands, les grands des petits ». Blanche Cerquiglini, « Quand la vie est un roman. Les biographies romanesques », Le Débat, no 165, 2011, p. 152.
-
[28]
Il écrit : « L’oeuvre de Fortier ne conduit pas à la découverte du point de vue de Sancho ni ne cherche à l’apprivoiser comme s’il lui avait été d’abord étranger. Ce que cette oeuvre révèle, c’est que le prosaïsme comme manière de voir et de sentir constitue, au pays de la vie ordinaire, un trait acquis, un trait qu’elle ne sent pas le besoin d’affirmer ou de confirmer, comme c’était le cas chez plusieurs écrivains des années 1960. » Mathieu Bélisle, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, p. 203. L’auteur souligne.
-
[29]
Ibid., p. 202.
-
[30]
Ibid., p. 204.
-
[31]
Michel Erman utilise le terme pour parler des personnages de François Taillandier et de Jean Echenoz, entendant par là « qu’ils ne représentent pas un monde mais qu’ils en portent seulement les traces ». Il spécifie par ailleurs : « Ces personnages sont, certes, plongés dans le flux de la vie mais ils se heurtent aux autres et ne pèsent guère sur les événements. On dirait qu’ils considèrent l’existence à partir de l’absence et qu’ils peinent à s’inscrire dans le temps. Antihéros ballottés dans un monde anonyme, ils représentent sans doute en creux une défense contre les angoisses contemporaines liées aux phénomènes de mondialisation des relations et des échanges. Il convient aussi de remarquer qu’ils n’ont pas un langage qui leur est propre et qu’ils rompent, ainsi, avec une des caractéristiques essentielles du personnage de roman au xxe siècle. » Michel Erman, « À propos du personnage dans le roman français contemporain », Études romanes de Brno, L 24, 2003, p. 168, en ligne : https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/113335/1_EtudesRomanesDeBrno_33-2003-1_19.pdf?sequence=1 (page consultée le 3 décembre 2018).
-
[32]
Michel Biron, « Premiers romans », Voix et Images, vol. XXIX, no 3, printemps 2004, p. 158-159.
-
[33]
Isabelle Daunais, Frontière du roman, p. 191.
-
[34]
Le personnage de La salle de bain (Paris, Éditions de Minuit, 1985, 122 p.), par exemple, qui décide, sans raison, de vivre dans sa baignoire ou encore celui de La télévision (Paris, Éditions de Minuit, 1997, 269 p.) qui « se condamne à l’immobilisme en confondant son existence avec celle du tube cathodique » (!) ; voir Oana Panaïté, « Poétiques du personnage contemporain », p. 507.
-
[35]
Daniel Letendre, « La révolte du personnage. Narration et résistance chez Chloé Delaume et François Bon », Temps zéro, no 9, 2015, § 4, en ligne : http://tempszero.contemporain.info/document1232 (page consultée le 3 décembre 2018).
-
[36]
Expression que j’emprunte à Samuel Archibald, « La Tchén’ssâ, les régions et moi. Entretien de Samuel Mercier avec Samuel Archibald », Québec français, no 175, 2015, p. 99.