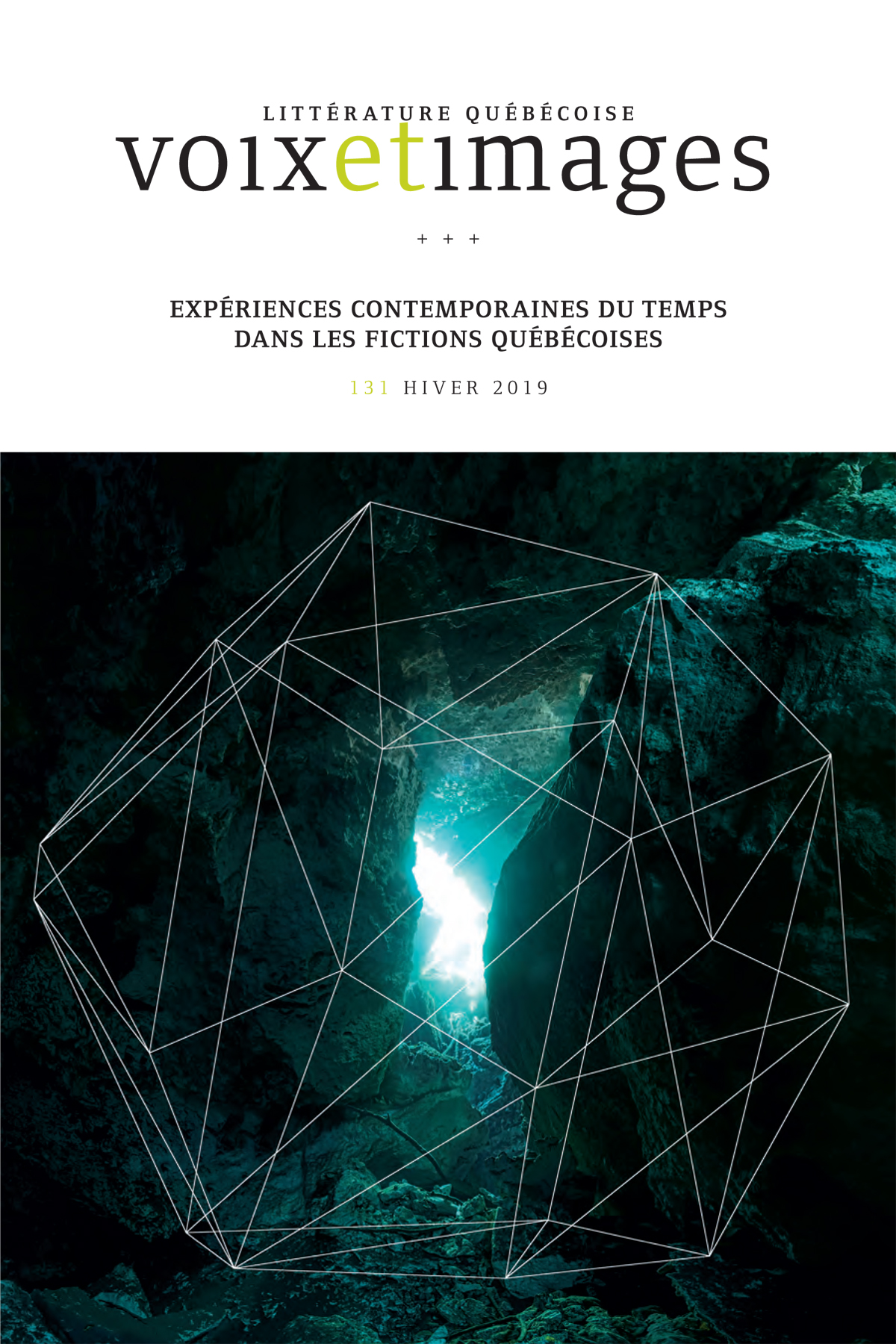Résumés
Résumé
Le motif de la filiation sert, comme l’ont démontré les travaux de Dominique Viart, puis de Laurent Demanze, en littérature contemporaine, le plus souvent à exprimer les enjeux d’une transmission défaillante de la mémoire familiale. Sujet au coeur de multiples romans et récits contemporains au Québec, la tentative d’appropriation fictionnalisée d’un passé familial inconnu relève, chez Anaïs Barbeau-Lavalette, Carole David et Judy Quinn, de ce qu’Astrid Erll appelle une « mémoire transculturelle », car c’est un passé autre qui fait irruption dans le présent des personnages. Construits autour de départs de membres de famille, les fictions des trois écrivaines imbriquent en effet mémoire familiale et histoire internationale en embrassant soit le point de vue en amont, soit celui en aval de la lignée familiale. Par le truchement de dispositifs narratifs et temporels complexes, qui servent de point de départ pour l’analyse, les fictions mettent à l’avant-plan le rôle des personnages comme porteurs d’une mémoire qui s’avère stratifiée. Dégageant les différents rapports au temps qui sous-tendent les mises en scène de mémoires « voyageantes », cet article fait l’analyse de la variété des postures proposées par ces fictions québécoises contemporaines face au « présent [qui] s’[est] découvert inquiet, en quête de racines, obsédé de mémoire » (Hartog 2012 : 248).
Abstract
Dominique Viart and subsequently Laurent Demanze have shown that the motif of filiation, in contemporary literature, is most often used to express issues related to a defective transmission of family memory. A topic at the heart of many contemporary Québec novels and narratives, the fictionalized attempt to appropriate an unknown family past, as it appears in the work of Anaïs Barbeau-Lavalette, Carole David and Judy Quinn, belongs to what Astrid Erll calls a “transcultural memory,” because it is an other past that bursts in on the characters’ present. Built around the departures of family members, the fictions of these three writers intertwine family memory and international history, taking a view either upstream or downstream from the family lineage. Using complex narrative and temporal devices that serve as a starting point for analysis, the fictions foreground the role of the characters in carrying a memory that reveals itself as stratified. Showing the various relations to time that underlie the presentations of “travelling” memories, the article analyzes a range of postures put forward by these contemporary Québec fictions in relation to a present that has discovered itself to be “inquiet, en quête de racines, obsédé de mémoire” (Hartog 2012: 248).
Resumen
El motivo de la filiación sirve, como lo demostraron los trabajos de Dominique Viart, y luego de Laurent Demanze, en la literatura contemporánea, las más de las veces para expresar lo que está en juego en una transmisión menguante de la memoria familiar. Tema central de múltiples novelas y relatos contemporáneos en Quebec, el intento de apropiación ficcionalizada de un pasado familiar desconocido depende, en Anaïs Barbeau-Lavalette, Carole David y Judy Quinn, de lo que Astrid Erll llama ‘memoria transcultural’, dado que es un pasado distinto el que irrumpe en el presente de los personajes. Construidas en torno a la partida de miembros de la familia, las ficciones de las tres escritoras imbrican, en efecto, la memoria familiar y la historia internacional al abarcar ya sea el punto de vista de más atrás o hacia adelante del linaje familiar. Mediante dispositivos narrativos y temporales complejos, que sirven de punto de partida para el análisis, las ficciones sitúan en primer plano el papel de los personajes como portadores de una memoria que resulta estratificada. Despejando las diversas relaciones del tiempo en que se apoyan las escenificaciones de memorias ‘viajeras’, este artículo analiza la variedad de posturas propuestas por estas ficciones quebequenses contemporáneas frente al “presente [que] se descubrió inquieto, a la búsqueda de raíces, obsesionado con la memoria” (Hartog 2012: 248).
Corps de l’article
Le « boom de la mémoire » fortement commenté du côté des sciences humaines[1] se décèle aussi dans la littérature québécoise actuelle. Cependant, la « relecture [du passé] depuis le point de vue du présent[2] » concerne ici le plus souvent, suivant Robert Dion, la petite histoire, soit l’« histoire des oublié(e)s, de figures non héroïques plongées dans les circonstances ordinaires[3] ». Parallèlement, Dion remarque au Québec un intérêt prononcé pour l’histoire des autres, la « grande » cette fois-ci, « comme si les romanciers du Québec avaient du mal à relier l’expérience de leur passé propre à leur situation présente, à en extrapoler les répercussions dans un hic et nunc devenu par là même mieux interprétable[4] ». Cela est visible, entre autres, dans des romans comme Le ciel de Bay City (2008) de Catherine Mavrikakis, qui traite de ce que Marianne Hirsch appelle la « postmémoire[5] » de l’holocauste, ou Revoir Nevers (2005) de Roger Magini, qui se penche sur la commémoration d’Hiroshima, deux romans dont la diégèse est située à l’extérieur du Québec.
Les divers écrits narratifs d’Anaïs Barbeau-Lavalette, de Carole David et de Judy Quinn vont toutefois à l’encontre de cette tendance extériorisante en ce qu’ils scrutent des expériences de l’autre — culturel ou géographique — en essayant de les lier à leur présent. En effet, La femme qui fuit[6] de Barbeau-Lavalette est une restitution très personnelle de la collaboration de sa grand-mère d’origine ontarienne au mouvement automatiste, tandis que les fictions de David et de Quinn explorent, depuis le présent, la participation d’un aïeul à la Seconde Guerre mondiale et le passé mouvementé d’immigrants. Construites autour de ce que Stéphane Inkel appelle des « filiations rompues[7] », c’est-à-dire des histoires de famille qui comportent des blancs et des inconnus, ces fictions se penchent soit sur des générations précédentes, soit sur celle qui vient après. Si La femme qui fuit, Impala[8] et Hunter s’est laissé couler[9] mettent en scène des enquêtes portant sur les mystères entourant des aïeux, Les mains noires[10] et Hollandia[11] ne se limitent pas à ce « regard amont[12] » qui caractérise les récits de filiation tels que définis par Dominique Viart[13] puis Laurent Demanze[14]. Le deuxième roman de Quinn et la nouvelle de David incluent en effet un « regard en aval » de la lignée familiale en embrassant le point de vue de « taiseux[15] » dont le présent se trouve soudainement envahi par le passé en raison du départ des fils des protagonistes.
Par le truchement de cette « figure privilégiée de notre contemporanéité[16] » que constitue le motif de la filiation, ces fictions illustrent alors une nouvelle phase des études de la mémoire, soit celle de la « mémoire transculturelle » proposée par Astrid Erll[17] et repérée par Anne Martine Parent dans Le ciel de Bay City de Mavrikakis, Hollandia de David et Guyana d’Élise Turcotte. À l’aide des notions de « postmémoire » et de « mémoire prosthétique[18] », Parent dégage de quelle manière « un passé traumatique appartenant à d’autres histoires nationales[19] » peut s’ingérer dans le présent d’un personnage, et ce, sans que le personnage soit entièrement conscient du pourquoi cet événement le hante. De tels « déplacements de la mémoire » font suite à des déplacements de personnages chez Barbeau-Lavalette, David et Quinn, où une telle hantise est liée à un départ ou à la disparition d’un membre de la famille. Imbriquant de la sorte la grande histoire et celle de familles québécoises, les fictions des trois écrivaines mettent à l’avant-plan le rôle des personnages comme porteurs de mémoire, une mémoire qui s’avère stratifiée, voire multiple en ce qu’elle mélange souvenirs, héritages et histoires d’ici comme d’ailleurs.
Dans le prolongement des analyses de Parent, je me propose d’approfondir l’étude de cette dimension « humaine » de la mémoire qui traverse les frontières chez Barbeau-Lavalette, David et Quinn, et ce, en portant une attention particulière à la mise en récit des différentes tentatives pour saisir le passé et le présent. En accueillant la part de l’autre dans la mémoire québécoise contemporaine, ces trois auteures conçoivent en effet divers cas de figure d’une transmission défaillante de la mémoire transculturelle qui révèle une variété d’expériences possibles de la relation entre présent et passé. L’analyse du dispositif narratif et temporel de ces trois tentatives de saisir l’autre (l’aïeul[e]), dans Impala, La femme qui fuit et Hunter s’est laissé couler, montrera que, dans ces trois textes qui s’inscrivent sur le canevas d’un récit de filiation « classique », la restitution du passé ne sert pas du tout la même fin — comprendre un abandon dans le cas de David et de Barbeau-Lavalette, et esquisser le portrait d’un grand-père inconnu dans celui de Quinn —, et illustre des postures divergentes vis-à-vis du passé à saisir. Puis, l’analyse des deux oeuvres qui incluent un « regard en aval » en opposant l’expérience de la mémoire de deux ou plusieurs générations, soit Les mains noires et Hollandia, visera, quant à elle, à distinguer des formes défaillantes d’une mémoire générationnelle « voyageante » en comparant l’expérience du temps des deux personnages pivots qui composent différemment avec le passé familial.
REGARDS EN AMONT : DESTRUCTION, APPROPRIATION ET EFFACEMENT
Le premier roman de Carole David, Impala, met en scène la transformation d’une quête de soi en une histoire de revanche. Abandonnée successivement par ses deux parents, Louisa, une jeune Montréalaise, livre depuis la prison un récit s’ouvrant sur le suicide de sa mère et se terminant par le meurtre de son père. Ayant grandi dans l’univers du faux et de l’incertitude d’une communauté italienne déracinée[20], Louisa n’a pas de repères identitaires stables, d’autant plus qu’Angelina, sa grand-tante maternelle qui l’a élevée, a instauré « la loi du silence » et ne parlait jamais du passé, ce qui a empêché la formation de ce que Jan Assmann appelle une « mémoire communicationnelle », soit ce « souvenir vivant[21] » des mémoires autobiographiques transmises au sein d’une famille. Cette expérience douloureuse d’un défaut de communication se cristallise chez elle en un cauchemar récurrent qui dresse un parallèle entre la perte de ce que Paul Ricoeur appelle « l’identité narrative[22] » et la perte de la vie. Rêvant que leur maison brûle, Louisa aperçoit sa mère, son père, sa grand-tante et elle-même :
Debout autour du feu, nous récitions une prière. Ce n’était pas vraiment une prière, mais le récit de nos vies. Chacun racontait sans écouter les autres. Il fallait faire très vite, car les murs commençaient à tomber. Il ne resterait plus à la fin qu’un trou béant et anonyme qui aurait contenu nos vies.
I, 28
C’est à partir de bribes de conversation et surtout de recherches menées après le départ d’Angelina dans une maison de retraite que la narratrice réussit à percer le mystère de l’abandon et à entrer en contact avec sa mère, qui est en prison et lui apprend qu’elle a été forcée par la mafia d’avouer un meurtre commis en réalité par son mari. Une fois sa quête accomplie, Louisa affronte son père. Face à son intransigeance, elle finit par le tuer dans un acte qui brise la « loi du silence » et de la soumission à laquelle s’étaient assujetties des générations de femmes avant elle. Accusée de meurtre, elle semble refaire le parcours de sa mère, mais en le corrigeant : elle commet effectivement le crime pour lequel sa mère a été punie, et ce, tout en la vengeant. En prison, elle s’avoue hantée par des images du passé, des « fantômes » (I, 127), dont seul le travail abrutissant de la prison la sauve temporairement. La jeune incarcérée se sent en effet prisonnière d’un présent dilaté qui lui dérobe l’avenir : « Le temps n’avance plus. Il s’est arrêté depuis que j’ai voulu moi-même mettre fin à cette histoire. » (I, 124) C’est son récit qui l’ancre dans le présent et l’aide à maîtriser son histoire familiale pour, dans les mots de Demanze, « n’en plus subir le joug inconscient[23] ». L’acte de mettre en mots son histoire, de briser le silence, lui apporte en effet « les seuls moments où [elle] reprend […] vie » (I, 127), en plus de lui permettre de laisser une trace de sa mère. Cette tentative violente (meurtrière) pour se libérer de l’emprise du passé suggère toutefois qu’il ne peut, au bout du compte, être réparé par des actes, mais seulement maîtrisé par les mots.
Une autre tentative pour maîtriser l’histoire familiale en la racontant se dessine dans La femme qui fuit, le premier roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette, texte autofictionnel qui essaie, lui aussi, de percer le mystère d’un abandon. La cinéaste québécoise s’adresse ici à sa grand-mère maternelle, Suzanne Meloche, poétesse et peintre membre du mouvement automatiste, figure qu’elle n’a pas connue, mais qui a toutefois fortement imprégné sa vie en raison de l’abandon de ses enfants : « Parce que je suis en partie constituée de ton départ. Ton absence fait partie de moi, elle m’a aussi fabriquée. » (LF, 376) Cet héritage d’une absence explique son désir de « raconter » (ibid.) sa grand-mère, et ce, au bénéfice de sa mère profondément blessée : « Tu as fait un trou dans ma mère et c’est moi qui le comblerai. » (LF, 346) Ainsi, Barbeau-Lavalette livre une version très personnelle d’un chapitre de l’histoire culturelle québécoise, son récit s’appropriant la vie de son aïeule afin de mettre en avant les implications familiales de cette période mouvementée. S’adressant à celle qui a abandonné sa mère, l’auteure-narratrice déploie un récit en forme de boucle dans lequel sa propre naissance encadre l’histoire de vie chronologique de son aïeule, s’inscrivant, de cette façon, dans une histoire familiale qui la précède.
Renfermant des documents authentiques comme une photo de famille (LF, 226) et une lettre (remaniée) de Marcel Barbeau à Paul-Émile Borduas (LF, 227), le roman de Barbeau-Lavalette est le résultat d’une enquête pour laquelle l’auteure a sollicité les souvenirs de multiples témoins ainsi que l’aide d’une détective privée qu’elle remercie en fin de volume. Son récit revendique toutefois l’usage de la fiction afin de « [s]e l’[Suzanne] inventer sur mesure » (LF, 377 ; l’auteure souligne) ; il est ainsi une « figuration[24] », c’est-à-dire une reconstruction par les moyens de la fiction de l’histoire familiale de Barbeau-Lavalette, dont la véracité, finalement, reste incertaine. Il en résulte un récit mêlant inextricablement faits et fiction à la recherche d’une histoire cohérente pour compenser le silence de l’abandon.
À travers la configuration de son récit, Barbeau-Lavalette commet toutefois clairement un geste d’appropriation très maîtrisé dont témoignent en particulier trois éléments du dispositif temporel et narratif du roman. D’abord, la narratrice, qui s’adresse à la deuxième personne du singulier à son aïeule, ponctue son récit de prolepses (par exemple : LF, 85, 87, 315), marquant ainsi son autorité qui ne se veut pas que narrative. Du haut de sa postériorité, elle peut en effet, par exemple, annoncer à sa grand-mère : « Tu sais maintenant que tu as un ailleurs. Ce que tu ne sais pas, c’est que tu en auras toujours un, et jamais le même. Ce sera ta tragédie. » (LF, 87) S’affranchissant ainsi du rôle de victime de l’abandon, elle se place en position de pouvoir, ce qui lui permet de résumer la vie de son aïeule de son point de vue, voire de lui annoncer le cours de sa vie telle une narratrice omnisciente à son personnage.
Ce personnage est, ensuite, placé dans une lignée familiale de quatre générations à travers laquelle un réseau de liens et d’oppositions crée une chaîne d’échos. La narratrice crée, de fait, une filiation en soulignant les parallèles dans les vies de son arrière-grand-mère, Claudia, de sa grand-mère, Suzanne, et de sa mère, qu’elle désigne par le surnom Mousse. Tel un leitmotiv, la narratrice évoque le piano muet dans le salon des arrière-grands-parents, intouché depuis la décision de Claudia d’abandonner la passion de son adolescence, épuisée et dépossédée de ses aspirations de musicienne par les tâches de la vie familiale. Le « souvenir des notes éteintes d’un piano » (LF, 174) poursuit Suzanne lorsqu’elle se rend compte que son mari a peint sur l’un de ses dessins pour économiser de la toile, acceptant en silence que son travail soit plus important que le sien. De plus, l’engagement de Suzanne et de sa fille auprès des Autochtones établit à distance un parallèle, une sorte d’héritage du militantisme (LF, 176). Renforçant de la sorte l’impression d’un lien familial à travers la distance et le temps, la narratrice se sert de la constellation des personnages afin de mieux (faire) comprendre les motifs de sa grand-mère. Ainsi, à Claudia, ce symbole de l’effacement de soi-même et de la soumission qui guette la femme assoiffée de liberté qu’est Suzanne, s’oppose le personnage de la célèbre coureuse Hilda Strike, l’idole de jeunesse de Suzanne. Lorsqu’elle rencontre l’ancienne athlète par hasard dans sa vieillesse, Suzanne doit toutefois réaliser, désillusionnée, que le point commun entre elle-même, qui s’est enfuie toute sa vie, et son idole « qui a couru toute sa vie » est que « personne ne s’en souviendra » (LF, 366).
Finalement, le troisième élément textuel permettant une meilleure compréhension des gestes de l’aïeule est l’adoption d’une structure temporelle et narrative en boucle. En effet, relatant les rares rencontres avec sa grand-mère, la narratrice explique dans la première partie non titrée du récit le déclencheur de sa quête : en fouillant dans les objets légués par Suzanne (héritage auquel les deux femmes ne s’attendaient pas), elle se découvre « avide d’indices » d’elle (LF, 18). Dans l’économie du récit, la citation de Nancy Huston[25] mise en exergue souligne ce sentiment d’appartenance à une lignée familiale qui persiste malgré l’abandon. Puis, le récit relate, de manière chronologique, la vie mouvementée de ce « tu » inconnu, débouchant sur une reprise exacte de la scène du début du roman qui place la narratrice et sa mère dans l’appartement de la défunte, à cette différence près que l’héritage n’est plus une surprise, car la rencontre de la grand-mère avec son idole Hilda Strike explique son désir de laisser des souvenirs. Ayant montré, de la sorte, que le cheminement de la quête permet à la narratrice de fournir une explication sur le comportement de sa grand-mère, le récit rejoint ensuite le présent de l’après-quête, marqué simultanément par la fin de la présence oppressive du passé et la continuité de la lignée familiale. Face à la tombe de sa grand-mère, le lieu de son dernier repos qui symbolise ici la fin de toute fuite, la narratrice, qui tient dans ses bras sa fille, accepte son héritage grand-maternel, « ce besoin d’être libre, comme une nécessité extrême » (LF, 378), avant de s’en distancier en mettant de l’avant l’importance des liens familiaux — « Je suis libre ensemble, moi » (LF, 376) —, affirmant ainsi que son présent à elle lui permet de concilier sa soif de liberté créatrice et sa vie de famille.
Tandis que l’auteure-narratrice de La femme qui fuit s’approprie le passé de l’autre afin de mieux se libérer de son emprise, la narratrice du premier roman de Judy Quinn, Hunter s’est laissé couler, s’efface quant à elle devant l’impossibilité de saisir le passé, voire une autre personne, par le récit. Plus précisément, et comme je l’ai souligné ailleurs[26], ce roman en trois parties entraîne le lecteur dans une recherche d’indices qu’il doit accomplir à la place de la petite-fille de Hunter et de Nanette, cela afin de reconstruire les événements de la Seconde Guerre mondiale qui ont traumatisé le grand-père éponyme, un ancien marin, et tué le frère de sa grand-mère, Léopold, un pilote « [d]isparu au-dessus d’Essen » (HLC, 173), en Allemagne. Au lieu d’offrir le résultat de la recherche de manière romancée, ce récit s’ouvre sur une mise en garde, dans laquelle la descendante de Hunter souligne que l’on « ne connaîtra jamais que le nom » (HLC, 11) de ce dernier avant de présenter les sources de sa recherche : le journal d’un passager clandestin d’un navire de l’armée canadienne traduit de l’anglais par la narratrice initiale, ainsi qu’une entrevue enregistrée par la même jeune femme avec un ami d’enfance de Hunter, dénommé Victor Souci. Ces deux documents permettent de comprendre qu’un jeune aviateur ayant déserté l’armée britannique avait contacté Hunter en évoquant une connaissance commune, Léopold, soit le frère de la fiancée de Hunter (Nanette), avant le départ de leur navire pour le Canada, mais que c’est finalement Victor qui accepte de cacher le déserteur dans les tuyaux d’aération. C’est là que le passager clandestin trouve la mort après un raid aérien, malgré les tentatives désespérées de Hunter pour le sauver. En révélant cet épisode passé sous silence pendant des années, Victor décrit Hunter comme un homme meurtri et las, « droit » (HLC, 55), mais « abonné au malheur » (HLC, 70).
La dernière partie du roman de Quinn rompt avec ce dispositif narratif, car elle plonge directement dans le passé afin de raconter la mort de Léopold en Europe. Dès lors, le lecteur n’apprend pas seulement les circonstances de celle-ci, mais découvre aussi la relation complexe entre Léopold, Nanette et Hunter, le premier s’étant apparemment engagé dans l’armée en raison de ses sentiments pour le fiancé de sa soeur, ce qui explique la culpabilité incommensurable de Hunter. Ouvertement fictionnel — l’instance narrative a accès aux pensées de Léopold —, ce récit est dépourvu de la « vraisemblance pragmatique[27] » qui caractérisait les deux récits précédents. Il s’agit donc d’une « figuration » du passé dans le sens de Viart, qui comble les trous de l’histoire tout en s’affichant comme une interprétation fictionnalisée des faits. Celle-ci se base sur les documents placés en première et en deuxième partie, mais aussi sur les recherches de Nanette, entrées depuis dans la « mémoire communicationnelle » de la famille et dont se sert la narratrice.
S’effaçant presque complètement, cette narratrice en retrait met à l’avant-plan le passé, mais sans restituer une filiation ; elle esquisse plutôt un portrait en creux de son grand-père. Ce faisant, elle dévoile ses sources, ce seul accès au passé, conférant ainsi au lecteur le rôle de l’enquêteur avant de présenter une version ouvertement fictionnelle des faits afin de mettre en lumière l’insaisissabilité du passé qu’on ne peut qu’imaginer par le biais de la fiction. Son récit ne peut donc pas offrir de consolation à sa grand-mère tourmentée par la disparition de son frère « qu’elle considérait comme non résolue » (HLC, 173). Discrète sur sa propre expérience d’une transmission défaillante de la mémoire, la narratrice offre des indices expliquant le malheur et le silence de son grand-père, mais ne construit pas de pont entre son passé à lui et son présent à elle. En bref, contrairement à Barbeau-Lavalette, elle essaie de cerner Hunter en tant qu’individu et non en tant que grand-père.
REGARDS EN AMONT ET EN AVAL : LA FUITE, LA PARALYSIE
Le deuxième roman de Judy Quinn, Les mains noires, remonte aux sources de ce « défaut de transmission » de la mémoire qui taraude les protagonistes de La femme qui fuit et de Hunter s’est laissé couler. Donnant la parole au parent « taiseux », ce texte soulève différents enjeux de la difficulté à transmettre une mémoire familiale trouble qui mêle la petite et la grande histoire, la culpabilité et le désir de se défaire du passé, livrant ainsi de possibles réponses aux questions des protagonistes des premiers romans de Barbeau-Lavalette et de Quinn.
Les mains noires entremêle une intrigue mince — le trajet en autobus entre Montréal et Québec d’un immigrant d’origine ukrainienne dénommé Vasyl Dranenko — et les souvenirs de l’histoire mouvementée du passager-protagoniste. À la linéarité du voyage s’opposent ainsi les allers-retours de la mémoire qui, elle, suit un cheminement associatif. Pendant le voyage à la rencontre de son fils Tassik, un soldat qui s’apprête à partir en mission pour l’Afghanistan, Vasyl laisse libre cours à ses impressions et associations. Souvenirs récents d’avant son départ, impressions banales du voyage, anecdotes de sa vie et remémorations d’histoires vécues ou entendues dans sa jeunesse se succèdent sans démarcation typographique, sous la forme d’un monologue intérieur, dans un récit qu’il adresse tour à tour à lui-même et à son fils, intégrant aussi d’autres voix qui se sont imprégnées en lui, comme celle de sa grand-mère (MN, 51-64).
Mettant ainsi en scène l’ingérence du passé dans le présent, le récit des Mains noires révèle un défaut de transmission de la mémoire malgré le désir du jeune Vasyl de créer une filiation et, par là, une mémoire transculturelle. Tassik porte en effet le nom du grand-père de Vasyl, un coureur de jupons qui a vécu la révolution russe et quinze ans de travail dans des mines avant de revenir vivre pour de bon avec sa famille à Stara Bouda, en Ukraine. Son père étant mort, ce grand-père aventurier devient la figure marquante dans la vie du jeune Vasyl, et ses souvenirs révèlent sa volonté de transmettre à son fils les expériences vécues avec celui-ci. Ainsi, il se rappelle avoir voulu aider son fils à se remettre d’un épisode de psychose en l’emmenant à la chasse, comme son grand-père l’avait fait avec lui, et répétant les gestes de son aïeul : « J’ai goûté à son sang [celui d’un chevreuil], comme me l’avait montré grand-père. » (MN, 199)
Qui plus est, le protagoniste part en autobus avec un lièvre en bois sculpté par son grand-père afin de le donner à son fils en guise de cadeau d’adieu. C’est toutefois les pressions de sa femme qui le décident à transmettre cet objet, car là où elle voit un symbole du lien familial — parce qu’enfant, Tassik réclamait souvent l’histoire entourant la sculpture du lièvre, « qui aurait dû être un cheval » (MN, 19) —, Vasyl voit le symbole de la vie ratée de son grand-père, voire d’un passé familial douloureux dont il n’arrive pas à se défaire : « Toutes les fois que j’ai voulu m’en débarrasser, il m’est revenu. » (MN, 20) À la fin du roman, après avoir failli le perdre dans une halte routière, il découvre même une lame de rasoir enfouie dans la petite sculpture qu’il qualifie de « chose la plus horrible qu’une main a pu créer dans l’histoire de l’humanité » (MN, 221) et qui semble effectivement symboliser les blessures du passé qu’il a transmises à son fils à son insu. Estimant que « [g]rand-père avait trop raté sa vie pour ne pas avoir droit à une deuxième chance » (MN, 7), il avait, comme je l’ai souligné, nommé son fils d’après son grand-père, mais il interprète désormais ce geste comme un mauvais présage pour son fils (MN, 37), vis-à-vis duquel il manifeste surtout de l’incompréhension. Ainsi, il ne peut pas s’expliquer l’épisode de psychose de Tassik, qui a sombré dans une dépression sévère après s’être isolé à la campagne, ni sa décision subséquente de s’enrôler dans l’armée et de suivre le règlement à la lettre : « Qu’est-ce qui ne va pas chez lui pour accepter qu’on le prive d’une bonne bière un vendredi soir ? » (MN, 24) Cette incompréhension semble mutuelle, comme le démontre un souvenir commun du père et du fils concernant une sortie au cinéma après laquelle ils avaient essayé de se cacher dans le bâtiment afin de regarder un autre film. Tandis que Tassik évoque « la honte » causée par son père qui « hurlai[t] en débile » (MN, 152) une fois découvert, ce dernier s’amuse en se remémorant son comportement rebelle qui semble faire écho à un cri lancé par son grand-père pendant une réunion à la Maison de la culture qui avait fait scandale.
Porteur d’une mémoire étrangère à la réalité de son présent, Vasyl superpose fréquemment la réalité ambiante et ses souvenirs d’Ukraine déclenchés par des objets tels le lièvre sculpté ou bien un arbre sur le trajet, qui lui rappelle « le frêne derrière la maison à Stara Bouda » (MN, 141). Cette double perception par laquelle son présent est alourdi du bagage du passé semble rendre impossible toute communication avec son fils. Cette incompréhension va de pair avec une certaine condescendance, car au lieu de se mettre à la place de Tassik, Vasyl juge les expériences de son fils, qu’il ne prend pas au sérieux, se mettant même en colère lorsque celui-ci lui explique l’entraînement pour le combat : « Je lui ai balancé, c’était plus fort que moi, il m’agaçait terriblement : On peut pas prévoir la réaction qu’on aura devant la mort, fiston. » (MN, 101) Il s’avère que Vasyl, qui a dû s’enfuir de l’Ukraine après la mort accidentelle de son meilleur ami afin d’échapper à un procès, n’a jamais livré le secret de son exil à son fils. La réaction cavalière de Tassik, qui balaie cette expérience traumatisante du revers de la main en disant « [t]’as même pas fait la guerre » (MN, 102), laisse entendre le même manque de compréhension ainsi qu’une volonté de se distinguer face à un père qui ne s’est jamais réellement ouvert à lui, comme le réalise Vasyl : « On se fait le héros d’un roman d’aventures et son propre fils en arrive à penser qu’on s’en sort toujours, au fond. Mais on ne s’en sort qu’à moitié, même si on est entier. » (MN, 174) En effet, bien que Vasyl se dise « indifférent » (MN, 199) devant le départ de son fils pour un endroit où il risque volontairement sa vie, cette nouvelle semble le tarauder, car il souffre de cauchemars et ne peut arrêter le flux de souvenirs, cet héritage d’histoires qui l’assaillent sous la forme d’une « voix qui se met à parler et qui n’en finit plus » (MN, 183). Les histoires tues du passé semblent ainsi étouffer Vasyl, qui ne voulait que transmettre une partie du passé et le transformer en un nouveau départ ; cela, au détriment du besoin de repères de son fils, accablé par un vide identitaire qu’il essaie de combler par ce que son père perçoit comme un retour absurde de l’histoire. Conséquemment, Vasyl interprète l’effort de son fils pour se tailler une place dans le présent comme une malédiction familiale qui le rattrape à la manière du petit lièvre cachant un secret meurtrier qui lui revient toujours, réduisant ainsi son fils à un pion dans l’histoire familiale.
Tandis que Les mains noires raconte le torrent de souvenirs d’un homme qui voit son fils rattrapé par le passé que lui-même essayait de fuir, Hollandia esquisse le mouvement inverse, car, au lieu de s’enfuir d’un passé qui l’assaille, le personnage « taiseux » embrasse pleinement l’impact des horreurs passées, se laissant submerger par les voix et les images d’un passé collectif qui le rendent aveugle face au présent.
Ayant grandi pendant la guerre froide, Joanne a vécu la peur de l’avenir ressentie par ses parents, qui allèrent jusqu’à construire un bunker antiatomique dans leur cave afin de pouvoir se mettre à l’abri en cas d’attaque nucléaire. À cette expérience de l’insécurité se mêle l’histoire tragique de son oncle Phil, un aviateur mort au-dessus d’Utrecht pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire communicationnelle trouble, transmise par les récits et les expériences de sa jeunesse, la hante depuis toujours :
Dès que Joanne ferme les yeux, des images l’envahissent : soldats agonisants, enfants dans les bras de leur mère, garçons et filles, les membres déchiquetés. Plus tard, elle s’est dit que c’était le fruit de son imagination et celui des paroles de sa mère.
H, 22
À cette postmémoire d’une guerre qu’elle n’a pas vécue s’ajoute ce qu’Alison Landsberg appelle la « mémoire prosthétique », c’est-à-dire la mémoire d’une expérience d’un événement traumatique véhiculée par le truchement des médias de masse[28]. En effet, au fil des ans, d’autres guerres vécues indirectement s’ingèrent dans le présent de Joanne. Ainsi, elle rencontre le père de son fils dans un café fréquenté par des draft dodgers de la guerre du Vietnam. Passant en revue sa relation avec celui-ci des années plus tard, elle se rend compte qu’ils avaient peu discuté des raisons de sa désertion. Elle se souvient toutefois du temps passé à jouer à un jeu électronique de ping-pong : « Entre deux manifs contre la guerre du Vietnam, les parties de ping-pong hypnotisaient, permettaient de demeurer prisonnier d’un autre monde. Le fond sonore des autres jeux mêlé à la musique métal confirmait leur participation à une guerre virtuelle. » (H, 45) Elle vit une expérience d’immersion semblable lors de la guerre du Golfe qu’elle suit à la télévision de manière compulsive après la fin de leur relation : « Elle vivait ce conflit comme une guerre intérieure, une version plus vertueuse de sa récente séparation à laquelle elle évitait de penser. » (H, 46)
Après le cambriolage de sa maison et la disparition de son fils, ce sont ces « souvenirs de guerre [qui] hant[ent] désormais son esprit : Utrecht, Vietnam, Bagdad, la transformation en fiction des événements vécus par procuration » (H, 44). Personnage « à l’identité incertaine[29] », Joanne est « figée[30] » dans l’expérience de l’horreur vécue par l’entremise de récits et de médias dont elle s’est gavée toute sa vie, ce qui a même des répercussions physiques, entraînant des chutes et des trous de mémoire (H, 29), symptômes d’un malaise supprimé qu’elle entretient au lieu de l’affronter. Conséquemment, au lieu de l’aider à développer de l’empathie et de la responsabilité sociale, deux capacités de la mémoire prosthétique selon Landsberg[31], son trop-plein de mémoire la paralyse et la rend aveugle devant son mal-être et celui de son fils, victime lui aussi de la postmémoire transmise sur plusieurs générations. C’est pourquoi, comme le remarque Nathalie Warren, elle ne se rend pas compte que Max cherche à vivre l’expérience qui la taraudait, elle aussi, lorsqu’il passe ses nuits à jouer à des jeux de guerre[32]. De la même manière, elle ne se doute pas que son fils est parti sur les traces de son oncle, sur lequel les deux avaient fait des recherches, se questionnant plutôt sur « la part d’hérédité dans ce besoin viscéral de disparaître » (H, 12 ; l’auteure souligne) qu’il semble avoir en commun avec son père. Obnubilée par ses préjugés, elle ne considère pas non plus les lectures de son fils, qui s’était plongé dans Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut et Hiroshima: Breaking the Silence d’Howard Zinn afin de se documenter sur la guerre aérienne.
Grâce à un déplacement de la focalisation de l’instance narrative sur Max, le lecteur peut comparer la persévérance du fils lors de ses recherches avec l’attitude passive de sa mère — là où sa mère s’arrête, se résignant à son rôle de « nièce de l’aviateur » (H, 52), il continue les recherches jusqu’à se rendre sur les lieux du drame de son aïeul. En effet, quand des dettes de drogue le poussent à s’enfuir, c’est sur les traces de son passé familial qu’il part, réalisant que « [d]ès sa naissance, les choses étaient en place pour qu’il fasse ce voyage circulaire entre deux continents à la recherche de ce qui est enterré au fond de son âme » (H, 73).
L’épilogue révèle un jeune homme marqué par la crise et l’horreur qu’il a accueillies avec tout son être. Ainsi, la crise d’épilepsie déclenchée lorsqu’il joue de nouveau à un jeu de guerre, cette « mort pour lui seul » (H, 91) qui fait écho à celle de son ancêtre, semble confirmer la citation de Rick Moody mise en exergue de l’épilogue : « Est-ce que tu as jamais eu le sentiment que l’histoire de ta famille s’écrivait d’une certaine manière sur ton corps [33]? » Le vide identitaire étant comblé, Max manifeste le désir de guérir, tout en sachant qu’il ne peut pas s’affranchir du passé, car « envers les choses destinées à disparaître, il n’a pas de prise » (H, 72). En se rendant sur le lieu du drame, il arrive néanmoins à le voir d’un autre angle et à se considérer comme le porteur d’une mémoire douloureuse qui serait oubliée sans lui et qui crée une filiation : « Il y a longtemps que ces événements se sont déroulés. Des détails insignifiants. De petits cailloux au fond des poches devenus météores dans mon esprit. Reliques précieuses. » (H, 73 ; l’auteure souligne.)
Le dispositif narratif en survol ne permet pas seulement d’élucider les motifs de Max et de son état, mais livre aussi un rapport des événements historiques, déplaçant encore une fois le point de vue afin de montrer la souffrance de ceux qui ont personnellement vécu la guerre aérienne. Le récit en mouvement, qui part des répercussions lointaines — aussi bien dans le temps que dans l’espace — pour rejoindre le centre de l’horreur, finit par se focaliser sur les habitants du quartier sur lequel s’est écrasé l’avion de Phil. Le dernier chapitre présente Martina, qui a perdu une grande partie de sa famille lorsqu’un avion de la Royal Air Force s’est écrasé dans le quartier pendant la guerre et qui s’est engagée toute sa vie à « faire en sorte que les gestes héroïques ne soient pas oubliés » (H, 81). Marraine de la tombe de Phil, elle accomplit ce devoir de mémoire par empathie, accueillant même la mère de l’aviateur pour l’aider à vivre son deuil. Au lieu de se laisser paralyser par cette tragédie personnelle ou de sombrer dans l’amertume, elle s’ouvre au malheur des autres et fait l’effort de rendre hommage à l’homme et au fils, ce qui distingue son rapport au passé de celui de Joanne. Cette dernière s’approprie l’horreur de la guerre vécue par procuration sans comprendre le malheur de son propre fils, ce qui s’apparente à une fuite dans le passé devant les exigences du présent. En bref, cette « novella » illustre de quelle manière le « nouveau culte de la mémoire[34] » décrié par Tzvetan Todorov peut faire des ravages sur le plan individuel, mais qu’il est aussi possible d’en guérir.
+
Mettant en scène divers rapports au passé, les écrits narratifs de Barbeau-Lavalette, de David et de Quinn illustrent le rôle prépondérant de la famille dans l’expérience d’un « présent inquiet […] en quête de racines et d’identité, soucieux de mémoire et de généalogies[35] ». Plus précisément, les trois premiers exemples soulignent la diversité des postures que l’on peut adopter face à un passé familial inconnu. Ainsi, alors que la narratrice de Hunter s’est laissé couler s’efface devant le passé afin de montrer l’impossibilité de le mettre en mots, renonçant à s’en servir pour éclairer son présent, la narratrice-auteure de La femme qui fuit s’approprie quant à elle la vie de sa grand-mère en restituant une filiation qui lui permet de se distancier de son aïeule tout en se constituant un héritage familial. Tandis que Quinn use de stratégies qui créent l’ambiguïté afin de mettre en évidence la fictionnalité de sa version de l’histoire, le dialogue unidirectionnel de Barbeau-Lavalette avec sa grand-mère ne laisse transparaître aucun doute. Comme elle aspire à une clôture, elle s’active à combler le « trou dans [s]a mère » causé par l’abandon, ce qui la rapproche ultimement de la narratrice d’Impala, qui, elle aussi, cherche à donner réparation à sa mère. Mais là où Barbeau-Lavalette réussit à concilier dans un présent davantage ouvert aux femmes les deux mondes entre lesquels était déchirée sa grand-mère — la vie d’artiste et la vie de famille —, la narratrice d’Impala ne peut se défaire de la culture machiste de la mafia qui ne régit sa vie que par la violence.
Cette structure en forme de boucle qui caractérise, sous diverses formes, tous les récits étudiés pointe donc paradoxalement vers un nouveau départ, car les « victimes d’un défaut de mémoire » mises en scène dans Impala, La femme qui fuit et Hunter s’est laissé couler embrassent, chacune à sa façon, le présent. De manière semblable, dans Hollandia, le voyage de Max sur les traces de son grand-oncle aviateur l’aide à comprendre l’emprise du passé sur son présent et celui de sa mère. La fin du récit, qui raconte une variation de l’histoire avec la disparition de Max et sa « petite mort », ne dévoile toutefois pas si sa mère réussira à sortir de sa paralysie causée par un trop-plein de mémoire. Il en va de même pour le protagoniste des Mains noires, qui explore lui aussi une transmission défaillante de la mémoire du point de vue de la génération précédente, car Vasyl doit constater l’échec de sa tentative pour laisser derrière soi son histoire de famille traumatisante lorsqu’il sent son fils rattrapé par son passé.
Histoires d’un retour au présent ou d’un retour du passé, les textes analysés s’inscrivent dans un courant actuel de la littérature québécoise qui tisse des liens entre le passé du Québec et celui d’autres nations. Contrairement à des romans généalogiques comme Les taches solaires (2006) de Jean-François Chassay, La fiancée américaine (2012) d’Éric Dupont ou La marche en forêt (2012) de Catherine Leroux, leurs fictions ne mettent pas seulement en scène les origines diverses des Québécois, mais explorent les répercussions de ces expériences de l’autre sur des êtres à mémoires multiples dont le présent est hanté par des histoires d’un passé autre passées sous silence. Soulignant le rôle de la famille comme lieu essentiel de la transmission de la mémoire, ces fictions inscrivent le Québec dans l’histoire internationale, brouillant, de la sorte, les frontières entre « notre » histoire et celles « des autres ».
Parties annexes
Note biographique
MARION KÜHN est chercheuse autonome et enseignante d’allemand et de français. Sa thèse sur la récriture comme réflexion du roman contemporain au Québec, publiée sous le titre Meta-Romane. Die récriture als Reflexion des Romans in Québec (1980-2007) chez Transcript, s’est mérité le Prix du gouvernement du Québec en 2011. Lors de deux stages postdoctoraux (DAAD et CRSH) au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université Laval à Québec, elle a publié divers articles sur le roman historique québécois, français et allemand du xxie siècle dans des collectifs et dans Tangence, Québec Studies, Paroles gelées, TrOPICS et la Revue Études Canadiennes/Canadian Studies, et codirigé, avec Andrée Mercier, un dossier de Tangence sur l’indécidabilité narrative. Ses intérêts de recherche sont le roman québécois contemporain, le (nouveau) roman historique ainsi que l’intertextualité et les rapports entre fiction et critique.
Notes
-
[1]
Voir à ce sujet, par exemple, Régine Robin, La mémoire saturée, Paris, Stock, coll. « Un ordre d’idées », 2003, 524 p. ; ou Aleida Assmann, « Re-framing Memory: Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past », Karin Tilmans, Frank Van Vree, Jay Winter (dir.), Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 35-50.
-
[2]
Robert Dion, « Le passé historique dans les écritures québécoises du présent (Hamelin, Ouellette-Michalska, Leclerc, Mavrikakis) », Letras de Hoje, vol. L, no 2, avril-juin 2015, p. 169 ; Dion souligne.
-
[3]
Ibid., p. 173.
-
[4]
Ibid., p. 169.
-
[5]
Marianne Hirsch a introduit la notion de la postmémoire, qui décrit les effets de traumatismes vécus par les générations d’avant sur ceux qui viennent après, dans « Family Pictures. Maus, Mourning, and Post-Memory », Discourse, vol. XV, no 2, hiver 1992-1993, p. 3-27. Elle l’a par la suite approfondie, entre autres dans Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, Harvard University Press, 1997, 304 p.
-
[6]
Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit, Montréal, Marchand de feuilles, 2015, 378 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LF suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[7]
Stéphane Inkel, « Filiations rompues. Usages de la mémoire dans la littérature contemporaine », Karine Cellard et Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Transmission et héritages de la littérature québécoise, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », 2011, p. 227-244.
-
[8]
Carole David, Impala, Montréal, Les Herbes rouges, 1994, 126 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle I suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[9]
Judy Quinn, Hunter s’est laissé couler, Montréal, l’Hexagone, coll. « Fictions », 2012, 173 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HLC suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[10]
Judy Quinn, Les mains noires, Montréal, Leméac, 2015, 221 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle MN suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[11]
Carole David, Hollandia, Montréal, Héliotrope, coll. « K », 2011, 90 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle H suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[12]
Dominique Viart (dir.), Mémoires du récit, Paris, Lettres modernes/Minard, coll. « Revue des lettres modernes. Écritures contemporaines », 1998, p. 14.
-
[13]
Dominique Viart, « Filiations littéraires », Jan Baetens et Dominique Viart (dir.), États du roman contemporain, actes du colloque de Calaceite, Fondation Noesis, 6-13 juillet 1996, Paris, Lettres modernes/Minard, coll. « Revue des lettres modernes. Écritures contemporaines », 1999, p. 115-139 ; « Le silence des pères au principe du “récit de filiation” », Études françaises, vol. XLV, no 3, 2009, p. 95-112.
-
[14]
Laurent Demanze, Encres orphelines. Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon, Paris, José Corti, coll. « Les essais », 2008, 403 p.
-
[15]
Dominique Viart, « Le silence des pères au principe du “récit de filiation” », p. 99.
-
[16]
Stéphane Inkel, « Filiations rompues », p. 229.
-
[17]
Voir Astrid Erll, « Travelling Memory », Paralax, vol. XVII, no 4, 2004, p. 4-18 ; et Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, Stuttgart, Metzler, 2011, p. 58.
-
[18]
Alison Landsberg, Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York, Columbia University Press, 2004, 215 p.
-
[19]
Anne Martine Parent, « Déplacements de la mémoire dans la littérature québécoise contemporaine », Robert Dion et Andrée Mercier (dir.), Que devient la littérature québécoise ? Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990, Québec, Nota bene, 2017, p. 91.
-
[20]
Voir à ce sujet Élisabeth Nardout-Lafarge, « La malédiction de l’italianité dans Impala de Carole David », Alessandra Ferraro et Anna Pia de Luca (dir.), Parcours migrants au Québec. L’italianité de Marco Micone à Philippe Poloni, Udine, Forum, 2006, p. 62.
-
[21]
Jan Assmann, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, traduit de l’allemand par Diane Meur, Paris, Aubier, coll. « Collection historique », 2010, p. 46.
-
[22]
Voir à ce sujet Paul Ricoeur, « L’identité narrative », Esprit, juillet-août 1988, p. 295-304 ; et « L’identité personnelle et l’identité narrative », Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Ordre philosophique », 1990, p. 137-166.
-
[23]
Laurent Demanze, Encres orphelines, p. 366.
-
[24]
Dominique Viart, « Le silence des pères au principe du “récit de filiation” », p. 110.
-
[25]
« Nous ne tombons pas du ciel mais poussons sur notre arbre généalogique » est tiré de Bad Girl. Classes de littérature, une autobiographie « intra-utérine » de Nancy Huston, qui y relate, entre autres, l’abandon de sa mère. Si la narration à la deuxième personne ne constitue qu’un parallèle sur le plan formel, car contrairement à Barbeau-Lavalette, Huston s’adresse à elle-même, les deux récits se rejoignent toutefois en ce qui concerne l’histoire des personnages féminins. La décision de Suzanne semble en effet se baser sur les mêmes motifs que celle de la mère de Huston qui, elle aussi, choisit de se libérer des devoirs ménagers et familiaux qui la restreignaient : « À regarder sa mère parfaite vaquer ainsi à ses obligations quotidiennes, les lèvres serrées, réprimant toujours ses propres ambitions et talents, ta mère jurera de ne pas lui ressembler, plus tard. Jamais au grand jamais elle ne mettra les besoins et désirs des autres avant les siens. Pas d’altruisme pour elle ; non, pas question. Rien que joie et liberté, indépendance et aventure ! » Nancy Huston, Bad Girl. Classes de littérature, Arles/Montréal, Actes Sud/Leméac, coll. « Domaine français », 2014, p. 97.
-
[26]
Marion Kühn, « Des voix du silence. Variations de la narration indécidable dans le roman de mémoire contemporain », Tangence, no 105, 2014, p. 31-54.
-
[27]
Céline Cavillac, « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle », Poétique, no 101, 1995, p. 23-46.
-
[28]
Alison Landsberg, Prosthetic Memory, p. 19.
-
[29]
Nathalie Warren, « Fin de la nuit », Moebius, no 135, 2012, p. 175-177.
-
[30]
Ibid., p. 177.
-
[31]
Alison Landsberg, Prosthetic Memory, p. 21.
-
[32]
Nathalie Warren, « Fin de la nuit », p. 175.
-
[33]
Cette citation est tirée de l’autobiographie de Moody (À la recherche du voile noir, traduit de l’anglais par Emmanuelle Ertel, Paris, Éditions de l’Olivier, 2004, p. 186), dans laquelle l’auteur raconte les recherches généalogiques sur l’homme ayant inspiré Nathaniel Hawthorne à écrire son récit « Le voile du pasteur ».
-
[34]
Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 53.
-
[35]
François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2003, p. 128.