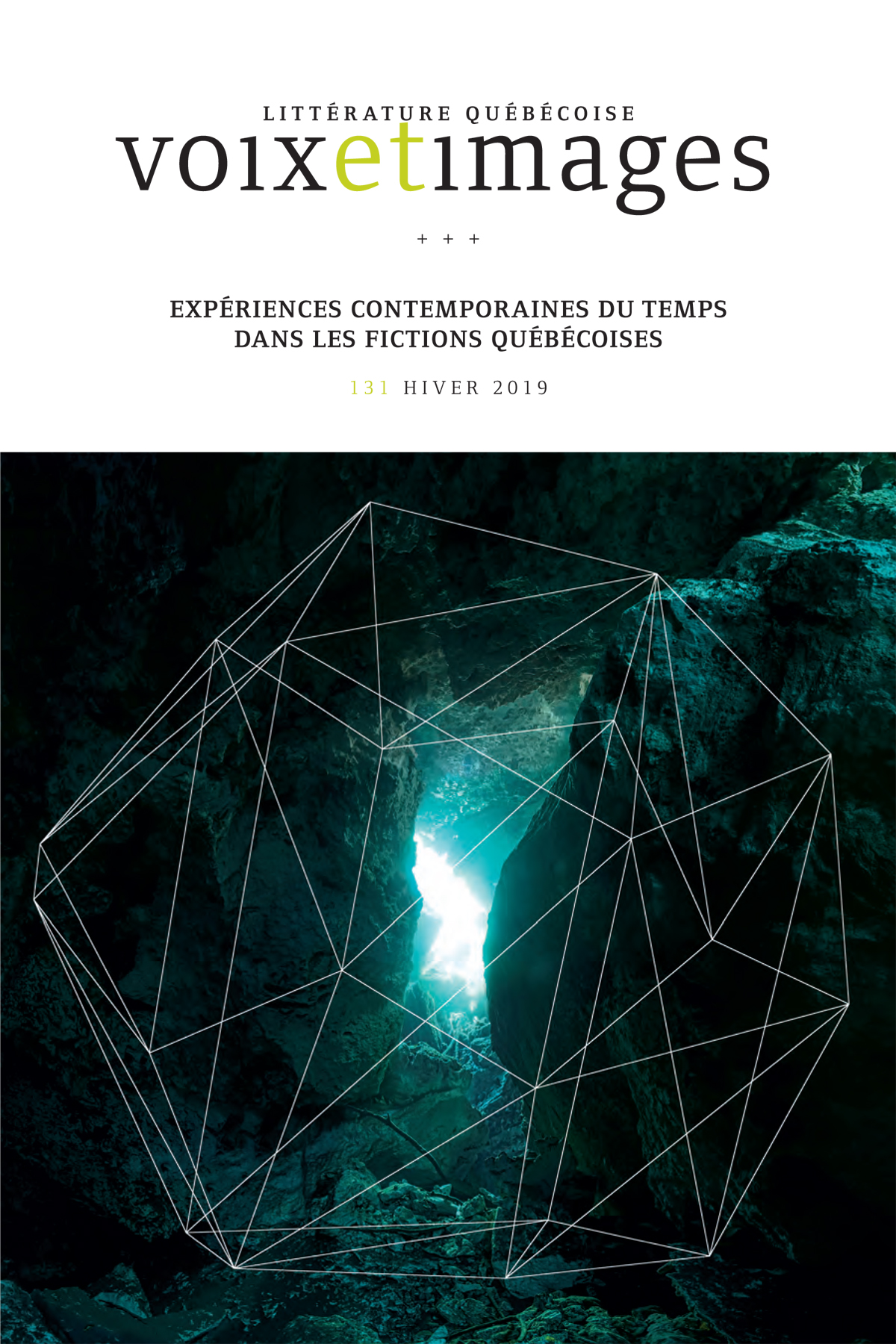Résumés
Résumé
Dans Les maisons, Tessa, une femme indécidable, qui est de plus en plus « rattrapée par la sévérité, le jugement et l’intransigeance », est continuellement aux prises avec une ironie destructrice. Pourtant, à certains endroits, l’autodénigrement laisse place à des « moments-voilà-peut-être-tout-ce-qui-existe-désormais », commandés par l’ironie elle-même et qui ont tous en commun la structure familiale, sorte de rempart contre le monde chaotique. C’est ainsi que la maman extrêmement lucide se résout, pour compenser une ironie avilissante, à « laisser se déployer la vie, cette vie qui fait parfois si bien les choses ».
Abstract
Tessa in Les maisons is an undecidable woman, more and more often “rattrapée par la sévérité, le jugement et l’intransigeance,” constantly grappling with a destructive irony. And yet, at times, her self-disparagement yields to “moments-voilà-peut-être-tout-ce-qui-existe-désormais” prescribed by irony itself; all such moments have in common the family structure, experienced as a kind of bulwark against the chaotic world. And so this extremely lucid mother makes up her mind to “laisser se déployer la vie, cette vie qui fait parfois si bien les choses,” as compensation for a degrading irony.
Resumen
En Les maisons (Las casas), Tessa, una mujer inenarrable, y además cada vez más ‘alcanzada por la severidad, el juicio y la intransigencia’, está constantemente presa de una ironía destructora. No obstante, en algunos momentos, la autodenigración deja lugar a ‘momentos-en-que-esto-sea-quizás-todo-lo-que-exista-en-adelante’, ordenados por la ironía en sí y que todos tienen en común la estructura familiar, una especie de muralla contra el mundo caótico. Es así, pues, cómo la mamá sumamente lúcida se decide, a fin de compensar una ironía envilecedora, a “dejar que se desarrolle la vida, esta vida que hace a veces tan bien las cosas”.
Corps de l’article
« Je me risque à un genre de plaidoyer pour l’ambiguïté[1] », s’écrie Fanny Britt dans Les tranchées (2013), essai sur la maternité et le féminisme qui entremêle anecdotes légères et témoignages saisissants. Celle que l’on a d’abord connue comme traductrice et scénariste réfléchit, dans ce petit ovni littéraire, à la pression exercée sur les femmes pour qu’elles réussissent en tant que femme, mère, travailleuse, et tout ça, en affichant un large sourire. En discutant avec d’autres femmes issues du milieu littéraire, Fanny Britt, elle-même mère de deux enfants de deux pères différents, expose une maternité ambiguë, loin d’être nécessaire, encore moins parfaite, une maternité empreinte de doutes, de remises en question, d’envies-de-sacrer-son-camp-à-l’autre-bout-du-monde. Désireuse de montrer, tant par la voie de l’essai que du récit, l’envers plus sombre d’une condition de mère toujours glorifiée, Fanny Britt met en scène dans son premier roman, Les maisons[2], publié en 2015 au Cheval d’août, une mère « rattrapée par la sévérité, le jugement et l’intransigeance[3] ». Tessa est une agente immobilière, mariée à Jim, un musicien, avec qui elle a trois enfants : Philémon, Boris et Oscar. Tous les cinq mènent une vie rangée dans leur maison du Mile-End. Le roman est celui d’une mère et épouse choyée, bien entourée, mais qui ne peut se résoudre à en profiter. En fait, Tessa est l’archétype même de cette femme assujettie aux impératifs de performance et d’excellence que regrettent Fanny Britt et ses acolytes dans Les tranchées. Grâce au découpage des Maisons en quatre parties, qui correspondent à des années distinctes dans la vie de Tessa[4], Britt montre qu’un tel asservissement est inhérent à la narratrice, qu’il la définit en quelque sorte.
Le récit de Fanny Britt est en parfait accord avec l’air du temps en ce qu’il est « indécidable ». L’indécidabilité narrative consiste dans la propension d’un récit à préférer, « à toute position […] dominante », « la posture contingente, mouvante, volontiers paradoxale[5] ». Pour les écrivains de telles oeuvres, toute certitude est suspecte. Refusant la linéarité, ils procèdent à une confusion délibérée qui n’épargne aucune composante de la diégèse. L’indécidabilité est immédiatement repérable dans Les maisons sur le plan de la forme. La récurrence des passages en italique qui interrompent le récit, qui est alors tiraillé entre le récit premier (le quotidien de Tessa) et cette mise en abyme (la voix intérieure de Tessa), en est un premier indice. Cette scission de la voix énonciative provoque une ambiguïté caractéristique des récits indécidables. Le brouillage qui s’opère par la fragmentation du récit en quatre périodes temporelles entrecoupées d’ellipses témoigne également de la « posture mouvante » des Maisons. L’indécidabilité détermine l’impossibilité d’une « approche constituée du Sujet[6] », dont l’identité s’écroule sous le poids de cette action continuelle. Tessa se dévoile au lecteur dans toute sa fragilité, rejoignant dès lors ce primat des identités fuyantes qui fait loi dans la littérature contemporaine : « [L]e monde ne se présente plus comme une totalité intelligible […], en même temps, le sujet, model[é] par la fragmentation du monde, éclate sous la pression de […] l’hétérogénéité[7]. »
L’ironie postmoderne est indissociable « de l’indécidabilité, de l’ambiguïté, de la polysémie et du paradoxe[8] ». Elle s’appuie sur le présupposé que le monde contemporain est absurde et incertain. Profondément autoréflexive, elle est la « conscience lucide qui constate le chaos en planant au-dessus du monde[9] ». En induisant une telle distanciation, l’ironie postmoderne instaure « une fracture interne et nécessaire de la voix auctoriale[10] » : les personnages marqués par une telle ironie cherchent à s’extraire des situations et à les commenter, en versant le moins possible dans le pathos. Cette conscience accrue ne signifie pas pour autant que les personnages contemporains retrouvent l’ordre ; bien au contraire, ils observent, impuissants, en retrait, le désordre qui les entoure. L’ironie constitue la prise de conscience d’un monde où l’indécidabilité est inévitable. Ces deux concepts, qui ont partie liée, ont été régulièrement convoqués pour appréhender le corpus contemporain français, notamment les oeuvres publiées chez Minuit. L’ironie de Jean Echenoz, de Jean-Philippe Toussaint et d’Éric Chevillard n’est plus à prouver : elle fait consensus. Plus rares, toutefois, sont les études sur l’usage de ces concepts dans la littérature québécoise contemporaine. Il s’agira ici de remédier à cette carence en montrant, à l’aide des outils herméneutiques que sont l’ironie postmoderne et l’indécidabilité, l’originalité de la démarche de Fanny Britt.
La posture ironique dans Les maisons est offensive : véritable danger, l’ironie assaille la narratrice et la prend à la gorge comme un bourreau impitoyable et infatigable. Tessa pose un regard extrêmement critique sur ses moindres faits et gestes. Le traitement de l’ironie constitue en ce sens un renversement par rapport au discours généralement tenu à l’endroit du procédé. Régulièrement assimilée à un mode de défense et à l’idée d’une délivrance, l’ironie est définie tantôt comme une « forme de protection[11] », tantôt comme un exutoire. Pierre Schoentjes, qui s’est notamment intéressé au pouvoir de séduction ironique, décrit le procédé comme « le plus solide des abris[12] ». Pour le chercheur, l’ironie permet de réaliser une communion des esprits : il cite d’ailleurs Wayne Booth, qui voit en ce procédé « une danse intellectuelle qui rapproche les hommes[13] ». Il fait de l’ironie une « stratégie efficace » pour charmer par le truchement de la « dissimulation » et du « jeu sur l’implicite[14] » : son usage est indissociable, pour le critique, d’une forme de subtilité calculée. Dans Les maisons, pourtant, l’ironie impose un régime de terreur, ne repose pas sur les non-dits et n’a rien d’un léger jeu d’esprit ; elle est catégorique, omniprésente et n’entend pas à rire. Elle ne cherche ni à plaire ni à faire profil bas ; c’est par la voie du martèlement et du harcèlement qu’elle prend racine et se propage. La conscience critique de la narratrice n’est pas maîtrisable. Bien au contraire, la lucidité exacerbée de Tessa la prend d’assaut, la harcèle, au point où elle devient, paradoxalement, la source d’une plus grande confusion. L’ironie n’a absolument rien d’un procédé dont se servirait la narratrice pour se prémunir contre le danger ; elle constitue le danger.
L’ironie de la surconscience et de l’autocritique cède pourtant sa place, dans quelques passages, à des « moments-voilà-peut-être-tout-ce-qui-existe-désormais[15] », qui ont tous en commun la structure familiale, sorte de rempart. C’est par la voie de l’intimité, de la proximité, que la narratrice, autrement tourmentée, parvient à « laisser se déployer la vie, cette vie qui fait parfois si bien les choses[16] ». Cette sortie momentanée de l’ironie est indispensable à Tessa, qui est partout ailleurs aux prises avec une ironie délétère. Les maisons comporte donc un mouvement double : nous commencerons par caractériser les stratégies ironiques qui y sont déployées avant de voir de quelle façon la narratrice parvient, le temps de quelques passages, à les évacuer.
RETRAIT D’UN MONDE EN RUINE
Tessa ne mène pas une existence que l’on pourrait qualifier d’exceptionnelle, encore moins de tragique. Elle est pourtant rongée par les doutes et les hésitations : elle remet en question chacune des situations, même la plus banale. Pour reprendre la métaphore immobilière, il y a discordance entre la façade du personnage et son intérieur : le fait que Tessa ait tout pour se réjouir ne la prémunit pas contre le doute généralisé qui est le lot de l’ironie contemporaine. Dès l’incipit, la narration est farcie de phrases interrogatives. La narratrice, consciente du chaos postmoderne, s’avoue toutefois incapable de l’appréhender. Jamais certaine de l’effet que produisent sur elle les événements, elle multiplie les formules oxymoriques. En parlant de l’irruption inattendue de Francis, Tessa emploie le syntagme « merveilleusement tragique[17] », agencement antagonique qui rend bien son incapacité à se camper dans l’un ou l’autre rang : la venue de Francis est-elle merveilleuse ? Tragique ? Même constat quand Tessa se décrit comme une « bienheureuse noyée » (LM, 23) ou raconte « le mépris douillet » (LM, 23) qu’elle inspire aux autres : toujours dans l’entre-deux, la narratrice indécidable de Fanny Britt se laisse envahir par l’incertitude. La récurrence de l’adverbe de doute « peut-être », souvent positionné en fin de phrase, contribue aussi à rendre vaine toute esquisse de stabilité. Dans la grande majorité des cas, la suite du récit révèle que les suppositions de la narratrice sont infondées. Pensons au simple malaise d’Oscar, probablement attribuable à un excès de sucre, qui devient, dans la tête de Tessa, « peut-être une encéphalite », avant que ses pensées déboulent : « S’il fallait perdre Oscar, comment survivre ? » (LM, 35) La forte propension à la nostalgie de la narratrice a pour effet de la « cloue[r] au divan » (LM, 142) et de la laisser se vautrer dans son état de pauvre victime. Incapable d’affronter les déceptions, qui la rendent « infirme de lâcheté et de frayeur » et la font « fumer comme un pompier » (LM, 142), Tessa choisit la voie de l’apitoiement.
La narratrice de Fanny Britt bat en retraite le plus souvent et devient mal à l’aise en société, préférant l’isolement aux mondanités. Ainsi refuse-t-elle, pour célébrer l’embauche de son époux Jim au sein de l’orchestre, la venue de leur groupe d’amis. Tessa avoue, à deux occasions, être une personne « désagréable » (LM, 13 ; 21). Cette noirceur de la narratrice, qui justement trouve « l’obscurité étrangement amicale » (LM, 125), est concrétisée dans le roman par une formule improbable : « Il fait beau. J’haïs ça. » (LM, 112) La narratrice, acariâtre, enchaîne les réflexions indignes. Désireuse de ne pas ébruiter les pipis au lit d’Oscar, elle s’imagine, à l’occasion d’une activité-bénéfice organisée à l’école, devoir mentir aux parents inquisiteurs des autres élèves, réflexion qui prend rapidement une tournure aigre :
Je serais alors forcée de leur sourire de toutes mes dents (plombées) et de mentir, c’est vraiment occasionnel (ce ne l’est pas), ou alors de tirer sur les chevelures striées d’un faux roux qui ne trompe personne, jusqu’à ce qu’elles ressemblent à ces poupées désolées auxquelles on a coupé la tignasse, la tête pleine de trous, à l’image de leur esprit. Je suis un être désagréable…
LM, 21
Faire preuve d’amabilité représente très certainement un défi pour la narratrice, qui est constamment sur le point de s’écrouler d’épuisement. Tessa est souvent forcée de faire ceci ou s’efforce de faire cela : elle n’agit jamais de façon complètement naturelle, spontanée. Même prendre un appel téléphonique semble requérir un effort surhumain de sa part : « Le téléphone n’arrête pas de sonner. Il faut fouiller, le trouver au fond du sac, répondre. » (LM, 117) Les syntagmes de l’énumération sont présentés comme autant d’étapes complexes que Tessa doit accomplir. En proie à une ironie qui serait un malaise, Tessa progresse dans la vie avec peine et est alors condamnée à effleurer le réel.
REFUS DU PATHOS ET AUTORÉFLEXIVITÉ
La narratrice est celle qui regarde plutôt que celle qui ressent. Quand l’émotion se fait un peu trop envahissante, Tessa tend à s’échapper, à se recroqueviller sur elle-même ou à évacuer par l’usage du coq-à-l’âne ses sentiments oppressants. Ayant fait la connaissance d’Évelyne, qui est atterrée par sa rupture d’avec Francis[18], la narratrice s’interroge : « Qui renonce à une femme pareille ? Je me garde de le dire à Évelyne, je ne veux pas que les larmes reviennent. J’ai promis aux garçons une lasagne, et il ne reste plus de farine pour la béchamel. » (LM, 15) La narratrice évite de peu l’émotion, y substituant une considération d’un prosaïsme absolu : c’est par l’évocation d’une béchamel qu’elle esquive les larmes, ravalant l’émotion d’Évelyne et la sienne, du même coup. Quand ce n’est pas une association d’idées inattendue, c’est carrément un changement de chapitre qui permet à la narratrice d’étouffer le pathos. Si Tessa refuse ainsi de partager ses émotions, c’est parce qu’elle a peur de paraître faible : « [I]l y avait des limites […] à ne pas franchir si je ne voulais pas être prise en pitié. » (LM, 170) Perçue négativement par la narratrice, l’expression authentique des sentiments lui est le plus souvent inconcevable : « Quand on en parle, les choses deviennent réelles, et révèlent leur ridicule. » (LM, 114) Si l’ironie est bel et bien ce rejet de l’émotion, cette « tendance naturelle à échapper au pathos[19] », il semblerait qu’elle soit l’un des traits saillants de la narratrice, voire une valeur qu’elle revendique. Après tout, « [s]a mère [lui] a toujours dit que l’ironie et le sarcasme étaient des signes d’intelligence » (LM, 85). Il apparaît en effet qu’un tel refus de l’émotion est nécessaire à la narratrice, peut-être même génétique :
Je lui promettrais [à sa mère] de l’aider à peindre le banc dimanche. Nous pourrions aller manger une crème glacée après et, surtout, je lui dirais que personne n’était aussi fort qu’elle. Je ne l’ai pas fait. C’était le milieu de la nuit et, de toute façon, cette famille n’en était pas une de sentimentaux.
LM, 104
Rejetant le plus souvent le pathos, parce que c’est ce qu’on lui a montré à faire, la narratrice de Fanny Britt dans Les maisons fait comme tous ces personnages indécidables qui, « pour dire le réel d’aujourd’hui, […] préfèrent se placer à côté[20] ».
Les passages en italique, plus ou moins nombreux selon l’époque, comportent une forte valeur autoréflexive et par là même ironique. Interrompant l’histoire pour mieux s’extraire d’elle-même et se jauger, la narratrice de Fanny Britt suit un « chemin ultra-lucide[21] » jusqu’aux confins de la folie. Les fragments en italique cèdent la parole, dans cette construction délibérée, à une voix intérieure pessimiste et défaitiste. Cette voix, supérieure à celle de la narratrice dans la hiérarchie textuelle, est profondément ironique. Les passages démarqués typographiquement sont formulés comme autant de réponses aux doutes de la narratrice. D’ailleurs, la voix tutoie Tessa : « tu es fatiguée, […] tu as mangé trop de sucre, […] tu as bu trop de café » (LM, 86). Les fragments enregistrent les moments de « conversation intérieure » (LM, 86) et « d’autosurveillance » (LM, 100) de la narratrice. Ainsi épiée (par elle-même) dans ses moindres faits et gestes, Tessa ne peut se résoudre au laisser-aller. Le motif du miroir, significatif en ce qu’il permet à la narratrice de se juger du point de vue des autres, est récurrent dans Les maisons, comme dans cet extrait : « Quand tu essaies un maillot […], quand tu te regardes dans le miroir du vestiaire de la piscine, puis dans le reflet de la vitre du bureau des sauveteurs […] c’est bien lui [Francis] que tu imagines te voir ? » (LM, 69) En plusieurs occasions, la narratrice parle d’elle-même à la troisième personne du singulier, illustrant parfaitement la distance envers soi-même qui caractérise l’époque contemporaine. Tessa, indécise quant à son avenir professionnel, se questionne ainsi : « Je me suis demandé ce qui se passerait si je décidais de rester en congé pour toujours […] et que la femme que me renvoyait le reflet des vitrines gardait éternellement ce pas oisif. » (LM, 179) La narratrice va même jusqu’à considérer les gens qu’elle croise comme autant de regards dirigés vers sa propre personne :
Ils [les deux vieux Portugais de la rue Saint-Laurent] savent déjà que le nôtre [le rendez-vous amoureux de Francis et Tessa] sera catastrophique. On pouvait le voir à la démarche du monsieur, en diagonale, ça l’éloignait d’elle, dirait l’un […]. Non, c’était dans la façon dont la femme a replacé une mèche derrière son oreille, comme un enfant se joue dans les cheveux pour tromper l’ennui.
LM, 198-199
Décortiquant ses moindres mouvements comme le ferait un observateur curieux, Tessa finit par se distancier d’elle-même au point de perdre son identité, désormais incapable de se reconnaître : « Qui est cette vieille mère qui fume, assise en tailleur dans sa cour jonchée de jouets ? » (LM, 121)
IRONIE FÉMININE ET AUTOCRITIQUE
Déstabilisante, la voix intérieure invasive de Tessa façonne, à coups d’invectives, une ironie de l’autodénigrement et de l’autocritique. Elle est une forme de juge qui intervient quand elle l’estime opportun, le plus souvent pour railler ou rabaisser la narratrice. Cette voix qui la hante ne passe pas par mille et un détours pour se faire entendre : Tessa est tour à tour une « niaiseuse » (LM, 13), une « pauvre conne » (LM, 36) et une femme « sans avenir » (LM, 99). Envahie par cette voix malveillante, dont elle pense qu’elle concorde avec l’opinion générale, elle finit par la croire sur parole : « [J]’étais nulle, tout le monde le savait. » (LM, 86) Par le biais de cette « parole auto-accusatrice[22] », la narratrice de Fanny Britt développe peu à peu un mépris de soi, avouant s’isoler pour mieux « s’haïr en paix » (LM, 86). Son envie d’adultère, qu’elle juge « horrible et crasse » (LM, 70), lui inspire un profond dégoût. C’est avec une lucidité assassine qu’elle se décrit alors comme la « triste, triste clown d’un sketch éculé » (LM, 205), réalisant tout le ridicule de sa situation.
L’autodénigrement se fait aussi par l’entremise de références sournoises à son corps, véritable objet de malheur évoqué systématiquement par le biais d’une ironie caustique. C’est ainsi que Tessa se compare à un « chien mouillé » (LM, 31), rapproche sa présence sexuelle de celle d’« un sapin de Noël » (LM, 59) et évoque « l’élastique de [s]on soutien-gorge [qui] ne [tient] plus qu’à un fil » (LM, 23). Habiter son corps est une réalité difficile et préoccupante pour Tessa. Elle se réduit même, en un passage, à ce seul corps : « Je suis juste une grosse laide sans avenir, on va se le dire. C’est tout ce que je suis. […] Si on s’en tient aux faits scientifiques. C’est tout vrai. » (LM, 87) L’ironie dans ce segment cache, sous le couvert de l’autodérision, un mal-être immense. La haine du corps est également mise en scène dans un épisode particulièrement éclairant, à savoir celui du maillot de bain, qui n’est pas sans rappeler le fameux « exercice d’humilité et d’humiliation[23] » de la pataugeoire raconté dans Les tranchées. Cherchant désespérément un maillot qui lui convienne, Tessa déchante parmi les « imprimés hibiscus et ananas qui trouvent le moyen d’être tristes comme la pluie » (LM, 65) et avoue errer « tel un spectre » (LM, 65) dans le centre Rockland. L’ironie, en plus d’exprimer l’inconfort de Tessa, renvoie à sa difficile condition de femme, qui prend les traits d’une véritable lutte lorsqu’elle déclare impossible la « grande réconciliation des corps et des femmes » (LM, 67). Dans son étude Le carquois de velours, Lucie Joubert soulevait cette propension de l’ironie féminine à investir la « sphère discrète du privé[24] », à commencer par la question du corps. Cette préférence pour les lieux de l’intimité et les préoccupations quotidiennes serait même, pour Joubert, la spécificité de l’ironie faite par les femmes québécoises.
Dans Les maisons, Tessa semble bel et bien victime d’une ironie qui ne s’en prendrait qu’aux Évelyne — une autre de ces femmes torturées à la lisière de la folie — et aux Tessa de ce monde. Elle appelle d’ailleurs à la « solidarité pour les vies pétées » (LM, 26) et à l’entraide entre toutes les femmes « brisées » (LM, 26). Dans les cabines d’essayage du magasin, le regard de Tessa croise celui d’une autre femme tout aussi préoccupée par ce que lui renvoie le miroir : « Dans ce court moment, sa honte et la mienne ne font qu’une, nous sommes la seule et même femme, et je la maudis autant que je me maudis de m’être exposée, encore une fois. » (LM, 66) Le roman de Fanny Britt formule une réflexion sur cette époque qui « commande [aux femmes] d’être au top[25] ». De telles considérations sont typiques de l’ironie au féminin qui s’attaque, le plus souvent, « aux problèmes qui touchent la condition des femmes dans la société[26] » dans l’objectif de leur donner la place qui leur revient. Dans Les tranchées, Fanny Britt élaborait déjà l’idée d’une ironie féminine universelle : « Nous souffrions du même mal : tous les matins, au réveil, nous étions en proie […] à une insatisfaction lancinante, nous étions perpétuellement en tabarnak[27]. » Dans Les maisons, elle refuse de mettre en scène « la femme réussie, telle que définie par la société, celle qui a tous les talents et qui n’a jamais de regrets[28] », y préférant une narratrice qui a le sentiment d’avoir tout raté, à commencer par sa vie professionnelle.
IRONIE ET PASSAGE DU TEMPS
Anciennement étudiante en musique, Tessa a rapidement dévié de cette trajectoire, devenant maman, puis agente immobilière, un boulot qu’elle juge payant, mais déprimant : « Je suis une agente d’immeubles, mais ce n’est pas une raison pour m’en souvenir au quotidien. » (LM, 188) Quand Francis lui raconte avoir vu son nom sur une pancarte, Tessa répond par une forme d’ironie rhétorique, avec ces quelques mots : « Ha. Oui. Ma gloire. » (LM, 206) L’ironie en est une d’attentes déçues et de rêves qu’on préfère oublier pour ne pas souffrir de leur non-réalisation. C’est pourquoi l’évocation du chant classique et de ses tenants est spécialement douloureuse pour Tessa :
Jim […] rapporte des fois un bouquet oublié par une diva surchargée. Mais elles ont chanté devant des centaines de personnes déjà charmées, vécu l’incomparable plaisir de faire vibrer leur voix dans l’enceinte d’une salle captive, de la déposer sur les couches fines et texturées produites par les musiciens qui les soutiennent, obtenu ce qui était le plus beau et le plus plein, déjà. Pourquoi leur offrir des fleurs ? Les fleurs sont pour les agents d’immeubles et leurs réceptionnistes, terrés dans les bureaux blafards d’une franchise…
LM, 18
Le passage du temps se révèle extrêmement difficile pour la narratrice de Fanny Britt. Les nombreuses analepses montrent un refus de la représentation linéaire, à laquelle il serait trop difficile de faire face. L’ironie à l’oeuvre dans le roman est donc graduelle, progressive : frappant plus lourdement au fur et à mesure que Tessa vieillit, cette ironie est celle d’une vie qui fane, pleine de désillusions. D’ailleurs, les passages en italique, les plus marqués par l’ironie, sont plus nombreux et plus longs dans les chapitres qui traitent de sa vie en 2015 que dans ceux de 2004, où ils sont plus denses qu’en 1993 et ainsi de suite. Ces passages sont de plus en plus envahissants, scindant parfois carrément une phrase en deux. En effet, la voix intérieure de la narratrice façonne plusieurs pauses narratives, soit entre parenthèses, soit entre tirets, qui défient les possibilités de la diégèse et témoignent de l’invasion ironique[29]. Tessa est de plus en plus touchée par l’ironie : insouciante à quatre ans, elle commence à douter à quinze ans, se remet systématiquement en question à vingt-six ans, puis devient obsédée à l’approche de la quarantaine. La narratrice revisite les différentes étapes de son passé en y accolant une forme de jugement, de reniement de celle qu’elle fut autrefois, comme dans ce passage :
Il fréquentait une fille de Montréal. Je vivais un grand amour, exquis et tellurique. Je m’y étais faite avec l’empressement d’une junkie, et je ne rouspétais jamais aux absences, aux rendez-vous espacés. Oh, dans ma tête, c’était une autre histoire. Nous avions fait notre nid dans mon petit appartement…
LM, 159
Le segment montre très clairement la répudiation de la Tessa d’il y a onze ans, jugée naïve et complètement dupe. Vieillir, c’est donc, pour Tessa, gagner en lucidité :
Quelque part entre la lointaine époque où nous regardions les garçons jouer au basketball dans la cour d’école et aujourd’hui, elle [Sophie] m’a vue devenir sombre. Je dirais lucide parce que c’est le terme juste et que l’un n’exclut pas l’autre, mais les gens n’aiment pas croire que leur vie ne remplira pas les promesses faites au berceau ou autour du feu, quand ils brillaient comme seuls les adolescents peuvent le faire, quand ils avaient la certitude inébranlable que tout irait bien. J’ai été comme eux.
LM, 112
Le roman de Fanny Britt est celui d’une vie qui n’est pas aussi lisse qu’on avait pu l’envisager avant l’entrée dans le monde adulte, moment qui coupe court à tout idéalisme. Le roman est d’ailleurs traversé par ce questionnement existentiel, que l’on retrouve en quatrième de couverture : « Cesse-t-on de vouloir ce que l’on a ardemment voulu à vingt ans ? » (LM, 37) Prenant conscience de sa vie qui tourne à vide, la narratrice avoue n’avoir jamais pu présager un tel dénouement : « Tu vois jamais ce moment-là, quand tu penses à l’avenir. Tu vois des voyages sans destination, les fenêtres de l’auto grandes ouvertes… Tu vois tout ce qui est beau et sent bon et fait vibrer et fait bander. Tu vois pas… ça. » (LM, 17) Plus lucide, mais aussi plus cynique, la Tessa d’aujourd’hui regrette l’époque où le « vin se buvait comme de l’eau » (LM, 193). Elle est régulièrement confrontée au contraste entre le temps de l’enfance, celui de l’insouciance, et le temps de l’âge adulte, plus associé à la prudence : « Souvent, quand Jim rentre de travailler, il me demande ce que j’ai fait aujourd’hui, et je pense à ce que faire veut dire, et à ce que faire a voulu dire à une autre époque de ma vie… » (LM, 22) Tessa doit faire le deuil de tout un pan de son existence et accueillir sa nouvelle réalité, ce à quoi elle se résout difficilement. Le vieillissement est doté d’une forte dimension restrictive : certaines actions ou paroles, pourtant aisément admises à l’enfance ou à l’adolescence, deviennent tout simplement inconcevables quand on a « trente-sept ans, et trois enfants » (LM, 38). Portant le poids du temps qui passe, « alourdie jour après jour » (LM, 17), Tessa ressent les effets irréversibles du vieillissement sur son corps de « vieille mère » (LM, 30) jusqu’à devenir complètement désillusionnée : « Ma vie va-t-elle s’arrêter dans cette vieille voiture au plancher jonché d’emballages, […] de coeurs de pommes oxydés ? Est-ce que cet infâme stationnement d’Ikea sera mon dernier tableau ? » (LM, 18)
UNE SORTIE NÉCESSAIRE DE L’IRONIE
Malgré l’omniprésence de l’ironie, Les maisons comporte des passages qui en sont exempts. Cette combinaison d’ironie et d’authenticité invite à penser le premier roman de Fanny Britt sous l’angle de la New Sincerity[30], mouvement artistique qui dépend de l’ironie contemporaine autant qu’il s’y oppose. La New Sincerity s’appuie sur la réintégration d’une forme d’authenticité dans les oeuvres artistiques postmodernes, qui sont autrement chargées d’une ironie froide et implacable. Elle ne nie pas la toute-puissance de l’ironie contemporaine ; elle cherche à faire contrepoids à son inhérent dédain du pathos en réinjectant dans les oeuvres une dose vitale d’affect. Le roman de Fanny Britt met en scène une ironie qui appelle une neutralisation : on ne l’admet pas sans broncher, on la remet en question. À l’opposé des récits français de Christian Oster ou de Jean-Philippe Toussaint, notamment, où l’ironie est inébranlable, irrévocable, Les maisons cherche à la contrebalancer par un retour à la compassion. L’oeuvre de Fanny Britt n’est pas à classer du côté des récits impassibles, terme fort souvent utilisé pour décrire la tonalité des écrivains de chez Minuit. Pour Dominique Viart, les romans dits impassibles, qui ont tout à voir avec une forme de ludisme, « jouent des modèles romanesques sans jamais leur donner l’ampleur ni l’intensité qu’un lecteur accoutumé à ces modèles est en situation d’attendre[31] ». Les maisons, malgré certains épisodes humoristiques, aborde les thèmes de la domesticité et de la maternité avec gravité. Tant l’ironie que la sortie de l’ironie se négocient avec une intensité qui n’a rien à voir avec la légèreté que présupposent les romans impassibles.
Pour Brigitte Adriaensen, qui reprend à son profit la dialectique établie par Alan Wilde, l’ironie « réductive », qui n’entre pas en dialogue avec le monde extérieur, s’oppose à l’ironie « générative », qui ménage « des anironic enclaves […] affirm[ant] certaines valeurs en face de l’univers absurde qui l’envahit[32] ». C’est ce deuxième type d’ironie qui est à l’oeuvre dans Les maisons : le texte de Fanny Britt érige l’amour et la famille en refuges contre le chaos postmoderne. Adriaensen juge que les enclaves dépourvues d’ironie sont difficiles à circonscrire dans les textes tant l’ironie a tendance à tout contaminer. Dans Les maisons, pourtant, la démarcation entre les passages à teneur ironique et ceux qui en sont dénués, mise en évidence notamment par des choix typographiques, est nette.
Si l’ironie faite par les femmes a tout à voir avec les sphères du quotidien et de l’intimité, il semblerait que son évacuation se fasse sur ce même terrain. L’intimité serait le territoire privilégié par l’ironie féminine autant que celui de son annihilation. Ce renversement est nécessaire pour Tessa : si elle n’était pas entièrement imprégnée d’une ironie asphyxiante, elle n’aurait pas à négocier des revirements. Le paradoxe est on ne peut plus étonnant : tout se passe comme si l’ironie, en dépassant les bornes, organisait son propre congédiement. Et c’est alors l’ironie qui finit par se chasser elle-même.
Le cadre familial, en libérant Tessa de sa conscience obsédante croissante, lui permet de s’affranchir d’une intériorité envahissante et de redevenir vivante, parce que chérie et admirée. L’évocation des souvenirs de sa propre enfance est un moyen privilégié par la narratrice pour se mettre à l’abri. Le thème de la maison, développé dès le titre, puis par tout un lot d’allusions, participe de ce mouvement de libération. L’analepse se déroulant en 1982, alors que Tessa a quatre ans, est d’ailleurs la plus dénuée de charge ironique : l’italique, marqueur d’ironie, en est d’ailleurs pratiquement absent. Les souvenirs liés à cette époque où elle ne décodait pas encore l’ironie du monde répondent à un besoin de la narratrice de trente-sept ans : ils lui permettent d’entretenir l’illusion d’une vie immunisée contre l’ironie. La Tessa de quatre ans, insouciante, occupe le plus clair de son temps à s’interroger sur tout ce qui tombe au sol, se demandant si « les objets [ont] mal quand ils s’écrasent » (LM, 44). La jeune fille comprend bel et bien la rupture de ses parents, mais n’a pas la lucidité pour en saisir la portée ou en anticiper les conséquences. Elle constate le mal-être de Paule, sa mère, et ses sautes d’humeur constantes, qu’elle observe toutefois objectivement, sans trop se sentir concernée. C’est que le poids des responsabilités — qui va de pair avec une conscience exacerbée — ne l’a pas encore frappée, la narratrice ayant encore « accès à [une forme] d’abandon » (LM, 55) propre au monde enfantin. Les descriptions de 1982 sont enveloppées d’une douceur sincère, relatant un « confort singulier » (LM, 45) tout à fait aux antipodes du reste du roman, souvent très dur. Pour oublier, ne serait-ce qu’un instant, sa vie gangrenée par une intelligence ironique excessive, Tessa revisite cette époque par l’entremise de considérations empiriques, notamment olfactives. Ses souvenirs comportent nombre d’odeurs réconfortantes, notamment celles « de la lotion à la noix de coco » (LM, 45) de son père et de « l’eucalyptus » (LM, 45) de son arrière-grand-mère. Aussi Tessa se rappelle-t-elle avec émotion « les sons rassurants de la vaisselle en plastique rose » (LM, 54) et de « la musique douce qu’[elle] rejouait à l’infini dans [sa] tête » (LM, 54). La description de ces sensations transpire le bonheur et la douceur : le retour dans le passé de Tessa est une façon de s’arracher à son quotidien complexe de femme tourmentée. Les moments passés avec maman ou papa, regrettés par la Tessa d’aujourd’hui, sont remplis de « baisers accueillis avec maladresse » (LM, 46), de « lectures de Gaulois et de pirates » (LM, 46), de baignades, d’escapades en voiture… La narration elle-même gagne en délicatesse pour rendre compte du temps de l’enfance, un temps qui « rec[èle] des promesses de bain moussant, d’histoires lues sans escamoter de pages et de lait chaud avant le sommeil » (LM, 53). La Tessa de 1982 aime à ce point la vie qu’elle ne fait qu’attendre impatiemment de vieillir pour ainsi rejoindre ce qu’elle nomme « le pays des grands » (LM, 55). À l’opposé, la Tessa de 2015, bien ancrée dans ledit pays, rêve de revenir en arrière afin d’y échapper.
La narratrice de Fanny Britt dans Les maisons est continuellement préoccupée, nous l’avons vu, par un regard braqué sur elle-même. À travers l’évocation de moments privilégiés vécus avec ses enfants à partir de la naissance, en 2004, de Philémon, Tessa parvient à rediriger ce regard. Entièrement dévouée à ses enfants, vautrée dans l’amour qu’elle leur porte, la narratrice, se dispensant d’une autoréflexivité accaparante, s’oublie — elle, mais aussi ses doutes, ses hésitations et ses déceptions. Le regard porté sur soi devient un regard porté sur l’autre. Et l’égocentrisme se mue alors en allocentrisme. Tout se déroule comme si la narratrice, n’en pouvant plus de s’épier sans relâche, devait opposer à l’autosurveillance qui la ronge à l’intérieur une vision entièrement détachée. À partir de la naissance de Philémon, en 2004, Tessa admet qu’elle ne peut, en sa présence, ressasser ses vieilles rengaines : « Elle n’était plus une fille mais une mère, son coeur en charpie commençait à battre pour un autre. » (LM, 176) La maternité est pour la narratrice une échappatoire d’une vie entièrement baignée dans l’auto-analyse et un moyen de rejoindre l’émotion pure. D’ailleurs, elle ne comprend le chagrin immense qui envahit ses parents à la mort de son frère Étienne[33] qu’au moment de goûter elle-même aux joies de la maternité, quelques années plus tard :
Il me faudrait beaucoup de temps, jusqu’à la naissance de Philémon sans doute, pour saisir ne serait-ce que furtivement de quoi était fait cet amour. À l’opposé d’eux, j’ai vécu ces années entièrement occupée à me regarder, et à mesurer sur moi les effets de l’existence. […] Quatre longues années dans le douloureux vortex de l’égotisme le plus absolu. J’ai perdu cette obsession, certes, et la vie de Philémon m’est devenue infiniment plus importante, ce qui a constitué un soulagement immense.
LM, 136
Même si Tessa n’en a pas complètement fini avec son obsession, la présence de Philémon — et de ses deux autres fils, ultérieurement — agit comme un baume sur ses plaies, la soulageant d’un poids extrêmement lourd. Délivrée, en leur compagnie, de sa « passion débile pour l’introspection » (LM, 136), elle parvient à fuir le malheur qui l’emporte autrement. Ses enfants l’empêchent de sombrer : leur évocation suffit à lui rappeler la part active qu’elle joue dans le monde. Sur le point de craquer sous la pression du choix d’un maillot de bain, Tessa parvient à s’oublier quelques instants en se tournant vers Oscar, qui l’accompagne :
Petit ventre à plis […] qui se gonfle et se vide au rythme de son souffle de poulet — mon coeur se brise là, pour la millième fois devant sa beauté et sa nonchalance. Son absence totale de regard sur lui-même me chavire, et je regrette amèrement ma conduite et ma sévérité. Combien de temps ai-je perdu à condamner ce corps qui a pourtant construit celui d’Oscar ? Je suis prise d’une forte envie de rédemption, je veux me vautrer dans la sérénité…
LM, 68-69
Quand elle ressent l’amour véritable — et que son « coeur se brise » —, Tessa se donne corps et âme. Pour compenser l’ironie intense et entière qui la tenaille, la narratrice se projette dans un amour aussi intense et entier. C’est la « sévérité » habituelle de Tessa qui rend nécessaire sa « sérénité » épisodique. La présence d’Oscar à elle seule suffit à lui faire « regretter » son adhésion à l’ironie, qui lui apparaît alors futile et vaine. Grâce à Philémon, Boris et Oscar, l’isolement de Tessa laisse place à une « solitude bénie », parce qu’en aucun cas contaminée par une forme d’« interférence » ou de « culpabilité » (LM, 139). Si sa vie semble, en dehors des valeurs-refuges, complètement détraquée, elle affirme que « dans [leur] espace » — celui qu’elle occupe avec ses enfants — il n’y a que des « personnes parfaitement accordées » (LM, 140). La compagnie de ses garçons est un moyen dont dispose Tessa pour retrouver l’ordre ; le contraste de ces moments avec le chaos ironique lui permet de rétablir un équilibre fondamental.
La proximité de ses enfants permet à Tessa d’entrer en contact avec une émotion puissante, vive, ce qu’un refus catégorique du pathos l’empêche de faire partout ailleurs. Déjà, dans Les tranchées, l’auteure évoquait ce pouvoir des enfants de faire « s’ouvrir le coeur » et « sortir de sa torpeur[34] ». Comment Tessa pourrait-elle ne pas s’émouvoir quand elle voit que Philémon, l’aîné de ses fils, parvient, pour la première fois, à soulever sa tête « quatre, cinq secondes » (LM, 164) ? À cet instant précis, elle s’étonne de « sa propre excitation » (LM, 164). La narratrice, abandonnée à son amour maternel et à son admiration, réapprend à rire en présence de ses enfants : « [R]ire ne me semble pas difficile, parce que Boris est drôle et merveilleux, que Philémon est drôle et merveilleux. » (LM, 38) La routine, souvent intenable parce que symbole d’une vie sans artifice, est mieux apprivoisée par Tessa lorsque les garçons sont à ses côtés. Elle n’a alors rien à faire de ceux qui « laissent entendre, sous les dehors de questions innocentes, qu’avoir un bébé, ce n’[est] pas un choix de carrière » (LM, 139). C’est parce que l’amour, comme l’ironie à d’autres moments, prend toute la place, sature tout l’espace. Tessa est alors comblée et n’a plus besoin de rien, pas même de la présence de ses vieux amis, qu’elle n’hésite pas à délaisser au profit de ses enfants, comme au moment de l’embauche de Jim à l’orchestre :
J’ai pensé aux amis qui arriveraient en troupeau […]. Je les entendrais ressasser des anecdotes du temps de l’école, derrière la porte fermée de ma chambre, où je me serais retirée pour nourrir Philémon. Là, je pourrais les écouter sans faire l’effort de sourire et d’acquiescer ; rien ne m’intéressait excepté ce silence rythmé de succions. D’ailleurs, rien de ce qu’ils m’offriraient, le vin, les blagues, l’énergie, ne pourrait me retenir auprès d’eux. J’étais prise, promise, merveilleusement emmurée.
LM, 166
Voulant faire contrepoids à sa vie écorchée par une ironie vindicative, Tessa choisit, à ses côtés, un homme protégé de l’ironie, un « homme-rocher[35] » à proprement parler. En effet, Jim ne se laisse pas ronger par le doute, demeure toujours égal à lui-même et se régale des petits plaisirs de la vie. Les soupirs qu’il lance ne trahissent pas de « l’agacement », mais bien de « l’empathie » (LM, 72). Tessa, obnubilée par l’ironie, a besoin d’un homme incapable — ou refusant — d’en percevoir les codes :
J’ai déniché un t-shirt volontairement élimé qui porte l’inscription : « Tout va bien. » L’ironie, intentionnelle ou non, m’a amusée. […] Jim, lui, s’amuse de ma dureté, elle le galvanise et l’attire. Il prétend que le t-shirt est dépourvu d’ironie. Tout va bien, vraiment. Tout va beaucoup mieux que je l’aurais imaginé, dit-il souvent.
LM, 72
Puisque Tessa a l’impression d’avoir tout gâché, elle s’accroche à l’idéalisme de Jim. Si la « dureté » (LM, 72) de Tessa « galvanise » (LM, 72) le père de famille, la délicatesse de celui-ci réconforte inversement la narratrice. Elle oppose à sa lucidité extrême l’inconscience absolue de Jim qui, comme « gavé de sa propre liberté » (LM, 127), ne se rend pas compte de son mal-être, encore moins de ses envies d’adultère. Entièrement consacré à son amour, le musicien ne trouverait même pas suspect, selon Tessa, de la voir toute parée s’il la croisait avant son rendez-vous clandestin avec Francis ; bien à l’opposé, il se serait adressé à Oscar en lui indiquant « comment maman est belle » (LM, 190). L’insouciance de Jim, parfois connotée négativement, a néanmoins quelque chose de salvateur, ce que Tessa réalise vers la fin de son récit. Jim ne se laisse pas aller à la conscience malsaine qui envahit sa femme ; au contraire, il lui fait découvrir une autre perspective, celle du détachement. À l’inverse de Tessa, qui passe le plus clair de son temps à se chercher dans le regard des autres, Jim est décrit comme un homme qui « n’a pas besoin qu’on l’admire » (LM, 71). Il ne porte pas, à l’instar de ses fils, de regard sur lui-même : Jim est un homme si peu complexe qu’il mérite à peine le titre de personnage. Avec les trois garçons, véritables « répliques » (LM, 186) qui ont hérité de son « indéfectible amour » (LM, 186) et de son « irrésistible lumière » (LM, 214), Jim érige un rempart nécessaire contre le doute généralisé qui s’empare de Tessa. En lieu et place de ce doute, Jim et les garçons substituent une vision entièrement ancrée dans l’émotion, dans le ressenti. À un moment, Tessa, conditionnée par cette vision, se laisse aller à son amour pour Jim :
Son grand souffle d’instrumentiste bloque tous les sons […]. [I]ci il n’y a que notre vague et notre respiration, que le concentré de nous deux, quinze ans de gestes répétés, adorés, nécessaires et maîtrisés, rien d’autre n’existe, il sait tout ce qu’il faut pour me ramener à la vie et me faire perdre conscience, ces minutes sont l’or de nos existences et je m’y noie.
LM, 78
Tessa, protégée de sa conscience envahissante, réussit à se vautrer dans un bonheur qui prend toute la place. Au moment de son rendez-vous avec Francis[36], les pensées de Tessa à l’endroit de Jim sont plus bienveillantes que jamais. À cet instant, c’est le souvenir de Jim qui rattrape Tessa et la redirige vers la voie de la sincérité et de la fidélité. Les faits et gestes de Francis lors de leur rencontre évoquent systématiquement ceux de Jim, qui sont valorisés par la mise en parallèle. Les gants et le foulard de Francis deviennent quant à eux une raison suffisante pour songer à Jim, qui « oublie toujours son foulard » (LM, 197), petit travers dont elle s’aperçoit qu’il la « remplit de fierté » (LM, 197). La narratrice décrit alors son besoin de voir Jim comme « aigu, impératif » (LM, 210). Tout se passe comme si la rencontre avec Francis et l’anticipation de leurs ébats à venir avaient suffi à lui faire réaliser sa chance, la désencombrant du même coup de « ce spectre de malheur qui a voulu [lui] faire miroiter son foutu univers parallèle » (LM, 210). Tessa comprend que c’est en Jim et en ses enfants qu’elle trouve une forme de rempart et qu’elle doit fonder tous ses espoirs d’insouciance.
Le roman Les maisons de Fanny Britt met en scène une ironie destructrice qui s’en prend à Tessa, la narratrice. Le récit est celui de cette femme indécidable, qui continuellement se regarde et se juge sévèrement. C’est en vérité la « maison » en tant qu’espace privilégié qui agit à titre de rempart contre l’ironie postmoderne, permettant à la narratrice de retrouver un certain ordre. Les souvenirs heureux de Tessa dans les maisons de ses parents et les moments précieux passés avec ses enfants, puis avec Jim dans leur nid du Mile-End, sont imprégnés d’une douce aura de sincérité qui compense l’âpreté ironique, conformément au mouvement de la New Sincerity. Dans Les tranchées, Fanny Britt considérait déjà « cette présence anticipée, espérée, salvatrice » qu’est la famille comme un « antidote ultime à la vacuité de l’expérience[37] ». Joana Duarte Bernardes voit dans le motif de la maison « un état d’âme[38] » ; Chantal Richard, un microcosme absolument essentiel dans « le diagnostic psychologique et psychosocial[39] ». Le rapport de Tessa à sa maison, à son chez-soi, est en ce sens nettement thérapeutique. Sous les façades impersonnelles se dissimulent des intérieurs intimes : les maisons sont cette tension entre camouflage et dévoilement de la démarche de l’être. Et les « intérieurs encombrés[40] », s’ils recèlent des existences faibles, malheureuses, comportent néanmoins leurs nécessaires instants de clarté.
Parties annexes
Note biographique
JULIEN ALARIE est étudiant de 3e cycle au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, où il s’intéresse à la littérature de l’extrême contemporain et à ses manifestations romanesques, intermédiales et numériques. Son mémoire de maîtrise portait sur l’esthétique du brouillage (spatial, temporel et narratif) de six romans parus entre 2005 et 2015 aux Éditions de Minuit. Sa thèse de doctorat visera à rendre compte de l’« ex-centrement géographique » dans un certain nombre de récits immédiatement contemporains publiés en France et au Québec.
Notes
-
[1]
Fanny Britt, Les tranchées. Maternité, ambiguïté et féminisme, en fragments, Montréal, sous la direction de Marie-Claude Beaucage, avec la collaboration de Madeleine Allard, Alexia Bürger, Annie Desrochers, Alexie Morin, Geneviève Pettersen et Catherine Voyer-Léger et les illustrations d’Isabelle Arsenault, Atelier 10, coll. « Documents », 2013, p. 13.
-
[2]
Fanny Britt, Les maisons, Montréal, Le Cheval d’août, 2015, 222 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LM suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. Le soulignement dans les citations est toujours de Britt.
-
[3]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 39.
-
[4]
Les quatre périodes temporelles autour desquelles s’organise Les maisons sont les suivantes : 1982, alors que Tessa a quatre ans, 1993, 2004 et 2015. Le « récit premier » se déroule en 2015 ; la narratrice évoque les autres époques par le biais d’analepses.
-
[5]
Bruno Blanckeman, Les récits indécidables. Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Perspectives », 2008, p. 222.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Jia Zhao, « L’ironie dans le roman français depuis 1980 : Echenoz, Chevillard, Toussaint, Gailly », Intercâmbio, vol. VI, no 2, 2013, p. 162. Dans son article, Zhao s’attarde sur ce trait ironique qu’est la « légèreté méditative », attitude impassible qui se déploie le plus chez les narrateurs minuitards.
-
[8]
Ibid., p. 169.
-
[9]
Ibid., p. 167.
-
[10]
Alexandre Gefen, « Compassion et réflexivité : les enjeux éthiques de l’ironie romanesque contemporaine », Fabula. La recherche en littérature, en ligne : http://www.fabula.org/colloques/document1030.php#tocto1n1 (page consultée le 1er février 2019). L’ironie contemporaine, telle que la conçoit Gefen, est indissociable d’une forme de distance : elle est « l’ouverture d’une option herméneutique de réserve, d’une possibilité de distanciation ».
-
[11]
Pierre Schoentjes, « La séduction de l’ironie », Mustapha Trabelsi (dir.), L’ironie aujourd’hui : lectures d’un discours oblique, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Littératures », 2006, p. 297.
-
[12]
Ibid.
-
[13]
Ibid.
-
[14]
Ibid., p. 296-297.
-
[15]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 83.
-
[16]
Ibid., p. 52.
-
[17]
Fanny Britt, Les maisons, p. 23.
-
[18]
Francis était le copain de Tessa lorsqu’elle était au début de sa vingtaine. Leur rupture, de laquelle Tessa ne s’est jamais entièrement remise, est le principal sujet du passage consacré à l’année 2004. Dans le cadre de ses activités professionnelles, Tessa rencontre Évelyne, qui vient de se faire larguer. Très tôt, Tessa apprend que l’homme qui a abandonné Évelyne est en fait Francis, qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs années. Leur réunion est source d’excitation.
-
[19]
Jean Echenoz, « La réalité en fait trop, il faut la calmer », propos recueillis par Jean-Baptiste Harang, Libération, 16 septembre 1999, en ligne : https://next.liberation.fr/livres/1999/09/16/la-realite-en-fait-trop-il-faut-la-calmer_283385 (page consultée le 1er février 2019).
-
[20]
Jackie Rubichon, « Au piano de Jean Echenoz : un roman néo-réaliste », Aline Mura-Brunel (dir.), Chevillard, Echenoz. Filiations insolites, Amsterdam, Rodopi, 2008, p. 53.
-
[21]
Josée Lapointe, « Dans la maison de Fanny Britt », La Presse, 28 octobre 2015, en ligne : http://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201510/28/01-4914800-dans-la-maison-de-fanny-britt.php (page consultée le 1er février 2019).
-
[22]
Alexandre Gefen, « Compassion et réflexivité : les enjeux éthiques de l’ironie romanesque contemporaine ». L’ironie postmoderne, que Gefen assimile à une stratégie discursive, se définit comme autoréflexivité. Elle produit dans les oeuvres (il évoque surtout le corpus français) « une parole auto-accusatrice, un narrateur improbable, des personnages ambivalents, un statut référentiel instable, un brassage des valeurs et des doutes ». Ces éléments constituent des marqueurs d’ironie.
-
[23]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 66. Dans un chapitre intitulé « Les reines de la pataugeoire », Fanny Britt énumère les types de mères qu’il est possible de croiser à la pataugeoire du parc Laurier : des mères pudiques qui adoptent « le tankini-jupette », des « irréductibles en vêtements » qui refusent de porter un maillot et des « plotes de pataugeoire » qui arborent « des bikinis triangles ». Ces dernières sont jugées coupables de jeter de l’ombre sur les deux premiers types.
-
[24]
Lucie Joubert, Le carquois de velours. L’ironie au féminin dans la littérature québécoise, 1960-1980, Montréal, l’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1998, p. 59.
-
[25]
Josée Lapointe, « Dans la maison de Fanny Britt ».
-
[26]
Lucie Joubert, Le carquois de velours, p. 202.
-
[27]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 34.
-
[28]
Fanny Britt, « Derrière les portes closes de nos maisons », entrevue radiophonique avec Marie-Louise Arsenault, Plus on est de fous, plus on lit, 27 octobre 2015, en ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2012-2013/chronique.asp?idChronique=387673 (page consultée le 1er février 2019).
-
[29]
Voir, entre autres exemples, le passage aux pages 63 et 64 : « Tanya respire (Quelle terrible injustice, quand même […] alors que moi, la vieille pâlotte à la chair pâteuse…), son visage s’anime, et elle s’empresse de signer… »
-
[30]
Voir à ce sujet les travaux d’Adam Kelly, notamment « David Foster Wallace and the New Sincerity in American Fiction », David Hering (dir.), Consider David Foster Wallace: Critical Essays, Austin, SSMG Press, 2010, p. 131-144.
-
[31]
Dominique Viart, « Écrire au présent. L’esthétique contemporaine », Francine Dugas-Portes et Michèle Touret (dir.), Le Temps des Lettres. Quelles périodisations pour l’histoire de la littérature française du 20e siècle ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 329.
-
[32]
Brigitte Adriaensen, « L’ironie postmoderne et le retour de l’auteur », Texte, nos 35-36, 2004, p. 84. Adriaensen reprend les propos formulés dans Alan Wilde, Horizons of Assent. Modernism, Postmodernism, and the Ironic Imagination, Baltimore/London, The John Hopkins University Press, 1981, p. 148.
-
[33]
Dans le chapitre consacré à 2004, Tessa raconte la disparition de son frère qui, pendant un voyage avec des amis en Écosse, est tombé du haut d’une falaise escarpée. Les parents d’Étienne, bien plus que Tessa qui est toujours obnubilée par Francis, ont du mal à s’en remettre. Ils demandent régulièrement aux amis d’Étienne de leur raconter les derniers moments de leur fils, ce qui exaspère et impatiente Tessa.
-
[34]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 76.
-
[35]
Ibid., p. 32. Dans le chapitre intitulé « Rien ne dure », Fanny Britt évoque cet homme insouciant, dont la solidité est salvatrice.
-
[36]
Après avoir revu Francis par l’entremise d’Évelyne, Tessa consent, non sans remords, à un rendez-vous galant, qui aura au moins le mérite de lui rappeler tout son amour pour Jim. Cet épisode clôt le récit.
-
[37]
Fanny Britt, Les tranchées, p. 36.
-
[38]
Joana Duarte Bernardes, « Habiter la mémoire à la frontière de l’oubli : la maison comme seuil », Conserveries mémorielles, no 7, 2010, en ligne : https://cm.revues.org/433?lang=en#quotation (page consultée le 1er février 2019).
-
[39]
Chantal Richard, « Des mots comme les murs d’une maison. Le leitmotiv du logis dans le roman acadien contemporain », Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne, vol. XXXV, no 1, 2010, p. 165 ; en ligne : https://journals.lib.unb.ca/index.php/scl/article/view/15945/17190 (page consultée le 1er février 2019).
-
[40]
Fanny Britt, « Derrière les portes closes de nos maisons ».