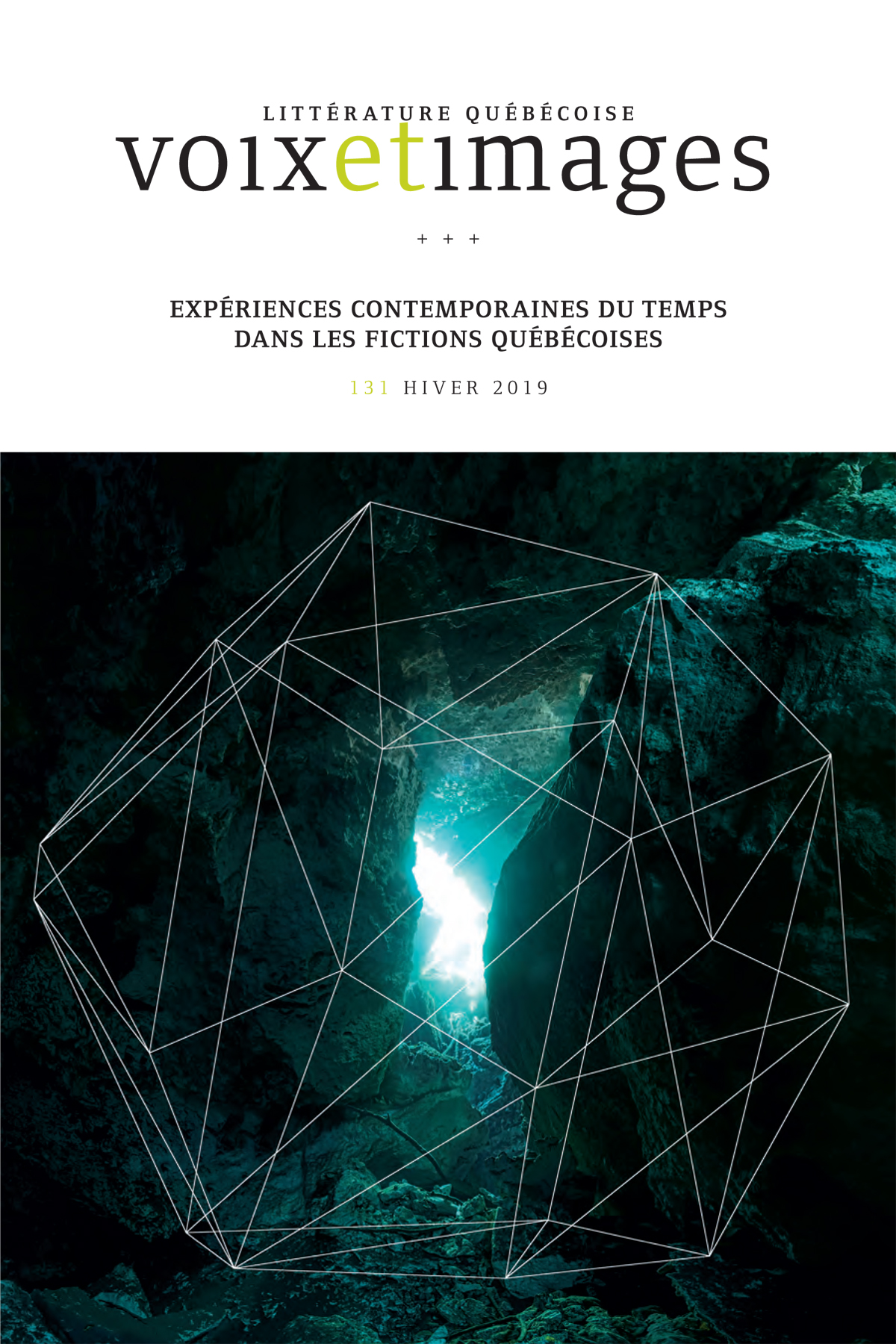C’est bien connu, tout se vend ; la littérature (ou, devrais-je dire, les écrivain.e.s) ne faisant évidemment pas exception. Prenez Samuel Beckett ; pensez à son visage. Pensez à toutes les phrases que l’on pourrait citer hors contexte. Par exemple : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter. » Merveilleux. Imprimez la phrase sur une carte, ajoutez son beau visage, creusé par l’inquiétude, et offrez-la à un ou une ami.e. Vous pouvez même en faire un slogan de pensée positive (super !). N’essayez pas de trouver la référence précise, en revanche (en français ou en anglais), le seul gage d’authenticité de la phrase, semble-t-il, étant le nombre de reprises. Que Beckett, en disant cela, pensait à la littérature irlandaise, pourquoi s’en soucier ? Ou devrait-on ? Il voulait dire écrire, alors ? Transposons le contexte à aujourd’hui. On pourrait, à certains égards, être porté à chanter. Ou à écrire. On ne s’en prive pas, d’ailleurs, avec la merde de l’époque en tête ou non. L’écriture, dans ce cas, peut faire office de refuge ou d’arme. Les trois livres dont il sera question ci-dessous ont en commun d’opposer l’écriture à l’époque, soit par une forme de repli, soit pour lutter, avec les armes du discours, contre l’hégémonie ambiante. Commençons avec la question du travail. Il fut un temps où les films de Denys Arcand étaient porteurs de révolte, d’impatience, voire de colère face à une soumission perçue comme déraisonnable ; celle des travailleuses et travailleurs du textile, par exemple, qu’il avait longuement interrogés pour le documentaire On est au coton. Transposée en matériau de fiction, cette somme d’affects a donné lieu, en vrac, à : un viol collectif ; une vengeance exercée à coups de chaînes et de bâtons de baseball en plein visage ; un gros plan sur les résidus rougeâtres rejetés par la cheminée d’éjection d’un souffleur à neige après qu’il a happé le corps d’un motoneigiste. Pour que l’on comprenne bien la portée sociale et politique d’un tel déchaînement, Gina reprenait, à la suite de la censure qui obligera On est au coton à circuler sous le manteau, des citations explicites du documentaire (Frédérique Collin, notamment, dont le personnage de Dolorès livre mot pour mot un extrait du témoignage de Carmen Bertrand), le film mettant en scène une équipe de cinéastes de « l’Office national du cinéma » en visite à Louiseville afin de tourner un documentaire sur l’industrie du textile. C’est à une violence similaire, aussi excessive, aussi crue, que nous convie Kevin Lambert dans son deuxième roman, Querelle de Roberval. Et au même mélange d’excès et de distanciation, nourri par une enquête qui donne à certaines sections du livre des accents proprement documentaires, alors que des éléments empruntés au théâtre antique viennent au contraire souligner la construction du dispositif. Résumé simplement, Querelle de Roberval se veut le récit d’une grève, celle des travailleurs et travailleuses de la scierie de Roberval. Or on le sait, la capitalisation financière des entreprises et la diminution du poids symbolique des syndicats dans le climat actuel rendent les conflits de travail défavorables aux travailleurs. Le conflit représenté se terminera en toute logique en catastrophe. À ce récit se greffe d’emblée ce qui est décrit comme un corps étranger : le héros éponyme, Querelle, d’un roman de Jean Genet, « copié-collé » dans le récit afin de servir de « grain de sable dans l’engrenage de la machine économique, hétérosexuelle et patriarcale ». Beau, musclé, à la virilité « minutieusement pétri[e] » (115) et décidée pour lui par les vétérans d’un …
Écrire à rebours du réel[Notice]
…plus d’informations
Stéphane Inkel
Université Queen’s