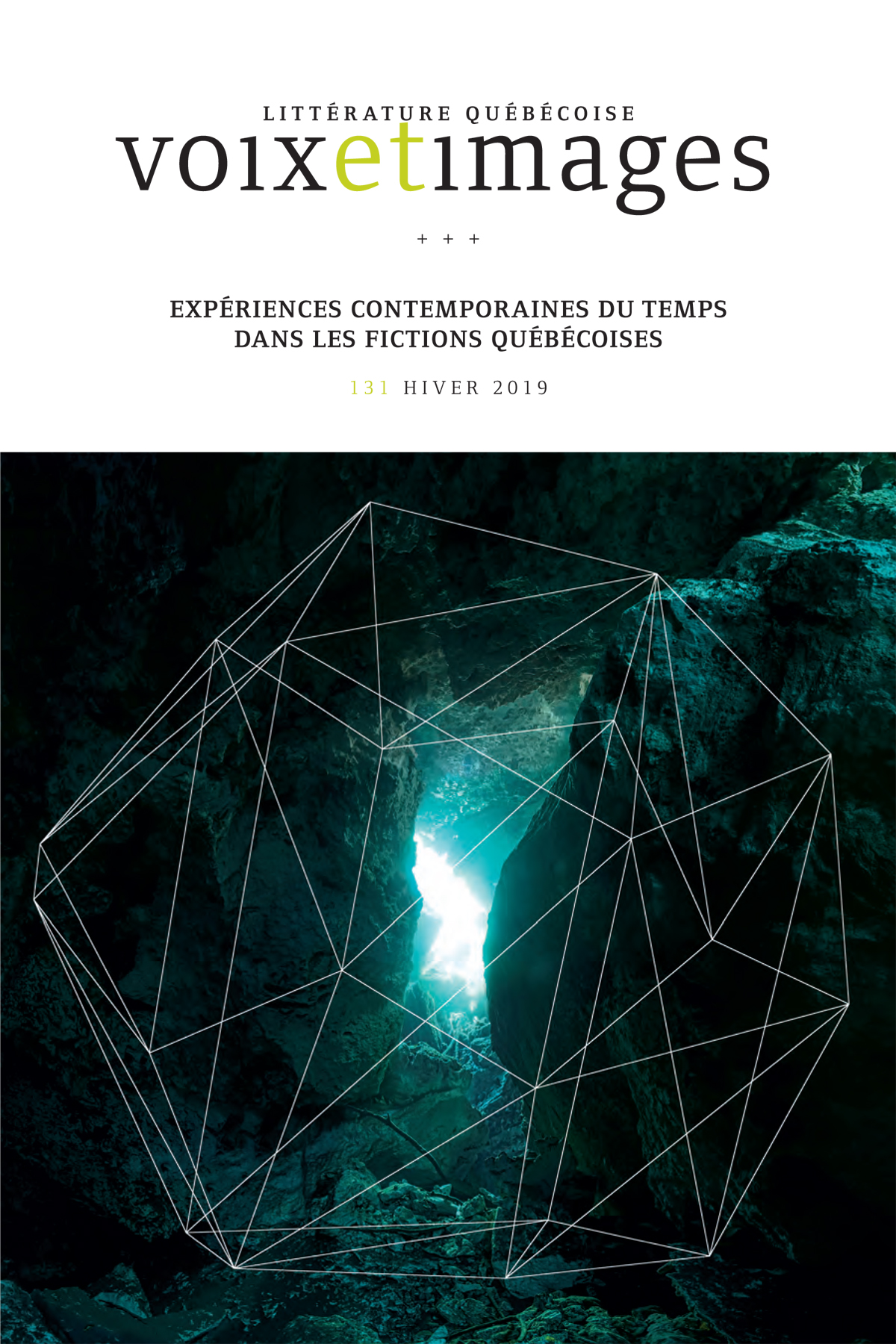Le terme « roman » désignant pratiquement aujourd’hui par défaut toute narration fictionnelle, sans doute une chronique consacrée au genre ne peut-elle que se heurter régulièrement à la question de l’incertitude de ses limites. Autant donc s’y confronter sans délai, en évoquant pour commencer des ouvrages qui tendent à échapper à la dénomination. Sous la plume de Dominique Fortier, celle qui s’est dérobée à son destin tout tracé d’épouse et de mère afin de pouvoir écrire est peut-être essentiellement une femme pour qui « on ne peut pas avoir à la fois la vie et les livres — à moins de choisir les livres une fois pour toutes et d’y coucher sa vie » (108). À travers la figure d’Emily Dickinson, il est manifeste que l’écrivaine interroge son propre destin. Car, née un siècle et demi après son héroïne, en un temps où la femme n’est plus confinée au foyer, elle a choisi le mariage et la maternité — et ses deux derniers livres qui entrelacent à la matière fictionnelle une sorte de journal d’écriture du déracinement font de son mari et de son enfant des personnages. Si la poétesse fournit à la « prosaïque » romancière la matière d’un livre, elle est aussi une sorte de prisme à travers lequel interroger la condition de femme vouée à la littérature, partagée entre le monde tangible et celui des livres, en diluant le « je » autobiographique dans l’encre du texte en train de s’écrire. C’est aussi un destin de femme singulier que relate la poète Catherine Lalonde dans La dévoration des fées, qui constitue une remarquable incursion en territoire narratif — mais un destin ancré dans la terre et la langue d’ici. Son héroïne, ensauvagée et sensuelle, semble au premier abord l’exact négatif de la diaphane Emily Dickinson, de la même manière que l’écriture viscérale de Catherine Lalonde et la prose délicate de Dominique Fortier paraissent s’opposer. Comme Les villes de papier, toutefois, ce récit est travaillé par la parole d’autres femmes poètes. L’auteure reconnaît ainsi sa dette à D. Kimm, Geneviève Desrosiers, Hélène Monette et Josée Yvon, et son titre dit assez qu’il faut ajouter à cette liste le nom de Denise Boucher. Avec Les fées ont soif, cette dernière avait cherché à libérer la femme des archétypes de la mère, de la prostituée et de la Vierge auxquels la société l’assujettissait, en donnant voix aux personnages de Marie, de Madeleine et de la Statue. Quelque quarante ans plus tard, Catherine Lalonde reprend le flambeau dans un récit effervescent qui donne à lire l’émancipation féminine en mêlant au récit le conte, le mythe et la poésie. Le texte s’ouvre sur une naissance : celle de la p’tite, mise au monde dans la douleur par une mère qui ne lui survivra pas. C’est à Grand-Maman qu’il revient de prendre soin, à contrecoeur, de cette enfant coupable d’avoir tué sa fille Blanche et de devoir connaître, comme toutes les autres, le triste sort des femmes (après les cris de l’enfantement, après le silence de la mort, après le vagissement du nouveau-né, c’est une exclamation de dépit qui retentit). Le texte raconte la grand-mère Carabosse aux prises avec la marmaille affamée qui toujours cavalcade. Dans l’absence de Blanche et des hommes — morts « comme des mouches » (55) —, Grand-Maman fulmine au milieu du désordre ; « elle a hâte que la p’tite arrive, enfin, dans sa vie de femme faite ; sa vie de femme faite de sang et d’eau de vaisselle » (53). Mais la p’tite va déjouer le sort. Malgré la mère morte et l’absence …
Le récit des femmes poètes[Notice]
…plus d’informations
Audrey Camus
Chercheuse indépendante