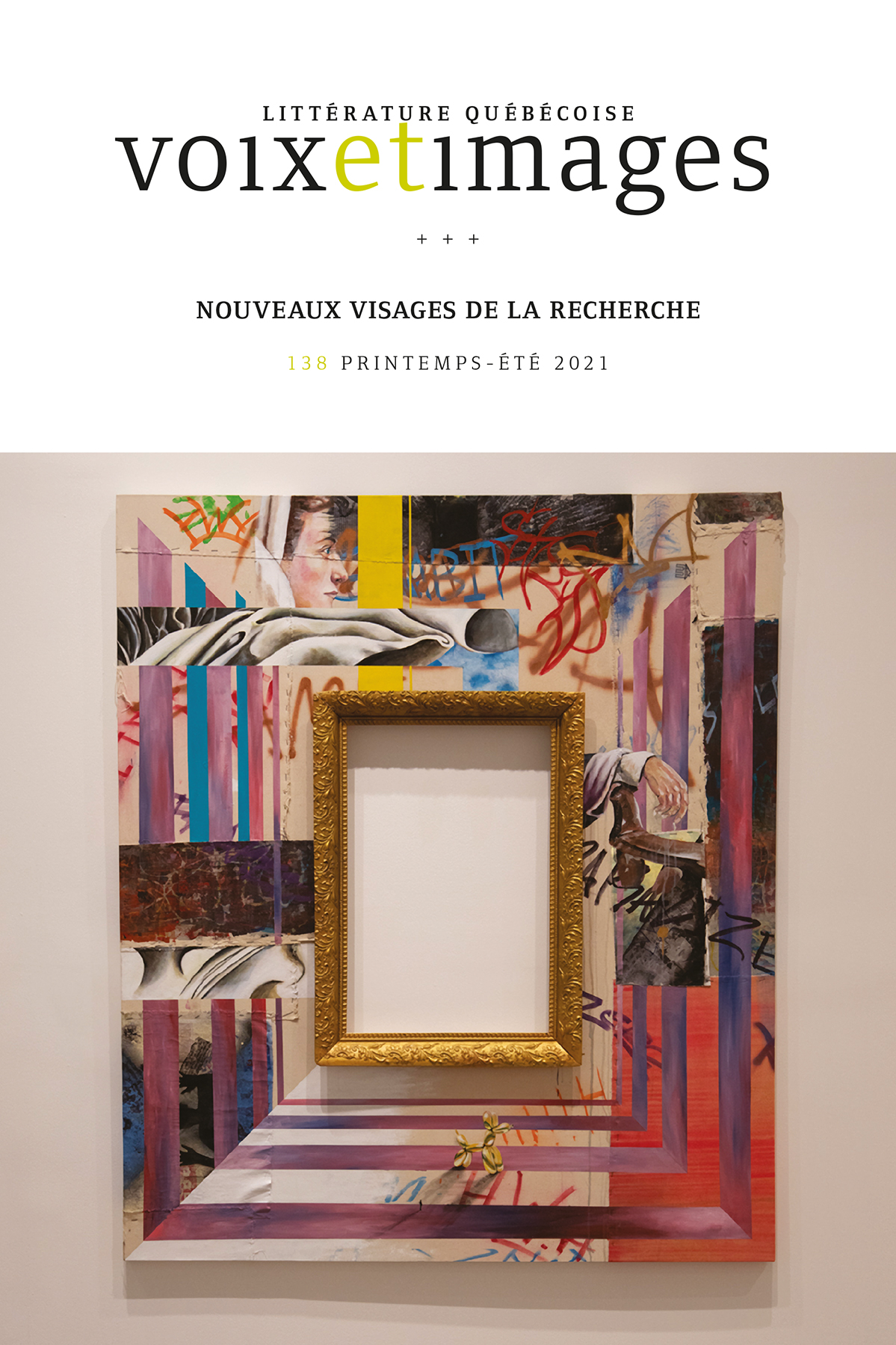Corps de l’article
J’ai commencé cette chronique en 1985 en la centrant entièrement sur le théâtre qu’on lit. De mon point de vue, une revue spécialisée en études littéraires devait envisager l’écriture dramatique pour ce qu’elle est, c’est-à-dire comme une oeuvre, hors de toute représentation et mise en scène, laquelle renvoie à une autre pratique artistique, à une autre approche, voire à une autre discipline du savoir. Il s’agissait pour moi de poser un regard singulier sur cette écriture, d’en saisir les enjeux et la dynamique. Si j’ai beaucoup lu le théâtre, c’est d’abord parce qu’on en a publié beaucoup et qu’il est aisément accessible en librairie et en bibliothèque. J’aime ces voix plurielles et les rapports qu’elles entretiennent les unes aux autres ou qu’elles laissent entrevoir entre des personnages. J’aime fréquenter l’espace qu’elles créent et qu’elles mettent en jeu. J’aime lire ces voix sans intermédiaire, sans narrateur, sans metteur en scène, pour ce qu’elles me disent en propre, à l’antithèse du roman, à l’antithèse du spectacle. Au cours des années, j’ai voulu partager ce que j’avais désigné dans ma chronique inaugurale comme « la passion du dialogue[1] ».
Au moment de mettre un terme à cette chronique – il faut savoir partir –, la pandémie de la COVID-19 qui frappe le monde a suspendu un temps l’édition théâtrale. La plupart des éditeurs, en effet, n’acceptent de publier un texte dramatique que si celui-ci a connu les feux de la rampe, c’est-à-dire qu’il a été agréé par un metteur en scène, une troupe, un public. Posture absurde s’il en est. Car on se demande bien pourquoi il ne serait pas possible de lire un texte dramatique injouable, non conforme à l’esthétique des metteurs en scène, par ailleurs en concurrence les uns avec les autres, ou à celle des publics souvent plus friands d’une sortie en couple ou entre amis que d’une oeuvre authentique à découvrir. Pourquoi ne pourrions-nous pas lire un texte dramatique avant qu’il ne soit joué ? Pourquoi faut-il toujours attendre après ? Évidemment, en l’absence d’activité théâtrale – les théâtres étant fermés –, l’édition théâtrale s’est ratatinée.
+
Quelques rares maisons d’édition ont alors choisi de revenir à des textes plus anciens dont elles livrent la valeur historique. Par exemple, les Éditions du remue-ménage ont remis en circulation en 2020 la pièce emblématique du Théâtre des Cuisines Môman travaille pas, a trop d’ouvrage ![2], pièce portant sur le travail domestique et la division sexuelle du travail, écrite et jouée par une troupe de théâtre d’intervention – du théâtre amateur, insistent les comédiennes –, pièce qui est aussi le premier livre publié par cet éditeur en 1976. Je dois dire que relire cette pièce au moment où tout le Québec tombait en panne, voir les femmes rentrer à la maison pour y retrouver leurs enfants chassés de l’école, affronter chaque matin le travail domestique et le travail rémunéré en même temps, sans issue, a réveillé chez moi la mémoire de ce temps où nous en avons eu assez. « Le chaudron est plus bouillant que jamais », écrit d’ailleurs Véronique O’Leary dans sa lettre-préface (11), où elle rappelle la genèse de la troupe, la nature de son travail et les circonstances dans lesquelles les comédiennes ont rencontré un public varié, engagé, majoritairement composé de femmes de milieux populaires, mais où elle ouvre aussi sur les situations plus nouvellement perçues que sont les discriminations et violences que subissent encore aujourd’hui les femmes, en particulier les femmes racisées. La pièce elle-même avait pour objectif de rendre visible la valeur du travail domestique ; une première version débouchait d’ailleurs sur la revendication d’un salaire pour le travail ménager, abandonnée depuis au profit de nouvelles formes d’organisation de la famille. Sur ce plan, la pièce a pris de l’âge. Néanmoins, quand les femmes déclenchent la grève du travail domestique, on entend le patron hurler devant l’absence de ses employés, on voit le premier ministre tenter de concevoir des mesures d’urgence, une loi spéciale, et un juge contraint d’évaluer la valeur financière de ce travail dans des mots qui résonnent encore en ces temps de désorganisation.
Les Éditions de la Pleine lune rééditent quant à elles Nous aurons les enfants que nous voulons[3], première création de la même troupe en 1974, écrite et jouée dans la tourmente des revendications féministes sur le droit des femmes à disposer de leurs corps au moment le plus crucial de ce que nous avons appelé depuis l’affaire Morgentaler. En cette période où les services de garde pour enfants sont en débandade et où la droite conservatrice n’en finit plus de déposer des projets de loi privés qui ont tous pour objectif de recriminaliser l’avortement par un biais ou un autre, la relecture de ces deux pièces a un côté rafraîchissant. Non, le féminisme ne date pas d’hier. Mais on n’a pas non plus beaucoup avancé depuis. L’initiative de ces maisons d’édition est également intéressante en ce qu’elle remet à l’avant-plan une des nombreuses fonctions sociales du théâtre, qui ne peut pas être réduit à sa fonction de produit culturel inscrit dans une vaste industrie pluridisciplinaire, ni même à sa stricte fonction artistique. Le Théâtre des Cuisines, dont le manifeste est ici reproduit, poursuivait l’objectif avoué d’agir sur le public, de déployer une action communautaire. La valeur esthétique, le divertissement comptaient, mais pas au détriment des idées, des revendications, des politiques.
Les deux maisons d’édition font ici oeuvre historique bien entendu, les textes eux-mêmes agissant comme témoins d’une époque, mais il est sans doute aussi utile de rappeler que ces pièces ont été vues par plusieurs milliers de spectatrices et que le collectif lui-même, composé de femmes d’horizons divers, travailleuses ou chômeuses, n’en a pas moins été le creuset d’une écriture féministe qui allait nous laisser quelques signatures importantes, celle de Véronique O’Leary d’abord, décrite comme l’âme du groupe, mais aussi celle de Carole Fréchette, co-autrice de la seconde pièce.
+
Sans doute aussi François Harvey fait-il oeuvre historique en publiant le Théâtre[4] d’Hubert Aquin, une série de cinq pièces écrites entre 1948 et 1960. Aucune n’a été portée à la scène. La dernière, L’emprise de la nuit, avait néanmoins obtenu une mention au concours organisé par le Théâtre du Nouveau Monde en 1960, concours dont le premier prix était allé à André Laurendeau pour ses Deux femmes terribles. Dans sa préface, Harvey rappelle que « le théâtre [a rempli] un rôle de premier plan dans le parcours scolaire d’Hubert Aquin », qui a fréquenté l’Externat classique Sainte-Croix, dirigé par une communauté très active en ce domaine – le père Émile Legault, fondateur des Compagnons de Saint-Laurent, était lui-même père de Sainte-Croix –, puis le collège Sainte-Marie, où il a fréquenté notamment Louis-Georges Carrier, Marcel Dubé et Pierre Perrault, et l’Université de Montréal, avant de s’installer à Paris, où il fréquente Jacques Languirand et d’où il écrit plusieurs articles de critique théâtrale et cinématographique, diffusés notamment à Radio-Canada. Harvey a également raison de rappeler que le théâtre se trouve aux sources de l’oeuvre romanesque, traversée par les grandes figures d’Oedipe et de Hamlet, marquée par la plume de Shakespeare et celle de Dostoïevski. La lecture, toutefois, révèle aussi des modèles plus contemporains, tel Pirandello, dont l’esprit traverse Le quatuor improvisé où, alors que cinq personnages font la queue dans la salle d’attente d’un presbytère pour rencontrer le curé, l’un d’entre eux entraîne les quatre autres dans une mise en scène qu’ils finissent par prendre au sérieux. On pourrait citer aussi Camus, Sartre et Adamov, qui imprègnent Le prophète, réécriture moderne de la trajectoire de Jésus, et L’écorché vif, qui n’entend pas les refus répétés de celle qu’il aime à travers le bavardage des membres de sa famille. Le drame des hormones, la pièce la plus ancienne, qui est aussi la plus courte, présente un aspect potache dans la relecture des amours entre Tristan et Iseult. La dernière pièce, L’emprise de la nuit, est de loin la plus achevée, mais elle est aussi la plus classique et la plus verbeuse. Un fonctionnaire du ministère du Revenu complote l’assassinat de son patron, dont il a séduit la femme. Toutes les pièces présentent une structure circulaire, soit que le personnage principal n’a pas avancé dans sa démarche, soit qu’il retourne au point de départ. Toutes présentent une forme de dédoublement de l’action dramatique, théâtre dans le théâtre (Le quatuor improvisé), superposition de récits parallèles (Le drame des hormones, Le prophète, L’écorché vif), complots croisés (L’emprise de la nuit). On lira le théâtre d’Hubert Aquin comme un laboratoire d’écriture qui ne manque ni d’intérêt ni de fraîcheur. Il y ouvrait des options d’écriture que la suite aura parfois abandonnées, parfois réactualisées autrement.
+
« Pourquoi publier, trente ans après sa création, À quelle heure on meurt ? » demandent Émilie Coulombe et François Jardon-Gomez dans leur introduction au collage des textes de Réjean Ducharme réalisé par Martin Faucher[5], créé sous ce titre le 8 novembre 1988 à l’Espace Go, repris avec succès en 1999, en 2011, en 2013, puis annoncé pour le printemps 2020 et finalement présenté en octobre 2021 au Théâtre de Quat’Sous, dans une nouvelle mise en scène signée par Frédéric Dubois. Tel succès est, en soi, une raison de publier le collage de Martin Faucher, qui trouve là une réactualisation intéressante. À défaut d’être vu, le texte se donne à lire avec quelques photographies de scène. Il faut tout de même rappeler le caractère étonnant de la présence scénique de Réjean Ducharme, dont les metteurs en scène n’en finissent plus d’adapter les romans, L’hiver de force par Lorraine Pintal, La fille de Christophe Colomb par Martin Faucher, par exemple. Or, Ducharme a aussi laissé une oeuvre dramatique importante, mais elle ne paraît intéresser personne. L’argument le plus fréquent soutient que Ducharme est réellement maître de son art dans le roman et que son théâtre est trop absurde ou trop difficile. Mais alors, pourquoi réduire les romans au théâtre ? Il y a dans cette démarche deux volets. D’une part, ces adaptations témoignent de la séduction forte qu’exerce le verbe ducharmien sur ces lecteurs que sont aussi les metteurs en scène. D’autre part, c’est peut-être que les adaptations rendent le verbe ducharmien plus accessible au plus grand nombre et à un moindre coût que ne l’exigerait la lecture réelle. Le travail de Martin Faucher, qui n’est pas une adaptation, mais un collage, opère une traversée intégrale de l’oeuvre. Le titre lui-même, À quelle heure on meurt ?, est emprunté à une sculpture. La trame musicale recourt aux chansons. Plusieurs répliques sont empruntées aux textes dramatiques que sont Ha ! Ha ! ou Le Cid maghané. La trame du spectacle est celle du Nez qui voque et les deux personnages sont Mille Milles et Châteaugué, qui vivent difficilement le passage de l’enfance à l’âge adulte. Nombreux sont les renvois aux autres romans (« Tout m’avale », 59). Dans la postface qu’elle signe avec générosité, Élisabeth Nardout-Lafarge décrit le travail de Faucher comme un florilège, voire un concentré qui met en valeur l’unité et la cohérence de l’univers ducharmien, et révèle comment « une théâtralisation de la parole est à l’oeuvre dans les romans de Ducharme » (74). Il faut en effet se rendre à l’évidence : trente ans plus tard, À quelle heure on meurt ? opère toujours ce « charme fou » qu’avait identifié la critique à l’époque de sa création[6].
+
Démarche semblable paraît avoir animé l’écriture de La femme la plus dangereuse du Québec, d’après Josée Yvon[7] que signent conjointement Dany Boudreault, Sophie Cadieux et Maxime Carbonneau. Le projet initial était de mettre en scène un des premiers recueils de poèmes de Josée Yvon, Filles-commandos bandées, et d’en accentuer les accents manifestaires. Les auteurs ont plutôt plongé dans les archives de l’écrivaine, lesquelles proviennent de toutes sortes de circonstances de sa vie : une correspondance avec le ministre Gérald Godin, avec ses parents, un journal intime, des notes, divers papiers. « La femme la plus dangereuse du Québec est un geste de profanation qui se nourrit non seulement de l’oeuvre publiée de Josée Yvon, mais aussi en grande partie des vingt-quatre boîtes composant son fonds à BAnQ. » (11) La version publiée est donc le résultat d’un collage composite, ce que confirme la présentation graphique de l’ouvrage, illustré de bouts de papier, manuscrits ou dactylographiés.
La pièce elle-même a été créée le 10 octobre 2017 à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, dans une mise en scène de Maxime Carbonneau. Elle emprunte son titre à la dédicace du recueil de poèmes. Trois personnages – la femme qui a lu tous les livres de Josée Yvon, la femme qui en a entendu parler, le gars qui préfère la poésie de Denis Vanier – s’expriment dans une série de monologues interrompus les uns par les autres. Le texte est donc imprimé en trois colonnes, pour faire lire les trois voix en parallèle. Il en résulte une sorte de lecture biographique, qui opère par détours, s’intéressant aux événements qui entourent la publication de ses recueils de poèmes et le déroulement de sa carrière, s’interrogeant sur sa relation avec Denis Vanier et sur les principaux enjeux de son écriture. De l’ensemble émane un univers trash qui cite abondamment, qui choisit les paroles les plus outrancières, les événements choquants. Le propos toutefois n’est pas toujours clair. Yvon s’y profile d’abord comme la moitié du couple mythique qu’elle forme avec Vanier, son « frère lesbien ». Elle est aussi présente par ses surnoms, notamment celui de « la fée des étoiles » (que lui aurait donné Raymond Cloutier). En dehors de ces accointances masculines, on la voit peu. La volonté des auteurs était sans doute d’en offrir un portrait, par accumulation de petites touches, de brèves scènes. L’écrivaine, pourtant, continue à nous échapper. La femme aussi. Le théâtre biographique est toujours un problème. Dans le présent cas, il s’arrête volontiers à l’anecdote et laisse seulement deviner la tragédie.
+
Parmi les victimes de la pandémie, il faut compter Lysis[8], pièce de Fanny Britt et Alexia Bürger, qui devait être créée au Théâtre du Nouveau Monde le 21 avril 2020, avant d’être reportée quelque part en 2021, puis à janvier 2022 et, enfin, tout simplement annulée. On ne verra pas à quoi aurait pu ressembler la mise en scène qu’avait conçue Lorraine Pintal pour cette nouvelle adaptation de la célèbre pièce d’Aristophane. Britt et Bürger, deux des plus intéressantes plumes actuelles, prennent ici la relève de Michel Tremblay et André Brassard, dont la Lysistrata de 1969 ne manquait pas d’intérêt, pour plonger cette fois le personnage dans un monde plus contemporain, plus féministe, plus écologiste que militaire. Lysis, dont le nom raccourci est déjà une mise à distance, n’en arrive pas moins « enduite de dizaines de siècles de mémoire » (134), prête à son tour à exercer « un pouvoir qu’on est les seules à pouvoir exercer » (35) en déclarant une grève de la procréation pour faire entendre les revendications des femmes et, surtout, pour protester contre la mise en marché, par la compagnie dont elle est chef de la recherche scientifique, d’un médicament qui a « des effets secondaires dévastateurs sur la santé mentale des femmes » (33). À mesure que le conflit social s’aggrave, l’éventail des revendications s’élargit, les appuis se multiplient. Les femmes prennent la rue, « les villes se mobilisent », le pouvoir réagit : il y aura des mesures d’urgence, puis une loi spéciale et enfin, forcément, une victime, Atlanta, devenue « le symbole de la jeune fille sacrifiée » (114), tragédie qui engage les parties à négocier. Lysis, qui s’était trouvée enceinte au moment de déclencher sa grève, aura ainsi l’occasion et même la responsabilité de contribuer à la création d’un monde nouveau.
L’intérêt du texte de Britt et Bürger réside dans sa construction, qui oppose deux séries de personnages, un groupe d’hommes et un groupe de femmes, réunis en deux choeurs distincts. La distribution est symétrique sauf pour un personnage féminin, donné en plus. Chaque personnage à son tour exerce la fonction de coryphée. On voit bien que la structure du dialogue emprunte à la logique du théâtre grec, mais plus encore à celle de l’opéra classique, où les choeurs sont entrecoupés d’arias. Pour une fois, j’aurais aimé entendre la pièce, car il arrive que la lecture du théâtre n’offre pas entière satisfaction, de la même manière qu’une partition musicale, dont on arrive à saisir la composition à l’oeil, prend toute sa valeur à l’oreille. C’est souvent le cas des pièces du théâtre féministe, ouvertement revendicatrices, qui tirent leur intérêt de leur capacité à réunir le public en collectif. C’était déjà le cas des pièces du Théâtre des Cuisines. Celle-ci n’y échappe pas.
+
Comment parler de l’ultime pièce que livre Pol Pelletier, créée deux fois sous deux titres différents, chaque fois un peu réécrite, maintes fois reprise, comme un texte obsessionnel, chargé d’émotions diverses et d’enjeux essentiels ? Dès le début, sous le titre Cérémonie d’adieu, la pièce s’est inscrite dans le cadre des événements commémorant, à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, le dixième anniversaire du massacre féminicide de l’École polytechnique. C’était en décembre 1999. Puis, sous le titre Nicole, c’est moi, une deuxième version a été créée en novembre 2004, à l’Espace Go, pour célébrer le Théâtre expérimental des femmes que Pelletier avait fondé 25 ans plus tôt avec Louise Laprade et Nicole-Anja Lecavalier. Elle fut reprise en décembre 2009 à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’Université du Québec à Montréal, lors de la commémoration du vingtième anniversaire de la tuerie de Polytechnique. C’est en 2021, au moment de sa publication, que la pièce a pris le titre Tragédie[9] et une tournure résolument testamentaire, comme si plus rien ne pouvait être dit après, mais aussi comme si toutes ces réécritures avaient pour objectif de trouver les mots justes, le ton juste, avant de tourner définitivement la page.
« Ce spectacle sera le dernier de Pol Pelletier » (24), annonce l’autrice dans le prologue, avant de préciser : « Du temps de son vivant, Pol Pelletier était une dinosaure vouée à la disparition. » (24) Cette confusion dans le temps des verbes, « sera » au futur, « était » à l’imparfait, laisse pourtant une place à un présent problématique, issu du passé et promis à un avenir incertain. Dans l’avant-propos (qui n’est pas destiné à être dit sur scène), Pelletier rappelle que le prénom qu’elle a reçu au baptême est celui de Nicole. Ce personnage est à la fois son passé à elle et un personnage collectif qui désigne « [t]outes les femmes assassinées, occultées, oubliées du Québec » (17). Et elle ajoute : « Je cherche à guérir Nicole, par le théâtre. » (17) Il faut donc dès le départ admettre une certaine confusion entre le singulier et le pluriel, entre le passé et le présent, entre le présent et l’avenir. Il faut aussi admettre cette fonction (curative ? purgative ? exutoire ?) donnée au théâtre, ici exprimée, mais dont il faut convenir qu’elle a sans doute été fondatrice, dès le début, de l’écriture de Pelletier. Il y a quelques années, je n’étais pas parvenue à trouver les mots justes pour parler de cette autre pièce, écrite quelques années après celle-ci, mais publiée plus rapidement, La robe blanche, qui raconte, entre autres épisodes, celui du viol d’une enfant de sept ans, baptisée Nicole elle aussi, et dont la narratrice dit : « La petite fille décida de faire du théâtre[10]. » Elle y revient ici, insistant sur le caractère plus personnel de la démarche : « [U]tiliser ce prénom donné à ma naissance était lourd de sens. Nicole est une enfant incestuée, cachée dans l’ombre depuis toujours. » (147) De ce point de vue, les féminicides survenus à l’École polytechnique en 1989, dont le récit arrive assez tardivement, au deuxième acte, doivent être considérés comme un moment terrifiant où ont été éliminées celles qui n’étaient pas restées « cachées dans l’ombre ». De là la nécessité de révéler les femmes cachées, de les mettre dans la lumière, toutes, y compris Nicole.
Comme tous les autres textes dramatiques de Pelletier, Tragédie est écrit pour un personnage seul, bien que, ici, un second personnage, la régisseuse, apparaisse brièvement, le temps de modifier un élément du décor ou du costume. Dans cette version, Pelletier suggère à qui voudrait représenter la pièce d’intégrer un troisième personnage, baptisé « l’Histoire », chargé de dire sur scène les notes historiques qui émaillent le texte. Celles-ci peuvent être des références à la mythologie grecque (note 3), des notices biographiques (Jean-Pierre Ronfard, en note 2 ; Françoise Loranger, en note 18), le récit d’un incident survenu lors d’une représentation antérieure (notes 12 et 31), une liste de femmes directrices de théâtre (note 36), autrices (note 37) et actrices (note 40), voire un hommage à Hélène Pedneault (notes 14, 15 et 16), qui avait agi comme conseillère dramaturgique sur les versions précédentes. La narratrice est décrite comme « une femme de théâtre ancienne » (19) ou « [u]ne femme qui a fait du théâtre dans les temps anciens » (23). Elle est vêtue d’un grand manteau qui dissimule une queue de reptile (celle de la dinosaure) et elle est entourée de quatorze lampions posés par terre, le nombre précis des victimes à l’École polytechnique, qui forment un cercle sur la scène. Elle porte une grande croix, à la manière du Christ. Le premier acte affirme les assises théoriques et politiques du féminin par un récit qui remonte à la préhistoire, « au début », quand « fémina et homo erectus [formaient] un couple charmant et très poilu » (30). Le deuxième acte illustre l’effacement des femmes par des cas concrets tirés du vingtième siècle, rappelant à la mémoire toutes les femmes artistes et intellectuelles oubliées ou négligées, dénonçant au passage « le passage vers un théâtre influencé par la télévision, la technologie, la facilité » (25). L’acte III, très bref, ramène Nicole et, du même coup, signe la disparition de Pol, qui s’envole dans l’éternité. Tragédie est suivi par une série de « Réflexions sur la mise en scène » et par un essai intitulé « Pourquoi et comment j’ai écrit Tragédie (1999-2021) […] ». La narratrice conclut : « Polytechnique est le point de non-retour, il signe la mort du Québec. Un climat de fin du monde. Je suis heureuse d’avoir pu le dire. » (151)
+
Au moment où j’écris ces lignes, les théâtres sont encore fermés. C’est la troisième fois que leur programmation est suspendue pour une durée indéterminée. Cette fois, la plupart des théâtres ont évité de revoir leurs calendriers et la plupart ont simplement annulé des spectacles pourtant dûment écrits, mis en scène et parfois répétés. On ne peut pas constamment empiéter sur les saisons à venir, déjà planifiées. Il y a ainsi un certain nombre d’oeuvres dramatiques qui n’auront connu ni la scène ni le livre et qui seront restées à l’état inachevé du manuscrit ou de la partition. J’aurais souhaité que cette ultime chronique porte la trace d’une vie théâtrale dynamique. Les circonstances m’auront plutôt entraînée à relire des textes restés jusqu’à présent inédits, parfois oubliés ou rendus accessibles tardivement, mais fort heureusement. À défaut de pouvoir suivre attentivement l’actualité théâtrale, j’ai fait comme les éditeurs, et je suis revenue en arrière, retraçant un parcours fragmentaire et en dents de scie, au hasard de ce qui, depuis deux ans, est resté vivant. « L’esprit est une sorte de théâtre où différentes perceptions font successivement leur apparition[11] », écrivait David Hume. Comme plusieurs autres, je souhaite retrouver sous peu la « notion du lieu où ces scènes sont représentées [et] des matériaux dont il se compose[12] ».
Parties annexes
Note biographique
LUCIE ROBERT a enseigné la littérature québécoise à l’Université du Québec à Montréal jusqu’à l’été 2020. Elle est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), où elle codirige le collectif La vie littéraire au Québec, 1764-1947 (PUL, 6 vol. parus depuis 1991 ; vol. VII et VIII en préparation). Ses plus récents ouvrages s’intitulent Apprivoiser la modernité. La pièce en un acte de la Belle Époque à la Crise (Nota Bene 2012), Le théâtre en revue (PUQ 2014) coridigé avec Shawn Huffman, et La littérature comme objet social II. Mélanges offerts à Denis Saint-Jacques (Nota bene 2019), codirigé avec Marie-Andrée Beaudet et Micheline Cambron. Elle est membre de la Société des Dix.
Notes
-
[1]
Lucie Robert, « La passion du dialogue », Voix et Images, vol. XI, no 1, automne 1985, p. 140-145.
-
[2]
Théâtre des Cuisines, Môman travaille pas, a trop d’ouvrage !, lettre de Véronique O’Leary, préface de Naïma Hamrouni, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, coll. « La Nef », 2020, 136 p.
-
[3]
Théâtre des Cuisines, Nous aurons les enfants que nous voulons, introduction de Véronique O’Leary, préface de Louise Desmarais, Lachine, Les Éditions de la Pleine lune, 2021, 57 p.
-
[4]
Hubert Aquin, Théâtre, édition établie par François Harvey, Montréal, Leméac éditeur, coll. « Théâtre », 2021, 261 p.
-
[5]
Réjean Ducharme et Martin Faucher, À quelle heure on meurt ?, Montréal, Triptyque, coll. « Matériaux », 2018, 81 p.
-
[6]
Notamment Paul Lefebvre, « À quelle heure on meurt ? du charme fou », Voir, 1988 (cité p. 19).
-
[7]
Dany Boudreault, Sophie Cadieux et Maxime Carbonneau, La femme la plus dangereuse du Québec, d’après Josée Yvon. Théâtre, Montréal, Les Herbes rouges, coll. « Scène_s », 2019, 131 p.
-
[8]
Fanny Britt et Alexia Bürger, Lysis, postface de Martine Delvaux, Montréal, Atelier 10, coll. « Pièces », 2020, 141 p.
-
[9]
Pol Pelletier, Tragédie, postface d’Olivier Dumas, Lachine, Les Éditions de la Pleine lune, 2021, 172 p.
-
[10]
Pol Pelletier, La robe blanche. Solo polyphonique, Montréal, Les Herbes rouges, coll. « Théâtre », 2015, p. 53.
-
[11]
David Hume, Traité de la nature humaine. Essai pour introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans les sujets moraux, t. I, De l’entendement [1739], partie IV, section VI, traduit de l’anglais par Philippe Folliot, Les classiques des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi, 2006, en ligne : http://classiques.uqac.ca/classiques/Hume_david/traite_nature_hum_t1/traite_nature_hum_t1.html (page consultée le 1er février 2022).
-
[12]
Ibid.