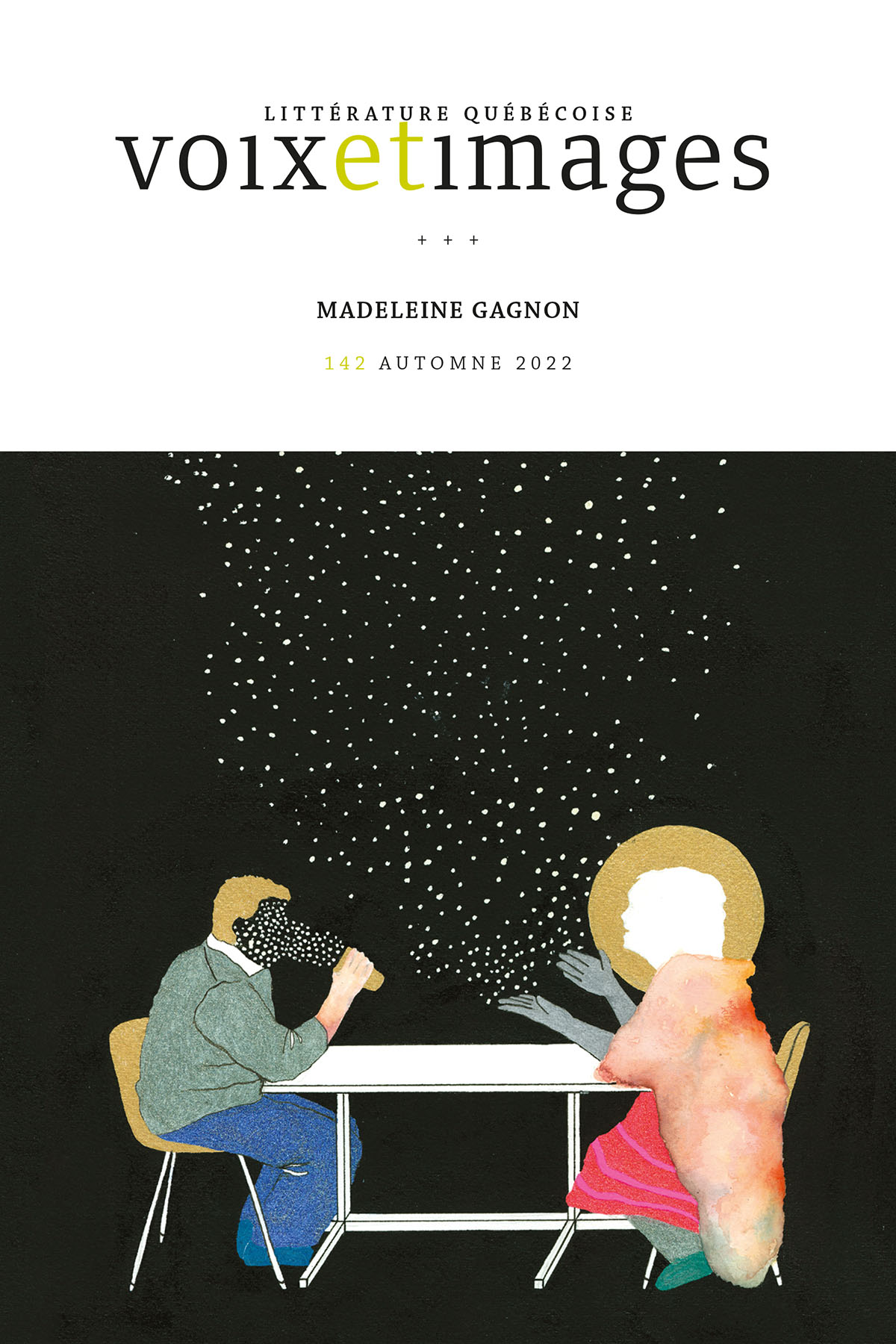Corps de l’article
En dépit de son titre et malgré une citation de Wayne Gretzky placée en exergue, Sauf quand je suis un aréna[1] n’est pas un imbuvable récit de hockey, mais un roman psychologique un peu décalé dont la lecture est aussi réjouissante qu’engageante. Le texte raconte l’hiver de la propriétaire d’un aréna dans une petite ville de région. Endeuillée, cette jeune femme de trente ans se remet mal de la mort d’un proche, happé à Montréal par une voiture conduite par un chanteur populaire dont la carrière n’a pas été ralentie par cet accident. Mal logée, elle habite un taudis qu’elle loue au « propriétaire des Retraites Gaïa-mazing » et qu’elle sous-loue quelques jours pendant le temps des fêtes, autant pour faire un peu d’argent que par vague désir de jouer dans le dos de son propriétaire. Outre sa mère et Merle, son ex, cette narratrice n’a que peu de relations significatives dans sa vie. La plupart de ses contacts sociaux sont liés à l’aréna. Elle connaît bien les jeunes qui font du patin artistique ou du hockey, un peu moins leurs parents, avec lesquels elle est souvent mal à l’aise.
De façon générale, c’est d’ailleurs ce sentiment, le mal-être, qui caractérise la vie de la narratrice. Cette dernière est mal en point – très mal en point même –, mais d’une manière tout à fait triviale et à laquelle on peut, conséquemment, tout à fait s’identifier. Mis à part la mort de son ami, elle ne vit pas de grande tragédie qui la distingue ou qui l’érige en martyre, et bien que les difficultés s’accumulent et se recoupent au fil du texte, la narratrice n’en demeure pas moins une sorte d’archétype des problèmes ordinaires. Même lorsqu’elle provoque un accident de voiture qui la blesse légèrement, la situation s’avère plus banale que dramatique. La narratrice a trop bu, elle a percuté un arbre, et c’est tout. L’événement ne représente pas un tournant ni un électrochoc, il ne suscite pas de révélations ou de profonde remise en question. La convalescence est pénible, mais pas trop. C’est un point fort de ce texte de ne pas faire la morale à son lecteur ni chercher à l’éclairer avec des leçons de vie en lui indiquant que chaque épreuve est une occasion d’épanouissement. Ce n’est probablement pas un hasard si la narratrice, qui avoue être une grande consommatrice de livres de croissance personnelle, révèle aussi qu’elle préfère les envelopper dans du papier de Noël pour pouvoir les lire au bar ou chez l’esthéticienne.
La narratrice a beau se désoler de sa condition « ordinaire » et de n’avoir rien à raconter – « je ne suis pas laide, je ne suis pas vieille, je ne suis pas droguée, je ne suis pas diplômée non plus, je pense que je suis alcoolique, ce serait déjà ça, mais je ne suis pas certaine […] » (18) – c’est précisément ce qui rend son récit intéressant et touchant. Le texte dépeint une morosité quotidienne en évitant la caricature, les exagérations ou la spectacularisation. Dès les premières pages, on est immédiatement frappé par la vulnérabilité de la narratrice et par tout ce qu’elle n’essaie pas de nous cacher :
Je fais à souper pendant que les fourmis mangent les corps de mulots morts en bas. Tout le monde décide pour lui-même, on forme une grande famille. Il est rendu huit heures du soir, je vais me coucher. Je demande au matelas, à voix haute, d’être bon pour mon dos. Je demande à Dieu, à voix basse, d’avoir une famille avant trente ans. Je dis Dieu en cachette, je dis beaucoup de choses en cachette, j’ai de la misère avec l’affirmation.
14
La narratrice n’est pas pudique, ce qui donne une impression de confidence, sans que l’on sente pour autant que le texte nous est véritablement ou directement destiné. Rédigé comme un long monologue mi-descriptif, mi-méditatif, le roman fait penser à une sorte de journal intime ou à un effort de retranscription d’un flot de pensées, mais il ressemble aussi à ce que la narratrice pourrait dire en s’adressant à son psychologue. Cette dernière projette constamment ce qu’elle pense sur les objets qui l’entourent, offrant ainsi un panorama étonnamment vivant de son paysage mental :
La forêt est toute trempe. Le ciel se demande ce qu’il veut. Il pleut, il change d’idée, il neige, il se mélange, il s’arrache les cheveux, il revient sur tout, ses décisions, ses rêves, le ciel grêle le temps que je prenne ma marche. Il se demande s’il faut prendre la trail à droite ou celle à gauche […]. Je me penche. Je cueille une branche fluo en tirant très fort avec mes mitaines. On dirait que j’épile les sourcils de la forêt. Ses yeux se remplissent d’eau, j’y dis que c’est ça, être une femme.
131-132
Avec de tels passages, Frédérique Marseille arrive à un équilibre entre une prose descriptive et un propos engageant émotionnellement ; il ne se passe presque rien même s’il se passe beaucoup de choses. En évoquant la pose des nouveaux tapis de vestiaires, la soirée spaghetti annuelle de collecte de fonds du club de hockey ou les entraînements des jeunes patineuses artistiques, l’écrivaine n’essaie jamais d’embellir le réel, même si sa narratrice est une romantique, voire une poète qui s’ignore. Si, comme moi, vous détestez les arénas, ce court roman arrivera peut-être à vous réconcilier avec leurs estrades froides et inconfortables ou avec le son claquant des patins sur la glace.
+
Les marins ne savent pas nager[2], deuxième roman de Dominique Scali, se déroule dans un xviiie siècle imaginaire, sur l’île fictive d’Ys, un rocher stérile et « égaré » quelque part dans l’Atlantique Nord, « entre Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Ouessant » (33). On y suit le personnage de Danaé Poussin, une orpheline frondeuse dont le destin sera déterminé par un talent particulier, la nage, qu’un nombre curieusement restreint d’individus maîtrise au sein une population pourtant constamment soumise aux aléas de la mer et dont l’économie repose principalement sur la pêche. La quatrième de couverture promet un roman « d’aventures maritimes », ce qui est à mon sens un qualificatif mal choisi. Le roman d’aventures porte son nom en raison de la place prépondérante accordée aux péripéties, à l’action, souvent violente, et aux rebondissements qui agissent comme moteur du texte. L’intérêt du roman de Scali est tout autre : à grands coups de microrécits, de légendes en trois lignes et de biographies imaginaires à la Schwob, l’écrivaine décrit pendant plus de sept cents pages une culture insulaire fonctionnant presque en vase clos. Si Danaé est le personnage principal du texte, elle s’avère souvent moins intéressante que cet assemblage que je viens d’évoquer et qui fait du roman une sorte d’encyclopédie fantaisiste et désordonnée.
Ys – qui n’a rien à voir avec l’île de la légende bretonne du même nom – est coupée du reste du monde : elle s’est émancipée de l’Europe et a instauré tant bien que mal son propre régime politique en abolissant les titres et en simplifiant au minimum le concept de classe sociale. Cette dimension politique se veut d’ailleurs au coeur du récit et oriente la majorité des intrigues, même si les lois d’Ys ressemblent davantage aux règles d’un jeu de société qu’à une véritable organisation sociale[3] :
-
Règle no 1 – Ys est scindée en deux : la cité, habitée par les citoyens, et les côtes, où s’organisent de petites sociétés parallèles, dont les habitants vivent de ce qu’ils trouvent, pêchent ou arrivent à récupérer lors des nombreux naufrages de navires issois ou autres. Ces riverains sont également soumis aux grandes marées qui, une fois par année, inondent l’ensemble des berges et représentent un danger mortel pour ceux qui ne trouveraient pas refuge ailleurs.
-
Règle no 2 – La dynamique entre les riverains et les citoyens est déterminée par le rythme régulier des « rotations », une procédure mise en place afin de permettre aux riverains d’accéder à la citoyenneté sur une base méritoire. Une personne convoquée doit se rendre à la cité, un voyage souvent long et pénible, et se prêter à une évaluation qui déterminera la retenue ou non de sa candidature.
-
Règle no 3 – Si la réponse est positive, le nouveau citoyen est autorisé à rester dans la cité pendant un certain temps. Si la réponse est négative, le candidat bredouille regagne généralement son taudis en ruminant et en maudissant l’administration l’ayant rejeté. N.B. Les rotations suscitent des émotions fortes chez la plupart des riverains. Ceux qui sont retenus vivent de grands moments d’exaltation suivis d’une rude adaptation au mode de vie de la cité. Ceux qui sont rejetés choisissent parfois d’ignorer les appels subséquents, ou encore d’entretenir le mystère quant au processus de sélection auquel ils ont été soumis.
-
Règle no 4 – Tout citoyen est libre d’accorder à une personne de son choix un statut intermédiaire lui garantissant l’accès à la cité. Les bénéficiaires de ce règlement se nomment « invités » et dépendent en tout temps du citoyen régulier qui les a choisis. Les invités ne jouissent d’aucune sécurité et risquent toujours l’expulsion. N.B. Les invités sont le plus souvent des femmes que des citoyens prennent comme maîtresse ou protégée. Parce qu’elles sont en relations de dépendance et de vulnérabilité, de nombreuses invitées sont particulièrement attentives aux dynamiques de pouvoir à l’intérieur de la cité et n’hésitent pas à passer d’un protecteur à l’autre en usant de leurs charmes et de leur finesse d’esprit afin d’y prolonger au maximum leur séjour.
À travers le regard de Danaé, qui pénètre tour à tour les différentes strates de la société, on découvre comment ces règles contraignent certains personnages alors que d’autres tirent leur épingle du jeu en les contournant, parfois de façon inattendue. Notons aussi que le paratexte évoque d’emblée les codes de la fantasy, avec une carte d’Ys et une chronologie des principaux événements depuis l’avènement d’une république indépendante sur l’île – le massacre des premiers hommes, la guerre des deux jaloux, la mort de l’astrologue Damalfie, et ainsi de suite. Cette chronologie est illustrée d’un blason, représentant une morue transpercée par une épée, et d’un phare, une référence à des épisodes importants de l’histoire d’Ys, mais aussi un clin d’oeil au logo des éditions La peuplade. Tous ces éléments invitent à recevoir le texte sur un mode ludique en indiquant au lecteur qu’il devra accepter les règles de cet univers alternatif ou passer son tour.
Le propos du texte ne porte pourtant pas à rire. La misère des riverains est au premier plan et elle est constamment opposée à l’opulence des citoyens. Cette opposition est dichotomique et c’est sans doute pour cette raison que l’aspect politique du texte s’avère peu convaincant. L’écart entre les riverains et les citoyens est si grand et l’injustice dont sont victimes les premiers si extrême qu’il est difficile de partager les aspirations ou les déceptions des personnages. De même, on s’afflige peu de la mort, de la maladie et des blessures qui sont omniprésentes dans le récit, malgré leur caractère dramatique. On souhaiterait parfois que le rythme s’accélère en raison d’une certaine redondance qui n’est pas étrangère au caractère répétitif de plusieurs éléments de l’intrigue. Du début à la fin, des marins partent mourir en mer tandis que leurs femmes les attendent sur le rivage en passant de la détresse à la rancoeur. Bien que l’univers inventé par Scali soit riche et extravagant, le plus clair du roman se déroule sur des plages rocailleuses avec l’océan pour seul horizon – ce qui ne serait pas nécessairement un problème si on s’attachait plus aux personnages, à commencer par Danaé, qui fait peu pour pimenter le texte. Outre ses aptitudes en natation qui la distinguent du lot, cette dernière ne semble pas avoir d’envies, de volonté, ni même de quête. Son implication dans le développement de l’intrigue semble presque toujours le fruit du hasard. À cet égard, le récit est susceptible d’induire le lecteur en erreur en raison d’espèces d’intermèdes rédigés au « nous », où s’exprime un groupe d’individus chargé d’enquêter sur le rôle de Danaé dans certains événements importants. Ce filon policier s’avère assez peu développé et n’apporte guère à l’ensemble.
Le plaisir que procure la lecture repose avant tout sur le dévoilement graduel de la culture de l’île d’Ys – culture issoise, devrait-on plutôt dire, comme l’explique ce passage illustrant à merveille la dimension encyclopédique évoquée précédemment :
Est « issois » ce qui est obstiné, audacieux, revanchard. Est « issois » ce qui fait bomber le torse. Le pêcheur qui rapporte plus de quintaux de morues que les autres ou le commandant qui va toujours au bout de ses menaces est considéré comme un « vrai Issois ». Un orateur éloquent se fait complimenter : « V’là qui parle issois. » Quand le temps est clément, avec juste assez de vent pour l’appareillage, on dit : « Le ciel se fait issois. » On ne perdra pas de temps à dire d’une chose qu’elle est digne, brave ou agréable quand on peut dire qu’elle est « issoise ».
35-36
Aux considérations linguistiques s’ajoutent aussi les légendes, les moeurs et le folklore issois, qui font véritablement le sel du roman : les funérailles en mer où les corps sont transportés loin de l’île par un courant appelé « Raz des Ailleurs » ou « Raz des Aïeux » ; l’histoire d’une invitée forgeant pendant plus de vingt ans des lettres racontant les aventures d’un capitaine de frégate disparu pour éviter de perdre sa place dans la cité ; le monument élevé à la mémoire de Budoc Tassé dit le Quêteux, qui s’était fait couper les deux jambes et dont la candidature n’a jamais été retenue pour la citoyenneté ; le mythe de la vague scélérate, véritable « mur d’eau sorti de nulle part pour aucune raison apparente » (481). De tels passages prennent admirablement le relais dans les moments où l’intrigue principale s’enlise. Ce qu’ils décrivent semble à la fois étrange et familier, exactement à l’image d’Ys qui évoque autant l’Europe que les provinces maritimes sans se rapporter spécifiquement ni à l’une ni aux autres.
J’ai dit précédemment que Les marins ne savent pas nager n’était pas un roman d’aventures, mais on aura compris que le texte emprunte toutefois à ce genre le procédé du dépaysement, qui vise à plonger le lecteur dans un univers contrastant avec celui de la vie quotidienne et au sein duquel des événements extraordinaires sont susceptibles de se produire. Pour les lecteurs qui souhaiteraient s’évader, le temps de quelques centaines de pages, l’étrange culture maritime inventée par Dominique Scali vaut assurément le détour.
+
Quelques phrases à peine suffisent pour reconnaître le style de Dominique Fortier. Sa prose soignée, mélange de fiction et d’introspection, se caractérise notamment par une économie narrative écartant tout élément superflu au sein d’une phrase ou d’un récit, mais aussi par un sens aiguisé de la formule et de la chute. J’en prends à témoin cet extrait du très beau Au péril de la mer qui, comme beaucoup de passages de l’oeuvre de Fortier, ne souffre guère d’être cité hors de son contexte romanesque :
Tout le monde sait que la lumière des étoiles lointaines continue de nous parvenir longtemps après qu’elles soient mortes. Mais on ne pense jamais aux étoiles tout juste nées. Si on aperçoit toujours le scintillement des astres disparus, il y a des soleils dont ne voit pas encore la lumière et qui pourtant sont là, flamboyants au milieu des ténèbres, parfaitement invisibles[4].
Après six romans, tous publiés chez Alto, il ne fait aucun doute que Dominique Fortier possède également son univers, avec des images réapparaissant d’une oeuvre à l’autre : le quartier Outremont, les plages du Maine, la mer, les coquillages, la couleur bleue, l’histoire des mots – et surtout de ceux qui ont plus d’un sens –, Emily Dickinson, les fleurs… Ces motifs confèrent à l’oeuvre de Fortier son unité et sont le signe d’une écriture de plus en plus décomplexée où la voix de l’écrivaine occupe graduellement toujours plus de place. À chaque nouvelle parution, l’auteure semble moins préoccupée par les frontières qui pourraient exister entre elle et ses personnages.
On le voit à la narration qui se scinde parfois en deux avec une voix portant le récit des personnages et une autre les réflexions de l’écrivaine, sans pour autant que ces deux voix diffèrent fondamentalement. En commençant un nouveau chapitre, quelques lignes sont parfois nécessaires avant de savoir qui, du narrateur du récit ou de la narratrice-écrivaine, est en train de s’exprimer. Les obsessions, les idées fixes et les passions de cette dernière sont aussi celles de ses personnages et on passe sans effort d’un point de vue à l’autre, d’un sujet au suivant, comme on assisterait au spectacle d’une pensée alerte et sensible au visible autant qu’à l’imaginaire. Un changement de chapitre peut correspondre à des bonds énormes dans le temps et l’espace – de plusieurs dizaines d’années, de plusieurs siècles, d’un pays ou d’un continent à un autre. D’un paragraphe à l’autre, on passe de l’évocation de la lumière sur une rue de Montréal à une réflexion sur l’inexistence d’un mot pour désigner la couleur bleue au Moyen Âge, ou encore de la description d’un souvenir d’enfance à des considérations sur l’organisation des plaques tectoniques et leur impact sur les éruptions volcaniques. Fortier relate souvent des scènes quotidiennes tout comme elle met en scène l’écriture de ses romans – en référant parfois à ses oeuvres précédentes –, gommant ainsi au maximum la distinction entre le processus de création et le produit final. Les célèbres vers de Garneau décrivent bien ce vagabondage narratif qui refuse constamment de se cantonner à un sujet et alterne sans cesse entre les récits inventés et ceux dont l’auteure fait l’expérience réelle :
Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches
Par bonds quitter cette chose pour celle-là
Je trouve l’équilibre impondérable entre les deux
C’est là sans appui que je me repose.
Quand viendra l’aube[5], le septième ouvrage de l’auteure, est moins un récit qu’une sorte de journal tenu par l’auteure dans la période précédant et suivant la mort de son père. Cette épreuve propice à l’introspection catalyse les éléments évoqués précédemment, de sorte que le texte se présente autant comme une sorte de bilan de la vie littéraire de l’écrivaine que comme un concentré de son univers et de son style. À plusieurs reprises, Fortier s’observe elle-même sans pour autant s’analyser, comme si l’écriture de cet ouvrage était aussi une manière de se regarder dans le miroir, mais de loin seulement :
Mon éditeur se moque gentiment de moi quand j’écris au sujet des vagues ou des coquillages. […] Mais je crois que chacun d’entre nous ne possède qu’un faible nombre d’images qui nous hantent sans qu’on sache d’où elles viennent, si ce sont des rêves ou des souvenirs, et qui disparaîtraient si par malheur on parvenait à les élucider. Elles n’existent que dans ce mystère renouvelé qu’elles ne cessent de nous présenter, chaque fois, sous un aspect un peu différent. Ce sont des nuages.
55
Contrairement à d’autres écrits de Fortier, le récit personnel ne s’arrime pas à un récit fictif ici, ce qui place le texte à part dans la production de l’écrivaine. Il ne s’agit pas d’une différence mineure. L’une des forces de l’écriture de Fortier est justement de se situer sur la frontière entre la fiction et l’intime, et l’absence de l’une de ces deux facettes entraîne un déséquilibre. Sans la distance imposée par la mise en scène de personnages fictifs et par la description de leurs aventures, on se sent par moments un peu trop proches du quotidien de l’écrivaine que l’on ne fréquente habituellement qu’à moitié. De fait, Quand viendra l’aube me semble une proposition un peu moins forte que ce à quoi nous a habitués l’écrivaine. On pourra légitimement se demander s’il n’est pas un peu injuste de mesurer cette publication à l’aune du reste de la production de Fortier, mais il faut dire que le texte lui-même y invite par ses nombreuses références aux oeuvres précédentes de l’écrivaine et par sa dimension autobiographique.
Dans cette configuration, la place accordée aux souvenirs littéraires est un filon particulièrement exploité. C’est l’occasion pour Fortier de revenir sur certains événements fondateurs de sa pratique, en évoquant notamment la disparition d’une seconde figure paternelle, celle de François Ricard, décédé en 2022, véritable mentor qui lui a assigné la tâche d’éditer les manuscrits de la suite de La détresse et l’enchantement alors qu’elle était encore étudiante. L’écrivaine se situe aussi dans une trajectoire de lectrice, de l’enfance passée « entre les Alice, les Achille Talon, les mémoires de Laura Ingalls Wilder et le journal d’Anne Frank », à l’adolescence, avec la découverte de la bibliothèque de son père contenant entre autres les romans de Jean-Paul Sartre – aujourd’hui « parfaitement imbuvables » – jusqu’à la constitution de sa propre bibliothèque, faites de romans de seconde main achetés au Colisée du livre du Vieux-Québec : Kundera, Hermann Hesse, Anne Hébert, Proust, Marguerite Yourcenar, Cervantès, Italo Calvino, John Steinbeck, etc. Si certains de ces textes sont encore aujourd’hui dans son bureau, l’écrivaine avoue désormais préférer les écrits de Pascal Quignard et de Christian Bobin, « où il y a autant de blancs que de mots, et plus de lumière que tout le reste » (48). On pourrait assurément écrire la même chose à propos des romans de Fortier – et Quand viendra l’aube ne fait pas exception –, ce qui montre bien que ce parcours de lectrice est aussi une manière pour l’écrivaine de situer sa propre pratique au sein des différentes influences qu’elle énumère.
On se perdrait à rapporter tout ce qu’il y a d’autre et de plus dans Quand viendra l’aube – des citations de Leonard Cohen, d’Alessandro Baricco, de Rebecca Solnit, des scènes familiales, des références à la série Nashville… Mais maintenant que j’y pense, il est surprenant de ne pas y retrouver l’image de la courtepointe, qui est un motif important du roman La porte du ciel, paru en 2011. Cette manière de travailler en assemblant des pièces de tissus disparates est sans doute la métaphore qui décrirait le mieux ce qu’accomplit l’écrivaine avec ce dernier opus. À l’instar des couvertures créées par les artisanes de Gee’s Band, Quand viendra l’aube semble devoir autant à l’intentionnalité de son auteure qu’au hasard des matériaux qui se sont présentés à elle. Il ne fait aucun doute que le texte ne répond pas à un programme préétabli. Tant pour l’écrivaine que pour le lecteur, le sens de l’écriture émerge graduellement, à mesure que s’accumulent les fragments. C’est dire que, plus que dans tout autre de ses romans, Fortier donne à voir un processus de découverte plutôt que le fruit d’une recherche.
Aux dernières pages, l’écrivaine affirme qu’elle ne sait pas vraiment à qui s’adresse Quand viendra l’aube. Chose certaine, ceux qui connaissent et aiment déjà son oeuvre traverseront ce petit livre avec bonheur, tout en se permettant d’en espérer un prochain plus substantiel.
Parties annexes
Note biographique
PIERRE-OLIVIER BOUCHARD est professeur de littérature québécoise et française à l’Université Memorial. Ses recherches portent sur le roman historique des années 1920, sur le rapport au temps et à l’histoire dans la littérature, de même que sur les récits biographiques français et québécois.
Notes
-
[1]
Frédérique Marseille, Sauf quand je suis un aréna, Montréal, Les éditions de ta mère, 2022, 168 p.
-
[2]
Dominique Scali, Les marins ne savent pas nager, Saguenay, La peuplade, coll. « Roman », 2022, 708 p.
-
[3]
Ces règles n’apparaissent pas comme telles dans Les marins ne savent pas nager et l’énumération qui suit n’est pas une citation ni une paraphrase d’un passage du roman.
-
[4]
Dominique Fortier, Au péril de la mer, Québec, Alto, 2015, p. 70.
-
[5]
Dominique Fortier, Quand viendra l’aube, Québec, Alto, 2022, 99 p.