Résumés
Résumé
Depuis quelques années, une littérature féministe critique s’intéresse à la déconstruction de la conception patriarcale des patrimoines culturels. En effet, selon l’étymologie du mot « patrimoine », sa signification désigne littéralement l’« héritage du père ». Le patrimoine cinématographique québécois ne faisant pas figure d’exception, une grande partie des œuvres cinématographiques se développera sous cette égide. Cette conception patriarcale a eu notamment pour conséquence d’exclure et d’invisibiliser une grande partie des œuvres réalisées par les femmes. L’auteure propose donc, dans un premier temps, d’ouvrir une discussion autour du concept de « patrimoine cinématographique » et, dans un second temps, de revenir sur les effets de la patrimonialisation des héritages des femmes aujourd’hui connus, et ce, pour en circonscrire les absences et les lacunes.
Mots-clés :
- féminismes,
- archives,
- patrimoine,
- cinéma
Abstract
In recent years, critical feminist literature has been interested in the deconstruction of the patriarchal conception of cultural heritages. Indeed, following the etymology of the word « heritage » in French, the meaning literally implies « father’s heritage ». Quebec cinema is no exception, a large part of the movies was built under this umbrella. This patriarchal conception of heritage had the effect of excluding and invisibilizing important sections of Quebec women’s cinematography. The author proposes, as a first step, to open a discussion around the concept of « cinematographic heritage » and, secondly, to return to the effects of the patrimonialization of women’s heritages today.
Resumen
Desde hace algunos años, una literatura feminista crítica se ha interesado en la desconstrucción de la concepción patriarcal del patrimonio cultural. En efecto, según la etimología de la palabra « patrimonio », su significado designa literalmente la « herencia del padre ». Como el patrimonio cinematográfico quebequense no hace excepción, una gran parte de las obras cinematográficas se desarrollaron bajo esta égida. Esta concepción patriarcal ha llevado como consecuencia la exclusión y la invisibilización de una gran parte de las obras producidas por mujeres. La autora propone entonces, en primer lugar, abrir una discusión en torno al concepto del « patrimonio cinematográfico » y, en segundo lugar, volver sobre los efectos de la patrimonialización de las herencias de las mujeres hoy conocidas, y esto, para circunscribir las ausencias y lagunas.
Corps de l’article
L’emploi du terme « patrimoine » reste aujourd’hui largement débattu dans les sciences humaines et fait l’objet de nombreuses controverses dans le milieu universitaire ainsi que dans la sphère politique au Québec[1]. Depuis les années 70, les études critiques du patrimoine ne cessent de se développer et d’interroger les théories et les pratiques traditionnellement observées dans ce domaine. Du latin patrimonium, l’tymologie du terme renvoie à un ensemble de biens hérités du père[2]. Plusieurs auteures et auteurs féministes rappellent qu’il ne fait plus aucun doute que ce mot demeure genré et évoque, à leur avis, une forme de domination masculine basée sur l’exclusion et l’invisibilisation des femmes. Selon l’auteure et historienne de l’art Marie-Rose Arbour (1996 : 14), « le propos patrimonial s’est défini d’abord et avant tout comme une glorification. Il s’est fondé principalement sur un répertoire de chefs-d’oeuvre, le terme étant entendu dans son sens large qui souligne le statut dominant de certaines oeuvres par rapport à d’autres ». L’apport des études féministes a permis, d’une part, de démontrer que le processus patrimonial sur lequel reposent les traditions et les pratiques artistiques a été fondé, voire canonisé, sous l’égide des sociétés patriarcales et, d’autre part, de revendiquer la légitimité du statut de « matrimoine » pour désigner les oeuvres de femmes exclues et invisibilisées par celles-ci (Colella 2018 : 253; Hertz 2001)[3].
Si une perspective genrée du patrimoine est largement répandue de nos jours dans les discours institutionnels véhiculés par les musées nationaux, il est essentiel de tenir compte d’une analyse féministe intersectionnelle pour éviter de tomber dans les pièges de la reproduction d’un langage hégémonique de la différence (Colard 2020). À cet égard, l’article « Heritage, Gender et Identity » écrit en 2008 par la chercheuse et archéologue Laurajane Smith, témoigne des inégalités de genre, de classe et de race historiquement perpétuées au sein des discours et des pratiques muséales. L’auteure souligne que ces inégalités sont rarement articulées ensemble au sein « des discours patrimoniaux autorisés[4] ». Bien au contraire, ces derniers construisent et renforcent l’instauration de catégories identitaires. Devant les nouvelles politiques institutionnelles promouvant des règles de gouvernance abstraites et superficielles sur la diversité et le genre, des pratiques muséologiques féministes se sont développées depuis plusieurs années pour penser l’articulation des différences et l’application de nouvelles lectures du patrimoine dans les musées. Si ces analyses féministes du patrimoine ont davantage été explorées du côté des beaux-arts et de l’architecture, on observe qu’il existe encore peu d’écrits sur ce que l’on continue de nommer le « patrimoine cinématographique ». Cette quasi-absence peut s’expliquer en raison de la reconnaissance plutôt tardive (comparativement aux autres disciplines artistiques) du cinéma en tant qu’art.
Dans le contexte du Québec, l’émergence du patrimoine cinématographique reste un cas d’étude fort intéressant et peu discuté à l’heure actuelle sous l’angle d’une perspective critique. Bien souvent, ce terme est employé dans de nombreux ouvrages et articles de référence sur l’histoire du cinéma québécois[5] pour désigner un répertoire de classiques, sans pour autant remettre en question les rapports de pouvoir qui sous-tendent ce classement.
Cependant, une littérature féministe au Québec révèle une critique marquée des récits sexistes du cinéma et défend l’écriture d’une histoire plus inclusive. Pensons à la riche contribution de chercheuses et d’auteures telles que Kay Armatage, Karine Bertrand, Louise Carrière, Martine Delvaux, Jocelyne Denault, Guylaine Dionne, Marion Froger, Monika Kin Gagnon, Thérèse Lamartine, Julie Lavigne, Rosanna Maule, Janine Marchessault, Silvestra Marinello, Julianne Pidduck, Diane Poitras, Julie Ravary-Pilon, Joëlle Rouleau, Marie-Josée Saint-Pierre, Alanna Thain, etc.
À ce titre, l’importante filmographie des femmes produite entre les années 60 et 80 au Québec s’avère un riche terrain propice à la discussion portant sur des formes de contestation qui ont émergé devant les inégalités de genre, de classe et de race. Dans l’introduction de son dossier thématique en ligne, la réalisatrice féministe et indépendante Sophie Bissonnette (2020) revient sur ses premiers constats concernant l’industrie cinématographique au début de sa carrière :
[D]epuis mon premier film, tourné en 1978-79, j’ai été confrontée aux images manquantes. Je suis de la génération de femmes qui, pour la première fois, ont accès aux moyens de production. Jusque-là, le cinéma a été presque exclusivement une affaire d’hommes, et d’hommes blancs, de milieu aisé le plus souvent. Avec chaque film je me heurte à des images d’archives inexistantes sur la vie des femmes, à des récits biaisés et mensongers sur leur contribution, à une représentation objectifiée ou victimisante, à l’absence de leur point de vue. Grâce aux participantes dans mes films, j’ai voulu contribuer à interroger les représentations, mettre en lumière les histoires occultées et rendre les femmes actrices de leur destin pour changer le narratif.
Ces expériences vécues par la cinéaste sont analogues aux récits partagés par de nombreuses réalisatrices qui chercheront de nouvelles manières de représenter et de diffuser plus largement l’histoire des femmes ainsi que les luttes féministes. Outre le programme En tant que femmes, porté par Anne-Claire Poirier et Jeanne Morazin, et le Studio D, dirigé par Kathleen Shannon à l’Office national du film (ONF), les femmes réussissent difficilement à accéder aux postes de réalisation. Ces processus d’exclusion toucheront davantage les femmes autochtones, racisées, immigrantes, issues de la classe populaire, dont l’absence de représentation se révèle d’autant plus frappante. Constatant la difficulté d’accéder au médium cinématographique, plusieurs collectifs de vidéastes féministes en quête de nouvelles images émergent au début des années 70, à Montréal et plus largement au Québec. En effet, la sortie de la caméra vidéo Portapak sur le marché retiendra particulièrement l’attention des féministes et des artistes qui saisiront l’occasion de s’approprier ce nouvel objet exempt d’historicité. La vidéo deviendra un outil privilégié pour les femmes issues majoritairement de la classe moyenne et blanches, qui leur permettra de créer plus librement et de s’émanciper des structures hiérarchiques du cinéma. On verra émerger, entre autres, des collectifs comme Vidéo Femmes en 1973, le Groupe Intervention Vidéo (GIV) et le réseau Vidé-Elle en 1975.
Sans prétention d’exhaustivité, nous nous intéresserons ici à quelques-uns des événements historiques, sociaux et culturels qui ont contribué à bâtir une conception dominante du patrimoine cinématographique québécois. Appuyée sur des sources issues de la littérature scientifique sur le cinéma et du domaine de la critique cinématographique, notre étude reviendra également sur la formation de corpus d’oeuvres cinématographiques produits par les femmes et les féministes entre les années 60 et 80, ces corpus étant longtemps restés dans l’ombre d’un patrimoine dominant. Ainsi, dans un premier temps, nous nous concentrerons sur des sources à la fois juridiques et historiques pour mettre en évidence le manque de références et les flous qui entourent aujourd’hui encore la notion de « patrimoine cinématographique » au Québec. Puis, dans un deuxième temps, nous recenserons, grâce à une sélection de discours critiques devenus incontournables, les éléments qui ont participé à forger une conception nationaliste et masculine du patrimoine cinématographique québécois. Enfin, dans un troisième temps, nous tenterons de rendre visible la pluralité des formes et des expressions filmiques produites par les femmes, et ce, afin d’ouvrir de nouveaux horizons pour envisager une conception du patrimoine plus inclusive.
Reconnaissance du cinéma québécois en tant que « patrimoine »
Hormis la Loi sur le cinéma[6], qui affiche une politique structurante, en conférant notamment à la Cinémathèque québécoise les fonctions de conservation et de diffusion du répertoire cinématographique au Québec, la seule définition à laquelle il est possible de se référer actuellement, à notre connaissance, est celle qui est relative à la Loi sur le patrimoine culturel. Selon l’article premier du chapitre 21, le patrimoine culturel est « constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d’événements historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel » (Loi sur le patrimoine culturel (loi C-21)[7]).
Les sections affichées dans l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel présentent une série de termes décrivant les critères sur lesquels les institutions peuvent se baser pour leur sélection. Ces définitions sont en réalité identiques à celles qui ont été déterminées par l’Unesco. En ce qui concerne les oeuvres et les archives cinématographiques, les définitions qui nous intéressent particulièrement sont regroupées dans les catégories suivantes (Loi sur le patrimoine culturel (loi C-21)) :
« document patrimonial » : selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images […].
« objet patrimonial » : tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique […].
« patrimoine immatériel » : les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération […].
Bien qu’elles demeurent un cadre de référence important pour les institutions québécoises, ces définitions restent généralistes et sujettes à interprétation. Il faut alors se tourner vers la Loi sur les archives[8] et plus particulièrement vers la Fédération internationale des archives du film (FIAF)[9], important réseau qui rassemble depuis 1938 les musées et les cinémathèques, pour trouver les protocoles régissant la préservation des archives aussi spécifiques que la pellicule argentique, la bande magnétique, le numérique ou encore des documents « non-film » comme des scénarios, des affiches, des photographies de tournage, des scénarios en images (story-boards), etc. Certes, ces ressources s’avèrent précieuses : cependant, les musées et les cinémathèques responsables de ce matériel doivent non seulement hiérarchiser et catégoriser les types de documents dignes de rejoindre leurs collections, mais également déterminer la valeur historique et artistique des fonds d’archives qui méritent d’être transmis aux générations futures. La description du mandat de la Cinémathèque québécoise témoigne de ce fait :
Acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine cinématographique, télévisuel et audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des oeuvres significatives du cinéma canadien mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives[10].
Dans ce contexte, une bonne connaissance juridique et muséologique ne suffit pas pour comprendre toute la complexité de cet héritage. Il est alors nécessaire de mieux circonscrire les facteurs historiques et socioculturels de même que les discours qui ont permis à ce patrimoine d’exister afin de mesurer les oublis et les manques qui le composent.
Aujourd’hui, il existe une littérature fort développée sur l’histoire du cinéma québécois. Il serait ainsi difficile de nommer l’ensemble de ces publications tant les approches sont diverses et s’enrichissent au fil des années. Cependant, de nombreux textes proposent un découpage temporel précis qui indique notamment la période historique dans laquelle le cinéma québécois aurait été reconnu en tant que patrimoine. Selon l’auteur et chercheur Christian Poirier (2007), le cinéma québécois bénéficiera d’une reconnaissance par la société à partir des années 70 :
La société québécoise de la Révolution tranquille considère globalement les films réalisés avant 1960 comme étant plutôt « passéistes ». Cependant, une réhabilitation a lieu à partir des années 1970 jusqu’au début des années 1980, tandis que la fibre nationaliste est particulièrement vive à l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976. De même, la production de documentaires portant sur le patrimoine et le folklore collectifs est en hausse.
Le contexte politique de la Révolution tranquille joue ainsi un rôle fondamental dans l’affirmation d’un cinéma québécois francophone. Avant cet événement historique, l’éducation aux images et la diffusion des films étaient contrôlées en partie par l’Église catholique, qui impose alors des normes de visionnement restrictives de même que des mesures de censure pour certains films américains jugés corrupteurs et dangereux pour la population. Du côté de la production, les films des prêtres Maurice Proulx et Albert Tessier promeuvent les valeurs catholiques et participent à la création d’un imaginaire nationaliste représentant les moeurs et les traditions religieuses de leur temps (Poirier 2004).
La période de 1940 à 1950 sera tout de même marquée par la contribution de cinéastes qui participeront au développement de l’industrie cinématographique québécoise. On retiendra surtout les réalisateurs Jean-Yves Bigras, René Delacroix, Paul Gury, Paul Langlais et Fédor Ozep pour la réalisation de films de fiction inspirés principalement du cinéma hollywoodien, majoritairement dominant à cette époque.
Au moment de la Révolution tranquille, on assiste donc à la décléricalisation de la province au profit d’une reprise de l’État dans le secteur social, de l’éducation et de la santé. En 1959-1960, le gouvernement de Maurice Duplessis s’effondre devant les libéraux dirigés par Jean Lesage. Une volonté de modernisation jusque-là largement observée en marge des pouvoirs politiques s’instaure et se traduit par de nombreuses réformes. Cette rupture politique, sociale et culturelle importante favorisera la montée du mouvement souverainiste qui influera grandement sur l’émergence et l’institutionnalisation d’un cinéma québécois francophone.
Devant les revendications nationalistes principalement masculines, le Québec assiste également à l’arrivée d’un féminisme qui favorise l’émergence de groupes de femmes aux positionnements et aux luttes d’une grande variété. Certaines prises de position vont nourrir les débats sur l’indépendance du Québec, tout en formulant des revendications relatives aux inégalités et aux discriminations produites envers les femmes dans le mouvement indépendantiste (Lamoureux 2001). Comme nous le verrons un peu plus bas, plusieurs artistes et de nombreuses cinéastes se joignent au mouvement féministe pour dénoncer les inégalités de genre perpétuées au sein du milieu artistique québécois. Ces inégalités restreignent notamment l’accessibilité aux ressources et contribuent à définir une élite de cinéastes.
Émergence d’un récit historique dominant : pour un patrimoine nationaliste francophone
Dès 1967, l’auteur et historien du cinéma Robert Daudelin annonce avec clairvoyance cinq facteurs qui ont participé à la reconnaissance du cinéma québécois francophone au cours des années 50 et 60. D’abord, le déménagement à Montréal de l’ONF en 1956 a largement contribué à favoriser la production de films québécois en langue française. Ensuite, la création de plusieurs ciné-clubs dans les établissements d’enseignement et dans le secteur privé a permis à une génération de spectateurs et de spectatrices de découvrir des oeuvres importantes de l’histoire du cinéma. Parallèlement à ces initiatives, on observe la tenue annuelle du Festival international du film de Montréal à partir de l’été 60 et un intérêt grandissant de la part du milieu de la critique pour la couverture des films internationaux et québécois, avec la création des revues telles que Découpages, L’Écran, Images, Objectif, etc. Enfin, l’ouverture de salles de cinéma d’art et d’essai offre à un public un accès privilégié à une cinématographie plus confidentielle, tandis que la Cinémathèque canadienne, officiellement créée en 1963[11], joue un rôle déterminant dans la formation de plusieurs cinéastes et dans la préservation d’une grande collection d’oeuvres cinématographiques québécoises (Daudelin 1967 : 18).
Pour de nombreux auteurs et auteures, comme Louise Carrière, Robert Daudelin, Marion Froger, Marcel Jean, Yves Lever, Christian Poirier ou encore Pierre Véronneau, le cinéma québécois francophone des années 60 et 70 reflète les revendications nationalistes d’une culture québécoise (Lever 1988; Daudelin 1967; Véronneau 1979; Jean 2005). La quête d’identité, d’un « nous » québécois, suscite alors autant le doute qu’une affirmation radicale dans les films produits durant cette période. Le critique Guy Robillard, dans son article « Le nationalisme dans le cinéma québécois », paru en 1968, présente une série de films de fiction explorant des récits liés à l’aliénation et à la soumission de la communauté francophone à l’égard de la colonisation britannique tout en analysant les formes de contestation qui en émergent. Ainsi, La vie heureuse de LéopoldZ (1965) de Gilles Carles, C’est pas la faute à Jacques Cartier (1967) de Clément Perron et Georges Dufaux ou encore Patricia et Jean-Baptiste (1968) de Jean-Pierre Lefebvre illustrent des satires ironiques de la société québécoise grâce à la mise en scène de personnages masculins ridiculisés et grotesques (Robillard 1968). Ce cinéma est ainsi axé sur la revendication et la prise de conscience d’une société laissée sans héritage qui réagit à l’angoisse d’un avenir politique incertain (Poirier 2004). Dans un registre qui diffère de la pratique du cinéma direct (courant documentaire largement dominant à l’époque), les films de fiction québécois auront cherché à revendiquer une identité québécoise francophone et blanche dans une formule plus narrative touchant à un imaginaire qui tentera de s’éloigner par la suite d’un récit plus misérabiliste (Poirier 2004).
Pour ouvrir ce champ d’études à d’autres formes cinématographiques, Pierre Véronneau, quant à lui, expose dans son article « Histoire du cinéma québécois : de 1896 à 1969 », et paru en 2015, un panorama important de la diversité des pratiques cinématographiques existantes et revient sur l’importance du genre documentaire :
La fermentation et le changement se produisent dans tous les domaines des arts. Les formats de films évoluent pour répondre aux besoins des cinéastes […] Pendant cette période, Pierre Perrault domine le cinéma direct avec sa saga sur la communauté de l’île aux Coudres. En collaboration avec Michel Brault et Bernard Gosselin, ses caméramans, il espère non seulement observer et filmer l’éveil de la nation québécoise, mais aussi y jouer un rôle. Toutefois, le cinéma direct ne se limite pas qu’à des sujets nationalistes. Certains producteurs veulent appliquer ces techniques aux films d’action sociale […]. Un bon nombre de ces efforts se déroulent dans le cadre du programme Société nouvelle de l’ONF (équivalent francophone de Challenge for Change). Ceci implique le fait de filmer des communautés marginalisées, et souvent avec la participation des sujets eux-mêmes.
La grande portée politique du mouvement nationaliste au Québec durant les années 60 et 70 a donc contribué à influer sur la répartition des modes de production des films sur le territoire et a dessiné progressivement une cartographie des pratiques qui définit aujourd’hui la nature complexe de cet héritage cinématographique. Pour autant, une bonne partie de ces auteurs ne mentionnent l’apport des femmes que très brièvement dans plusieurs de leurs écrits et contribuent ainsi à favoriser l’écriture de récits hégémoniques du cinéma.
Comme le souligne Véronneau, cet héritage ne comprend pas uniquement une cinématographie nationaliste. Au contraire, celui-ci est traversé par d’autres pans cinématographiques qui demeurent malheureusement encore peu documentés et parfois invisibilisés. Christian Poirier (2004 : 5) explique notamment comment la mémoire de la collectivité québécoise est sujette à de nombreux réaménagements :
La société québécoise, rappelons-le, est composée d’une majorité nationale francophone, d’une minorité nationale anglophone, de onze nations autochtones et d’une multiplicité de Québécois d’origines ethniques et culturelles diverses. Les processus récents de globalisation des marchés et de mondialisation des cultures imposent de surcroît la nécessité, pour la collectivité québécoise, de se (re)définir et de s’interpréter constamment.
L’importance de reconnaître un patrimoine cinématographique québécois francophone s’est imposée comme une préoccupation majeure durant les années 70. Notons également que le cinéma anglophone est rarement défini comme « cinéma québécois », mais plutôt nommé comme « cinéma canadien-anglais » (Véronneau 1991). Il importe donc actuellement de développer une réflexion critique de cette histoire. Comme le fait remarquer la chercheuse Karine Bertrand (2013 : 120), le cinéma québécois francophone restera également l’auteur d’un discours dominant et colonisateur pendant de longues années :
La situation sociale au Québec, jusqu’au début des années 60, est caractérisée par l’oppression du peuple colonisé par un régime politique aberrant (le règne de Duplessis et la loi du cadenas) et par une autorité religieuse exerçant un contrôle quasi total sur les moeurs de ses ouailles. De plus, le peuple québécois demeure sous le joug des anglophones (les employeurs), qui, même minoritaires, imposent bien souvent leur langue aux francophones contraints d’obéir à leurs supérieurs. Les Autochtones sont au bas de l’échelle sociale, ce sont eux les plus colonisés de tous lorsqu’à l’aube de la Révolution tranquille, les autorités religieuses prennent en main l’éducation des jeunes autochtones, qui seront dès lors privés de l’usage de leur langue et de l’apprentissage de leur culture, en plus d’être les victimes, nous l’apprendrons bien longtemps après les faits, d’agressions sexuelles répétées de la part des prêtres responsables de leur apprentissage.
Si cette culture patrimoniale se poursuit à ce jour, notons que cette « fixation » de l’identité québécoise francophone sera remise en question par bon nombre de cinéastes dans de nombreux films des années 80 et 90 comme Haïti (Québec) (1985) de Tahani Rached, Kanehsatake, 270ans de résistance d’Alanis Obomsawin (1993) et La déroute (1998) de Paul Tana (Poirier 2004). Ces cinéastes témoigneront du processus d’altérisation opéré par une frange du nationalisme québécois et d’une absence de critique relativement à l’historique colonial du Québec. Ce sera d’ailleurs ce dont témoigne Tahani Rached dans un texte publié dans la revue Copie Zéro en 1986[12]. À la suite de la sortie de son documentaire Haïti (Québec), qui porte sur le racisme vécu par la communauté haïtienne à Montréal au cours des années 0, la réalisatrice répond, par l’entremise d’une lettre adressée à la revue, à l’auteure Denyse Therrien. Cette dernière avait publié quelques mois auparavant dans la même revue un article qui reprochait à la cinéaste d’avoir réalisé un film raciste et anti-québécois (Therrien 1985). S’adressant à la revue de la Cinémathèque québécoise, Rached (1986) fait valoir que les institutions ont longtemps consenti à véhiculer une vision figée de l’identité québécoise :
Vous avez publié non seulement des accusations de la plus haute gravité – du moins pour qui donne encore un sens aux mots – des accusations non fondées de « racisme primaire vis-à-vis du peuple québécois » contre un individu, mais des jugements ignorants, erronés par conséquent, méprisants sinon chauvins contre toute une collectivité à qui l’on n’accorde même pas d’être montréalaise ou québécoise, fut-ce plus récemment que d’autres.
Dans cette perspective, la multiplicité des héritages et les rapports de pouvoir et d’oppression engendrés par les histoires coloniales du Québec sont des facteurs importants qui participent, entre autres éléments, au manque de définitions explicites du patrimoine cinématographique québécois. En outre, l’encadrement prévu par les lois mentionnées plus haut et leur application dans le secteur patrimonial passent sous silence les conséquences de cette hégémonie culturelle.
Bien qu’une évolution de la signification du terme « patrimoine » soit remarquée dans les rapports de l’Unesco, notamment en ce qui concerne l’inclusion des communautés marginalisées, ceux-ci restent silencieux quant aux pratiques de réhabilitation de ces héritages, mais aussi sur la manière dont les institutions patrimoniales font aujourd’hui preuve de leur responsabilité relativement à l’invisibilisation et à l’exclusion de ces corpus. En effet, puisqu’elles répondent majoritairement à des directives gouvernementales ou aux décrets qui régissent le monde des musées, certaines institutions patrimoniales décident encore à l’heure actuelle par elles seules des règles de gouvernance et de transmission des archives. Or, si les revendications de plus en plus médiatisées des communautés autochtones, féministes, LGBTQ2S+[13] et immigrantes contribuent au bouleversement de la conception du patrimoine cinématographique, on pourrait aisément s’interroger quant aux raisons pour lesquelles les règles de gouvernance sont essentiellement réfléchies par les institutions elles-mêmes sans l’engagement des communautés.
Ces explorations critiques nous ont permis, d’une part, de constater les liens importants qui se sont noués entre le mouvement nationaliste québécois et la patrimonialisation du cinéma et, d’autre part, de comprendre la façon dont le renouvellement des luttes sociales et culturelles contribue à définir la conception du patrimoine au Québec. Pour autant, comme nous l’avons vu précédemment, les récits légitimés autour des patrimoines continuent à glorifier la contribution des hommes en marginalisant celle des femmes. Le patrimoine cinématographique québécois ne fait pas exception à la règle.
Plusieurs auteures féministes le soulignent, le milieu de la critique cinématographique aura contribué à ne valoriser qu’une certaine forme de cinéphilie en minorant l’apport des femmes, en particulier de celles qui sont issues de communautés marginalisées, dans le développement de la production cinématographique. Nous analyserons dans la prochaine section la manière dont les femmes se sont emparées de cet espace critique pour faire émerger des corpus oubliés de l’histoire du cinéma au Québec et nous montrerons ainsi les hiérarchies et les distinctions opérées par la patrimonialisation des oeuvres. Cette section ne pouvant être exhaustive, nous n’avons pas pour prétention d’englober l’ensemble des cinématographies produites par les femmes au Québec, mais plutôt de revenir sur la formation de différents corpus constitués à partir des années 60 jusqu’aux années 80 et de souligner les lacunes et les absences concernant plusieurs d’entre eux.
Naissance d’un corpus de films féministes (1960-1970) à l’ombre du patrimoine
Un grand nombre d’auteures et auteurs ainsi que de chercheuses et chercheurs contribuent depuis bientôt plus de 50 ans à dénoncer les inégalités de genre persistantes au sein du milieu cinématographique[14]. Leurs recherches ont permis de faire émerger des pans d’histoire jusqu’ici oubliés et de valoriser le parcours de nombreuses réalisatrices. Ainsi, contrairement au statut globalisant conféré à l’ensemble du patrimoine cinématographique, il serait impossible ici de nommer un unique corpus. La pluralité des histoires et des oeuvres produites par les femmes doit être analysée dans une perspective ouverte et non figée.
En 1996, Jocelyne Denault publiait un ouvrage consacré aux premières artisanes du cinéma québécois intitulé Dans l’ombre des projecteurs: les Québécoises et le cinéma. Cette auteure cherche à mettre en valeur les différents rôles occupés par les femmes dans le cinéma québécois de 1896 à 1969. Son ouvrage contribue alors à déconstruire les multiples discours dont l’objet est d’invisibiliser le travail des femmes dans le domaine de la réalisation. Elle explique par exemple que les femmes qui réussissent à intégrer les équipes de tournage se sont souvent placées au service des institutions cinématographiques et ont vu leur contribution effacée par ces dernières en raison des hiérarchies surplombantes dans le milieu du cinéma. Au sein de l’ONF, des réalisatrices telles que Judith Crawley, Jane Marsh, Evelyn Spice Cherry ou l’animatrice Evelyn Lambart se voient accéder à des postes de création, tandis que resteront dans l’ombre une majorité de femmes occupant des postes précaires comme monteuses ou secrétaires. Cette « histoire-panthéon », pour reprendre les mots de Michèle Lagny, construite en partie par les institutions, les spécialistes de l’histoire et le milieu de la critique, aura une incidence importante sur la formation des héritages exclusivement produits par les femmes à partir des années 70.
En octobre 1981, la critique et enseignante Louise Carrière soumet un article à la revue Copie Zéro de la Cinémathèque québécoise afin de souligner la rareté des écrits et des recherches portant sur les films réalisés par des femmes. L’auteure explique notamment qu’une partie importante des oeuvres réalisées par les femmes s’est développée dans le contexte des luttes indépendantistes et féministes des années 70. Elle mentionne également le manque d’intérêt de ses confrères pour la cinématographie des femmes et appelle le milieu cinématographique à porter la responsabilité de cette inégalité (Carrière 1981 : 45) :
Je crois plutôt que nous avons passé comme critiques à côté d’un phénomène important et que nous n’avons pas su à l’époque lire à travers les changements. Après avoir relu encore récemment les livres et articles sur le cinéma québécois, j’ai pu constater comment les critiques, dont moi-même, accordent en gros 3-4 lignes ici et là à la participation des femmes dans le cinéma québécois. Il n’y a pas pour le Québec d’études plus générales sur le phénomène des femmes à la réalisation, tout au plus une interview occasionnellement sur des films de femmes.
Outre cette critique, l’auteure esquisse une cartographie des pratiques cinématographiques souvent reprises par de nombreux ouvrages portant sur l’engagement personnel des femmes dans le cinéma québécois avant 1981. Ainsi, on connaît aujourd’hui le travail important de la monteuse et réalisatrice Monique Fortier, des pionnières des deux studios d’animation français et anglais (Mitsu Daudelin, Francine Desbiens, Suzanne Gervais, Evelyn Lambart, Estelle Lebel) et aussi celui de la cinéaste Anne-Claire Poirier, devenue au cours des années 70 la première cinéaste permanente de l’ONF. Elle est également cofondatrice avec Jeanne Morazain de la série « En tant que femmes », dont l’objectif est de susciter une prise de conscience collective de la situation des femmes à cette époque-là. Le programme débutera en 1972 et donnera lieu, entre autres, à des oeuvres féministes telles que J’me marie, j’me marie pas (1973) de Mireille Dansereau, Souris, tu m’inquiètes (1973) d’Aimée Danis et Les filles c’est pas pareil (1974) d’Hélène Girard (Blackburn 1980).
Du côté anglophone, le Studio D, dont la fondation est impulsée en 1974 par la réalisatrice Kathleen Shannon, sera le premier studio de production financé par des fonds publics et portera notamment des films comme Firewords : Louky Bersianik, Jovette Marchessault, Nicole Brossard de Dorothy Todd Hénaut, qui rend hommage à l’audace et à la créativité de ces trois auteures féministes devenues célèbres, Not a Love Story: A Film about Pornography de Bonnie Sherr Klein, oeuvre polémique qui critique sévèrement le milieu de la pornographie aux États-Unis et au Canada au courant des années 70 et 80 ainsi que Some American Feminists de Nicole Brossard, Luce Guilbeault et Margaret Wescott, où l’on trace un portrait de la pensée de certaines théoriciennes féministes aux États-Unis (Vanstone 2007).
Néanmoins, nous devons rapporter qu’aucune mention n’est faite dans l’article de Louise Carrière à propos du travail de la réalisatrice Alanis Obomsawin. Celle-ci a pourtant été une des rares cinéastes autochtones à intégrer l’ONF d’abord en tant que consultante en 1967 puis à titre d’auteure d’une cinquantaine de documentaires mettant en valeur les voix et les récits de plusieurs communautés autochtones longtemps rejetées et ignorées par la société québécoise (Bertrand 2013).
Bien que de nombreux ouvrages abordent de façon détaillée le parcours de plusieurs réalisatrices au sein de l’ONF et demeurent de précieuses références pour documenter les pratiques de l’institution, peu d’analyses se concentrent précisément sur les rapports de pouvoir existants au sein du milieu cinématographique à cette époque-là et plus largement sur les conditions de production des films de même que sur les inégalités et les hiérarchies produites entre les femmes par l’industrie. Pourtant, cette analyse pourrait apporter un éclairage sur la formation des héritages cinématographiques que nous connaissons à l’heure actuelle.
Outre la domination masculine largement dénoncée dans plusieurs écrits, il faut reconnaître le privilège alors accordé aux réalisatrices majoritairement blanches. Certaines ont bénéficié d’une permanence au sein de l’ONF et donc, d’un statut social bien plus confortable que les cinéastes indépendantes. À noter que la distinction entre une cinématographie indépendante et une cinématographie institutionnelle ne peut faire l’objet de catégories fixes et rigides. On observe ainsi que plusieurs réalisatrices indépendantes ont quand même bénéficié de contrats avec l’ONF pour y réaliser quelques films. Pensons notamment aux réalisatrices telles que Paule Baillargeon, Sophie Bissonnette, Monique Crouillère, Mireille Dansereau, Marilú Mallet ou Sylvie Van Brabant.
Plus généralement, ces réalisatrices offriront, à travers leur filmographie, un nouveau regard sur les femmes qui demeuraient jusqu’ici prises au piège des stéréotypes véhiculés dans la cinématographie dominante.
À titre d’exemple, le premier long métrage de la cinéaste Sophie Bissonnette, coréalisé avec Martin Duckworth et Joyce Rock, Une histoire de femmes (1979), s’attache à documenter l’évolution de la grève des femmes d’ouvriers mineurs de la multinationale INCO à Sudbury en 1978-1979. Vivant depuis plusieurs mois au sein des familles de grévistes, les trois cinéastes ont tout particulièrement cherché à mettre en avant le point de vue et les actions des femmes de cette ville minière. Souvent ignorées des mouvements féministes, les travailleuses et les « ménagères » tiennent dans ce documentaire un rôle central dévoilant avec force et ingéniosité leur capacité d’agir. Dans un tout autre registre, le film autobiographique Journal inachevé (1982) de Marilú Mallet déjoue les codes du documentaire politique souvent observé à l’époque, en intégrant une écriture filmique intime et poétique. La cinéaste revient sur sa trajectoire migratoire, du Chili au Québec, et amène une réflexion politique, saisissante et encore taboue au début des années 80 sur la question du déplacement et de l’identité.
Néanmoins, rappelons que cette créativité nécessite la présence de nombreuses ressources apportées bien souvent par les réalisatrices elles-mêmes. Subissant une précarité importante, la plupart du temps avec une famille à charge, elles devront se confronter aux rapports de forces avec les réalisateurs et les producteurs du milieu et, bien sûr, aux rapports de pouvoir et de compétition instaurés entre les femmes pour bénéficier de fonds (Dubé 2013).
Après avoir reconnu le manque de documentation et le peu de visibilité accordée aux films réalisés par des cinéastes indépendantes, la Cinémathèque québécoise et l’ONF ont restauré, grâce au soutien du Plan culturel numérique du gouvernement du Québec, une série de films féministes des années 60 et 70. Ainsi, ce corpus explorant différents sujets comme l’accouchement, les rapports hommes-femmes et l’immigration comprend des films tels que : Anastasie Oh ma chérie (1977) de Paule Baillargeon, Le grand remue-ménage (1978) de Francine Allaire et Sylvie Groulx, Les voleurs de job (1980) de Tahani Rached, Depuis que le monde est monde (1981) de Sylvie van Brabant, Serge Giguère et Louise Dugal, Journal inachevé (1982) de Marilú Mallet, Londeleau (1988) d’Isabelle Hayeur (CTVM.info 2019).
Ici encore, nous ne pouvons que déplorer le retard des institutions concernant la valorisation de ce corpus longtemps resté dans l’ombre, et ce, malgré les alertes des chercheuses et critiques féministes. De plus, les inégalités et les discriminations étant encore plus significatives à l’égard des femmes autochtones, racisées et immigrantes, celles-ci subissent une double discrimination qui mériterait, croyons-nous, une plus grande investigation.
Enfin, nous souhaitons mettre l’accent sur l’importance de savoir reconnaître l’existence d’un corpus longtemps ignoré par le milieu de la recherche : celui de la vidéo féministe. Si les femmes sont discriminées du fait de leurs identités de genre, de classe et de race, elles seront aussi exclues par rapport aux médiums utilisés et aux genres cinématographiques explorés.
Les études des Réalisatrices équitables ont montré historiquement que l’accès aux longs-métrages de fiction représentait un défi majeur pour les femmes (Dubé 2013). Afin de s’émanciper du monde du cinéma demeurant difficilement accessible, une majorité de femmes préférera explorer d’autres genres (par exemple, des documentaires, des films expérimentaux ou encore des installations) avec différents médiums tels que la vidéo. Fabriquée par la compagnie Sony, la caméra vidéo Portapak fait son apparition en 1965 aux États-Unis. Destinée à l’origine à un public familial, la mise en marché de ce produit devait principalement servir à inciter la population à la réalisation de films de vacances et de divertissement. Sa facilité de manipulation, son coût plus abordable que le cinéma et sa légèreté attirent néanmoins beaucoup plus les groupes d’artistes, d’éducation populaire, d’animation sociale ainsi que les institutions culturelles qui, grâce au magnétoscope, peuvent désormais visionner immédiatement les séquences tournées. Au Québec, son utilisation s’insère rapidement dans le groupe Challenge for Change de l’ONF avant d’arriver entre les mains des cinéastes francophones de « Société nouvelle », et particulièrement de Robert Forget, fondateur du tout premier organisme de production, de distribution et de diffusion de films tournés en vidéo en 1971 : le Vidéographe. Ainsi, dans ce foisonnement effervescent de productions créatives, où l’on n’éprouve pas encore le poids d’une histoire aux structures hiérarchiques, se déploient de nouveaux espaces que les femmes vont investir pendant plus de deux décennies. C’est ce qu’affirme Christine Ross (1982) dans sa programmation nommée « Semaine de la vidéo féministe québécoise », organisée au Musée d’art contemporain de Montréal, à l’occasion de l’exposition « Art et féminisme[15] » :
Les recherches menées pendant l’été 1981 dans le cadre de l’exposition Art et féminisme, afin de retracer les réalisations féministes québécoises, nous ont permis de constater qu’un pourcentage élevé de femmes a choisi la vidéo comme moyen d’expression de leur vision féministe.
Dans la continuité de cet héritage cinématographique indépendant à Montréal, à Québec et dans plusieurs autres régions du Québec, une nouvelle mouvance de vidéastes féministes définira d’autres moyens de produire et de distribuer leurs films. Selon l’auteur et cinéaste Luc Bourdon (2013 : 15), le mouvement de la vidéo indépendante au Québec émerge comme une solution de rechange aux institutions :
Durant les années 1970, une atmosphère d’effervescence créatrice s’était propagée. Les cégeps, les universités, les télévisions communautaires, des galeries d’art et des organismes de toutes sortes avaient vu le jour. Cette décennie est aussi marquée par deux grands mouvements qui viennent bouleverser la société québécoise : la montée du nationalisme et l’affirmation du mouvement féministe. Plusieurs groupes de création et de production vidéo émergent durant cette période, notamment grâce à des programmes d’aide gouvernementale tels que Jeunesse Canada au travail. Un des objectifs communs à tous ces groupes est de constituer une solution de rechange aux institutions.
Ainsi, plusieurs centres d’artistes, tels que le GIV, le réseau Vidé-Elle et Vidéo Femmes, se sont révélés de véritables lieux d’émancipation pour plusieurs femmes, majoritairement blanches de classe sociale moyenne, quant aux discriminations produites par les institutions cinématographiques de l’époque (Lemieux Lefebvre 2018). Outre qu’ils proposent de nouvelles formes de production et de distribution, ces organismes vont largement contribuer à préserver et à diffuser les oeuvres et les documents réalisés par les vidéastes féministes et lesbiennes. On observera alors le développement de corpus importants sauvegardés en grande partie par certains de ces organismes. Oscillant entre pratiques artistiques et pratiques militantes, les premières réalisations produites sur support vidéo témoigneront des préoccupations du mouvement féministe des années 70 et se concentreront principalement sur les expériences vécues par la communauté francophone. Ces dernières proposeront de nouvelles formes très peu explorées par le cinéma québécois pendant cette période. Pensons à Partir pour la famille d’Hélène Bourgault, documentaire rare montrant des images d’un avortement clandestin, ou au film Femmes de rêve de Louise Gendron, production expérimentale sur les stéréotypes de genre véhiculés par la télévision ou encore au film Chaperons rouges (1979) d’Helen Doyle et Hélène Bourgault, un des premiers à donner la parole à des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Bien qu’il soit précieux et rare, ce corpus reste encore malheureusement peu diffusé et exposé dans les musées. À ce propos, en janvier 2014, Anne Golden, vidéaste et directrice artistique du GIV, se prononçait sur l’histoire du collectif et apportait un éclairage quant à l’importance de rendre visibles ces oeuvres et d’offrir une solution de rechange aux pratiques dominantes des musées (Bourdon et Gajan 2013 : 28) :
Chaque centre d’artistes est porteur d’une part de l’histoire. C’est dans mon mandat de porter l’histoire du GIV. Le groupe, à ses débuts, prônait des positions d’intervention radicales. On se doit de continuer dans ce sens. On le fait en donnant des ateliers à des jeunes ou en présentant des programmes vidéo aux communautés culturelles, parfois à des gens qui ne savent pas du tout ce que c’est... On prend la place que le musée devrait occuper. Et quand les femmes artistes viennent nous voir, on veille à ce qu’elles soient bien accueillies, que le contexte de présentation soit le meilleur possible, qu’elles reçoivent un cachet (et ce, même s’il n’est pas extraordinaire), que le contact avec le public soit assuré et la présentation accompagnée d’un repas, d’un verre de vin, d’une rencontre.
Cette citation d’Anne Golden nous amène à penser que, malgré les efforts fournis au cours des dernières années par les institutions patrimoniales pour réhabiliter des corpus exclus du champ artistique dominant, la création de refuges féministes (tels que des centres d’artistes comme le GIV) sera toujours un rempart nécessaire à la protection d’oeuvres marginalisées, surtout quand celles-ci demeurent condamnées à rester dans l’ombre du patrimoine.
Conclusion
Notre article nous a permis de soulever les problématiques qui sous-tendent les origines de la conception patrimoniale du cinéma au Québec. Le flou actuel dans les définitions relatives au patrimoine cinématographique québécois nous donne l’occasion d’investiguer ce champ et de nous le réapproprier dans une perspective féministe.
Nous avons ainsi observé que les circuits de production des films et la formation des discours critiques demeuraient le terreau fertile d’inégalités de genre, de classe et de race. En plus de nos ajouts à la documentation sur les films de femmes tournés au cours des années 60 et 70, nous avons également souligné la nécessité de considérer de nouvelles analyses féministes pour étudier le développement de ces corpus.
Outre ces inégalités, d’autres collections tournées sur support vidéo ont été largement délaissées, mais elles méritent une attention particulière. Comme le précise Golden, les oeuvres produites par les féministes et plus largement par les femmes sont plurielles et échappent aux catégories fixées par les institutions patrimoniales. Il s’avère alors important de concevoir l’hybridité des pratiques, des médiums et des genres explorés plutôt que de réifier des catégories devenues obsolètes.
Le processus de sélection opéré par les institutions s’est révélé inégalitaire envers les femmes et devrait faire l’objet d’une meilleure concertation avec les communautés ciblées. Toutefois, les études menées sur les rapports de pouvoir et d’oppression à l’égard des cinéastes autochtones, racisées et immigrantes dans le cinéma québécois demeurent lacunaires. On remarquera ainsi qu’un certain nombre d’artistes autochtones, racisées et immigrantes ne souhaitent pas s’identifier comme « cinéastes » bien qu’elles réalisent des films. Pensons notamment à kimura byol lemoine, à Caroline Monnet ou à Skawennati qui revendiquent, entre autres choses, une pratique artistique multidisciplinaire. Cette donnée devra être considérée de près si l’on souhaite aujourd’hui redéfinir le champ patrimonial. Cette redéfinition devrait alors tenir compte des recherches actuelles en études de genre et s’accomplir au Québec en concertation avec des organismes comme Ada X, Black on Black Films, le Bureau de l’écran des Noirs, le centre d’art Daphne, le GIV, Nigra Luventa, les Réalisatrices équitables, le Wapikoni mobile et bien d’autres actrices d’importance dans le milieu artistique qui pourraient contribuer à offrir une conception plus équitable et inclusive du patrimoine cinématographique québécois.
Parties annexes
Note biographique
Julia Minne est doctorante en cotutelle à l’Université de Montréal en communication et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en arts et sciences de l’art. Elle est également responsable de l’initiative Savoirs communs du cinéma à la Cinémathèque québécoise et chargée de cours à l’Université de Montréal. Dans le cadre de son doctorat, elle prépare une thèse en recherche-création, qui porte sur la remédiation des archives du centre d’artistes féministes Vidéo Femmes; en outre, elle collabore régulièrement avec différents organismes culturels au Québec et en France en tant que programmatrice invitée.
Notes
-
[1]
Rappelons l’intervention de la militante féministe et députée Manon Massé, du parti Québec solidaire, qui, en 2017, à l’occasion des élections générales, a suggéré de remplacer ce terme par « héritage culturel ». À propos de son témoignage, voir Charles Lecavalier (2017).
-
[2]
Voir également l’étymologie et la définition du mot « patrimoine » sur le site Web du Centre national des ressources textuelles et lexicales : www.cnrtl.fr/etymologie/patrimoine.
-
[3]
Voir le texte important d’Ellen Hertz (2001). Elle retrace l’histoire du terme « matrimoine » en analysant les conditions de son effacement jusqu’à l’usage courant du terme « patrimoine ».
-
[4]
Traduction libre de l’expression authorized heritage discourse signifiant, selon Smith (2008), qu’il existe des discours hégémoniques ancrés dans les traditions muséales depuis de nombreuses années.
-
[5]
Nous songeons notamment aux ouvrages de référence sur l’histoire du cinéma tels que ceux de Robert Daudelin (1967), de Léo Bonneville (1979), de Madeleine Fournier-Renaud et Pierre Véronneau (1982), d’Yves Lever (1988), de Heinz Weinmann (1990), d’André Gaudreault, Germain Lacasse et Jean-Pierre Sirois-Trahan (1996), de Michel Coulombe et Marcel Jean (1999), de Bill Marshall (2001), de Christian Poirier (2004), de Caroline Zéau (2006) et de Marion Froger (2009).
-
[6]
Loi sur le cinéma : « La présente loi s’applique à tous les champs d’activité ayant trait au film, notamment la production, la distribution, la présentation de films en public et le commerce au détail de matériel vidéo » (www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-18.1/).
-
[7]
Voir le site Web suivant : www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-9.002/20121019#se:1.
-
[8]
Pour consulter la Loi sur les archives : www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-21.1#:~:text=Nul%20ne%20peut%2C%20%C3%A0%20des,28.
-
[9]
La FIAF est le plus important réseau mondial de cinémathèques et d’archives cinématographiques : www.fiafnet.org/pages/E-Resources/FIAF-Statutes-and-Rules.html.
-
[10]
Voir le site Web de la Cinémathèque québécoise : www.cinematheque.qc.ca/workspace/uploads/files/rapport-annuel_2020-2021_vf_web_1.pdf.
-
[11]
La Cinémathèque québécoise, anciennement nommée « Cinémathèque canadienne », prend racine dans une organisation appelée « Connaissance du cinéma », regroupant notamment Guy L. Coté, Michel Patenaude ou encore Avram Garnaise. À la même époque, Serge Losique et Jean Antonin Billard ont déjà l’ambition de créer une cinémathèque canadienne sur le même modèle que la Cinémathèque française. En relation directe avec Henri Langlois, Serge Losique pense alors ce lieu comme la section canadienne de la Cinémathèque française. Une tension apparaît donc entre le groupe de Serge Losique et Connaissance du cinéma qui s’appuie sur deux conceptions différentes de la mission d’une cinémathèque. À ce sujet, voir Antoine Godin (2018).
-
[12]
Voir Rached (1986).
-
[13]
L’acronyme signifie : Lesbiennes, Gais, Bisexuels/les, Transgenres, Queer/en Questionnement, Bispirituels/les et les autres.
-
[14]
Pensons notamment à des ouvrages comme ceux de Louise Carrière (1983), de Jocelyne Denault (1996), de Thérèse Lamartine (2010), des Réalisatrices équitables (Lepage 2014), de Julie Ravary-Pilon (2018), de Kay Armatage, qui dirige un collectif formé de Brenda Longfellow, Kass Banting et Janine Marchessault (1999), d’Anna Lupien (2012) ou de Marie-Josée Saint-Pierre (2022) ainsi qu’aux publications du groupe de recherche Archive/Counter Archive, qui se concentre sur la sauvegarde et la valorisation des « oeuvres réalisées par les populations des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que par la communauté Noire, des personnes de couleur, des femmes, la communauté LGBT2Q+ et les communautés immigrantes » (counterarchive.ca/fr/propos-francais).
-
[15]
Voir le dépliant de présentation de la « Semaine de la vidéo féministe québécoise », programmation organisée en 1982 par Christine Ross au Musée d’art contemporain.
Références
- ARBOUR, Rose-Marie, 1996 « Inventer. Et transmettre », dans La Centrale (dir.), Transmission. Montréal, Les éditions du remue-ménage : 14-18.
- ARMATAGE, Kay, et autres (dir.), 1999 Gendering the Nation: Canadian Women’s Cinema. Toronto, University of Toronto Press.
- BERTRAND, Karine, 2015 « Du tiers absent au passeur de mémoire : la présence autochtone et la figure du médiateur blanc dans le cinéma des Premières Nations », Recherches amérindiennes au Québec, 45, 1 : 51-58.
- BERTRAND, Karine, 2013 Le cinéma des Premières Nations du Québec et des Inuit du Nunavut : réappropriation culturelle et esthétique du sacré. Thèse de doctorat. Montréal, Université de Montréal.
- BISSONNETTE, Sophie, 2020 « Au coeur de la mouvance féministe, les films de Sophie Bissonnette »,Cinémathèque québécoise, [En ligne], [www.cinematheque.qc.ca/fr/dossiers/sophie-bissonnette/] (21 avril 2021).
- BONNEVILLE, Léo, 1979 Le cinéma québécois par ceux qui le font. Montréal, Éditions Paulines et A.D.E.
- BOURDON, Luc, 2013 « Vidéographie 70 », 24 images, 165 : 10-17.
- BOURDON, Luc et Philippe GAJAN, 2013 « Des instants poétiques et numériques : Entretien avec Anne Golden / Entretien avec Catherine Ikam et Louis Fléri / Entretien avec Jocelyn Robert », 24 images, 165 : 27-32.
- BOYER, Jean-Pierre, 1980 Analyse du système de médiations et méthode d’intervention par les médias. Mémoire de maîtrise. Montréal, Université du Québec à Montréal.
- BRASSARD, Noémie, 2017 « Des filles des vues à Vidéo Femmes, les dix premières années », Spirascope, 12 : 9-15.
- CARRIÈRE, Louise, 1983 Femmes et cinéma québécois. Montréal, Boréal Express.
- CARRIÈRE, Louise, 1981 « À propos des films faits par des femmes au Québec », Copie Zéro, 11 : 44-51, [En ligne], [collections.cinematheque.qc.ca/en/articles/a-propos-des-films-faits-par-des-femmes-au-quebec/] (12 mars 2021).
- CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE, 2020 Rapport annuel de la Cinémathèque québécoise 2019-2020, [En ligne], [www.cinematheque.qc.ca/workspace/uploads/files/rapport-annuel_2019-2020_vf_web_1.pdf] (24 mars 2021).
- COLARD, Jean-Max, 2020 « Paul B. Preciado, un intellectuel en transition », Code couleur, 36, janvier-avril, [En ligne], [www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/paul-b-preciado-un-intellectuel-en-transition] (14 avril 2021).
- COLELLA, Silvana, 2018 « “ Not a Mere Tangential Outbreak ”: Gender, Feminism and Cultural Heritage », Il capitale culturale, 18, [En ligne], [doi.org/10.13138/2039-2362/1897] (22 avril 2021).
- COULOMBE, Michel, 2010 « Les anglophones et les immigrants dans le cinéma québécois : un cinéma blanc, blanc, blanc? », Ciné-Bulles, 28, 4, automne : 34-37.
- COULOMBE, Michel, et Marcel JEAN, 1999 Le dictionnaire du cinéma québécois. Montréal, Les Éditions du Boréal.
- CTVM.info, 2019 « Elles, féministes et indépendantes du 25 au 29 mai à la Cinémathèque québécoise », CTVM.info, 22 mai, [En ligne], [ctvm.info/elles-feministes-et-independantes-du-25-au-29-mai-a-la-cinematheque-quebecoise/] (25 avril 2021).
- DAUDELIN, Robert, 1967 Vingt ans de cinéma au Canada français. Québec, Ministère des Affaires culturelles.
- DENAULT, Jocelyne, 1996 Dans l’ombre des projecteurs : les Québécoises et le cinéma. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
- DESCARRIES, Francine, et Anna LUPIEN, 2011 Parcours de réalisatrices québécoises en long métrage de fiction : encore pionnières. Recherche menée en partenariat avec Réalisatrices équitables. Montréal, Institut de recherches et d’études féministes.
- DUBÉ, Sophie, 2013 Paule Baillargeon : cinéaste et féministe. Parcours d’émancipation et de subjectivation d’une femme en robe rouge. Mémoire de maîtrise. Montréal, Université de Montréal.
- DUGUET, Anne-Marie, 1981 Vidéo, la mémoire au poing. Paris, Hachette, coll. « L’Échappée belle ».
- DUMONT, Micheline, 2001 Découvrir la mémoire des femmes : une historienne face à l’histoire des femmes. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- FOURNIER-RENAUD, Madeleine, et Pierre VÉRONNEAU, 1982 Écrits sur le cinéma : bibliographie québécoise, 1911-1981. Montréal, Cinémathèque québécoise.
- FROGER, Marion, 2009 Le cinéma à l’épreuve de la communauté. Le cinéma francophone à l’Office national du film 1960-1985. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- GARNEAU, Marie-Julie, 2009 Hors champ : la marginalisation des femmes québécoises devant et derrière la caméra. Mémoire de maîtrise. Montréal, Université du Québec à Montréal.
- GAUDREAULT, André, Germain LACASSE et Jean-Pierre SIROIS-TRAHAN, 1996 Au pays des ennemis du cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec. Québec, Nuit Blanche éditeur.
- GODIN, Antoine, 2018 Origines de la Cinémathèque québécoise. Montréal, La Cinémathèque québécoise.
- HERTZ, Ellen, 2001 « Le matrimoine », dans Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaehr (dir.), Le musée cannibale. Neuchâtel, GHK Éditions : 153-168.
- JEAN, Marcel, 2005 Le cinéma québécois. Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Boréal Express ».
- KUHN, Annette, 1982 Women’s Pictures: Feminism and Cinema. Londres, Routledge.
- LAGNY, Michèle, 1992 De l’histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma. Paris, Armand Colin.
- LAMARTINE, Thérèse, 2010 Le féminin au cinéma. Montréal, Les Éditions Sisyphe, coll. « Contrepoint ».
- LAMOUREUX, Diane, 2001 L’Amère Patrie. Féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- LECAVALIER, Charles, 2017 « Jugé trop masculin, le mot patrimoine est gommé par Québec solidaire », Le Journal de Québec, 28 novembre, [En ligne], [www.journaldequebec.com/2017/11/28/juge-trop-masculin-le-mot-patrimoine-est-gomme-par-quebec-solidaire] (18 avril 2021).
- LEMIEUX LEFEBVRE, Catherine, 2018 « Émergence de la vidéo au Québec, pour une démocratisation de l’image », Ciné-Bulles, été : 32-35, [En ligne], [id.erudit.org/iderudit/88639ac] (19 avril 2021).
- LEPAGE, Marquise (dir.), 2014 40 ans de vues rêvées, l’imaginaire des cinéastes québécoises depuis 1972. Montréal, Réalisatrices équitables et Éditions Somme toute.
- LEVER, Yves, 1988 Histoire générale du cinéma au Québec. Montréal, Boréal.
- LEWIS, Randolph, 2006 Alanis Obomsawin: The Vision of a Native Filmmaker. Lincoln, University of Nebraska Press.
- LUPIEN, Anna, 2012 De la cuisine au studio. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- MARSHALL, Bill, 2001 Quebec National Cinema. Toronto, McGill-Queens University Press.
- MARSOLAIS, Gilles, 1974 L’aventure du cinéma direct. Paris, Segher.
- PAGÉ, Benoit, 1993 Critiques cinématographiques et institutions du cinéma québécois,1953-1962. Mémoire de maîtrise (sociologie). Québec, Université Laval.
- POIRIER, Christian, 2007 « Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française, [En ligne], [www.ameriquefrancaise.org/fr/article-107/Clerg%C3%A9_et_patrimoine_cin%C3%A9matographique_qu%C3%A9b%C3%A9cois_:_les_pr%C3%AAtres_Albert_Tessier_et_Maurice_Proulx.html#.YzM953bMKBI] (19 mars 2021).
- POIRIER, Christian, 2004 Le cinéma québécois. À la recherche d’une identité, t. I : « L’imaginaire filmique ». Québec, Presses de l’Université du Québec.
- RACHED, Tahani , 1986 « HAÏTI-QUÉBEC : une mise au point de la réalisatrice », Copie Zéro, 29, juillet : 4-5, [En ligne], [collections.cinematheque.qc.ca/wpcontent/uploads/ 2013/08/CZ_1986_29_p04-05w.pdf] (18 septembre 2022).
- RAVARY-PILON, Julie, 2018 Femmes, nation et nature dans le cinéma québécois. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- ROBILLARD, Guy, 1968 « Le nationalisme dans le cinéma québécois », Séquences, 53 : 10-18.
- ROSS, Christine, 1984 Perspectives holistiques dans la vidéo-fiction féministe au Québec, 1978-1982. Mémoire de maîtrise. Montréal, Université Concordia.
- ROSS, Christine, 1982 Semaine de la vidéo féministe québécoise, catalogue de programmation. Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal.
- SAINT-PIERRE, Marie-Josée, 2022 Femmes et cinéma d’animation : un corpus féministe à l’Office national du film du Canada 1939-1989. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- SMITH, Laurajane, 2008 « Heritage, Gender and Identity », dans Brian Graham et Peter Howard (dir.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Farnham, Ashgate : 159-179.
- THERRIEN, Denyse, 1985 « Entre le rêve et le cauchemar », Copie Zéro, 28, avril, [En ligne], [collections.cinematheque.qc.ca/articles/perspectives-2/entre-le-reve-et-le-cauchemar/] (18 septembre 2022).
- VANSTONE, Gail, 2007 D Is for Daring: The Women Behind Studio D. Toronto, Sumach Press.
- VÉRONNEAU, Pierre, 2015 « Histoire du cinéma québécois : de 1896 à 1969 », L’Encyclopédie canadienne, [En ligne], [www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cinema-quebecois] (17 avril 2021).
- VÉRONNEAU, Pierre, 1979 « Le succès est au film parlant français (Histoire du cinéma au Québec I) », Les dossiers de la cinémathèque, avril, [En ligne], [collections.cinematheque.qc.ca/articles/la-diffusion-du-film-en-francais-au-quebec-2/les-origines-1929-1930/] (22 avril 2021).
- VÉRONNEAU, Pierre (dir.), 1991 À la recherche d’une identité. Renaissance du cinéma d’auteur canadien-anglais. Montréal, Cinémathèque québécoise et Musée du cinéma.
- WAUGH, Thomas, Michael BAKER et Ezra WINTON, 2010 Challenge for Change: Activist Documentary at the National Film Board of Canada. Montréal, McGill-Queen’s University.
- WEINMANN, Heinz, 1990 Cinéma de l’imaginaire québécois : de La petite Aurore à Jésus de Montréal. Montréal, Les Éditions de l’Hexagone.
- ZÉAU, Caroline, 2006 L’Office national du film et le cinéma canadien (1939-2003). Bruxelles, Peter Lang, coll. « Études canadiennes ».

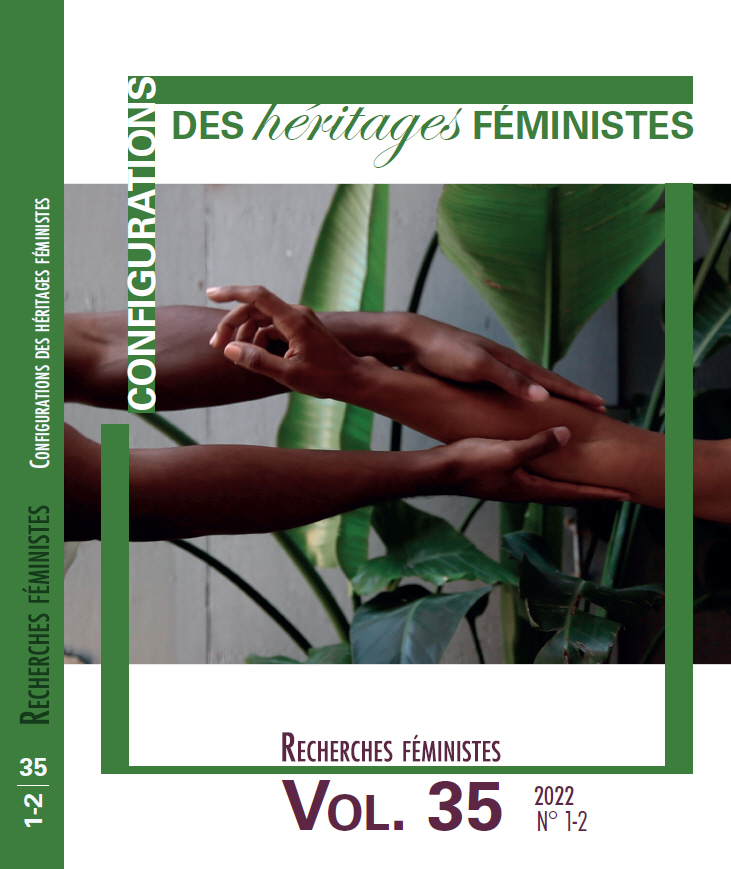
 10.7202/1035164ar
10.7202/1035164ar