Résumés
Résumé
Au Québec, l’égalité femmes-hommes a été au cœur des débats sur la laïcité, en occultant le féminisme religieux, bien qu’il constitue un héritage dont la réappropriation permet de concevoir une laïcité radicale. L’autrice présente d’abord la concrétude de cet héritage et des éléments du contexte menant à son refus. Puis elle expose la position du Conseil du statut de la femme, négatrice de cet héritage. Ce refus a conduit le Conseil à défendre une vision androcentrique de la laïcité, laissant intacte la liberté religieuse des hommes de dominer les femmes dans l’Église catholique. L’autrice préconise la réappropriation de l’héritage féministe religieux afin d’ouvrir de nouvelles possibilités.
Mots-clés :
- laïcité,
- mouvement féministe au Québec,
- féminisme religieux,
- théologie féministe,
- patriarcat
Abstract
In Quebec, equality between women and men was at the heart of the debates on secularism, while concealing religious feminism, even though it constitutes a heritage whose reappropriation makes it possible to conceive a radical secularism. The author presents first the concreteness of this heritage, then elements of the context leading to its refusal. She also shows the position of the Conseil du statut de la femme (CSF) negating this heritage. This refusal has led the CSF to defend an androcentric vision of secularism that preserves the religious freedom of men to dominate women in the Catholic Church. The author advocates for a reappropriation of the religious feminist heritage, in order to open up new possibilities.
Resumen
En Quebec, la igualdad de género ha estado en el centro de los debates sobre el laicismo, ocultando el feminismo religioso, aunque constituye una herencia cuya reapropiación permite concebir un laicismo radical. La autora presenta primero la concreción de esta herencia y de los elementos del contexto que conducen a su rechazo. Luego expone la posición del Consejo de la condición femenina, que niega esta herencia. Esta negativa llevó al Consejo a defender una visión androcéntrica del laicismo, dejando intacta la libertad religiosa de los hombres para dominar a las mujeres en la Iglesia católica. La autora preconiza la reapropiación de la herencia religiosa feminista para abrir nuevas posibilidades.
Corps de l’article
En 1976, Monique Dumais (1939-2017), cofondatrice de la collective L’autre Parole, déclarait ceci à la Société canadienne de théologie : « il y a des théologiennes au Québec, elles sont féministes et critiquent la théologie traditionnelle, elles exigeront un changement radical de structure de l’Église et elles devront travailler avec d’autres femmes » (Dumais 1978b : 2-7). Quarante-cinq ans plus tard, les théologiennes féministes existent toujours au Québec, elles critiquent autant la théologie traditionnelle (et elles en créent d’autres) et elles réclament invariablement des changements. Toutefois, le travail avec d’autres femmes s’est révélé difficile à la suite du débat sur la laïcité qui a soulevé des visions conflictuelles entre féministes.
J’entends stimuler notre imagination politique en présentant comme (hypo)thèse que l’héritage féministe religieux permet de penser autrement la laïcité pour que celle-ci cesse de limiter la liberté religieuse des femmes, tout en laissant intacte la liberté religieuse des hommes de discriminer des femmes dans le groupe religieux majoritaire.
Je m’arrêterai précisément au féminisme chrétien contemporain en contexte québécois pour exposer une perspective de positionnement située en solidarité avec les femmes des groupes religieux minoritaires. Je veux répondre ainsi à une interpellation de Gayatri Chakravorty Spivak (1988 : 288) : à titre de femme blanche francophone, de tradition catholique, issue du groupe religieux majoritaire au Québec, mon défi consiste, selon Spivak, non pas à chercher à définir les Autres (Couture 2007 : 74), mais à me situer d’abord moi-même avant de vouloir inclure les autres dans l’analyse.
Selon Denise Couture (2021 : 222), contester la compatibilité entre féminisme et religion repose sur un point de vue qui manque de matérialité, où l’on ignore la concrétude de vie de femmes religieuses qui ont une posture féministe. Contribuer à faire admettre la matérialité des féministes chrétiennes au Québec sera mon premier objectif. Pour ce faire, je présenterai d’abord brièvement quelques actrices québécoises du féminisme religieux chrétien en faisant voir leurs liens avec le mouvement féministe. Leurs militantismes seront décrits dans la section « L’héritage québécois du féminisme religieux chrétien », où je me limiterai à traiter de la dissidence des féministes chrétiennes[1] au regard de l’avortement et de l’accès au sacerdoce. Cela me permettra de faire voir des modèles de discours moraux et théologiques dégagés du patriarcat[2] pouvant constituer un héritage pour qui souhaite s’opposer à l’antiféminisme religieux. Dans la section « Éléments contextuels de la marginalisation et de l’occultation », j’analyserai des éléments du contexte politique et culturel qui ont facilité l’occultation et la marginalisation de l’héritage féministe religieux. Par la suite (« D’une position antipatriarcale à une position antireligieuse »), j’explorerai comment la promotion de la laïcité mise en oeuvre par le Conseil du statut de la femme (CSF) a occulté l’héritage féministe chrétien. Dans la section « La laïcité androcentrique et la consolidation du patriarcat religieux », je m’appuierai sur les travaux d’une juriste, Gila Stopler, citée par le CSF, pour montrer que la conception de la laïcité qui a été défendue par celui-ci est androcentrique et qu’elle consolide le patriarcat religieux. Enfin, je montrerai, dans la section « Repenser la laïcité féministe », que la réappropriation de l’héritage féministe chrétien invite à penser une laïcité radicalement féministe qui fait obstacle au patriarcat religieux pour intégrer le droit à la citoyenneté ecclésiale.
Le féminisme religieux, un héritage méconnu
La méconnaissance de l’expérience des femmes religieuses entretient l’idée que le rapport à la transcendance qu’elles vivent est marqué uniquement par l’aliénation. Toutefois, des femmes, comme sujets religieux, ont revendiqué pour elles-mêmes et d’autres des droits et des manières de vivre une expérience religieuse exempte de la domination patriarcale. Des femmes croyantes ont partagé des préoccupations communes avec l’ensemble du mouvement féministe, qu’il soit question de sujets liés aux lois antidiscriminatoires, à la protection contre la violence sexuelle et domestique, aux droits génésiques aussi bien qu’aux enjeux rattachés à la représentation politique. Il importe de souligner, avant d’aborder le féminisme chrétien, que ces pratiques religieuses féministes ont également un enracinement historique. Elles ont émergé dans diverses aires géographiques et dans différentes confessions (Gasquet 2019) et non pas seulement en Occident et dans le christianisme (Briggs et McClintock Fulkerson 2012). Les féministes religieuses inscrivent ainsi leurs actions dans des contextes particuliers marqués par les effets, sur les femmes, du colonialisme et de la mondialisation néolibérale. Elles ont donc à composer avec des défis spécifiques (Couture 2021 : 151-157).
Quelques actrices du féminisme chrétien québécois
Au Québec, les actrices du féminisme chrétien ont une diversité de statuts, d’expériences et de parcours. Il ne saurait être question d’en rendre compte ici intégralement. Certaines sont bénévoles ou encore travailleuses rémunérées en Église[3], où elles occupent divers postes d’animation, d’accompagnement ou de responsable en paroisse ou dans un diocèse. Parmi elles, certaines sont répondantes diocésaines à la condition des femmes. Ce sont des femmes engagées par un diocèse pour faire un travail de sensibilisation à la condition des femmes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu ecclésial. Ces postes ont été créés en 1981, l’année où sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code civil du Québec concernant l’égalité juridique au sein du mariage. Voir ces répondantes travailler directement à l’intérieur de l’institution catholique peut soulever le doute au regard de leur engagement féministe. La sociologue Mary Fainsod Katzenstein, qui a analysé les positionnements des militantes féministes dans deux organisations masculines étatsuniennes, soit l’armée et l’Église catholique, déplore l’insuffisance de certains discours féministes suspicieux à l’égard de l’appartenance religieuse. Selon elle, l’engagement dans l’institution catholique ne peut être conçu uniquement comme un enrôlement dans un système patriarcal et rendre compte de leur expérience féministe. Elle invite à renoncer à une analyse du militantisme féministe basée sur la dichotomie intérieure/extérieure de l’institution. Il faudrait davantage voir les féministes chrétiennes situées dans un continuum qui tient compte d’un investissement à la fois dans des relations externes à l’institution et à l’intérieur de celle-ci.
Au Québec, les femmes du réseau des répondantes entretiennent des liens étroits avec des groupes féministes locaux. Elles ont été nombreuses à participer à l’organisation de la Marche mondiale des femmes en 2000 aux quatre coins du Québec, d’Amos à Gaspé, en passant par Rouyn-Noranda, et à soutenir cette marche avec enthousiasme. L’ouvrage Les répondantes diocésaines à la condition des femmes 25 ans d’histoire 1986-2006 (Veillette 2012 : 455-517) fait place à leurs témoignages. Bien qu’elles soient dépendantes directement de l’institution, elles n’ont pas hésité à se joindre à d’autres organismes liés à l’Église catholique pour dénoncer le retrait de l’appui à la Marche mondiale des femmes par l’organisation catholique canadienne qui milite pour le développement et la paix (Développement et Paix). Au coeur du litige se trouve la question de l’avortement[4].
D’autres ont moins eu à composer avec les contraintes de l’institution catholique en travaillant à l’intérieur de facultés de théologie universitaires[5]. Elles y ont élaboré des théologies féministes qui se sont attaquées plus précisément aux questions de genre propres aux communautés croyantes. Elles ont fait la critique du caractère patriarcal de leur tradition et de ses structures institutionnelles, et promu l’accès des femmes à des rôles religieux en se réappropriant l’histoire de ces dernières. Ces théologies féministes n’opèrent pas cependant une réflexion sur des éléments propres aux femmes. Ce ne sont pas des théologies de femmes : elles visent plutôt à la transformation des rapports, tant dans la société que dans des groupes religieux, à partir de positions subversives pour échapper au patriarcat (Veillette 1990 : 36).
Marie-Andrée Roy (2007 : 32-35) trace un portrait succinct des théologiennes à l’oeuvre dans les universités québécoises dès les années 70, de Madeleine Sauvé[6], la première à obtenir un doctorat en 1962 avec une thèse intitulée La femme dans la Bible, à Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie, dont les travaux ont porté, entre autres, sur l’interspiritualité féministe (Couture 2008 et 2021) et l’antiféminisme du Vatican (Couture 2005, 2012 et 2018). L’une d’elles, Monique Dumais, est souvent considérée comme une figure marquante de la théologie féministe québécoise (Caron 2018). Elle a poursuivi ses études supérieures à l’Université Harvard puis à New York. Elle a été professeure de théologie et d’éthique au Département de sciences religieuses et d’éthique de l’Université du Québec à Rimouski et membre du comité de rédaction de la revue Recherches féministes de 1987 à 1992. Parmi ses thèmes, le corps. Sous sa plume, la colère devient une façon d’exprimer l’énergie incarnée qui s’avère nécessaire pour résister à l’oppression et non un péché capital. La théologie se réécrit à partir de l’expérience des femmes, de toutes les femmes, affirmait-elle, dans une recension du rapport Hite (Dumais 1978a : 9). Elle déplorait l’incapacité dans le christianisme d’assumer pleinement le credo de l’incarnation (Couture 2012 : 107; Dumais 1978a). Selon Roy (2007 : 31), au Québec, la majorité des théologiennes ont aussi des liens avec des groupes féministes hors du réseau ecclésial.
L’historienne Micheline Dumont s’est intéressée particulièrement à l’histoire des femmes membres de communautés religieuses. Un ouvrage qui rassemble le fruit de ses recherches porte un titre évocateur : Les religieuses sont-elles féministes? Selon elle, faire l’histoire des religieuses peut soutenir une vision émancipatrice autant qu’aliénante de leurs actions (Dumont 1995 : 21). Aujourd’hui, bien que les communautés soient en voie d’attrition, nombre de religieuses sont engagées à lutter pour les droits des femmes (Daviau 2021 : 4-6). C’est le cas notamment des membres de l’Association des religieuses pour le droit des femmes (ARDF), créée dans la foulée de l’Année internationale des femmes de 1975, décrétée par l’Organisation des Nations unies (ONU) (Dubé 2011 : 4-5). En 2002, une représentante siège au conseil d’administration de la Fédération des femmes du Québec, tandis que d’autres membres ont été et demeurent engagées dans des activités de divers groupes féministes. Parmi leur engagement, notons en 2016, la campagne contre les conditions de détention des femmes à la prison Leclerc (Nadeau 2016).
L’héritage québécois du féminisme religieux chrétien
L’héritage religieux est bien un legs conflictuel. Toutefois, contre les forces de l’antiféminisme, nourries des discours religieux, qui s’entêtent à faire reculer les droits des femmes, les prises de position des féministes chrétiennes offrent un appui pour combattre et résister. Elles constituent un héritage. Je présenterai ici deux prises de position concernant l’avortement et l’ordination afin de poursuivre l’objectif de rendre tangible l’héritage féministe chrétien dans l’histoire récente. La première prise de position est principalement le fait de la collective L’autre Parole, alors que la seconde, soit la militance en faveur de l’ordination, est portée par le réseau Femmes et ministères.
La réalité de l’expérience des femmes dont « la vie n’est pas un principe » a guidé la collective L’autre Parole. Dès 1981, elle avait publiquement dénoncé les évêques québécois opposés au libre choix des femmes. En plus d’une conférence de presse, une déclaration commune a été publiée dans Le Devoir (Coordination pour l’avortement libre et gratuit et autres 1981) en alliance avec d’autres groupes féministes, dont la revue La Vie en rose et le Centre de santé des femmes du quartier. Les membres de la collective L’autre Parole déploraient que les évêques québécois fournissent des arguments à la droite tant dans la société que dans l’Église. Bien que les arguments religieux soutiennent les principales objections en regard du libre choix, ce sont principalement les féministes chrétiennes qui attaquent les positions religieuses (Jacquet 2017 : 224). En 2013, la collective réitérait sa position en déclarant ceci : « Nous affirmons que c’est une déformation du christianisme de penser qu’il commande une position anti-choix[7]. »
En définissant l’Église comme une ecclésia, c’est-à-dire un regroupement où règne l’égalité entre les disciples, des féministes chrétiennes s’organisent et contestent leur mise à l’écart des rôles décisionnels. Dans cette foulée, le réseau Femmes et ministères est créé en 1982. Ce groupe a eu recours à l’opinion publique à la suite de la publication de la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis du pape Jean-Paul II qui, en 1994, affirmait que la position de l’Église concernant les ministères réservés aux hommes « doit être définitivement tenue par tous les fidèles » (paragraphe 4). La requête a été envoyée au président de la Conférence des évêques catholiques du Canada et s’est transformée en pétition signée par 725 personnes dans une première publication dans Le Devoir, le 29 juin 1994. Puis lors d’une seconde publication, deux mois plus tard, 1 300 signatures se sont ajoutées (Jacob 2006 : 85).
Le refus de l’héritage du féminisme religieux et le débat sur la laïcité
En 2013, une invitation à participer à une émission de télévision[8] dont la question portait sur la compatibilité du féminisme et de la religion m’a permis de constater la vigueur de la négation de l’héritage féministe religieux. Bien que j’y aie présenté des informations concrètes sur l’existence de celui-ci, près de la moitié des personnes sondées lors de l’écoute ont opté pour l’incompatibilité entre féminisme et religion. Il est connu que les modalités d’entrée dans les mouvements sociaux, tels que le féminisme québécois, sont conditionnées par le contexte politique et culturel (Lamoureux et Mayer 2019 : 129-148). Force m’est toutefois d’admettre que celui-ci n’a pas été favorable à la reconnaissance du féminisme religieux. Plusieurs éléments ont contribué à bloquer la réception d’un legs féministe chrétien, voire à corroborer l’hypothèse que les féministes se sont battues principalement contre la religion plutôt que contre le patriarcat (Jacquet 2017).
Des éléments contextuels de la marginalisation et de l’occultation
La mise à l’écart de la religion par le mouvement féministe durant sa deuxième vague, la sécularisation de la société et le poids du patriarcat religieux concourent à produire ce que Carmen Chouinard (2017) nomme la triple occultation du féminisme religieux abrahamique. Les voix des féministes chrétiennes au Québec ont pu se faire entendre davantage au cours des années 80 et 90. Toutefois, à la suite d’un contrôle accru des autorités religieuses, à partir des années 2000, les progressistes catholiques sont devenues inaudibles dans la sphère publique (Lefebvre et Beaman 2012 : 85). Dans une analyse approfondie des représentations de la religion et de la laïcité par les féministes québécoises lors des débats sur la laïcité, Caroline Jacquet montre que le « récit séculariste » a occupé une place importante. Dans cette perspective, la religion s’oppose à la modernité, elle est irrationnelle et oppressive (Jacquet 2017 : 402). En découle une représentation essentialiste de la religion vue uniquement comme patriarcale qui marginalise toute forme de pratiques religieuses. Celles-ci sont vues comme aliénantes et entièrement sous le joug du patriarcat. Cette position ignore les pratiques des féministes croyantes. Ainsi, accusées d’avoir une « fausse conscience », isolées, aux prises avec le patriarcat issu de leur groupe religieux sans possibilité d’alliance avec le réseau féministe, les féministes religieuses font donc face à une double marginalisation : ostracisées dans leur propre groupe, elles sont considérées comme illégitimes à titre de féministes (Fussinger et autres 2019 : 9).
Il importe de ne pas perdre de vue toutefois que la visibilité de la perspective religieuse féministe est victime des nombreux maux que la vie spirituelle des femmes a subis : longtemps muselée, elle s’est retrouvée sans mémoire ni moyens pour se dire, comme l’affirme Roy (Fussinger 2019 : 129). Remédier à ces maux a été une pratique à laquelle les féministes chrétiennes se sont ardemment livrées. Elles ont réinterprété et reformulé le discours religieux pour dire leur propre expérience de la foi. Elles ont élaboré des discours théologiques autres. Cela constitue une pratique de militance discursive (Katzenstein 1998 : 17).
La sociologue Katzenstein affirme que, chez les féministes catholiques, la militance discursive a été plus importante que le militantisme de groupes d’intérêts, fait principalement d’actions en vue d’influencer les milieux décisionnels ou encore de favoriser ou de défavoriser des mesures législatives ou politiques. Puisqu’elles étaient plus familiarisées avec ce dernier type d’actions, plusieurs alliées féministes potentielles ont probablement trouvé difficile de percevoir le militantisme discursif comme une forme de contestation (Katzenstein 1998 : 19). La militance discursive exercée par les féministes chrétiennes, soit l’interprétation féministe du christianisme et sa théologie, dans certains milieux chrétiens, reçoit un accueil, mais elle est très peu connue du public, du monde politique et des activistes. Dans un contexte de sécularité, lorsqu’il est question de débattre des aménagements de la laïcité, ce discours trouve peu d’écho tant auprès de l’État que de l’ensemble de la société. Voilà peut-être une raison qui expliquerait l’occultation du féminisme chrétien au Québec qui a culminé durant les débats sur la laïcité. Toutefois, il n’en a pas toujours été ainsi. Sans faire l’unanimité au sein du mouvement féministe, la contribution du féminisme religieux a été la bienvenue. Cela a été le cas, avant 2007, au CSF. La nomination comme membre du CSF de Marie Gratton et de Marie-Andrée Roy, de la collective L’autre Parole, et la tenue du colloque « Diversité de foi, égalité de droit[9] », organisé en 2006 par le CSF, témoignent de la pertinence de l’apport des féministes religieuses.
D’une position antipatriarcale à une position antireligieuse
Dans l’histoire récente, le CSF se révèle une figure emblématique du refus de l’héritage religieux féministe. Durant les débats sur la laïcité de l’État québécois, son point de vue a été largement accepté. Pourtant, il avait alors opéré un changement de valeurs et nié ses positions antérieures. Avant le colloque de 2006, le CSF s’était prononcé sur des questions religieuses. Il avait consulté des femmes ayant une expertise en études religieuses et sur le féminisme religieux (Lefebvre et Beaman 2012 : 88). Dans un avis de 1997, le CSF, tout en dénonçant l’intégrisme religieux, ne posait pas de regard négatif à l’endroit de la pratique religieuse des femmes. Les valeurs de solidarité entre les femmes et d’autonomie des femmes « sont des conditions de réalisation de l’égalité entre les sexes » (CSF 1997 : 17). Le pluralisme était également une valeur défendue par le CSF, autant dans la société qu’à l’intérieur du mouvement féministe. De plus, la croyance religieuse n’était pas prise à partie, comme en fait foi ce passage (CSF 1997 : 60) :
Dans leurs dénonciations des diverses inégalités présentes dans les religions, il est important que les féministes qui n’adhèrent pas à des mouvements religieux conservent un respect et une ouverture d’esprit à l’endroit des femmes adeptes, et créent des ponts avec elles. C’est de cette façon que les critiques féministes seront aidantes pour celles qui, à l’intérieur des mouvements religieux, remettent en question des pratiques patriarcales. Les croyantes, quelle que soit leur foi, ont parfois le sentiment que les féministes athées ou agnostiques ne comprennent pas, ou méprisent même, leur attachement à la religion.
Avec l’arrivée d’une nouvelle présidente en novembre 2006, on assiste à un changement (Lefebvre et Beaman 2012). C’est le début d’une période durant laquelle les présidentes du CSF ne viennent pas du mouvement féministe (Maillé 2019 : 58). La séparation de la religion et de l’État ainsi que la primauté du fait français deviennent des valeurs sur lesquelles le CSF fait reposer sa réflexion. Il construit sa défense de la laïcité à travers un récit nationaliste auquel s’adjoignent un récit féministe blanc et un récit séculariste pour faire l’éloge de l’évolution de la nation québécoise, une société qui a vaincu la grande noirceur et où les femmes profitent de l’égalité qui se verrait aujourd’hui menacée par les personnes immigrantes ne partageant pas les valeurs d’égalité entre les sexes et de séparation entre la religion et l’État (Jacquet 2017 : 87-88).
Pour le CSF, la religion apparaît désormais comme un phénomène suspect, voire caricatural (Couture 2012), comme en fait foi cet extrait de l’avis, Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (CSF 2011 : 47) :
Les religions sont absolues, totalitaristes, entières. L’excommunication guette la croyante et le croyant dissidents. Les fidèles doivent obéir à des dogmes régis par le représentant de Dieu sur terre. Devant Dieu, les humains ne sont pas tous égaux. Une personne athée brûlera en enfer, les incroyantes et incroyants ne seront pas sauvés lors du jugement dernier.
Ici, la « religion » est confondue dans un grand tout sans aucune spécificité, représentée comme irrationnelle, répressive (Jacquet 2017 : 403). Les pratiques et les interprétations religieuses variées, notamment celles des féministes chrétiennes, ne sont jamais invoquées. On comprend dès lors que toute réflexion sur les aménagements politiques et juridiques favorables à l’égalité des femmes dans le monde religieux se révèle inopportune. Le CSF (2011 : 92) a souhaité « la mise en place d’un État où les liens avec le religieux seront effacés ». Il semble ignorer que près de 75 p. 100 des Québécoises déclarent une appartenance religieuse au catholicisme (Statistique Canada 2013), donc qu’une grande majorité de la population se dit toujours croyante.
Malgré tout, l’avis de 2011 du CSF semble avoir obtenu collectivement l’assentiment (Dumont 2013 : 46). Il est notamment salué par l’éditorialiste du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, qui écrit : « Voilà un travail de défrichage qui ne détonne en rien dans l’histoire du CSF » (Chouinard 2011). Elle compare même l’avis au rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance de 1978, document majeur pour l’orientation des luttes féministes (Maillé 2019 : 50-54). Cependant, loin de défricher, le CSF ignore dans son analyse le soutien de l’État québécois à la discrimination des femmes à l’intérieur du groupe religieux majoritaire compromettant l’égalité.
Ce sont les demandes liées aux accommodements envers les groupes religieux minoritaires, principalement issus de l’immigration, qui font l’objet de l’attention du CSF. Il a fait sienne l’idée que l’acceptation par l’État du port de signe religieux dans la fonction publique compromet l’égalité des sexes et la neutralité religieuse de l’État. Cette perspective portée par le CSF, alliée à l’idée que la sécularisation est une transition vers un monde où le religieux se trouve effacé, n’intègre pas la lutte contre la domination vécue par les femmes qui souhaitent vivre une appartenance religieuse. Bien que l’avis de 2011 du CSF cite un texte de la juriste Gila Stopler, la possibilité de revendiquer l’égalité à l’intérieur même du domaine religieux n’est pas retenue. Pourtant, c’est bien la thèse principale du texte de Stopler (2008) auquel le CSF renvoie. L’extrait suivant, auquel le CSF fait référence dans son avis, pourrait s’appliquer directement au CSF (Stopler 2008 : 366) :
Historically, feminists, especially religious feminists, have recognized the central role of religion in women’s oppression and have demanded equality for women inside as well as outside religion. Modern feminism has largely neglected the call for equality within religion, assuming, following the enlightenment and its underlying assumptions, that it is both possible and desirable to guarantee equality for women in society at large without directly confronting religious prejudice and that religion and its accompanying prejudice are a passing phenomenon.
La laïcité et la réappropriation de l’héritage féministe religieux chrétien
Si l’on n’a pas en mémoire les luttes des féministes chrétiennes, il est difficile de débusquer l’androcentrisme à l’oeuvre dans l’articulation actuelle de la laïcité. C’est à un tel travail que la juriste Stopler s’est livrée dans l’article cité par le CSF. Pour faire oeuvre de défrichement, celui-ci aurait dû se laisser interpeler par les analyses de Stopler et considérer plus en détail les arrangements religions/État qui perpétuent l’hégémonie du patriarcat religieux. Au Québec, comme ailleurs en Occident, l’État donne un soutien à l’Église catholique sans demander en contrepartie qu’elle cesse la discrimination envers les femmes et les minorités sexuelles. L’héritage féministe chrétien interroge les principes de la laïcité, telles la séparation et la neutralité de l’État. Penser la laïcité de manière féministe demande que l’on s’intéresse de près à ces questions.
La laïcité androcentrique et la consolidation du patriarcat religieux
La séparation est un principe phare de la laïcité. Cela semble contre-intuitif de prétendre que ce principe soit défavorable aux femmes, compte tenu du caractère patriarcal des religions. C’est pourtant ce que met en avant Stopler (2004 : 500). Par une analyse effectuée à partir du point de mire des femmes, elle fait voir que l’hypothèse libérale, selon laquelle la séparation serait suffisante pour assurer la protection des droits des femmes, n’est pas fondée. Elle montre que les liens avec les groupes discriminants sont maintenus de même que leur influence patriarcale. Les aménagements de la séparation reposent sur une conception patriarcale des religions qui fait fi de la pluralité interne vécue dans les communautés croyantes. La pratique actuelle de la séparation – Stopler la nomme « séparation de protection » – ne fait que protéger les autorités religieuses qui exercent de la discrimination. Elle se révèle insuffisante pour mettre la société à l’abri des interventions politiques des autorités religieuses qui s’opposent aux droits génésiques des femmes. Dans sa défense de la laïcité, le CSF insiste sur le principe de séparation qui consacre la souveraineté des groupes religieux, mais sans percevoir les effets pervers que cela provoque (CSF 2011 : 46) :
[La laïcité] consiste donc à distinguer les sphères des pouvoirs politique et religieux des zones d’autorité respective : l’Église est souveraine dans son domaine de compétence, l’État est souverain dans son domaine de compétence. Ce principe d’aménagement ne peut donc constituer un obstacle à l’épanouissement de la religion puisqu’il assure que l’État n’interviendra pas dans les affaires religieuses.
L’héritage féministe religieux invite à s’interroger sur le type d’épanouissement dont il est question. Est-ce l’épanouissement de l’ecclésia ou bien celui de l’autorité patriarcale qui discrimine les femmes et promeut l’antiféminisme? Le récit nationaliste et séculariste mis en scène par le CSF pour promouvoir la laïcité disqualifie la parole des féministes croyantes. Il ne fait pas de place à une analyse des conduites de l’État dans le domaine religieux. Les actions qui viennent compromettre la neutralité de l’État québécois et l’égalité des sexes n’ont pas retenu l’attention du CSF. Ces pratiques incluent, entre autres, la reconnaissance du droit canon de l’Église catholique discriminatoire envers les femmes. L’octroi d’un droit associatif distinct[10] consacrant l’inégalité des femmes est une des principales formes de l’attestation du droit canon. On en trouve également des traces dans la Loi concernant des programmes d’enseignement universitaire dispensés par les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal[11] et la Loi relative à l’université de Sherbrooke[12]. Cette dernière prévoit que le titulaire de la fonction de chancelier[13] de l’Université est l’archevêque catholique romain, donc de facto ce titre est réservé à un homme. Ces privilèges que l’État accorde au groupe religieux majoritaire permettent la forte différenciation de l’Église et consacrent son droit d’être exemptée de l’application des lois interdisant la discrimination contre les femmes. Faire oeuvre de défrichage aurait demandé de s’intéresser à ces questions.
Selon Michel Foucault (1976 : 121-122), l’analyse du pouvoir est complexe. Il présente celui-ci comme une « multiplicité de rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s’exercent[14] ». Ces différents rapports de force(s) peuvent donner lieu à des faits de domination (Foucault 2001 : 1530; l’italique est de moi) :
[…] dans lesquels les relations de pouvoir, au lieu d’être mobiles et de permettre aux différents partenaires une stratégie qui les modifie, se trouvent bloquées et figées. Lorsqu’un individu ou un groupe social arrivent à bloquer un champ de relations de pouvoir, à les rendre immobiles et fixes et à empêcher toute réversibilité du mouvement – par des instruments qui peuvent être aussi bien économiques que politiques ou militaires – on est devant ce qu’on peut appeler un état de domination.
Par sa défense de la laïcité à partir d’une position qui récuse l’héritage féministe religieux, le CSF s’est fait complice du maintien de la domination pratiqué par les autorités catholiques, en négligeant de prêter une attention aux instruments que l’État met à leur disposition. Cela s’ajoute à la concession d’une souveraineté aux autorités religieuses patriarcales qui entretient le domaine religieux comme une zone de non-droit pour les femmes. Dans ce contexte, la liberté religieuse des femmes qui refusent d’être traitées inégalement par les autorités patriarcales se résume à la liberté de quitter le groupe religieux. Voilà ce qui constitue une marginalisation de leurs droits. Aux croyantes, et à elles seules, il est demandé de renoncer de recourir au droit pour astreindre une organisation à respecter l’égalité femmes-hommes. C’est là un déni de citoyenneté rarement dénoncé.
L’importance de repenser la laïcité féministe
La théologienne Margarita Pintos de Cea-Naharro (2002 : 81) a élaboré le concept de citoyenneté ecclésiale, qu’elle décrit comme la pratique d’être pleinement sujet dans la sphère morale, théologique et ecclésiale. Vivre la citoyenneté ecclésiale pour les femmes, c’est ne plus être des receveuses passives et soumises au discours moral patriarcal, mais plutôt faire advenir un discours non entaché par le patriarcat. Dans la sphère de la théologie, cela consiste à concevoir des interprétations propres de la tradition qui contestent l’herméneutique à partir de la subjectivité des femmes pour en faire une part légitime du dépôt de la foi. Comme actrices ecclésiales dans l’Église, les femmes se réunissent, s’associent et font acte de dissidence (ibid. : 86). Des femmes au Québec ont exercé leur citoyenneté ecclésiale. Par leurs engagements, elles ont fait advenir un discours moral autre, nommé Dieue, sans passer par le patriarcat et milité pour la constitution d’une ecclésia dans laquelle femmes et hommes sont des disciples égaux. Toutefois, pour l’État québécois, ces femmes ne sont pas des citoyennes ayant les mêmes droits que des femmes appartenant à d’autres types d’organisations. On considère que, en se joignant à un groupe religieux, les femmes abdiquent leur droit à l’égalité. Cea-Naharro affirme que les femmes sont dépossédées de celui-ci, bien que, dans la société, des progrès aient été réalisés en ce qui concerne la reconnaissance des droits politiques et civils.
Dans l’Église catholique, le refus d’accorder aux femmes un statut égal s’incarne principalement dans la question de l’accès au sacerdoce. Pour sa part, Pauline Jacob (2006 : 88-92) tisse des liens entre les raisons invoquées par l’Église pour justifier le refus du droit de vote et celles qui le sont actuellement pour refuser l’ordination des femmes catholiques. Tout comme le droit de vote, l’ordination permettrait l’engagement dans les structures décisionnelles et une pleine reconnaissance de l’égalité des femmes. De plus, celles-ci auraient accès à une partie de l’espace public d’où elles sont toujours absentes, soit l’espace public religieux et ecclésial[15]. Il n’est pas à l’avantage des femmes, peu importe qu’elles soient croyantes ou non, qu’une partie de l’espace public leur soit toujours inaccessible. Faire place à l’héritage féministe religieux ne consiste pas à souscrire à une vision croyante, mais simplement à ouvrir la possibilité de faire collectivement un pas vers « l’égalité sans limites[16] ». Il faut repenser les principes de la laïcité pour que ceux-ci cessent de jouer contre l’égalité des femmes croyantes. L’État devrait revoir l’arbitrage entre deux droits fondamentaux : celui de la liberté religieuse de l’institution (qui, à ce jour, est le seul qui règne) et celui du droit à la non-discrimination pour les femmes. La réappropriation de l’héritage religieux féministe invite l’État à cesser de donner du crédit uniquement aux autorités masculines. Pour ce faire, Stopler (2004 : 502) suggère de s’inspirer de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de refuser aux groupes religieux le droit de pratiquer la discrimination. Ne pourrait-on pas penser à une reconnaissance explicite de la Convention pour encadrer les pratiques de l’État québécois afin que cesse l’appui du patriarcat religieux et que des croyantes puissent avoir des recours juridiques en cas de discrimination (Lampron 2009)?
Conclusion
Dans ce texte, j’ai voulu établir que religion et féminisme ne sont pas incompatibles et que le féminisme chrétien est une réalité concrète. Il constitue un héritage, malgré la tendance à céder le domaine religieux à des hommes qui ont un programme antiféministe. L’oeuvre des féministes chrétiennes qui ont pris position à partir de leurs convictions pour le libre choix en matière d’avortement et pour la pleine reconnaissance des femmes dans des rôles religieux publics constitue bel et bien un matrimoine pouvant contribuer à combattre l’antiféminisme. Certes, il est occulté lorsqu’un réflexe identitaire prend le pas sur la volonté de conquérir plus de droits pour les femmes. Toutefois, passer du refus de l’héritage à sa réappropriation permet d’imaginer autrement les relations religions/État afin que ce dernier cesse d’être un allié du patriarcat religieux.
Que des croyantes ne puissent recourir à l’État pour défendre le droit à l’égalité dans une organisation religieuse nous semble tout naturel. Affirmer la souveraineté des groupes religieux et proclamer que l’État n’a pas à intervenir dans les religions sert de prétexte pour le justifier. Des juristes de par le monde, qui ne font pas des groupes religieux minoritaires leur point de mire, contestent cette affirmation. Leurs travaux sont peu cités. Ne serait-il pas le temps d’ouvrir le débat à propos de la laïcité pour inclure d’autres préoccupations que la visibilité de signes et de symboles religieux?
Parties annexes
Note biographique
Johanne Philipps est titulaire d’un doctorat en sciences des religions de l’Université de Montréal. Sa thèse de doctorat s’intitulait Comment le projet de laïcité québécoise est défavorable aux femmes. L’urgence de briser une évidence. Membre de la collective L’autre Parole, elle est l’autrice de nombreux articles concernant les relations religions/État. Elle a travaillé comme intervenante en soins spirituels en milieu hospitalier.
Notes
-
[1]
J’ai conservé l’appellation « féministe chrétienne », bien qu’en contexte québécois, il soit question principalement de catholique. Je fais ce choix pour honorer la propre appellation de ces femmes qui travaillent de manière oecuménique. Toutefois, il aurait été plus juste d’employer les termes « féministe et chrétienne » pour ne pas diluer l’appartenance tant féministe que chrétienne des femmes qui luttent pour la fin du patriarcat religieux.
-
[2]
J’emploie le terme « patriarcat » selon la définition que la théologienne Ivonne Gebara lui donne et qui a été reprise par Pauline Jacob (2006 : 93).
-
[3]
En 1988, Sarah Bélanger, pour le compte du réseau Femmes et ministères, a fait une des premières études sociologiques sur le statut des femmes travailleuses en Église : Les soutanes roses : portrait du personnel pastoral féminin au Québec. En 1995, une autre étude a été publiée par Lise Baroni et autres : Voix de femmes, voie de passage, qui consistait en une recherche-action auprès de 225 répondantes exerçant des rôles dans l’Église catholique.
-
[4]
Voir la reproduction de la lettre adressée au directeur de Développement et paix (Veillette 2012 : 491).
-
[5]
Pour un aperçu de l’émergence des femmes dans les facultés de théologie québécoises, voir Marie-Andrée Roy (2001 : 343-359).
-
[6]
Madeleine Sauvé n’a pas poursuivi sa carrière comme théologienne, mais plutôt comme grammairienne : www.125.umontreal.ca/Pionniers/Sauve.html (29 mai 2021).
-
[7]
Cette prise de position apparaît en ligne à l’adresse suivante : www.lautreparole.org/avortement/ (21 mai 2021).
-
[8]
L’émission est diffusée alors sur la chaîne MA TV : elle est animée par Sophie Durocher le 31 octobre 2013 (Couture 2021 : 221-222).
-
[9]
Les actes de ce colloque, qui a réuni des croyantes de diverses communautés, ont été publiés (CSF 2006).
-
[10]
Divers régimes juridiques permettent l’incorporation d’un organisme au Québec. L’État québécois a prévu quatre régimes spécifiques pour les organisations catholiques : la Loi sur les évêques catholiques romains, la Loi sur les fabriques, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains et la Loi sur les corporations religieuses.
-
[11]
Cette loi a été sanctionnée le 20 juin 1998 : www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-278-35-2.html (9 juin 2021).
-
[12]
Voir le site Web suivant : www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/documents-officiels/ (9 juin 2021).
-
[13]
Ce n’est pas un titre honorifique puisque, selon les statuts de l’Université de Sherbrooke (amendés le 27 mai 2019), le chancelier préside l’assemblée de l’Université et vote quand il y a égalité des voix : www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/documents-officiels/ (9 juin 2021).
-
[14]
Gilles Deleuze (1986 : 77), dans ses commentaires des analyses de Foucault, précise que « la force n’est jamais au singulier, il lui appartient essentiellement d’être en rapport avec d’autres forces ». Il écrit donc « rapport de forces » au pluriel, dérogeant ainsi de l’usage commun que respecte Foucault.
-
[15]
Bien que l’on associe la religion à l’espace privé, un tel espace public existe à travers les représentations médiatiques ou à l’occasion de rituels. Solange Lefebvre (2021 : 12-13) témoigne de cette tendance : « Combien de fois, au cours de ma carrière, ai-je vu que l’on déroulait le tapis rouge aux évêques et cardinaux, imams et pasteurs, prêtres et rabbins, à 98 % masculins, attitude allant de pair avec une marginalisation des femmes diplômées en théologie ou engagées et crédibles dans ces groupes religieux. Il suffit d’effectuer une recherche sur un moteur de recherche des expressions “ leader religieux ” ou “ représentants religieux ” pour voir à quel point la Toile est peuplée d’hommes affublés de leurs ornements religieux, sollicités par les États et présidant des rituels collectifs ».
-
[16]
C’était le slogan de l’intersyndicale des femmes pour le 8 mars 2017.
Références
- BARONI, Lise, et autres, 1995 Voix de femmes, voies de passage : pratiques pastorales et enjeux ecclésiaux. Montréal, Éditons Paulines.
- BÉLANGER, Sarah, 1988 Les soutanes roses : portrait du personnel pastoral féminin au Québec. Montréal, Éditions Bellarmin.
- BRIGGS, Sheila, et Mary MCCLINTOCK FULKERSON (dir.), 2012 The Oxford Handbook of Feminist Theology. Oxford, Oxford University Press.
- CARON, Alexandra, 2018 « L’éthique théologique et féministe de Monique Dumais », Théologiques, 26, 2 : 141-160.
- CEA-NAHARRO, Margarita Pintos de, 2002 « Women’s Right to Full Citizenship and Decision-Making in the Church », Concilium, 5 : 79-87.
- CHOUINARD, Carmen, 2017 La triple occultation des femmes croyantes abrahamiques au Québec : analyse de perspectives contemporaines de solutions féministes. Thèse de doctorat. Montréal, Université de Montréal.
- CHOUINARD, Marie-Andrée, 2011 « Éditorial – Laïcité. Les défricheuses », Le Devoir, mercredi 30 mars : A8.
- CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (CSF), 2011 Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Québec, Gouvernement du Québec.
- CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (CSF), 2006 Diversité de foi, égalité de droits : actes du colloque tenu les 23 et 24 mars 2006. Québec, Gouvernement du Québec.
- CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (CSF), 1997 Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme. Québec, Gouvernement du Québec.
- COORDINATION POUR L’AVORTEMENT LIBRE ET GRATUIT et autres, 1981 « La vie des femmes n’est pas un principe, des groupes de femmes répliquent à l’épiscopat », Le Devoir, 11 décembre : 9.
- COUTURE, Denise, 2021 Spiritualités féministes : pour un temps de transformation des relations. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
- COUTURE, Denise, 2018 « Le discours anti-femmes du pape François : une analyse féministe », dans Jean-François Roussel (dir.), Decoloniality and Justice: Theological Perspectivea. Porto Alegre, Brasil Oikos Editoria : 111-124.
- COUTURE, Denise, 2012 « L’antiféminisme du “ nouveau féminisme ” préconisé par le Saint-Siège », Cahiers du genre, 2 : 15-35.
- COUTURE, Denise, 2008 « Feminist Theologies in Québec. Interspirituality and the Feminine Divine », dans Mary Ann Beavis, Elaine Guillemin et Barbara Pell (dir.), Feminist Theology with a Canadian Accent. Toronto, Novalis : 58-75.
- COUTURE, Denise, 2007 « La question du genre. Un féminisme théologique en contexte québécois », dans Monique Dumais (dir.), Franchir le miroir patriarcal. Montréal, Fides : 59-77.
- COUTURE, Denise, 2005 « La subordination de la femme à l’homme selon le Saint-Siège », Rever, Revista de Estudos da Religião, 5, 3 : 14-39.
- DAVIAU, Pierrette, 2021 « Liminaire Religieuses et féministes : d’hier à aujourd’hui », L’autre Parole, 158 : 2-4.
- DELEUZE, Gilles, 1986 Foucault. Paris, Les Éditions de Minuit.
- DUBÉ, Céline, 2011 « Les origines de l’ARDF », Reli-femmes, 73 : 4-5.
- DUMAIS, Monique, 1978a « Le corps de la femme et l’Église : le rapport Hite, un livre important sur la sexualité féminine », L’autre Parole, 5 : 7-9.
- DUMAIS, Monique, 1978b Ferveurs d’une théologienne. Rimouski, Université du Québec à Rimouski.
- DUMONT, Micheline, 2013 Pas d’histoire, les femmes! Réflexions d’une historienne indignée. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- DUMONT, Micheline, 1995 Les religieuses sont-elles féministes? Québec, Bellarmin.
- FOUCAULT, Michel, 2001 « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », dans Michel Foucault, Dits et écrits, t. ii : « 1976-1988 ». Paris, Gallimard : 1527-1548 [1re éd. : 1974].
- FOUCAULT, Michel, 1976 Histoire de la sexualité, t. i : « La volonté de savoir ». Paris, Gallimard.
- FUSSINGER, Catherine, 2019 « Marie-Andrée Roy, sociologue des religions et chercheuse féministe. Quarante ans avec la Collective féministe et chrétienne L’autre Parole au Québec », Nouvelles Questions féministes, 38, 1 : 120-135.
- FUSSINGER, Catherine, et autres, 2019 « Oser penser un engagement féministe et religieux », Nouvelles Questions féministes, 38, 1 : 8-17.
- GASQUET, Béatrice de, 2019 « Quels espaces pour les féminismes religieux? », Nouvelles Questions féministes, 38, 1 : 18-35.
- JACOB, Pauline, 2006 L’authenticité du discernement vocationnel de femmes qui se disent appelées à la prêtrise ou au diaconat dans l’Église catholique du Québec. Thèse de doctorat. Montréal, Université de Montréal.
- JACQUET, Caroline, 2017 Représentations féministes de « la religion » et de « la laïcité » au Québec 1960-2013 : reproductions et contestations des frontières identitaires.Thèse de doctorat. Montréal, Université du Québec à Montréal.
- KATZENSTEIN, Mary Fainsod, 1998 Faithful and Fearless: Moving Feminist Protest inside the Church and Military. Princeton, Princeton University Press.
- LAMOUREUX, Diane, et Stéphanie MAYER, 2019 « Portraits de féministes francophones du xxie siècle au Québec », Recherches féministes, 32, 2 : 129-148.
- LAMPRON, Louis-Philippe, 2009 « Convictions religieuses individuelles versus égalité entre les sexes : ambiguïtés du droit québécois et canadien », dans Pierre Bosset et autres (dir.), Appartenances religieuses, appartenance citoyenne. Québec, Les Presses de l’Université Laval : 205-259.
- LEFEBVRE, Solange, 2021 « Comment l’État peut-il épauler les féministes croyantes? Plaidoyer », L’autre Parole, 157 : 10-15.
- LEFEBVRE, Solange, et Lori BEAMAN, 2012 « Protéger les relations entre les sexes. La commission Bouchard-Taylor et l’égalité hommes-femmes », Revue canadienne de recherche sociale, 2, 1 : 84-94.
- MAILLÉ, Chantal, 2019 « Le Conseil du statut de la femme, un laboratoire d’idées au service de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec », Bulletin d’histoire politique, 28, 1 : 43-62.
- NADEAU, Jean-François, 2016 « Les religieuses se mobilisent en faveur des prisonnières », Le Devoir, 3 mai, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/469797/les-religieuses-se-mobilisent-en-faveur-des-prisonnieres] (9 juin 2021).
- PARENT, Annine, 2013 Devoir de mémoire. Femmes et évêques : un dialogue à poursuivre. Québec, Réseau Femmes et ministères.
- ROY, Marie-Andrée, 2007 « Sexe, genre et théologie », dans Monique Dumais (dir.), Franchir le miroir patriarcal. Montréal, Fides : 13-57.
- ROY, Marie-Andrée, 2001 « Les femmes, le féminisme et la religion », dans Jean-Marc Larouche et Guy Ménard (dir.), L’étude de la religion au Québec. Bilan et prospective. Québec, Les Presses de l’Université Laval : 343‑359.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty, 1988 Can the Subaltern Speak? Basingstoke, Macmillan.
- STATISTIQUE CANADA, 2013 « Profil de l’enquête nationale auprès des ménages. Enquête nationale auprès des ménages de 2011 », Statistique Canada, [En ligne], [www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F] (10 juin 2021).
- STOPLER, Gila, 2008 « “ A Rank Usurpation of Power ” – The Role of Patriarchal Religion and Culture in the Subordination of Women », Duke Journal of Gender, Law and Policy, 15 : 365-397.
- STOPLER, Gila, 2004 « The Free Exercise of Discrimination: Religious Liberty, Civic Community and Women’s Equality », William and Mary Journal Women and the Law, 10 : 459-532.
- VEILLETTE, Denise, 2012 Les répondantes diocésaines à la condition des femmes. 25 ans d’histoire. 1981-2006, t. v : « Des questions qui interpellent ». Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval.
- VEILLETTE, Denise, 1990 « Exister, penser, croire autrement. Thématique religieuse féministe de la revue Concilium », Recherches féministes, 3, 2 : 31-71.

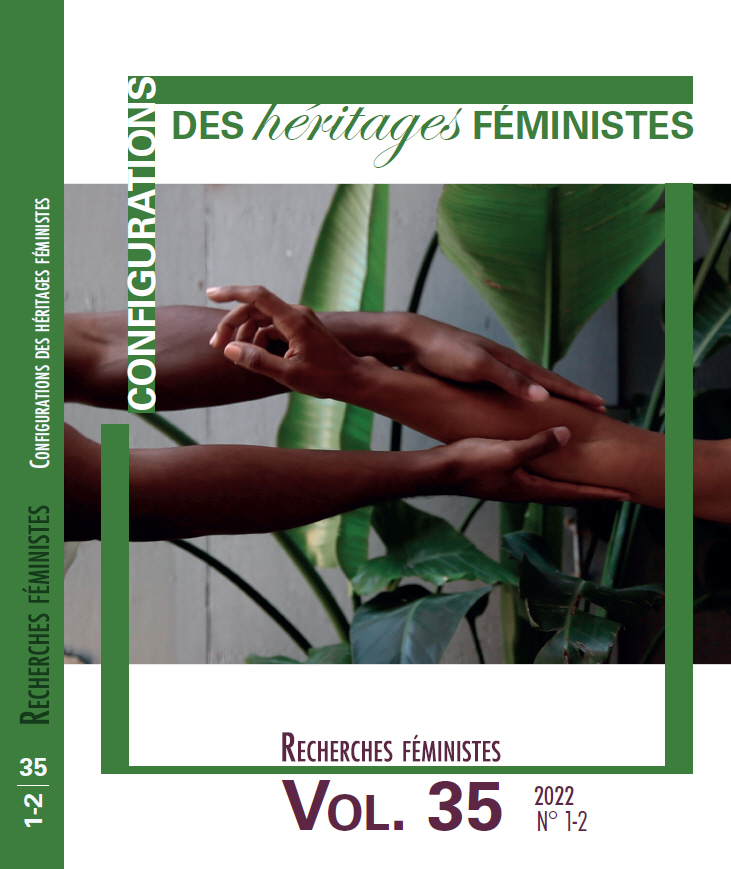
 10.7202/1065199ar
10.7202/1065199ar