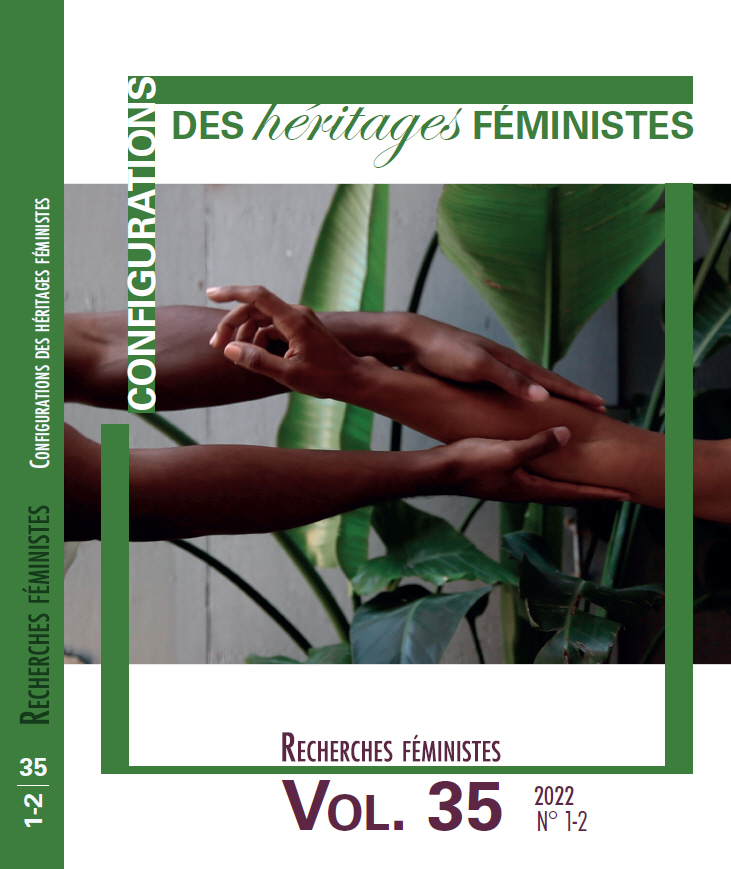La première section de l’ouvrage passe en revue le rôle des femmes dans les mouvements politiques et sociaux en Acadie, notamment l’histoire peu connue du féminisme acadien. Pour briser la représentation stéréotypée de l’Acadienne en tant qu’épouse et mère vénérée comme « gardienne de la race » (p. 25), l’historienne Phyllis Leblanc puise dans 91 thèses de maîtrise en histoire à l’Université de Moncton depuis 1978 où elle en découvre 5 qui traitent précisément de femmes. Celles-ci travaillent dans des milieux genrés non traditionnels (la manufacture, l’industrie forestière, le domaine des affaires, la gestion hospitalière) et se trouvent même sur la route vers les usines de textile aux États-Unis dans le grand exode franco-canadien au début du xxe siècle. Le chapitre de Julien Massicotte, « Idéologies et utopies en Acadie : retour historique », ainsi que celui de Michael Poplyansky, « Féminisme et néonationalisme : le cas du Parti Acadien », se rejoignent pour montrer les rapports entre le mouvement féministe des années 1960 et d’autres mouvements sociaux tels que le néonationalisme représenté par le Parti acadien. Poplyansky fait remarquer l’incompatibilité entre les revendications féministes et la perspective nationaliste du Parti acadien, où les femmes sont valorisées surtout comme « mères de la nation » (p. 87), porteuses d’enfants destinés à garantir la survie du peuple en milieu minoritaire. Selon Poplyansky, même les revendications initiales d’avoir 50 % de députées et d’appuyer des garderies gratuites sont vite abandonnées par le Parti acadien. Massicotte, de son côté, fournit un aperçu éclairant des revendications des groupes féministes tels que LES FAM (Liberté, Égalité, Sororité; les femmes acadiennes). Il finit par conclure que, parmi les trois idéologies des années 1960 et 1970 étudiées, soit le néonationalisme, le féminisme et le socialisme, seul le féminisme reste d’actualité. Pour sa part, à partir d’une analyse des journaux de l’époque, Mélanie Morin situe le mouvement féministe acadien surtout dans ses rapports avec la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (commission Bird) des années 1970, en s’interrogeant sur le rôle du Groupe de femmes francophones de la région de Moncton, entre autres. Auprès de la commission Bird, le Groupe fait entendre ses revendications sur le traitement différentiel des pensions, la garde des enfants, la parité salariale, le besoin d’une plus grande variété de débouchés pour les femmes. Les textes de Poplyansky, de Massicotte et de Morin révèlent la vitalité du mouvement féministe en Acadie, tout en soulignant le manque d’appui au niveau politique. La deuxième section met en vedette des Acadiennes engagées à assurer la transmission de l’histoire acadienne au féminin. Clint Bruce offre une analyse des mémoires peu connues de la Cadienne Désirée Martin (1830-1877), Les veillées d’une soeur ou le destin d’un brin de mousse (1877), où il considère en détail sa décision controversée à l’époque de se défroquer ainsi que sa critique de l’esclavage, institution à laquelle la famille et l’institution religieuse de la mémorialiste avaient pourtant participé avant son abolition en 1865 aux États-Unis. Spécialiste de l’orature, dans son article « La quête des contes de Laure-Irène Pothier-McNeil, conteuse acadienne de Pubnico-Ouest », Jean-Pierre Pichette présente l’histoire de Laure-Irène Pothier-McNeil (1896-1968), enseignante et mère de famille, qui fait valoir le patrimoine acadien en communiquant les contes et les chansons de sa mère à des collaboratrices ou à des collaborateurs tels que la chanteuse mezzo-soprano Juliette Gauthier (1888-1972), des spécialistes du folklore tels que Helen Creighton et Luc Lacourcière, ainsi que l’éditeur du Petit Courrier de West-Pubnico qui publie ses contes. Dans « Sur les traces de la Marichette… Prise de parole féminine dans les chroniques de la …
Jimmy Thibeault et autres (dir.), Paroles et regards de femmes en Acadie, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, 331 p.[Notice]
…plus d’informations
Kathleen Kellett
Université métropolitaine de Toronto