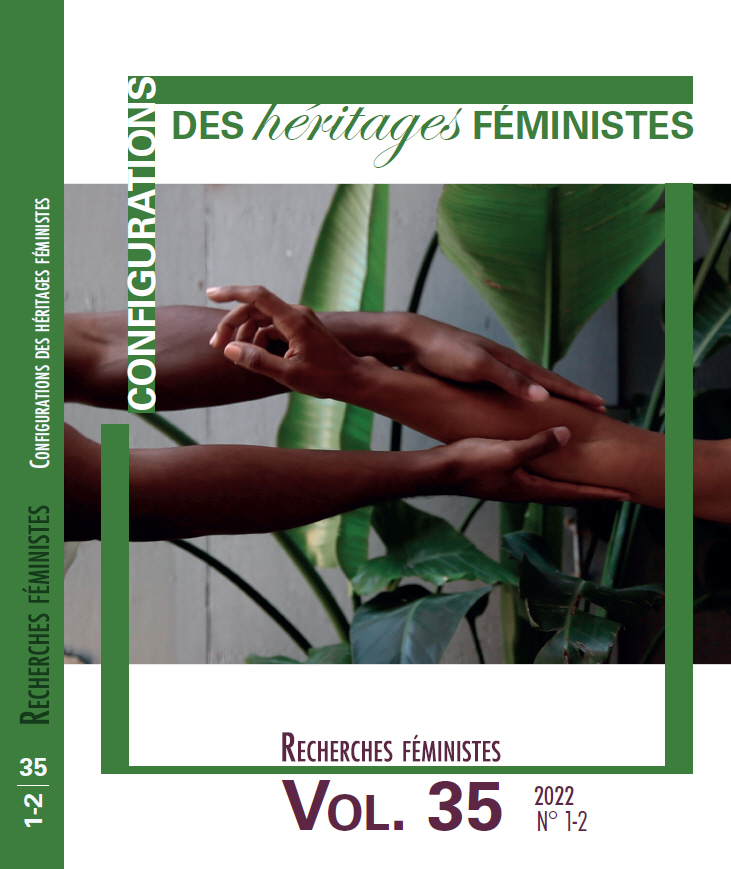Dans cet ouvrage, l’auteur relate les réalités de certaines femmes dont le commerce entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa constitue l’unique moyen de survie. Souhaitant répondre à la question de savoir si cette activité, importante pour l’économie urbaine, contribue à élever le niveau de vie de ces femmes, il s’est intéressé aux échanges qui se sont déroulés entre les deux villes de part et d’autre du fleuve Congo. Pour y répondre, il a interviewé des acteurs sociaux et des actrices sociales comme les femmes commerçantes, les douaniers et douanières ainsi que le personnel administratif du port Fima et des services de l’immigration. Il a principalement essayé de comprendre les réalités de ces femmes commerçantes à travers l’identification de leur activité et de leur statut social avec un accent particulier sur le petit commerce sans cependant l’isoler de l’ensemble. Cette analyse lui a permis, à travers l’identification de l’activité, autant d’en montrer les causes, l’organisation et le fonctionnement que de mieux appréhender ses effets sur l’économie urbaine. L’ouvrage, divisé en trois grandes parties (hormis l’introduction et la conclusion), positionne, dans un premier lieu, son sujet. L’auteur illustre tout particulièrement, pour reprendre Durkheim (1919), « les manières d’être, d’agir et de réagir » des femmes qui tiennent un petit commerce entre Brazzaville et Kinshasa. Il s’agit d’une activité informelle et précaire qui représente, chez certaines commerçantes, un tremplin avant d’apprendre un métier. Il se présente comme un moyen permettant à certaines d’entre elles d’épargner l’argent nécessaire pour se lancer ensuite dans l’apprentissage. Dans la deuxième partie, l’auteur présente le contexte dans lequel s’est réalisée son étude. Cet essayiste et romancier transporte ses lecteurs et lectrices en Afrique subsaharienne, dans les deux capitales les plus rapprochées du monde : Brazzaville, en République du Congo, et Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les deux villes sont séparées par le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l’Amazone. Long de 5 600 kilomètres, il prend sa source dans la région des Grands Lacs et se jette dans l’océan Atlantique. Bien que plusieurs aspects permettent de distinguer ces deux villes, tels que le développement économique, l’étendue du territoire, l’histoire coloniale et le nombre d’habitants, entre autres, ce sont pratiquement les mêmes peuples qui vivent de part et d’autre du fleuve Congo puisqu’ils parlent « à peu de choses près les mêmes langues » et ont à peu près les mêmes coutumes. Ce sont ces aspects qui facilitent les échanges commerciaux entre les deux villes. La troisième partie dresse principalement le portrait de femmes tenant un petit commerce entre Brazzaville et Kinshasa, les conditions dans lesquelles il se déroule ainsi que les motivations à le pratiquer. D’origine paysanne ou ouvrière, ces femmes sont, bien souvent, plutôt jeunes, âgées de 25 à 35 ans, et séparées, veuves, divorcées ou célibataires. Elles sont, dans la majorité des cas, peu scolarisées et mères d’enfants d’âge scolaire. Cette activité de commerce intéresse particulièrement les femmes qui souhaitent donner un nouvel élan à leur vie, avec un passé difficile, généralement caractérisé par des cas de divorce, de viol, de perte d’un ou de plusieurs êtres chers, entre autres. À partir de données issues de l’observation d’une journée typique d’une femme commerçante et d’entrevues individuelles, l’auteur tente, notamment, de faire réfléchir sur les conditions très difficiles dans lesquelles se déroule ce type d’activité. Ces femmes doivent tout d’abord remplir certaines conditions essentielles avant de commencer ce métier. La condition sine qua non est l’acquisition d’un capital de départ qui, généralement, provient d’une entraide parentale, mais il faut aussi remplir les formalités administratives, qui jouent un rôle prépondérant. …
Parties annexes
Références
- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, 2016 « Rapport sur le développement en Afrique 2015. Croissance, pauvreté et inégalités : lever les obstacles au développement durable », Groupe de la Banque africaine de développement, [En ligne], [www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ADR15_FR.pdf] (30 avril 2022).
- CANGUILHEM, Georges, 1966 Le normal et le pathologique. Paris, Presses universitaires de France.
- DE CERTEAU, Michel, 1990 L’invention du quotidien. Paris, Union générale.
- DURKHEIM, Émile, 1919 Les règles de la méthode sociologique. Paris, Éditions Félix Alcan.
- PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD), 2019 « Rapport sur le développement humain 2019. Au-delà des revenus, des moyennes et du temps présent : les inégalités de développement humain au xxie siècle », Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, [En ligne], [reliefweb.int/report/world/pr-sentation-rapport-sur-le-d-velop pement-humain-2019-au-del-des-revenus-des-moyennes] (30 avril 2022).