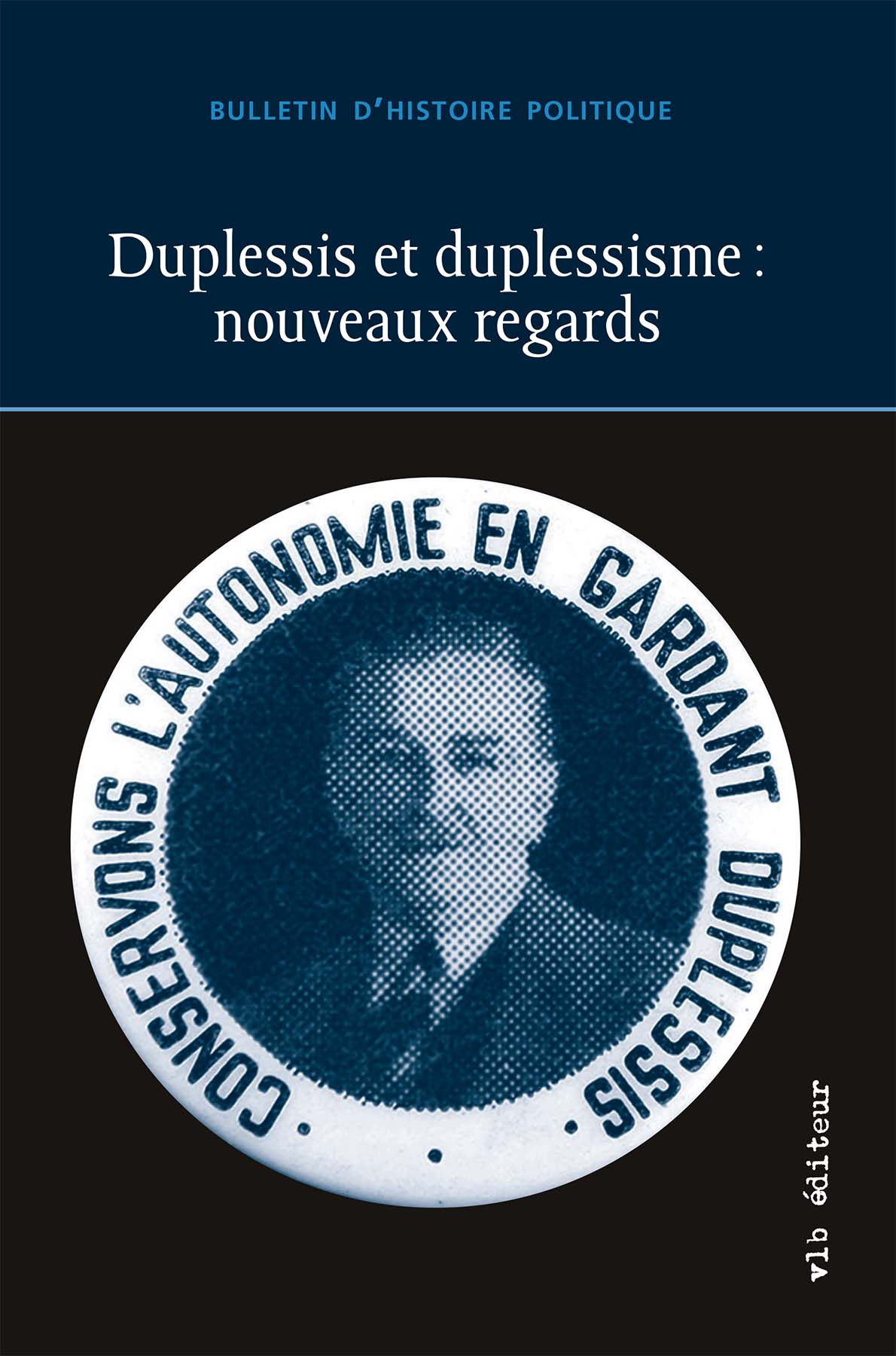Article body
Tremblante bravoure
W. Shakespeare, Jules César, acte V, scène 1, partie du vers 10
Les visages démasqués du courage
Ce sont 40 000 fiches de circonstances de décès de la Première Guerre qui sont consultables en ligne (quelques 15 000 fiches, des noms de famille commençant par « Si » jusqu’à « Z » inclusivement ont été perdues dans les transferts vers Ottawa). Quelques milliers de ces fiches sont plus informées, le plus souvent dans un style rappelant l’objectivité clinique. Mais si la mort instantanée rassurante – l’impression de Vera Brittain est justifiée – est fréquente sous la plume des rédacteurs et vraisemblablement dans les témoignages qui les ont inspirés, l’horreur voisine aussi, comme dans la description de la mort du soldat Kinnear : « il a été frappé par un fragment d’obus, la majeure partie de la tête étant pulvérisée, provoquant une mort instantanée[1] ». Aux curieux qui lisent les registres à la suite, rien n’est épargné, ou presque. Ainsi, Hector Labelle, soldat du 22e Bataillon canadien-français tué le 6 juin 1918, est mort à la 4e Ambulance de campagne de blessures causées par des shrapnels (billes de métal dispersées par un obus explosant au-dessus du sol) « perforant les globes oculaires, incisant le visage, la tête, les épaules, les mains, avec fracture complexe de la main droite[2] ». La confrontation de ce texte avec le dossier personnel[3] montre que l’inscription au registre est ici la transcription d’une fiche médicale. En quelque sorte, un travail de copiste. Mais ce n’est vrai que pour les morts de blessures traités par le système médical. Des témoins n’appartenant pas aux services de santé ont nécessairement contribué aux fiches, pour les soldats décédés avant d’atteindre un poste de secours, ou pour les disparus et les prisonniers de guerre (pour ceux-là, le Comité international de la Croix-Rouge est la source principale).
La pudeur d’exposer des blessures affreuses, sans être totalement absente, n’est pas de règle : les amputations traumatiques[4] et les éviscérations sont décrites ainsi que les blessures au visage ou au bas du ventre, à l’aine[5], avec quelquefois des références aux testicules[6], et, au moins une fois, à la section du pénis, ou encore les blessures mortelles à travers le postérieur ou les fesses[7]. L’impression générale est que l’autocensure ne prive pas le chercheur d’un accès à la brutalité de la guerre[8].
Dans le registre qui donne les circonstances du décès d’Hector Labelle, se trouve aussi la fiche de l’artilleur Trefflé Laboulière, travail « littéraire » plus sophistiqué :
Mort de blessures. Vers midi le 12e jour de septembre, il arrivait à Barlin de Passchendaele avec sa batterie. Elle venait de rejoindre sa place dans la file des wagons, la position étant soumise aux tirs des canons ennemis. Pendant que le canonnier Laboulière attendait son tour pour mener ses chevaux à l’abreuvoir, il a été frappé à la tête par l’éclat d’un obus ennemi qui a explosé à quinze verges de lui. Il a reçu les premiers soins et a ensuite été évacué jusqu’à ce qu’il se retrouve finalement à l’Hôpital général no 7 à Saint-Omer, où il est décédé cinq jours plus tard.
La dernière phrase n’a pu être tirée du dossier personnel, car ce dernier est muet sur ce qui s’est passé à l’abreuvoir[9]. Il a donc fallu recourir à des sources externes pour établir les circonstances, d’où la référence « 649-L-11937 ». C’est une classification alphanumérique de dossiers de correspondance ayant eu cours durant la Première Guerre mondiale, dont le premier membre est une indication de sujet (dossiers de correspondance relatifs aux soldats), le second réfère à la première lettre du nom de famille de l’individu concerné, tandis que le dernier chiffre est un numéro indiquant la séquence dans laquelle le dossier fut créé. Malheureusement, je n’ai pas réussi à retrouver les dossiers de correspondance commençant par « 649 ».
La mise en récit du courage a ceci de particulier que le temps du récit est moins celui des narrateurs que celui du héros où, pour emprunter libéralement à Ricoeur, le temps du récit s’efface devant le temps de l’action[10], ce même si les morts n’y parlent que grâce aux efforts des témoins, copistes, rédacteurs et dactylographes[11]. Toutefois, il y a indéniablement un rapport à l’action plus étroit dans une mise en récit comme la suivante, que dans un rapport des blessures. Ainsi, le caporal suppléant Kivell, déjà décoré pour bravoure de la Médaille militaire, est rapporté blessé avant d’être porté manquant et présumé mort. Si sa disparition n’a pas été élucidée, sa blessure a eu des témoins qui racontent ce qu’ils savent des derniers moments connus de Kivell, le 1er octobre 1918 : « Alors qu’il participait à une attaque sur Abancourt, durant un recul temporaire, on l’a entendu pousser des cris [« to cry out »] et on l’a vu tomber. Depuis, on n’a rien vu ni entendu à son sujet[12]. »
Vaillance militaire et courage ordinaire
Dans les exemples précédents, l’effort de mise en récit était faible ; on copiait surtout des faits cliniques. Ce n’est plus tout à fait le cas avec les récits d’actes de courage, certainement plusieurs centaines. Ils sont de deux types : une mort altruiste en secourant un blessé ou une mort glorieuse lors d’un acte de vaillance guerrière.
Du premier genre, les plus nombreux, citons le cas du sergent-major de compagnie John Parker Kirkpatrick, dont le comportement exemplaire est mis en récit de manière économique, en une seule phrase : « Il est mort du fait des tirs ennemis juste au nord de Pozières, alors qu’il portait un camarade blessé vers nos lignes[13]. » Autre exemple, le soldat John Lemon : « alors qu’il aidait à panser un blessé durant un bombardement intense de nos positions au Bois du Sanctuaire, a été tué instantanément par un obus ennemi qui a explosé près de lui dans la tranchée[14] ». Quant au soldat Cyril LeMesurier, il est mort de ses blessures : « le 20 novembre 1916, pendant son retour vers la tranchée Regina, le long de la route Pys-Miraumont, après avoir accompagné un blessé au poste de secours de Courcelette, a été sérieusement blessé au côté et au pouce par un éclat. Ses camarades lui ont prodigué les premiers soins, puis il a été porté vers un poste de secours et par la suite à la Station de triage no 49, où il est décédé le lendemain[15] ». Notons qu’en 14-18, on décorait rarement pour avoir sauvé un blessé[16].
La mort durant un acte de vaillance militaire, second genre, n’est pas non plus toujours récompensée par une décoration ou une citation à l’ordre du jour – assurément, la majorité des actes de courage ne font pas l’objet d’une récompense –, tel l’exemple suivant le 1er mai 1917, dans un village martyr près de la crête de Vimy :
Une section de canons antiaériens à Thélus était à l’ouvrage sous un intense feu des canons adverses, et a dû être reculée avec grandes difficultés avant d’être remise en action. Les munitions se faisant rares, le caporal Kirk et trois camarades se sont portés volontaires pour retourner à la position précédente, toujours bombardée avec intensité, pour en ramener. Pendant qu’il accomplissait cette vaillante tentative, il a été tué[17].
Lorsqu’ils font l’objet d’une récompense, on peut penser que la mise en récit est plus soignée, particulièrement dans le cas de décorés de la Croix de Victoria (Victoria Cross ou VC), ce afin d’éviter les contradictions entre les récits officiels. Parce que les registres semblent avoir été assemblés en 1919-1920, les rédacteurs avaient le loisir de comparer la citation officielle (toujours publiée dans le journal officiel de l’Empire britannique, la London Gazette) avec les pièces du dossier personnel et les témoignages réunis par correspondance. Or, l’examen des citations des deux seules Croix de Victoria québécoises francophones de 14-18 montre qu’elles ne furent pas l’objet de longs fignolages pour les faire correspondre à la citation du journal officiel.
Le caporal Joseph Kaeble et le lieutenant Jean Brillant ont tous deux été décorés de la VC de manière posthume pour des actes de bravoure survenus à l’été 1918 ; les deux citations sont parues rapidement dans la London Gazette de septembre 1918. Les compilateurs des registres avaient donc tout le loisir d’y référer. Il n’en fut rien. Au contraire, l’enflure des citations officielles disparaît presque entièrement dans la fiche rapportant les circonstances du décès de Kaeble et totalement dans celle de Brillant.
Citation pour la VC et circonstances du décès du caporal Joseph Kaeble, 22e Bataillon canadien-français[18]
On remarque que dans la citation officielle, Kaeble semble commander à plusieurs fusils-mitrailleurs Lewis, alors que dans le registre, il ne manoeuvre que son fusil (et par conséquent, ne commande que deux ou trois assistants). Le cri d’encouragement n’est pas un cas unique, on le verra, mais ici il a l’air d’un « dialogue » tiré d’une vignette de film muet. Évidemment, Kaeble, qui ne parlait peut-être pas l’anglais (il vient de Saint-Moïse et vivait avec sa mère à Sayabec au moment de l’enrôlement), et qui s’adressait à des compagnons francophones du 22e Bataillon canadien-français, n’a pas crié en anglais, même si le texte officiel est en anglais. Le texte du cri est donc attribuable à un rédacteur dont on ne sait s’il traduisait des propos véritables ou s’il les fabriquait. Le dossier personnel de Kaeble, mince, contient plusieurs copies de la citation officielle, ainsi que la mention du transport à l’ambulance de campagne britannique que l’on trouve au registre, celle-ci fidèlement copiée de l’un des états de service, mais rien sur l’origine du cri. On apprend aussi par le dossier que l’attribution de la Médaille militaire (pour un fait d’armes non précisé, mais antérieur à la VC) a été officiellement publiée dans le supplément de la London Gazette no 30940 du 7 octobre 1918, donc après la publication de sa citation pour la VC.
La citation officielle de Jean Brillant comporte des précisions qui, compte tenu des durs combats de la fin septembre, paraissent douteuses. Comme pour Brillant, elle se termine par le genre de langage attendu chez des hagiographes médiévaux ou les fabricants de message publicitaire du vingtième siècle, mais qui détonne comparé à l’ultra-laconisme du registre des circonstances de décès.
Le registre est si laconique que l’on ne sait que Brillant a reçu la Croix de Victoria que parce que dans la case d’identification du formulaire son nom est suivi de « V.C. ». La comparaison des deux textes est des plus instructives sur les ressorts de la fabrique de héros. L’exploit de Brillant est dans la citation contée en deux paragraphes correspondant aux deux journées de ses exploits, paragraphes précédés du chapeau obligatoire introduisant les citations et suivi, mais ceci n’est pas obligatoire, d’une leçon morale.
Les décorations comme la VC ou d’autres moins importantes et moins rares comme la MM, la MC, la DCM, etc. ne font pas le courage. Le processus par lequel on attribuait une Croix de Victoria plutôt qu’une Croix militaire n’est d’ailleurs pas un processus entièrement objectif. Des quotas par division (pour les MM et les MC en particulier) existaient et les comités chargés des recommandations étaient susceptibles aux préjugés et aux influences extérieures, parmi lesquelles la réputation d’un régiment (Gardes versus ligne, cavalerie versus infanterie) ou l’appartenance à une famille ayant rendu des services à la Couronne[19], etc.
Début de la citation officielle pour l’exploit ayant valu au lieutenant Jean Brillant (1890-1918) la Croix de Victoria à titre posthume. Les récipiendaires de la VC avaient droit à des numéros distincts du supplément de la London Gazette. Ce numéro-ci compte trois pages donnant les citations de neuf médaillés de la VC. C’est Jean Brillant qui a anglicisé son prénom (voir la signature au bas de l’attestation d’enrôlement dans son dossier personnel, BAC en ligne).
Citation pour la VC et circonstances du décès du lieutenant John Brillant, 22e Bataillon canadien-français[20]
La citation officielle de Brillant est de toute évidence une fabrication à destination édifiante ; le contraire aurait été étonnant. Mais de ce fait, elle ne représente pas le courage qui a vraiment animé la majorité des hommes, et a permis la prolongation de l’épreuve que fut la Grande Guerre, hommes qui resteraient plus ou moins anonymes sans un récit comme celui que procurent les fiches des registres de circonstances de décès. Cette compilation devient ainsi singulièrement significative, car c’est non seulement la source officielle qui représente le mieux le courage ordinaire durant une guerre où il ne fut par une rareté, mais en outre la seule qui permette une étude un tant soit peu systématique. Les faits de bravoure y sont sans masque, ils n’exposent pas la vanité suffisante de ceux qui se servent de leur autorité pour en faire accroire ; le courage n’y a besoin d’aucun spin médiatique ni d’aucune rhétorique moralisante.
Courage et mort sans gloire
Le cas de Frank W. Hinchcliffe pourrait rappeler l’exploit de Kaeble, si ce n’est que les dernières paroles de Hinchcliffe correspondent bien à l’idée que l’on se fait d’un sous-officier d’expérience expirant dans les bras du chef de bataillon. Né en Angleterre et âgé de 37 ans, Hinchcliffe a servi dans les Gordon Highlanders avant d’immigrer en Nouvelle-Écosse et de servir dans la Milice non permanente canadienne. Il est sergent-major régimentaire au 25e Bataillon d’infanterie (même division que le 22e Canadien-français) – c’est le rang le plus élevé pour un sous-officier de bataillon. Comme Kaeble, il est déjà détenteur de la Médaille militaire. Hinchcliffe est tué au combat le 9 avril 1917. « Durant l’assaut sur la Crête de Vimy, lit-on sur sa fiche[21], il est atteint par une balle à la poitrine juste après l’atteinte du premier objectif, et meurt quelques instants plus tard. Ses derniers mots au commandant de bataillon sont : “J’ai joué le jeu, Sir, n’est-ce pas ? ” »
Jouer le jeu du courage ? Celui du sous-officier exemplaire entraînant les hommes ? Le sergent-major régimentaire ne participait généralement pas à l’assaut en première vague ; il agissait plutôt en soutien au commandant de bataillon d’une position où l’on pouvait communiquer avec les compagnies à l’attaque. Ce qui semble être le cas ici, le PC avancé de bataillon s’installant sur le premier objectif, alors que les éléments avancés continuaient l’assaut vers les objectifs suivants.
L’exemple à donner aux hommes vient des gradés inférieurs, les caporaux comme Kaeble, les sergents comme Hinchcliffe et, chez les officiers, les lieutenants comme Jean Brillant. Il est difficile d’expliquer les responsabilités écrasantes d’un lieutenant, à peine plus âgé que les quarante hommes (un lieutenant canadien commande généralement à moins d’hommes qu’un lieutenant français ou allemand) dont il est le chef, et souvent plus jeune que le sergent qui l’assiste. Brillant avait 25 ans quand il reçut son brevet d’officier et 28 ans au moment de son décès. Le lieutenant Frank Lawson est également âgé de 28 ans au moment de sa mort en Belgique en avril 1916. Les circonstances sont connues à cause de témoins ayant assisté au drame, à n’en pas douter les hommes qu’il commandait, et qui sont venus au secours de leur chef :
Le 10 avril 1916, il était sur la ligne de front ayant la responsabilité de deux pelotons. Après la venue de l’obscurité, il s’est rendu devant la ligne pour retrouver le corps d’un homme tué la nuit précédente. À trois reprises, il a été blessé à la tête par le tir des fusils de l’ennemi. On l’a ramené rapidement, et après lui avoir prodigué les premiers soins, il a été conduit à la Section de triage no 10, où il est décédé à 3h30 A.M. le 12 avril 1916[22].
Ce récit, pas unique, doit être placé dans le contexte où des milliers de cadavres étaient abandonnés aux éléments du fait du grand danger à les récupérer. La règle ancienne (« Il serait peu raisonnable d’exposer/Des vivants pour sauver un mort », chant XVIII du Roland furieux) avait valeur universelle pour tous les combattants[23].
J’ai souvent fait allusion au laconisme et on peut dire que toutes les fiches de circonstances de décès ou presque sont laconiques. C’est du fait de ce laconisme que les rédacteurs des fiches approchent la « grande » littérature, tant l’éloquence économe – les « paroles frustes et directes » de ceux qui furent les héros écrivait Genevoix[24] – arrive à dire le courage dans des situations où la machine à décorer est inopérante.
Le destin du soldat George Henry Gage rappelle le héros de Stephen Crane, Henry Fleming, le volontaire de 18 ans qui, on l’a vu, s’était fait une idée livresque du courage, mais dès l’entraînement s’est demandé s’il serait un brave ou fuirait le combat[25]. Gage s’est trouvé dans la même situation. Né en 1896, enrôlé en janvier 1916 à dix-neuf ans, il débarque en France en août suivant. Il est alors victime de toute une série de maladies infantiles (rougeole, oreillons, impétigo) et d’une blessure anodine à l’oeil qui le tiennent à l’écart de son unité pendant une bonne partie de l’année. Ses petites malchances sont des chances diminuant l’exposition au risque des grandes batailles de Vimy, Lens et Passchendaele. C’est un bon fils qui sur sa solde de 31 $ verse 20 $ par mois à sa mère et obtient qu’elle reçoive l’allocation gouvernementale de séparation, une somme supplémentaire de 25 $[26].
Pendant l’hiver, le printemps et le début de l’été 1918, son bataillon est généralement hors de la ligne de feu, se préparant pour une contre-offensive qui aura lieu en août. En prévision du retour au front, les unités canadiennes reviennent s’acclimater en ligne, notamment en se livrant à l’une de leurs activités favorites, le raid de tranchées. C’est le cas du 102e Bataillon de Gage le 22 juillet :
Tué au combat. Avec son peloton, il est sorti la nuit du 22 au 23 juillet 1918 afin de participer à un raid entre Gavrelle et Oppy. Au point de rassemblement, il s’est plaint de violentes crampes. Parce qu’il était connu pour être un combattant très solide, qu’il serait le dernier à s’esquiver devant le danger, on l’a autorisé à faire demi-tour. Il s’est rapporté au PC de sa compagnie et a été examiné. Le jour d’après, il était manquant et on a cru qu’il avait été évacué à l’hôpital. Lorsqu’on s’est rendu compte qu’il avait disparu, des équipes de recherche sont sorties de nuit et le 29 juillet elles ont retrouvé son corps dans le « No Man’s Land » avec une balle dans la tête. On suppose que lorsqu’il s’est senti mieux, prenant conscience que la décision de laisser tomber le groupe de raid pouvait être mal comprise, il est retourné à l’attaque de son propre chef.
« Seul dans le no man’s land. Devant lui, la mort, derrière lui la honte », écrivait Curzio Malaparte des soldats italiens de 1917[27]. Le raid fit deux morts et treize blessés dans le 102e Bataillon (sans compter Gage) sur un effectif engagé d’une compagnie (150 hommes environ), contre quinze à vingt « Huns » tués et dix autres faits prisonniers[28].
Ce récit des dernières heures de Gage est d’autant plus intéressant qu’il est une rare occurrence dans laquelle la peur qui tourmente les entrailles est évoquée d’une manière directe. Contrairement aux écrivains, assez peu d’historiens ont osé y faire allusion, et Dennis Showalter, un spécialiste connu de l’Armée allemande de la Première Guerre mondiale, est l’un des rares à avoir écrit une page sur le sujet[29]. Du reste, comme Jünger l’a dit, « il est difficile d’être lâche sous le regard d’autrui[30] ».
Chez Lawson et encore plus chez Gage, il n’y a pas de cette sorte de vaillance rhétorique que l’on fabrique pour les récipiendaires des Croix de Victoria. Dans la réalité, le courage relève soit d’un sentiment de culpabilité (comme chez Conrad et Crane) – on ne laisse pas tomber les compagnons –, soit du sens de la responsabilité du chef direct qui se soucie de ses hommes dans la vie comme dans la mort, d’où la tentative quasi suicidaire du lieutenant Lawson mentionnée auparavant de récupérer le corps d’un malheureux tué du jour précédent, dont le corps est sans doute tout près, probablement visible à l’observation des camarades protégés par la tranchée. Le courage n’est pas ici un acte de témérité, mais un geste raisonné étalé dans le temps. Si le lieutenant prend des risques au point de se sacrifier pour la dépouille d’un mort, alors n’est-il pas un chef digne et courageux qu’il faut suivre, lui ou les autres hommes de la même trempe ? On compte sur le fait qu’il y a une sorte de contagion dans le courage comme dans la peur, non ?
Simples soldats, sous-officiers et officiers subalternes vivent ensemble et affrontent les mêmes dangers. Si les officiers supérieurs sont moins exposés, leurs responsabilités sont nettement plus grandes : un major peut avoir plus de 200 hommes sous son autorité, un lieutenant-colonel commandant un bataillon d’infanterie 1000, un général de brigade 3500, un major général commandant une division plus de 15 000. Peu supportent facilement le stress de voir détruire et devoir reconstruire leurs unités. Rappelons qu’un bataillon d’infanterie à l’effectif théorique de 1060 hommes a dû pour maintenir cet effectif recruter 5000 à 6000 hommes en tout durant la guerre si l’on se fie à l’étude séminale de Jean-Pierre Gagnon sur le 22e Bataillon canadien-français, la meilleure étude d’un bataillon d’infanterie canadien durant la Grande Guerre[31]. L’expérience aidant, les officiers savaient à quoi s’attendre en termes de ratio de pertes pour tel ou tel type d’opérations, mais le fait de prédire avec exactitude n’avait rien de rassurant et pouvait au contraire briser des officiers.
Les registres ne livrent pas toujours une information suffisante à eux seuls ; ils donnent pourtant des indices signalant les cas intéressants. On peut alors croiser l’information avec les dossiers personnels ou les journaux de guerre. Ainsi du cas du lieutenant Hudson[32], avec lequel on revient au sacrifice de l’officier chez qui la responsabilité est devenue obsessive comme dans le cas Lawson, mais dans une situation peut-être plus significative. Tout frais breveté, Hudson est un héros martial exemplaire : deux fois titulaire de la Médaille militaire (décembre 1916 et juillet 1917), une fois de la Distinguished Conduct Medal (avril 1918), blessé à la tête et aux yeux le 10 novembre 1917 dans les derniers jours de la bataille de Passchendaele. Ce chauffeur de machine à vapeur né en 1893 s’était enrôlé comme simple soldat en décembre 1914, avait été promu caporal en juillet 1916 et sergent en avril 1917. Il rentre de l’école d’officiers subalternes au 8e Bataillon le 22 septembre 1918 avec huit autres subalternes qui arrivent ce jour-là au bataillon. On est à l’avant-veille d’une bataille pour le Bois de Bourlon, lieu de sinistre réputation. Moins de 48 heures avant l’assaut, Hudson flanche et se suicide avec un fusil Lee-Enfield, une arme qui n’est plus la sienne depuis qu’il a été breveté officier (il devait posséder une arme de poing, revolver ou pistolet), mais évidemment l’arme avec laquelle il avait gagnée ses médailles précédentes, fusil qu’il a « emprunté » à un soldat juste avant de s’exploser la tête au petit matin du 26 septembre 1918. L’enquête sur la mort accidentelle a lieu le matin de la découverte du corps et les funérailles l’après-midi. Si la célérité procédurale est commune à l’époque – c’était une nécessité, les témoins pouvant disparaître du fait de leurs décès, de leurs hospitalisations, des permissions et des mutations –, on l’a sans doute accéléré, car une inspection par le général commandant la division était prévue l’après-midi, le général venant encourager le bataillon pour un assaut qui promettait d’être sanglant[33].
Outre le médecin livrant les constatations d’usage, le principal témoin de l’enquête est un autre subalterne tout juste sorti du rang, le lieutenant G.R. Gibson, MM[34] :
Je connaissais intimement le lieutenant C.A.H. Hudson depuis plus de deux ans. Nous avons fait le chemin depuis Boiry [cantonnement du bataillon avant la remontée en ligne] vers notre position actuelle dans la nuit du 25 courant. Juste avant de quitter le secteur de Boiry, j’ai eu une longue conversation avec le Lieut. Hudson, qui semblait être inquiet de ses responsabilités d’officier. Au cours de la conversation, il m’a dit que depuis sa blessure à la tête et aux yeux à Passchendaele en novembre, il était sujet à des blancs de mémoire et à des absences totales. Après la conversation il m’a paru normal et plutôt enjoué. À notre arrivée ici, j’ai passé ½ heure avec le Lieut. Hudson avant de nous coucher (nous avons le même bivouac). Il avait l’air parfaitement normal. […] À environ 7h30 A.M. je me suis réveillé et me suis rendu compte que le Lieut. Hudson n’était pas au bivouac. Cinq minutes plus tard, j’ai reçu l’ordre de me diriger vers le bois derrière le campement, où j’ai trouvé le corps du Lieut. Hudson au sol avec une partie de la tête explosée par une balle. Il avait des marques de brûlures par poudre sur le visage, surtout sous l’oeil gauche[35].
Le suicide d’un homme épuisé mentalement par une longue guerre et angoissé par de nouvelles responsabilités paraît difficilement être un acte de courage, mais quand cet individu a des états de service aussi brillants que ceux de Hudson, on est en droit de se demander si le courage n’est tout simplement pas de se lever une autre fois, un autre matin, la veille d’une autre bataille sanglante. Il se savait probablement incapable de conduire avec compétence des hommes dans un combat qui allait être difficile.
La mort du major Mantle met à nouveau en cause la responsabilité de chef. Les circonstances de la disparition de cet officier supérieur ne nous sont connues que par la fiche de circonstances de décès :
Alors qu’il commandait une compagnie tenant une portion de la ligne près du cimetière, au nord de Courcelette, le matin du 26 septembre 1916, l’un de ses avant-postes a été repoussé par l’ennemi. Il a fait rapport à son commandant, qui a reçu l’ordre du général de brigade de proposer un plan pour reprendre le terrain. Le major Mantle a été tué instantanément par une balle au coeur après son départ du PC de bataillon.
On remarque le hiatus séparant les deux premières phrases faisant le récit d’un problème tactique de la troisième exposant la mort subite du commandant de compagnie. Il faut savoir qu’après la prise de Courcelette à la mi-septembre 1916, les Canadiens allaient s’acharner à prendre la ligne de résistance suivante des Allemands, située dans un bas-fond ondulé, terrain gluant et bien défendu. Les Canadiens ayant la hauteur (le cimetière municipal en est la limite), les Allemands voulaient être le moins possible dans la situation d’une attaque surprise, et donc harcelaient les avant-postes canadiens. La possession de ceux-ci était chose difficile étant donné la position exposée, mais indispensable si on voulait continuer l’offensive commencée en juillet 1916. Mantle savait que pour quelques mètres de terrain, il perdrait des dizaines d’hommes. Dans la troisième phrase, il y a une omission : la provenance de la balle au coeur. En effet, généralement dans les fiches l’épithète « ennemie » précède ou suit les mots « balle » (ou « éclat d’obus »). Généralement. Il y a aussi que dans le journal de guerre du 28e Bataillon, auquel Mantle appartenait, l’attaque allemande est bien notée, mais la contre-attaque canadienne n’a pas lieu. La mort de Mantle, commandant de la compagnie « B » y est brièvement mentionnée[36]. Dans son dossier personnel, on apprend que Mantle était âgé de 34 ans, était fonctionnaire et officier de réserve avant-guerre, qu’il était marié et père de trois enfants et s’était enrôlé en août 1915. Il avait été propulsé capitaine puis major avant le départ outre-mer, donc sans aucune expérience de combat. En Angleterre en juillet 1916, il demande sa rétrogradation au grade de capitaine, sans doute pour obtenir rapidement une affectation au front, le CEC ayant en abondance des officiers inexpérimentés[37]. Cela réussit. Il est affecté au 28e Bataillon et retrouve rapidement son grade de major en Belgique, toujours sans avoir vu une grande bataille. Puis le CEC déménage de Belgique vers la Somme, où il est engagé les 14 et 15 septembre 1916.
J’aimerais croire que Mantle s’est suicidé devant la tâche impossible qui l’attendait, mais il n’a peut-être fait que céder à la peur, à moins qu’il fût tué par une balle perdue dans l’arrière-front du bataillon… Mais on l’aurait noté ! Sa mort a peut-être servi à l’annulation d’une attaque inutile, toutefois pas pour longtemps, car il fallut encore deux mois avant que les Canadiens renoncent à attaquer la position allemande suivante (c’est la bataille pour la tranchée de Regina, autre lieu à réputation sinistre).
Si l’on peut spéculer sur les circonstances du décès du major Mantle, il ne fait pas de doute que la mort du capitaine Howard, récent récipiendaire de la Croix militaire, est un suicide. Le récit de la mort de ce héros que l’on trouve dans sa fiche de circonstances de décès est presque entièrement factuel et vise à assurer du fait qu’il s’agit d’une mort « accidentelle » auto-infligée et non d’un meurtre ou d’une mort due à une négligence. Il est semblable aux rapports que font les autorités civiles sur les suicides dans la première moitié du XXe siècle. La cause, au sens où on pourrait l’entendre aujourd’hui, c’est-à-dire le ou les mobiles du geste, n’était que rarement l’objet de l’investigation. Si dans les conclusions se rencontraient de moins en moins la formule courante depuis le XIXe siècle d’un acte commis pendant un moment de folie, on n’offrait pas d’explications, sauf si une intention manifeste, comme avec une lettre de suicide, était retrouvée, et encore ! La fiche du capitaine Howard se lit ainsi :
Tué au combat. Mort vers 10 A.M. le 22 juillet 1917 dans son cantonnement de Barlin des suites d’une blessure par balle. L’enquête a déterminé qu’il a placé un revolver dans sa bouche, la balle pénétrant le palais, mais ne sortant pas de la tête. La cause du geste reste inconnue. Immédiatement après le coup de feu, plusieurs soldats et deux officiers sont accourus. Le pouls battait faiblement et il a expiré après quelques minutes[38].
Cependant, l’enquête militaire qui se trouve au dossier personnel de Howard est près de fournir un motif à cette mort volontaire. Le second de Howard et le médecin régimentaire témoignent que le capitaine ne se sentait pas bien la veille de son décès. Il avait demandé à voir le médecin. Howard parlait d’un malaise inopportun parce que son unité de mortier venait de recevoir l’ordre de faire mouvement vers le front : « il ne se sentait pas en forme pour continuer[39] », dit le médecin, qui l’examine et ne trouve rien de grave, mais prescrit une cure de repos d’une semaine. Il lui donne des somnifères en attendant. Howard aurait ensuite dit à son ordonnance de préparer ses bagages pour l’hôpital. L’ordonnance a alors remarqué que le revolver de l’officier n’était pas dans son étui. Au réveil le lendemain, le médecin est à nouveau appelé au chevet de Howard, arrivant à temps pour le voir expirer dans ses bras.
Les disparitions du lieutenant Hudson et du capitaine Howard, décorés pour bravoure, et par contraste celle du major Mantle, jamais décoré, montrent que le courage est une affaire complexe dans laquelle la personnalité est tourmentée par l’anticipation des événements à venir, tel le Jim de Conrad.
Le courage dans la sensibilité depuis 1916
L’examen des circonstances du décès des soldats, sous-officiers et officiers, qu’il soient considérés comme des hommes valeureux et décorés, ou qui, sans être décorés, perdent la vie du fait d’un acte que l’opinion publique estime courageux (secourir un blessé sous un bombardement, etc.) révèle une réalité prosaïque, loin des images d’Épinal de l’héroïsme. En cela, la culture administrative qui préside à l’élaboration des registres est tout à fait en phase avec la culture d’avant-garde littéraire.
On peut dire que les circonstances font tout : qui était un héros hier n’est plus bon à rien le lendemain ; qui toujours sans histoire, se révèle un jour courageux. Ce qui paraît en filigrane de bien des récits cités ici, c’est l’obscurité (la routine des tranchées implique l’action de nuit), le silence inquiétant ou son inverse, le bruit assourdissant des tirs, la fumée, la désorientation causée par la fragmentation du terrain. Dans l’analyse que Stephen Crane fait du courage, la « nature » même paisible (en l’occurrence la forêt dans laquelle Henry Fleming se réfugie après sa fuite) paraît dangereuse du fait de l’état d’excitation du jeune soldat : il s’empêtre dans les ronces, est frappé par branches et troncs, trébuche dans les inégalités du sol pour fuir la gueule ouverte du monstre qui le poursuit (voir aussi le traitement que fait Crane des bruits de l’artillerie aux chapitres 7 et 8 de L’insigne rouge de la bataille). C’est finalement une bonne nuit de sommeil sous la surveillance d’un camarade plein de sollicitude (fin du chapitre 13, début du chapitre 14) qui le remet d’aplomb. Le second jour de la bataille, sans avoir bien anticipé ce qui allait venir, il devient un héros, mais pas de la manière qu’il s’imaginait qu’il le deviendrait. De toute l’expérience, il sort plutôt navré, car malgré l’acte final de courage du second jour, il demeure honteux de sa fuite le premier jour. Ç’aurait pu être l’inverse, non ? « Enfin ses yeux semblèrent s’ouvrir différemment sur les choses. Il découvrit qu’il pouvait tourner ses regards en arrière, vers les cymbales et la grandiloquence de ces évangiles antérieurs, pour les voir tels qu’ils étaient. Il ressentit de la joie en découvrant qu’il les méprisait à présent[40]. »
*
La représentation du courage obtenue dans une source aussi parlante que les registres de circonstances de décès, croisés avec les informations complémentaires tirées des dossiers médicaux ou des enquêtes sur les accidents qu’on trouve dans les dossiers du personnel, et avec les journaux de campagne des unités, est aux antipodes de la fabrique de héros qui existe dans l’industrie de la citation pour bravoure des grandes décorations militaires comme la Croix de Victoria.
Il ne semble pas exagéré de dire que le livre à tendance pacifiste l’emporte après 1918 ; Vera Brittain, Virginia Woolf, E.M. Remarque n’en sont qu’un échantillon remarquable. Mais l’industrie du courage était déclinante dès la guerre, comme le montre la publication des récits de Barbusse et de Genevoix dès 1915-1916 ; le « démasquage » était en cours.
L’image du courage ne pouvait pas ne pas en être transformée par 14-18, la bravoure devenant en quelque sorte affaire d’endurance plus que de vaillance. Ce changement de sensibilité avait été anticipé fameusement dès le tournant du XXe siècle par des écrivains comme Joseph Conrad et Stephen Crane. Cet esprit se trouve aussi dans la source plus clinique à finalité administrative que nous avons analysée ici, source qui a été compilée dès l’Armistice entré en effet, source qui a le grand avantage de la représentativité et de l’équité entre les classes. L’effet cumulé de la lecture de quelques centaines de fiches contenues dans un seul registre prend moins de temps qu’Orages d’acier et est plus efficace pour qualifier le vrai courage, démasquer l’imposture. Ce n’est pas que le courage cessât d’exister, car sous le masque il a bien un visage ; mais sa mise en récit ne pouvait plus relever du genre des poncifs propres à une certaine littérature populaire, ou à la fabrique des citations pour bravoure.
Appendices
Notes
-
[*]
La première partie de ce texte a paru dans le numéro 29.2 du BHP (printemps 2021), p. 251-271.
-
[1]
Circonstances du décès du matricule 183802, Bibliothèque et Archives Canada, registre 202, image 67. Les morts instantanées sont généralement associées à des blessures à la tête (« a shell landed in front of him, blowing his head off », registre 200, image ; « his head was blown off », registre 202, image 381 ; « the top of his head being blown off », registre 201, image 123) ; au coeur (registre 201, images 125 et 661 ; registre 202, image 107) ou à la poitrine ; au polytraumatisme causé par une explosion (registre 201, image 799 pour des blessures de la tête aux jambes) ou par rafales de mitrailleuses ; enfin, à l’impact d’un obus sur la victime pulvérisée (registre 201, image 759 et registre 202, image 251), comme celle du soldat Kirk (registre 201, image 179) : « Whilst advancing with his Company in front of Marcelcave, an enemy shell exploded quite close to his platoon. After the explosion he could not be found, and it is presumed that he was blown to pieces. » Ou encore le registre 200, image 731 pour un corps déchiqueté par une explosion. Voir aussi la note précédente. La pulvérisation entraîne une déclaration de disparition modifiée en présomption de mort après un certain temps. Voir la section que Jay Winter consacre à ce problème dans Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre dans l’histoire culturelle de l’Europe, Paris, Armand Colin, 2006 [1995], p. 50-53. Les enquêtes citées par Winter avaient été conduites par le CICR.
-
[2]
BAC, registre no 203, image 17. La liste des blessures arrachant ou défonçant partie ou totalité de la face serait longue, mais ce genre de blessures suscite un malaise évident chez les informateurs et les compilateurs des registres, comme ici : « He was found dead about fifteen yards behind the Battalion’s objective at Vimy Ridge, apparently killed by shock or a bullet, as he was not disfigured at all » (à propos du matricule 174315, registre 201, image 705). Autres exemples dans ce même registre 201, image 875, et dans le registre 202, image 13 : « hit with shrapnel through the nose ».
-
[3]
BAC, Dossiers du personnel militaire de la Première Guerre mondiale en ligne, dossier du matricule 847910. Ce dossier nous apprend aussi que le soldat Labelle est né en 1895, est originaire de Sainte-Rose-du-Nord, était charpentier avant de s’enrôler en août 1916 et était plutôt indiscipliné.
-
[4]
« [H]e had both legs blown off by the explosion of an enemy shell, and died shortly afterwards », BAC, registre 202, image 759 ; « both his legs were blown off », registre 205, image 623 ; autre cas, même registre, image 703.
-
[5]
Par exemple, BAC, registre 202, image 385, registre 203, image 859, et registre 204, images 585 et 591.
-
[6]
Mentionnées plus souvent que l’euphémisme « he was wounded in the legs and other parts of the body », BAC, registre 200, image 719.
-
[7]
Pour le postérieur, BAC, registre 201, image 527; registre 202, images 21 et 273, etc. J’ai lu les fiches de circonstances de décès sur une décennie et n’ai pas noté toutes les occurrences dont je parle ici. Tous les types de blessures se retrouvent dans Lucien Laby, Les carnets de l’aspirant Laby, médecin dans les tranchées, 28 juillet 1914 – 14 juillet 1919, avant-propos de Stéphane Audoin-Rouzeau, Paris, Hachette Littératures, 2003 [2001], 359 p.
-
[8]
Le problème des corps démembrés et dispersés concerne tous les belligérants. Voir François Cochet, La Grande Guerre, fin d’un monde, début d’un siècle, Paris, Éditions Perrin, 2014 p. 326-328. Encore ici, Zola anticipe sur les écrivains du XXe siècle en multipliant les mentions (chacune brève cependant) de membres fracassés, de têtes arrachées, de blessés du ventre, de scènes d’amputation à l’ambulance de campagne, ce à partir du chapitre II de la 2e partie de La Débâcle, éd. commentée et augmentée de documents, Paris, Pocket, 1993, p. 240, 302, 304-305, 325 et suiv. (le chirurgien découragé au travail), 322, 326 et 330 (amputations en 35 secondes!), 333, 345 (entrailles), 354, et plus loin sur les cadavres mutilés restés sur le champ de bataille (p. 399-400 et 407)). Ces blessures sont, comme chez les écrivains de 14-18, surtout dues aux effets de l’artillerie. Malgré tout, les descriptions de Zola n’ont rien à voir avec celles de Genevoix, qui est allé bien plus loin dans la communication de l’horreur, usant parfois de la métaphore de viande humaine (« Sous ma main qui vient de glisser, quelque chose roule, élastique et froid, un peu poisseux; je regarde de près l’aspect réel de la viande d’homme; on ne pourrait la reconnaître à rien, si l’on ne savait que “ça en est”. ») ou un corps humain éventré au corps « d’un bétail sur l’éventaire d’un boucher » (Ceux de 14, Paris, Éditions du Seuil, 2005, p. 654 et 688 respectivement). Joanna Bourke (Dismembering the male: men’s bodies, Britain and the Great War, Chicago, University of Chicago Press, 1996, 366 p.) parle d’une sensibilité aux mutilés de guerre moins farouches qu’on pourrait le croire.
-
[9]
BAC, dossier personnel du matricule no 97. Cet artilleur non gradé était instruit : il a passé six ans au Séminaire de Chicoutimi pendant lesquelles, membre du corps institutionnel de cadets, il a fait de la drill.
-
[10]
Paul Ricoeur, Temps et récit 2. La configuration dans le récit de fiction, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points/Essais », 2005 [1984], p. 121. Ricoeur raisonne sur des textes de fiction, dont Mrs. Dalloway.
-
[11]
Les armées ont longtemps employé dans la fonction des hommes en uniforme (cas britannique évoqué par Frederic Manning, Nous étions des hommes, Paris, Éditions Phébus, 2002 [1929], p. 79 et suiv.). C’est l’accroissement de la pression bureaucratique et le désir d’envoyer les hommes au front qui ont créé des brèches dans cette partie de l’univers masculin des armées. On ne sait rien du sexe des dactylos des fiches, mais ceux ou celles-ci pratiquaient l’initialisation dans le coin inférieur gauche du formulaire (voir les illustrations).
-
[12]
Circonstances du décès du matricule 871125 in BAC, registre 202, image 379.
-
[13]
Décès du matricule 110300 le 15 septembre 1916, BAC, registre 202, image 263. Dans ces exemples, il ne s’agit pas de brancardiers, mais de compagnons. Le mot « camarade », comrade dans les originaux, revient sans cesse dans les récits comme pour accentuer la fraternité des armes et l’esprit altruiste.
-
[14]
Décès du matricule 113354 le 2 juin 1916, BAC, registre 205, image 771.
-
[15]
Décès du matricule 129424 le 21 novembre 1916, BAC, registre 205, image 733.
-
[16]
Il semble que ce soit le résultat d’une prodigalité de décorations de ce type durant la Guerre sud-africaine (1899-1902). Des instructions à l’effet de ne pas donner de VC pour ce genre d’actes de courage ont été renouvelées en 14-18 par Douglas Haig, le commandant du groupe d’armées britanniques dans lequel s’insérait le CEC. Voir Hugh A. Halliday, Valour Reconsidered : Inquiries into the Victoria Cross and Other Awards for Extreme Bravery, Toronto, Robin Brass Studio, 2006, p. 26.
-
[17]
Mort du matricule 43531, caporal Samuel Kirk, registre 202, image 203.
-
[18]
On trouve cette traduction du texte officiel britannique sur le site Internet de la Direction Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale : http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/gal/vcg-gcv/bio/kaeble-jt-fra.asp. Le raid a fait l’objet d’un rapport spécial par le major Landry qui se trouve en annexe du Journal de guerre du bataillon pour le mois de juin 1918 (BAC, en ligne). Voici comment y est décrit l’exploit de Kaeble à l’alinéa 2 b : « A few men of the attacking party [les Allemands] managed to reach our parapet but were immediately repulsed by the aid of Lewis Guns and bombing. 889958 Cpl. Kaeble J. was i/c Lewis Gun section at this point and was instrumental to large extent repulsing attempted raid by enemy. Although severely wounded he continue to fire his Lewis Gun until he fell into the trench exhausted, suffering from compound fractures of both legs. At this point fierce fighting with bayonets took place. » Ce rapport fait état de quatre morts (Kaeble inclus), trente-neuf blessés et deux manquants.
-
[19]
Même source que pour Kaeble. Le journal de guerre du 22e Bataillon de septembre 1918 (BAC, en ligne) est muet sur l’exploit. La carrière de Jean Brillant, frère de l’homme d’affaires connu Jules-A. Brillant, a été célébrée immédiatement après la guerre, mais est tombée dans l’oubli presque total depuis. Voir maintenant Luc Bertrand, Le dernier assaut : la vie du lieutenant Jean Brillant, VC, MC, Québec, Les éditions du Septentrion, 2020, 240 p. La citation traduite pour la VC se trouve aux pages 177-178 de cet ouvrage, celle pour la MC aux pages 175-176. On comparera aux récits parus dans la presse de l’époque que l’on trouve aussi dans cet ouvrage bien fait, p. 171, 179-180 et 186-187. Manquant de matériel – les Brillant ont laissé peu d’archives malgré leur notoriété –, Bertrand se sert de toute la littérature possible. Il en arrive ainsi à parler de Kaeble (p. 146 par exemple) et de mentionner Genevoix (p. 170).
-
[20]
Pour une histoire critique du processus d’attribution des décorations pour vaillance et spécialement de la Croix de Victoria, de la variabilité des critères de sélection et de l’inconstance des comités, voir H. A. Halliday, op. cit., chap. 1, 2 et 4.
-
[21]
BAC, registre 192, image 783, fiche du matricule 67863.
-
[22]
BAC, registre 204, image 555, pour les circonstances du décès ; dossier personnel pour l’âge.
-
[23]
On la trouve avec cette traduction de deux vers de l’Arioste dans Emilio Lussu, Les Hommes contre, roman traduit de l’italien par Emmanuelle Genevoix et Josette Monfort, Paris, Éditions Denoël, 2005 [1938], p. 198. Lussu y raconte de manière romancée une année (juin 1916 à juin 1917) de sa guerre sur le front des Alpes. Pour rassurer sa femme inquiète, H. Barbusse note que même pour un brancardier – il l’a été un temps en 1915 –, il était interdit d’aller chercher un blessé dans le no man’s land (Henri Barbusse, Lettres à sa femme 1914-1917, Paris, Buchet-Chastel, 2006, p. 194).
-
[24]
Maurice Genevoix, Ceux de 14, op. cit., p. 66.
-
[25]
Stephen Crane, L’insigne rouge du courage, nouv. trad. de Pierre Bondil et Johanne Le Ray, Paris, Éditions Gallmeister 2019, p. 23-27.
-
[26]
BAC, dossier personnel du matricule 703290.
-
[27]
Traduction de la citation dans Antoine Compagnon et Yuki Murakami, La Grande Guerre des écrivains, d’Apollinaire à Zweig, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », 2014, p. 434. On trouve difficilement le texte intégral : Curzio Malaparte (Curt Erich Suckert) Viva Caporetto !, éd. de Stéphanie Laporte, Paris, Les Belles lettres, coll. « Mémoires de Guerre », 2012 [éd. orig. italienne 1921], 130 p. Il s’agit d’un essai écrit par un jeune Malaparte, qui n’avait pas encore adopté son nom d’écrivain. Il y exalte le « sacrifice » – le mot apparaît des centaines de fois – du « peuple des soldats », du « peuple des tranchées » ou du « peuple des mourants », appelant à une révolution dont le modèle, avant l’arrivée au pouvoir de Mussolini, est la révolution bolchévique. On y trouve des descriptions crues, mais, comme ce sera presque toujours le cas chez Malaparte, il est difficile de faire la part d’exagération ou de dramatisation.
-
[28]
Voir le Journal de guerre du 102e Bataillon pour juillet 1918, BAC en ligne, pour un rapport détaillé sur le raid et les activités du bataillon durant ce mois. « Huns » apparaît aussi souvent dans les sources britanniques et canadiennes-anglaises que « Boches » dans les sources françaises.
-
[29]
Dennis Showalter, Instrument of war : the German Army 1914-18, Oxford, Osprey Publishing, 2016, p. 172. Genevoix note l’envie d’uriner à de mauvais moments (Ceux de 14, op. cit., p. 33 et 525). Zola écrivait : « il n’avait pas encore peur, car il ne se croyait pas en danger ; et il n’éprouvait, à l’épigastre, qu’une sensation de douleur, tandis que sa tête se vidait, incapable de lier deux idées l’une à l’autre » (La Débâcle, éd. citée, p. 239).
-
[30]
Ernst Jünger, Sturm, dans Journaux de guerre I. 1914-1918, éd. de Julien Hervier, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2008 [éd. orig. 1923], p. 54.
-
[31]
Jean-Pierre Gagnon, Le 22e bataillon (canadien-français) 1914-1919 : étude socio-militaire, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1986, p. 11. Il donne 5 584 hommes en tout, mais j’ai des raisons de penser que quelques dizaines ayant servi peu de temps au bataillon ont pu être oubliées.
-
[32]
Fiche dans le registre 194, image 769. Cette fiche donne un résumé fidèle de l’enquête sur le suicide en dépit du fait que le titre en rubrique se lit « Killed (Accidentally) ».
-
[33]
Information sur les états de service de Hudson dans son dossier personnel en ligne (BAC), où se trouve également un exemplaire de l’enquête sur le suicide ; information sur l’arrivée des subalternes au bataillon, sur l’inspection de l’après-midi et sur la participation à la bataille du Bois de Bourlon dans BAC, Journal de guerre en ligne du 8 th Canadian Infantry Battalion, septembre 1918.
-
[34]
BAC, dossier personnel de George Robertson Gibson pour sa Médaille militaire.
-
[35]
BAC, dossier personnel du lieutenant Cecil Hudson, enquête sur son décès, p. 2.
-
[36]
BAC, journal de guerre du 28 th Canadian Infantry Battalion, septembre 1916.
-
[37]
Il y avait un débat à ce sujet à l’intérieur du CEC : devait-on appeler en renfort des volontaires promus officiers à cause de leur bonne éducation, comme Brillant, ou devait-on donner des promotions à des sous-officiers expérimentés, comme Hudson ? Après la Somme, c’est la seconde approche qui prévalut. Les officiers arrivants du Canada durent suivre des cours de tactique élémentaire et accepter des postes subalternes ou rentrer au pays. Le dilemme est longuement exposé dans Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps II : le volontaire, Montréal, Éditions Fides, 2001, p. 41, 68-70 et 83 à 93.
-
[38]
BAC, registre 194, image 463.
-
[39]
BAC, dossier personnel de William Jesse Edward Howard, MC, enquête tenue le 22 juillet 1917, feuillet no 3, témoignage du médecin.
-
[40]
Stephen Crane, op. cit., p. 204-205. C’est l’avant-dernière page du chapitre 24 et final.
List of figures
Début de la citation officielle pour l’exploit ayant valu au lieutenant Jean Brillant (1890-1918) la Croix de Victoria à titre posthume. Les récipiendaires de la VC avaient droit à des numéros distincts du supplément de la London Gazette. Ce numéro-ci compte trois pages donnant les citations de neuf médaillés de la VC. C’est Jean Brillant qui a anglicisé son prénom (voir la signature au bas de l’attestation d’enrôlement dans son dossier personnel, BAC en ligne).
List of tables
Citation pour la VC et circonstances du décès du caporal Joseph Kaeble, 22e Bataillon canadien-français[18]
Citation pour la VC et circonstances du décès du lieutenant John Brillant, 22e Bataillon canadien-français[20]