Cela fait quinze ans déjà que la revue Etudes Inuit Studies a publié son dernier numéro entièrement consacré à la région de Tchoukotka et à ses habitants. Si l’on peut voir la Tchoukotka en partie comme une « région marginale du monde inuit », comme le disait Yvon Csonka, rédacteur invité de ce précédent numéro, on ne peut cependant pas nier la nécessité de saisir les dynamiques qui s’y produisent pour une meilleure compréhension du monde eskaléoute mais aussi plus largement de l’Arctique, autochtone ou non. Depuis le dernier numéro thématique consacré à la Tchoukotka, de nombreuses études anthropologiques, historiques, archéologiques et linguistiques ont été publiées sur la région. La Tchoukotka n’a cessé de changer, tout comme la vie quotidienne de la population autochtone. Marquée par une densité démographique faible (moins de 50 000 habitants pour un territoire d’environ 720 000 km2 – une superficie équivalant à environ une fois et demie l’Etat du Yukon), la Tchoukotka regroupe une grande diversité de population. Les Autochtones y sont minoritaires (ils représentent aujourd’hui environ 25 à 30 % de la population totale), mais leur proportion a augmenté par rapport à la fin de la période soviétique. En effet, au cours des années 1990, une grande partie des Allochtones a quitté la région ne trouvant plus les privilèges salariaux accordés à ceux vivant dans le nord (en russe, severnye nadbavki) suffisamment intéressants face aux difficultés économiques de la période post-soviétique, aux conséquences particulièrement prégnantes dans la région. D’autres mobilités ont été induites par la fermeture de certaines agglomérations considérées non rentables comme Iul’tin en 1995 (district d’Iul’tin), Ureliki en 2000 (district de Providenia) ou encore Šahtërskij en 2008 (district d’Anadyr). Ce mouvement général de la période post-soviétique a conduit une partie des autochtones à quitter les villages pour les centres urbains où s’était libérés des logements à la suite du départ de certains allochtones et où la « qualité de vie » semblait meilleure, présentant un bassin de l’emploi plus vaste, de meilleurs salaires, des produits de meilleure qualité, des meilleures écoles et un meilleur accès aux activités culturelles pour les enfants, etc. Dans les années 2000, de nouveaux habitants sont venus de Russie centrale (appelée localement « le continent », materik), en particulier des Républiques de la Volga (Kalmoukie et République des Maris). Ils occupent des postes de gardes-frontières, médecins, enseignants et directeurs d’école. Leur venue a permis de stabiliser la situation démographique de la région sans pour autant entrainer une croissance véritable de la population. Si les villages sont en général à majorité autochtone, ils témoignent également d’une grande diversité. La définition des assignations identitaires peut être sujette à débat, mais quelques données chiffrées, aussi imprécises soient-elles, offrent un aperçu des différentes communautés qui se dessinent : du côté des autochtones, d’après le recensement de 2010, les Tchouktches, qui ont donné leur nom à la région, sont environ 12 800, les Yupik environ 1500, les Evènes 1400 et les Tchouvantses 900. Selon la même source, les populations dites Allochtones sont à majorité des Russes (près de 25 000) ; on y rencontre aussi des Ukrainiens (près de 2900), mais aussi des représentants d’autres nationalités, moins nombreux tels que des Tatars (451), des Azerbaïdjanais (107), des Arméniens (105), des Ouzbeks (79) et des Kazakhs (70). L’attention de ce numéro est portée surtout aux Autochtones, à la fois du fait des intérêts de la revue, mais aussi parce qu’ils sont davantage au coeur des recherches existantes. Située à l’extrême nord-est de la Russie, la Tchoukotka établit un pont entre l’Asie et l’Amérique : si elle fait géographiquement partie de l’espace …
Appendices
Références
- Ajnana L., V. Leont’ev, T. Tein, et L. Bogoslovskaja, 2007. « Tradicionnaja pišča aziatskih èskimosov i beregovyh čukčej » [Alimentation traditionnelle des Eskimos asiatiques et des Tchouktches de la côte], In Bogoslovskaja L., Slugin I., Zagrebin I., Krupnik I. (dir.), Osnovy morskogo zverobojnogo promysla [Fondements de la chasse marine], p. 390-398. Moscou, Anadyr, Institut Nasledija.
- Bogoras, Waldemar, 1904-09 The Chukchee. Vol. XI of Memoirs of the American Museum of Natural History. Réédition du Vol. VII de Franz Boas (dir.), The Jesup North Pacific Expedition, Leiden, E. J. Brill. New York, G. E. Stechert and Co.
- Bogoras, Waldemar, 1910 Chukchee Mythology. Vol. XII of Memoirs of the American Museum of Natural History. Réédition du Vol. VIII de Franz Boas (dir.), The Jesup North Pacific Expedition, Leiden : E. J. Brill. New York : G. E. Stechert and Co.
- Bogoslovskaja, L.S., 2003 Kity Čukotki. Posobie dlja morskih ohotnikov [Les baleines de Tchoukotka. Guide pour les chasseurs marins]. Moscou, Institut Nasledija.
- Bogoslovskaja L., V. KRIVOŠËKOV et I. Krupnik (dir.), 2008 Tropoju Bogoraza [Sur le chemin de Bogoraz]. Moscou, Institut Nasledija.
- Bogoslovskaja, L. et I. I. Krupnik (dir.), 2013 Naši lʹdy, snega i vetry : narodnye i naučnye znanija o ledovyh landšaftah i klimate Vostočnoj Čukotki [Nos glaces, nos neiges et nos vents : Savoirs traditionnels et scientifiques sur les paysages de glace et le climat de l’est de la Tchoukotka]. Moscou, Washington, Institut Nasledija.
- Bogoslovskaja L., Slugin I., Zagrebin I., Krupnik I. (dir.), 2007 Osnovy morskogo zverobojnogo promysla [Fondements de la chasse marine]. Moscou, Anadyr, Institut Nasledija.
- Chichlo, Boris, 1981 « Les Nevuqaghmiit, ou la fin d’une ethnie », Etudes Inuit Studies 5 (2) : 29-47.
- Chichlo, Boris, 2008 “L’ethnographie en ‘zone interdite’ », La revue pour l’histoire du CNRS [en ligne], 20 : 8. Consulté le 20 mai 2021, http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/ 6192.
- Chichlo, Boris (dir.), 1993 Sibérie III : questions sibériennes. Les peuples du Kamtchatka et de la Tchoukotka. Paris, Institut d’études slaves.
- Členov, Mihail A., 1980 Perspektivy social’novo i èkonomičeskogo razvitija èskimosov Čukotki [Perspectives de développement social et économique des Eskimos de Tchoukotka]. In Collectif. Kompleksnoe èkonomicheskoe i social’noe razvitie Magadanskoj oblasti v bližajshej i dolgosročnoj perspektive. Tezisy k konferencii [Développement économique et social de l’oblast de Magadan à court et à long terme. Résumés pour la conférence], p. 105-107. Magadan, Magadanskij obkom KPSS.
- Členov, Mihail A., 1981 « Kit v folklore i mifologii aziatskih èskimosov [La baleine dans le folklore et la mythologie des Eskimos d’Asie] ». In I. S. Gurvič (dir.). Tradicionnye kultury Severnoj Sibiri i Severnoj Ameriki, p. 228-244. Moscou, Nauka.
- Členov, Mihail A., 1988 Ekologičeskie faktory etničeskoj istorii rajona Beringova proliva [Facteurs écologiques de l’histoire ethnique de la région du détroit de Béring]. In V. Tiškov (dir.) Ekologija amerikanskih indeicev i èskimosov. Problemy indeanistiki [Ecologie des Indiens d’Amérique et des Eskimos. Problèmes d’indianistique], p. 64-75. Moscou, Nauka.
- Csonka, Yvon, 1998 « La Tchoukotka : Une illustration de la question autochtone en Russie », Recherches amérindiennes au Québec XXVIII (1) : 23-41.
- Csonka, Yvon, 2007 « Le peuple Yupik et ses voisins en Tchoukotka : Huit décennies de changements accélérés », Etudes Inuit Studies 31 (1-2) : 7-22.
- Davydov, V.N., Davydova E.A., 2021 « Proekty razvitija infrastruktury na Čukotke : ispolʹzovanie resursov žiteljami nacionalʹnyh sel »[« Projets de développement des infrastructures en Tchoukotka : Utilisation des ressources par les habitants des villages autochtones »], Ètnografija [Ethnographie] 1 (11) : 25-49.
- Davydova, E.A., 2019 « Holodilʹnik, solʹ i sahar : dobyča i tehnologii obrabotki pišči na Čukotke » [« Réfrigérateur, sel et sucre : Extraction de nourriture et technologies de la transformation alimentaire en Tchoukotka »], Sibirskie istoričeskie issledovanija [Recherches historiques sibériennes] 2 : 143-161.
- Diatchkova, Galina, 2005 « Models of Ethnic Adaptation to the Natural and Social Environment in the Russian North ». In E. Kasten (dir.), Rebuilding Identities : Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia, p. 217-235. Berlin, Dietrich Reimer Verlag.
- Dudarev, Alexei, Yamin-Pasternak, Sveta, Pasternak, Igor et Valery Chupakhin, 2019(a) « Traditional Diet and Environmental Contaminants in Coastal Chukotka I : Study design and dietary patterns », International Journal of Environmental Research and Public Health 16 : 702. doi : 10.3390/ijerph16050702.
- Dudarev, Alexei, Yamin-Pasternak, Sveta, Pasternak, Igor et Valery Chupakhin, 2019(b) « Traditional diet and environmental contaminants in coastal Chukotka II : legacy POP », International Journal of Environmental Research and Public Health 16 : 695.
- Dudarev, Alexei, Yamin-Pasternak, Sveta, Pasternak, Igor et Valery Chupakhin, 2019(c) « Traditional Diet and Environmental Contaminants in Coastal Chukotka III : Metals. International », International Journal of Environmental Research and Public Health 16 : 699.
- Dudarev, Alexei, Yamin-Pasternak, Sveta, Pasternak, Igor et Valery Chupakhin, 2019(d) « Traditional Diet and Environmental Contaminants in Coastal Chukotka IV : Recommended intake criteria », International Journal of Environmental Research and Public Health 16 : 692
- Dunn, Michael, 1999 A Grammar of Chukchi. Thèse de Doctorat. Australian National University.
- Fitzhugh, William W., et Aron Crowell (dir.), 1988 Crossroads of Continents : Cultures of Siberia and Alaska. Washington, D. C., Smithsonian Institution Press.
- Golbceva V.V., 2017 « Prazdničnye i žertvennye bljuda u čukčej i èskimosov » [« Repas festifs et sacrificiels des Tchouktches et des Eskimos »]. In Golbceva V.V., Prazdničnaja i obrjadovaja pišča narodov mira [« Nourriture festive et rituelle des peuples du monde »], p. 249-270. Moscou, Nauka.
- Golbtseva, V.V. [Golbceva V.V.], 2008 « The Thanksgiving Ceremony “Mn’in” ». In V. V. Obukhov (dir.), Beringia – A Bridge of Friendship. Materials of the International Scientific and Practical Conference, pp. 42-51. Tomsk, Tomsk State University, Pedagogical University Press.
- Gray, Patty, 2000 « Chukotkan Reindeer Husbandry in the Post-socialist Transition », Polar Research 19 (1) : 31-37.
- Gray, Patty, 2005 The Predicament of Chukotka’s Indigenous Movement : Post-Soviet Activism in the Russian Far North. Cambridge, Cambridge University Press.
- Gray, Patty, 2012 “I should have some deer, but I don’t remember how many” : Confused Ownership of Reindeer in Chukotka, Russia. In A. Khazanov and G. Schlee (dir..), Who owns the Stock ? Collective and Multiple Property Rights in Animals, p. 27-43. New York and Oxford, Berghahn Books.
- Gray, Patty, sous presse « Exiled from Siberia : Fieldwork conditions in Chukotka in the 1990s ». In V. Vaté et O. Habeck O. (dir.), Anthropology of Siberia in the 19th and 20th Centuries, Halle Studies in Anthropology of Eurasia.
- Gray, Patty, Nikolai Vakhtin, et Peter Schweitzer, 2003 « Who Owns Siberian Ethnography ? A Critical Assessment of a Re-internationalized Field » Sibirica 3 (2) : 194-216.
- Grej, Pètti [Gray Patty], 2021 « O vkuse hleba my uže zabyli ». Obespečenie čukotskogo sela v postsovetskij period” [« Nous avons déjà oublié le goût du pain ». Approvisionnement des villages tchouktches dans la période post-soviétique], Sibirskie istoričeskie issledovanija [Recherches historiques sibériennes] 4 : 21-36.
- Holzlehner, T., 2011 « Engineering Socialism : A History of Village Relocations in Chukotka, Russia ». In S.D. Brunn (dir.), Engineering Earth : The Impacts of Mega-engineering Projects, p.1957-1973. Dordrecht, Netherlands : Springer Science + Business Media
- Ikeya, Kazunobu (dir.), 2003 Chukotka Studies No. 1 : Reindeer Pastoralism among the Chukchi. Osaka, Chukotka Studies Committee.
- Ikeya, Kazunobu et Elliot Fratkin, 2005 « Introduction : Pastoralists and their Neighbors – Perspectives from Asia and Africa ». In K. Ikeya and E. Fratkin (dir.), Pastoralists and their Neighbors in Asia and Africa, p. 1-14. Osaka, National Museum of Ethnology.
- Istomin, Kirill, Jaroslava Panáková et Patrick Heady, 2014 « Culture, Perception, and Artistic Visualization : A Comparative Study of Children’s Drawings in Three Siberian Cultural Groups ». Cognitive Science 38 : 76-100.
- Jääskeläinen, Kira, 2012 Tagikas – Once Were Hunters. Katharsis Fims Oy. (Film).
- Jääskeläinen, Kira, 2019 Northern Travelogues. Illume Oy. (Film).
- Jarzutkina, A.A., 2017 « Prijuty, rèjdy, desanty : Praktiki sosuščestvovanija žitelej s alkogolem v čukotskih selah. Strategii minimizatsii problemy » [« Les refuges, les raids, les atterrissages : Pratiques de la cohabitation des habitants avec l’alcool dans les villages de la Tchoukotka. Les stratégies de minimalisation du problème », Istoričeskaja i social’no-obrazovatel’naja mysl’ [La pensée historique et socio-éducative] 9 (6/2)n : 137-143.
- Jarzutkina, A.A., 2021 « Ovoše(olene)vodstvo v čukotskom sele Vaegi » [« Production de légumes et élevage de rennes dans le village tchouktche de Vaegi »], Sibirskie istoričeskie issledovanija [Recherches historiques sibériennes], 4 : 94-111.
- Jašenko, O.E., 2016 « Smotri i učisʹ : molodye čukotskie i èskimosskie morskie ohotniki sël Lorino i Sireniki 2010-h gg. » [« Regarde et apprends : Les jeunes chasseurs maritimes tchouktches et yupik des villages de Lorino et Sireniki dans les années 2010 »]. In Igor Krupnik (dir.), Licom k morju : pamjati L.S. Bogoslovskoj [Face à la mer. En mémoire de Ljudmila Bogoslovskaja], p.191-213. Moscou, Avgust Borg.
- Kerttula, Anna, 2000 Antler on the sea. The Yup’ik and Chukchi of the Russian Far East, Ithaca et Londres, Cornell University Press.
- Klokov, Konstantin, 2018 « Substitution and Continuity in Southern Chukotka Traditional Rituals : A Case Study from Meinypilgyno Village, 2016-2017 », Arctic Anthropology 55 (2) : 117-133.
- Klokov, Konstantin, 2021 « Ètno-kul’turnyj landšaft čukčej sela Mejnypil’gyno » [« Paysage ethnoculturel du village tchouktche de Mejnypil’gyno »]. Sibirskie Istoričeskie Issledovanija [Recherches historiques sibériennes] 4 : 37-54.
- Kolomiec O.P., et I.I. Krupnik (dir.), 2020 Prikladnaja ètnologija Čukotki : narodnye znanija, muzei, kulʹturnoe nasledie (K 125-letiju poezdki N.L. Gondatti na Čukotskij poluostrov v 1895 g.) [Ethnologie appliquée en Tchoukotka : savoirs populaires, musées, patrimoine culturel (à l’occasion du 125e anniversaire du voyage de N.L. Gondatti dans la péninsule de Tchoukotka en 1895)], Moscou, PressPass.
- Kozlov, A. I., 2007 « Sovremennyj vzgljad na problem pitanija morskih zveroboev Arktiki [« Un point de vue contemporain sur les problèmes nutritionnels des chasseurs de mammifères marins de l’Arctique »]. In Bogoslovskaja L., Slugin I., Zagrebin I., Krupnik I. (dir.), Osnovy morskogo zverobojnogo promysla [Fondements de la chasse marine], Moscou, Anadyr, Institut Nasledija : 369-389.
- Kozlov, A., Nuvano V., Vershubsky G., 2007 Changes in Soviet and post-Soviet Indigenous Diets in Chukotka, Etudes Inuit Studies, 31 (1-2) : 103-119.
- Krupnik, Igor, 1979 « Zimnie. “ličnye” prazdniki u aziatskih èskimosov » [« Fêtes “personnelles” d’hiver chez les Eskimos d’Asie »], Etnokul’turnye processy v sovremennyh i tradicionnyh obščestvah [Processus ethnoculturels dans les sociétés modernes et traditionnelles], p. 28-42. Moscou, Institut ètnologii akademii nauk SSSR.
- Krupnik, Igor, 1980 Eskimosy [Eskimos]. In I.S. Gurvič (dir.), Semejnaja obrjadnost’ narodov Sibiri. Opyt sravnitel’novo izučenija [Rituels familiaux des peuples de Sibérie. Étude comparative], p. 207-215. Moscou, Nauka,
- Krupnik, Igor, 1989 Arktičeskaja ètnoèkologija [Ethnoécologie arctique]. Moscou, Nauka.
- Krupnik, Igor, 1993 Arctic Adaptations. Native Whalers and Reindeer Herders of Northern Eurasia, Hanovre et Londres, University Press of New England.
- Krupnik, Igor, 1998 « Understanding Reindeer Pastoralism in Modern Siberia : Ecological Continuity versus State Engineering ». In J. Ginat et A. Khazanov (dir.), Changing Nomads in a Changing World, p. 223-242. Brighton, Sussex Academic Press.
- Krupnik, Igor, 2000a « Reindeer Pastoralism in Modern Siberia : Research and Survival during the Time of Crash », Polar Research 19 (1) : 49-56.
- Krupnik, Igor, 2000b Pust’ govorjat naši stariki : Rasskazy aziatskih èskimosov-jupik, zapisi 1975-1987 gg.[Laissons parler nos aînés : Histoires des Eskimos-Yupik asiatiques, enregistrements de 1975 à 1987]. Moscou, Institut Nasledija.
- Krupnik, Igor et M. Chlenov, 2007 « The End of “Eskimo land” : Yupik relocation in Chukotka, 1958-1959 », Etudes Inuit Studies 31 (1-2) : 59-81.
- Krupnik, Igor et M. Chlenov, 2013 Yupik Transitions : Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks, University of Alaska Press.
- Krupnik, I.I. et M.A. Členov, 1979 « Dinamika ètnolingvističeskoj situacii u aziatskih èskimosov » [« Dynamique de la situation ethnolinguistique chez les Eskimos d’Asie »], Sovetskaja ètnografija [Ethnographie soviétique] 2 : 19-29.
- Krupnik, Igor et W. Fitzhugh (dir.), 2001 Gateways. Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897-1902, Washington D.C. : Arctic Studies Centre, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution.
- Krupnik, I. et E. Mihajlova, 2006 « Peizaži, lica i istorii : eskimosskie fotografii Aleksandra Forštejna (1927–1929 gg.) » [« Paysages, visages et histoires : Photographies eskimos d’Aleksandr Forštejn (1927-1929) »], Antropologičeskij Forum [Forum anthropologique] 4 : 188-219.
- Krupnik, I. et E. Mikhailova [Mihajlova E.], 2006 « Landscapes, Faces and Memories : Eskimo Photography of Aleksandr Forshtein, 1927-1929 », Alaska Journal of Anthropology, 4 (1-2) : 92-113.
- Krupnik, Igor et Nikolai Vakhtin, 1997 « Indigenous Knowledge in Modern Culture : Siberian Yupik Ecological Legacy in Transition », Arctic Anthropology 34 (1) : 236-252.
- Krupnik, Igor et Nikolai Vakhtin, 2002 « In the “House of Dismay” : Knowledge, Culture, and Post-Soviet Politics in Chukotka, 1995-1996 ». In E. Kasten (dir..), People and the Land : Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia, p. 7-43. Berlin, Dietrich Reimer Verlag.
- Kumo, K. et T.V. Litvinenko, 2019 « Nestabil’nost’ i stabil’nost’ v dinamike naselenija Čukotki i eë naselënnyh punktov v postsovetskij period : regional’nye osobennosti, vnutriregional’nye i lokal’nye različija » [« Instabilité et stabilité dans la dynamique de population de la Tchoukotka et de ses lieux d’habitations dans la période post-soviétique : spécificités régionales, interrégionales et locales de distinction »], Izvestija RAN. Serija geografičeskaja [Nouvelles de l’Académie des Sciences de Russie. Série géographique] 6 : 107-125.
- Kuznecova Varvara, G., 1957 « Materialy po prazdnikam i obrjadam amguèmskih olennyh čukčej » [« Matériaux sur les fêtes et les cérémonies des éleveurs de rennes tchouktches »], Sibirskij ètnografičeskij sbornik II, trudy instituta ètnografii imeni N.N. Mikluho-Maklaja t.XXXV, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moscou-Léningrad, p. 263-326.
- Laugrand, Frédéric, 2021 « Inuit hunters, Saami herders, and lessons from the Amadjuak experiment (Baffin Island, Canada)”. In A. Averbouh, N. Goutas et S. Mery (dir.), Nomad Lives, from Prehistoric Times to the Present Day, p. 339-359. Paris, Muséum national d’Histoire Naturelle.
- Leonova, V.G., 2020 « Rodnoj jazyk i deti Čukotki » [« Langue maternelle et enfants de Tchoukotka »]. In Kolomiec O.P. et I.I. Krupnik (dir.) Prikladnaja ètnologija Čukotki : narodnye znanija, muzei, kulʹturnoe nasledie (K 125-letiju poezdki N.L. Gondatti na Čukotskij poluostrov v 1895 g.) [Ethnologie appliquée en Tchoukotka : savoirs populaires, musées, patrimoine culturel (à l’occasion du 125e anniversaire du voyage de N.L. Gondatti dans la péninsule de Tchoukotka en 1895)], Moscou, PressPass.
- Leonova, V. (dir.), 2014 Naukan and Naukans Nuvuӄaӄ ynkam nuvuӄahmit [Histoires d’Eskimos de Naukan]. Gouvernement de l’Okrug autonome de Tchoukotka, conseil circumpolaire Inuit de Chukotka Public Organization et Vladivostok, Dalpress.
- Mihajlova, E.A., 2015 Skitanija Varvary Kuznecovoj. Čukotskaja èkspedicija Varvary Grigor’evny Kuznecovoj [Voyages de Varvara Kuznecova. Expédition en Tchoukotka de Varvara Grigor’evna Kuznecova]. 1948-1951 gg., Saint Pétersbourg, MAE RAN.
- Morgunova-Švalʹbe, D.N., 2020 « Jazykovaja adaptacija na primere èskimosov-jupik s. Novoe Čaplino, 1998-2018 gg. Vybor jazyka i jazykovoe pereključenie » [« Adaptation linguistique dans le cas des Eskimos-Yupik de Novoe Čaplino, 1998-2018. Choix de la langue et commutation linguistique »]. InPrikladnaja ètnologija Čukotki : narodnye znanija, muzei, kulʹturnoe nasledie (K 125-letiju poezdki N.L. Gondatti na Čukotskij poluostrov v 1895 godu) [Ethnologie appliquée en Tchoukotka : savoirs populaires, musées, patrimoine culturel (à l’occasion du 125e anniversaire du voyage de N.L. Gondatti dans la péninsule de Tchoukotka en 1895)], Moscou, PressPass.
- Mymrin, N.I., 2016 « Rabota s nabljudateljami, korennymi žiteljami Čukotki. Nekotorye vpečatlenija i nabljudenija » [« Travailler avec des observateurs et des habitants autochtones de Tchoukotka. Quelques impressions et observations »]. In Igor Krupnik (dir.), Licom k morju. Pamjati Ljudmily Bogoslovskoj [Face à la mer. En mémoire de Ljudmila Bogoslovskaia], p. 68-86. Moscou, Avgust Borg.
- Nuvano, V. N., 2006 « Incineration Ritual among the Vaegi Chukchi ». In K. Ikeya (dir.), Chukotka Studies No. 4 : The Chukchi Culture, p. 23-37. Osaka, Chukotka Studies Committee.
- Oparin, Dmitriy, 2012 « The commemoration of the dead in contemporary Asiatic Yupik ritual space », Études Inuit Studies 36 (2) : 187-207.
- Oparin, Dmitriy [Dmitrii], 2020 « Vospominanija o čudesah i kamlanijah èskimosskovo šamana : sovremennaja atomizacija ritual’noj žizni i post-sovetskaja nostal’gija » [« Souvenirs des miracles et des séances extatiques du chamane yupik sibérien : Atomisation contemporaine du rituel et nostalgie post-soviétique »], Sibirskie istoričeskie issledovanija [Recherches historiques sibériennes], (2) : 229-250.
- Oparin, Dmitriy [Dmitrii], à paraître « Soviet-era Ethnography and Transmission of Ritual Knowledge in Chukotka ». In V. Vaté et O. Habeck (dir.), Anthropology of Siberia in the 19th and 20th Centuries, Münster, Halle Studies in Anthropology of Eurasia.
- Panáková, Jaroslava, 2005 The Seagull Flying Against the Wind / Let čajky proti větru (15’) ; FAMU (Film).
- Panáková, Jaroslava, 2015 Päťživotov, Five Lives, Cinq vies, Pamodaj Community, (65’) (Film).
- Panáková, Jaroslava, 2014 « The Grave Portraits and the Ancestralization of the Dead (Chukchi and Yupik Eskimo Case) », Slovenský Národopis 62 (4) : 505-521.
- Panáková, Jaroslava, 2019 « Something like happiness : Home Photography in the Inquiry of Lifestyles’ ». In J. O. Habeck (dir.), Lifestyle in Siberia and the Russian North, pp. 191-256. Cambridge, Open Book Publishers.
- Puja, Vladimir, 2014 Čauču, https://www.youtube.com/watch?v=1wzDs4S6nPA, (Film).
- Pupynina, M.Ju., 2013 « Čukotskij jazyk : Geografija, govory i predstavlenija nositelej o členenii svoej jazykovoj obšnosti » [« La langue tchouktche : Géographie, dialectes et représentations des locuteurs sur leur appartenance à leur communauté linguistique »], Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvističeskih issledovanij 9 (3) : 245-260.
- Rubcova, E. S., et N. B. Vahtin (dir.), 2019 Teksty na jazykah èskimosov Čukotki v zapisi E. S. Rubcovoj [Textes en langues yupik de Tchoukotka enregistrés par E. C. Rubcova]. Saint-Pétersbourg, Institut lingvističeskih issledovanij RAN, Art-Èkspress.
- Schwalbe, Daria, 2015 « Language Ideologies at Work : Economies of Yupik Language Maintenance and Loss », Sibirica 14 (3) : 1-27.
- Schwalbe, Daria, 2017 « Sustaining Linguistic Continuity in the Beringia : Examining Language Shift and Comparing Ideas of Sustainability in Two Arctic Communities », The Canadian Journal of Anthropology 59 (1) : 28-43.
- Schweitzer, Peter, 2001 Siberia and Anthropology : National Traditions and Transnational Moments in the History of Research. Habilitationschrift. Thèse post-doctorale. Faculty of the Human and Social Sciences, University of Vienna.
- Schweitzer P., Golovko E., 2007 « The “priests” of East Cape : A Religious Movement on the Chukchi Peninsula during the 1920s and 1930s », Études Inuit Studies 31 (1-2) : 39-38.
- Schindler, Debra L., 1992 « Russian Hegemony and Indigenous Rights in Chukotka », ÉtudesInuit Studies 16 (1-2) : 51-74.
- Schindler, Debra L., 1997 « Redefining Tradition and Renegotiating Ethnicity in Native Russia », Arctic anthropology 34 (1) : 194-211.
- Thompson, Niobe, 2008 Settlers on the Edge. Identity and Modernization on Russia’s Arctic Frontier. Vancouver, University of British Columbia Press.
- Vahrušev, A., 2011 Kniga tundry. Povest’ o Vukvukaj – malen’kom kamne [LeLivre de la toundra. Un conte de Voukvoukaï, le petit caillou], High Latitudes ltd. Moscou (Film). Consulté le 31 mai 2021, https://www.youtube.com/watch?v=rg0HGetYTh4&t=118s.
- Vahtin, Nikolaj, B., 1992 « K tipologii jazykovyh situacij na Krajnem Severe (predvaritel’nye rezul’taty issledovanija) » [« Pour une typologie des situations linguistiques dans le Grand Nord (résultats préliminaires de l’étude) »], Voprosy jazykoznanija [Questions de linguistique] 4 : 45-59.
- Vahtin, Nikolaj, B., 2000 « Jazyk sirenikskih ėskimosov : teksty, grammatičeskie i slovarnye materialy » [« La langue des Eskimos de Sireniki : Textes, grammaire et vocabulaire »], LINCOM studies in Asian linguistics, 33.
- Vahtin, Nikolaj, B., 2001 Jazyki narodov Severa v XX veke. Očerki jazykovogo sdviga[Les langues des peuples du Nord au vingtième siècle. Essais sur le glissement linguistique], Saint-Pétersbourg, Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge.
- Vahtin, Nikolaj, B., 2004 « Jazykovoj sdvig i izmenenie jazyka : dogonit li Ahilles čerepahu ? » [« Glissement et changement linguistiques : Achille rattrapera-t-il la tortue ? »]. In, Tipologičeskie obosnovanija v grammatike : K 70-letiju professora V. S. Hrakovskogo [Fondements typologiques de la grammaire : à l’occasion du 70e anniversaire du professeur V. S. Hrakovskij], p. 119-130. Moscou, Znak.
- Vahtin, N., et Št. Dudek [Stephan Dudeck] (dir.), 2020 Deti devjanostyh v sovremennoj Rossijskoj Arktike [Les enfants des années 90 dans l’Arctique russe contemporain], Saint-Pétersbourg, Izd-vo Evropejskogo universiteta v Sankt-Petersburge.
- Vahtin, N. B., E. V. Golovko, et P. Švajtcer [P. Schweitzer], 2004 Russkie starožily Sibiri. Socialʹnye i simvoličeskie aspekty samosoznanija[Les anciens habitants russes de Sibérie. Aspects sociaux et symboliques de la conscience de soi], Moscou, Novoe izdatelʹstvo.
- Vakhtin, Nikolai [Vahtin N.], 2005 « The Russian Arctic between Missionaries and Soviets : The Return of Religion, Double Belief, or Double Identity ? ». In E. Kasten (dir.), Rebuilding Identities : Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia, p. 27-38. Berlin, Dietrich Reimer Verlag.
- Vakhtin, Nikolai [Vahtin N.], 2006 « Transformations in Siberian Anthropology : An Insider’s Perspective ». In G. L. Ribeiro et A. Escobar (dir.), World Anthropologies : Disciplinary Transformations within Systems of Power, p. 49-68. Oxford et New York, Berg Publishers.
- Vaté, Virginie, 2005a « Maintaining Cohesion Through Rituals : Chukchi Herders and Hunters, a People of the Siberian Arctic ». In K. Ikeya et E. Fratkin, Pastoralists and their Neighbours in Asia and Africa, p. 45-68. Osaka, National Museum of Ethnology, Senri Ethnological Studies.
- Vaté, Virginie, 2005b « Kilvêi : The Chukchi Spring Festival in Urban and Rural Contexts ». In E. Kasten (dir.), Rebuilding Identities : Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia, p. 39-62. Berlin, Dietrich Reimer Verlag.
- Vaté, Virginie, 2007 « The Kêly and the Fire : An Attempt at Approaching Chukchi Representations of Spirits ». In Frédéric B. Laugrand et Jarich G. Oosten (dir.), La nature des esprits. Humains et non-humains dans les cosmologies autochtones/Nature of Spirits in Aboriginal Cosmologies, p. 219-239. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Vaté, Virginie, 2009 « Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism ». In M. Pelkmans (dir.), Conversion after Socialism : Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union, p. 39-57. New York, Berghahn Books.
- Vaté, Virginie, 2013 « Building a Home for the Hearth : An Analysis of a Chukchi Reindeer Herding Ritual ». In D. G. Anderson, R. P. Wishart et V. Vaté (dir.), About the Hearth : Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North, p. 183-199. New Yorkf and Oxford, Berghahn Books.
- Vaté, Virginie, 2019 « L’orthodoxie aux confins de la Russie arctique : Le marquage religieux d’un territoire stratégique ». SciencesPo Centre de recherches internationales, Avril 2019. Consulté le 12 avril 2022, https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03471421.
- Vatè, V. [Vaté V.], 2021 « Vozvrašenie k čukotskim duham » [« Retour aux esprits des Tchouktches »], Sibirskie istoričeskie issledovanija 4 : 55-75.
- Vaté, Virginie et John Eidson, 2021 « The Anthropology of Ontology in Siberia – a Critical Review », Anthropologica 63 (2). https://doi.org/10.18357/anthropologica63220211029.
- Vdovin, Innokentij S., 1965 Očerki istorii i ètnografii čukcej [Essais sur l’histoire et l’ethnographie des Tchouktches], AN SSSR. Moscou-Léningrad, Nauka.
- Vdovin, Innokentij S., 1976 « Priroda i čelovek v religioznyh predstavlenijah čukčej » [« La nature et l’humain dans les représentations religieuses des tchouktches »]. In I. S. Vdovin (dir.), Priroda i čelovek v religioznyh predstavlenijah narodov Sibiri i Severa [La nature et l’humain dans les représentations religieuses des peoples de Sibérie et du nord], p. 217-253. Léningrad, Nauka.
- Vdovin, Innokentij S., 1979 « Vlijanie hristjanstva na religioznye verovanija čukčej i korjakov » [« L’influence du christianisme sur les croyances religieuses des Tchouktches et des Koryaks »]. In I. S. Vdovin (dir.), Hristianstvo i lamaizm u korennogo naselenija Sibiri (vtoraja polovina XIX v-načalo XX v) [Christianisme et lamaisme chez les peuples autochtones de Sibérie (deuxième moitié du XIXe-début du XXe siècles], AN SSSR, p. 86-114. Léningrad, Nauka.
- Vdovin, Innokentij S., 1981 « Čukotskie šamany i ih social’nye funkcii » [« Les chamanes tchouktches et leurs fonctions sociales »]. In I.S. Vdovin (dir.), Problemy istorii obščestvennogo soznanija aborigenov Sibiri (po materialam vtoroj poloviny XIX-načala XX v.) [Problems of history of collective conscience of the Indigenous People of Siberia (according to materials of the first half of the 19th century and of the beginning of the 20th century)], AN SSSR, p. 178-217. Léningrad, Nauka.
- Wachowich, Nancy, 2001 Sagiyuk. Stories from the Lives of Three Inuit Women, Montréal, Kingston and London, Mc Gills Queen’s University Press.
- Weinstein, Charles, 2010 Parlons Tchouktche. Une langue de Sibérie. Paris, L’Harmattan.
- Weinstein, Charles, 2018 Chukchi French English Russian Dictionary. Anadyr ; Saint Petersburg : Lema (3 vol.).
- Zhukova, Alevtina N., et Tokusu Kurebito, 2004 Bazovyj tematičeskij slovar’ korjaksko-čukotskih jazykov. A Basic Topical Dictionary of the Koryak-Chukchi Languages. Tokyo, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
- Yamin-Pasternak, Sveta, 2007 « An Ethnomycological Approach to Land Use Values in Chukotka », Études Iuit Studies 31 (1-2) : 121-141.
- Yamin-Pasternak, Sveta, Andrew Kliskey, Lilian Alessa, Igor Pasternak et Peter Schweitzer, 2014 « The Rotten Renaissance in the Bering Strait : Loving, Loathing, and Washing the Smell of Foods with a (Re)Acquired Taste », Current Anthropology 55 (5) : 619-645.

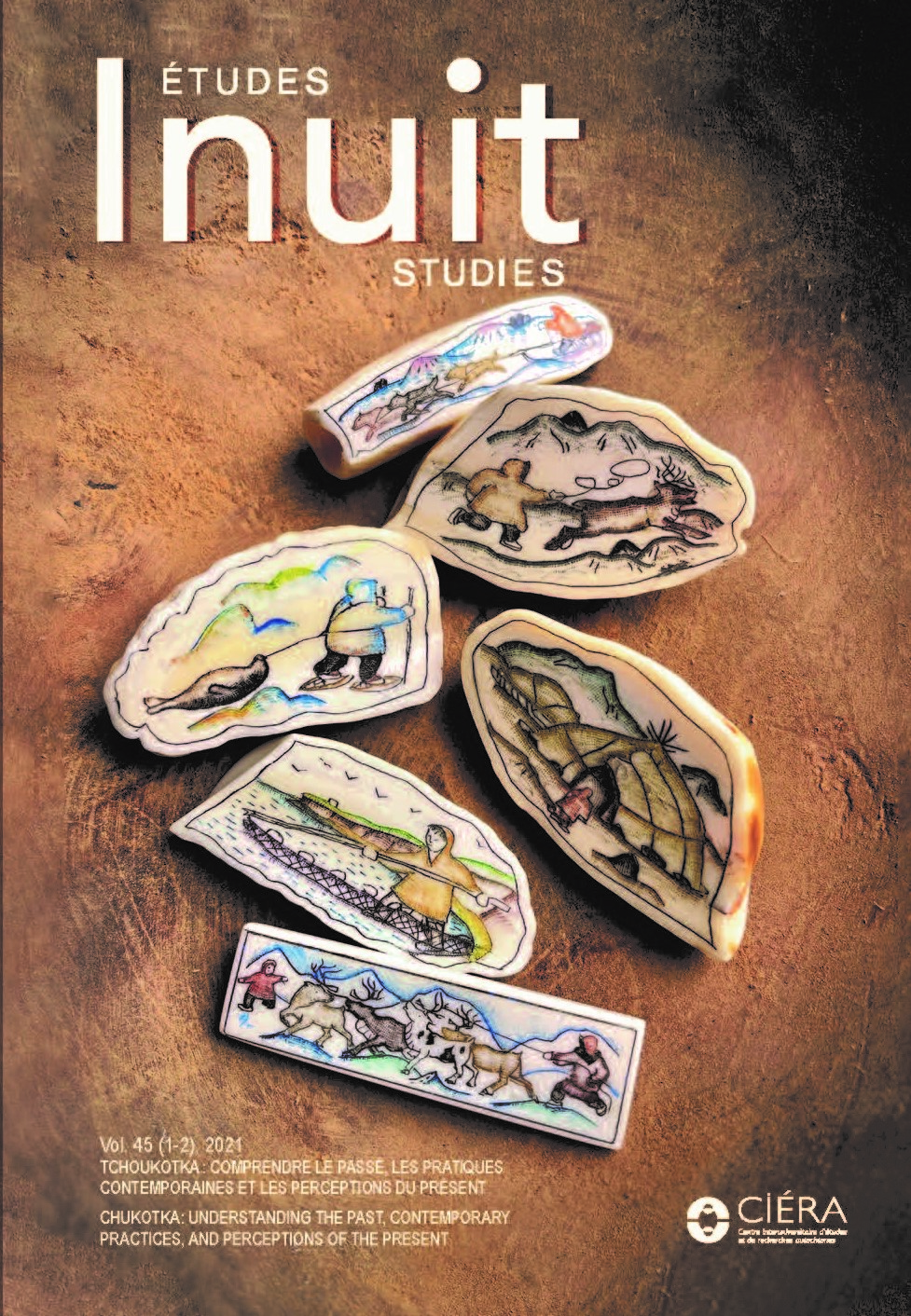
 10.7202/019713ar
10.7202/019713ar