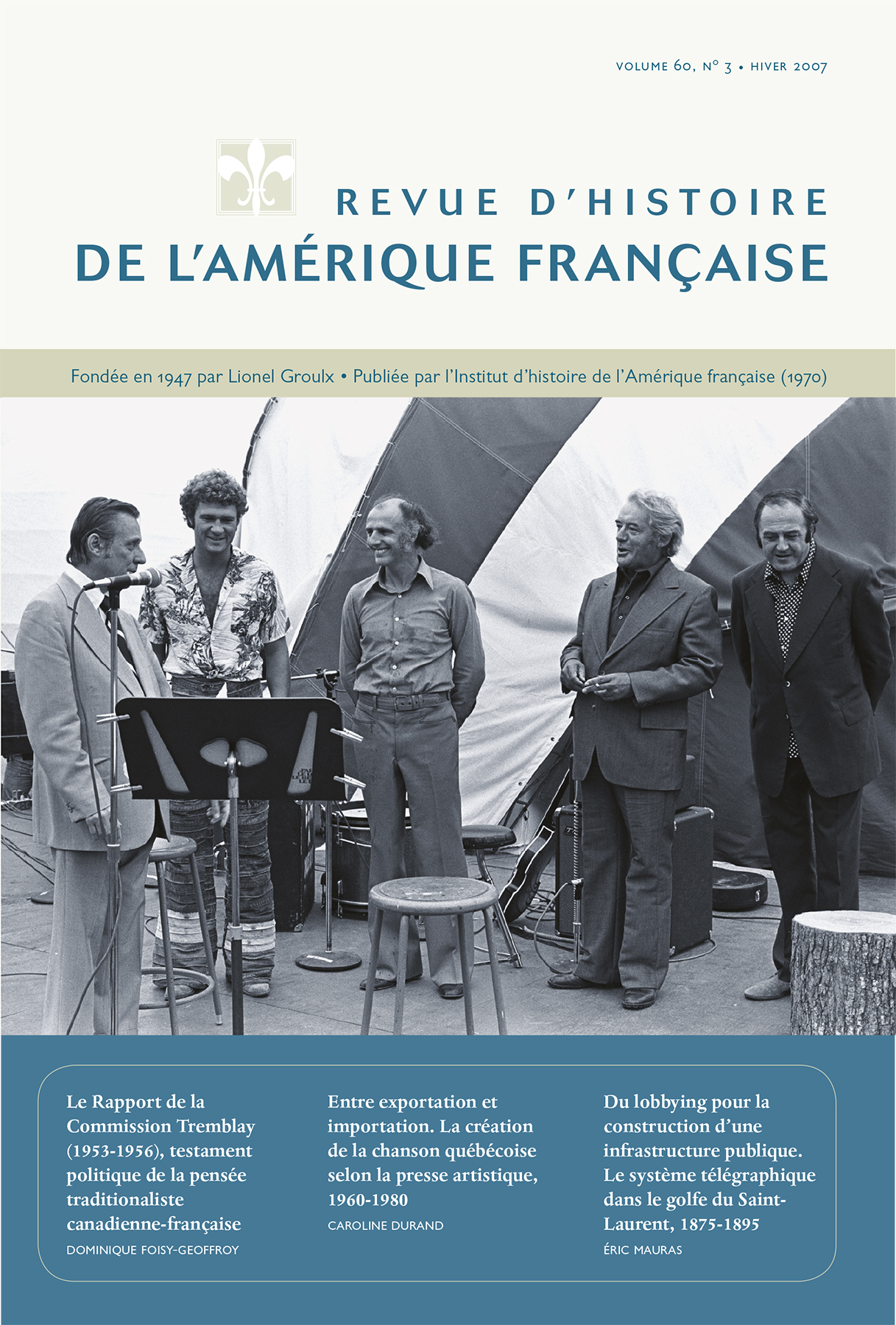Article body
L’Église catholique des années 1930-1970 : avant tout celle des laïcs de l’action catholique ?
Ce livre n’a pas fini de faire parler de lui ! Au Canada anglais, le visage qu’il présente de l’Église et du catholicisme québécois des années 1930 à 1970 est encore, je crois bien, totalement inédit ; au Québec, où E.-Martin Meunier et Jean-Philippe Warren ont déjà attiré l’attention sur le personnalisme, où Lucie Piché et Louise Bienvenue ont consacré des études très fouillées aux mouvements de jeunesse de l’Action catholique spécialisée et où Gaston Desjardins et Diane Gervais, entre autres, se sont penchés sur les transformations de la sexualité, du couple et de la famille au milieu du xxe siècle, le propos développé par Gauvreau étonnera sans doute moins, mais le portrait qu’il dessine surprendra tout de même bien des spécialistes de l’histoire socioreligieuse.
Les intellectuels des années 1950 et 1960 ont dressé un acte d’accusation sans merci contre l’Église et le catholicisme d’avant 1960. Pourtant, l’effort patient de l’historiographie, depuis une vingtaine d’années, a permis de démontrer hors de tout doute que l’institution et la religion catholiques n’ont pas été seulement un adversaire et un obstacle à la modernité du Canada français, mais qu’elles ont aussi joué le rôle de ferments de cette modernité qui s’est pleinement déployée dans la culture commune et les structures de l’État pendant la première moitié des années 1960. L’originalité du livre de Gauvreau réside dans sa tentative d’articuler ces deux positions. Sa démonstration s’appuie sur une documentation variée, tirée des archives des mouvements d’Action catholique spécialisée ; des publications intellectuelles de l’époque (Le Devoir, Relations, Cité Libre, La Revue dominicaine, Maintenant) ; et enfin du fonds Paul-Larocque, conservé dans les archives de la Commission Parent.
La thèse pourrait se résumer ainsi. Sans nier la persistance en son sein de courants de pensée traditionalistes, l’Église catholique d’avant Vatican II a été profondément traversée par le personnalisme, une philosophie élaborée d’abord et avant tout par des laïcs. Les préoccupations des laïcs ont ainsi été reprises par l’institution jusqu’aux plus hauts niveaux de la hiérarchie, jusqu’aux papes mêmes, et c’est ce qui ferait d’ailleurs l’originalité du catholicisme au xxe siècle. En particulier, le personnalisme a été adopté par l’Action catholique spécialisée qui, à partir des années 1930, a rejoint au Québec des milliers de jeunes garçons et filles de tous les milieux sociaux. Or, le personnalisme affirmait la supériorité de la spiritualité des jeunes, qu’on voulait faite d’une foi personnelle et d’un engagement chrétien authentique, sur celle de la génération antérieure, décrite avant tout comme superficielle et conformiste. Il donnait aussi toute son importance à la communauté (famille nucléaire fondée sur l’amour des époux, corps intermédiaires) à la fois comme lieu d’épanouissement de personnes engagées dans des relations égalitaires et comme rempart contre la dépersonnalisation qu’engendrent inévitablement des rapports sans médiation entre les individus atomisés et l’État tout puissant. Rupture avec le passé, mais tout en continuant à valoriser la famille comme cellule de base de la société, à maintenir des corps intermédiaires et à se méfier quelque peu d’une extension tous azimuts de l’État : on reconnaît bien là le projet institutionnel de la Révolution tranquille tel qu’il a été porté par le gouvernement Lesage, ainsi que les caractéristiques culturelles principales de la première Révolution tranquille. Oui, donc, poursuit Gauvreau, l’Église et le catholicisme ont pu être des ferments de la modernité au Canada français. Mais le drame, dit l’auteur, c’est que ce qui a bien commencé a mal tourné. À la fin des années 1960, que peut-on observer ? La famille est en crise, la jeunesse se donne à fond dans l’individualisme de la contre-culture, le féminisme se radicalise, l’État a pris une expansion considérable au détriment des corps intermédiaires, l’Église comme institution est marginalisée dans les institutions publiques, les Québécois ont massivement délaissé la pratique religieuse. Que s’est-il donc passé ? Gauvreau en impute la responsabilité aux élites catholiques, tant laïques que cléricales. Des hommes comme Gérard Pelletier, formé à la JEC puis pilier de Cité Libre, ont mis pendant vingt ans leur plume au service de leur anticléricalisme, de leur antinationalisme, de leur pessimisme moral et de leur profond conservatisme social fait d’un mépris écrasant pour les classes populaires accusées sans cesse de se complaire dans le consumérisme, la culture de masse américaine et une piété sentimentale, grégaire, sans envergure ni exigence spirituelles. Puis, les orientations données par Vatican II et reprises par une partie du clergé et des élites laïques croyantes, nationalistes cette fois, tel Fernand Dumont, ont fini d’écarter la famille et la paroisse de leurs rôles traditionnels de transmetteurs de la foi, de la socialisation chrétienne et de la solidarité sociale. Bref, Gauvreau soutient qu’en déqualifiant sans cesse tous les corps intermédiaires, en rejetant avec véhémence toute la manière traditionnelle de vivre la foi et en accusant sans cesse l’Église ancienne d’avoir versé dans un cléricalisme omnipotent et rétrograde, l’Église de Vatican II et les élites catholiques ont fini par ne faire confiance qu’à l’État. Elles ont jeté par terre les digues qui empêchaient l’extrême individualisme de s’imposer dans la culture contemporaine, et ont contribué directement, quoique bien malgré elles, à la déchristianisation de la société québécoise.
Ce propos de l’auteur se déroule en sept chapitres, à la fois thématiques et chronologiques. Dans les chapitres 1 et 2, fondés essentiellement sur une documentation jéciste et citélibriste, Gauvreau développe l’idée selon laquelle les mouvements d’Action catholique ont favorisé une rupture entre les jeunes et leurs aînés. Les chapitres 3 à 5 analysent les transformations qui marquent le discours catholique sur la sexualité, le couple et la famille au milieu du xxe siècle, sous la poussée des préoccupations des laïcs. Cette fois, Gauvreau réfère souvent, entre autres, aux cours du Service de préparation au mariage de la JOC. Le chapitre 6 analyse les rapports entre l’Église et l’État dans l’espace public au tout début des années 1960, et fait la preuve que le gouvernement Lesage était bien convaincu que l’État interventionniste et la société québécoise avaient tout à gagner à favoriser le maintien de la présence et de l’influence de l’Église dans les champs de l’éducation, de la santé et des services sociaux. Enfin, au chapitre 7, Gauvreau met à la question les positions de la Commission Dumont et des élites catholiques « nationalistes de gauche » des années 1960.
Bien des spécialistes, dont moi-même, auront l’impression, à lire Gauvreau, qu’ils s’initient à l’histoire de l’Église et du catholicisme québécois au milieu du xxe siècle. Nous avons toujours affirmé que l’Église institutionnelle québécoise de ces années, plus qu’à d’autres moments de son histoire, avait été particulièrement conservatrice, notamment sur la question de la place des femmes dans la famille et la société. Sans doute, il y avait encore plus conservateurs qu’elle sur le plan social, et en particulier ces intellectuels laïcs gravitant autour de Cité Libre, que la hiérarchie invitait d’ailleurs à témoigner de moins de mépris envers le peuple et de plus de confiance dans la jeunesse et la société d’après-guerre. Mais tout de même, d’apprendre que l’Église institutionnelle du temps (du moins par le biais du Service de préparation au mariage) était très attentive à la satisfaction sexuelle de la femme au sein du couple marié, qu’elle invitait le père à participer de près à l’éducation de ses enfants et à considérer son épouse comme une égale dont il devait veiller à l’épanouissement, qu’elle encourageait les couples à mieux maîtriser leur fécondité et les parents à établir avec leurs enfants des relations plus égalitaires, cela surprend un peu, même si Gauvreau prend bien la peine de dire que, ce faisant, l’Église cherchait bien entendu à rendre le foyer si attirant pour les femmes qu’elles ne voudraient pas s’en échapper. Et si l’on savait déjà que les aumôniers des mouvements de jeunes (d’ailleurs pas seulement ceux de l’AC, mais bien avant eux déjà ceux de l’ACJC) proposaient à ceux-ci un idéal chrétien héroïque tout en contraste avec la vie ordinaire des croyants, on est surpris d’apprendre que l’Église enseignait aux jeunes à se considérer supérieurs à leurs propres parents sous le rapport de la spiritualité. En fait, je crois que le regard de Gauvreau sur l’Église et le catholicisme québécois du temps est conditionné par deux éléments. D’une part, il considère que les laïcs de l’Action catholique ont eu un impact décisif sur les positions de la hiérarchie ; à mon sens, il surestime sans doute quelque peu cet impact. D’autre part, Gauvreau est un spécialiste de l’histoire du protestantisme, et notamment du protestantisme évangéliste. Or selon Gauvreau, le protestantisme des années 1930 à 1970, au contraire du catholicisme, n’a pas encouragé une telle culture jeune, une telle identité jeune fondée sur un sentiment très net de la supériorité spirituelle et morale de chaque nouvelle génération sur les précédentes. Le protestantisme n’a pas non plus contribué à redéfinir la vie familiale comme l’a fait le catholicisme personnaliste. Le Québec aurait donc vécu au milieu du xxe siècle une expérience culturelle de la famille très distincte de celle du reste de l’Amérique du Nord et beaucoup plus moderne, qui l’aurait préparé au radicalisme des mouvements de jeunes et de femmes des années 1960, les uns et les autres n’étant plus prêts à accepter quelque autorité que ce soit sur leur vie, surtout pas celle d’Humanae Vitae. Cette hypothèse d’une expérience culturelle de la famille plus moderne au Québec qu’ailleurs, au milieu des années 1950, est surprenante.
On l’a vu, Gauvreau n’est pas tendre envers les réformateurs catholiques, clercs et laïques, de la mouvance Vatican II, à qui il reproche d’avoir en quelque sorte ouvert toutes grandes les portes à la déchristianisation de la société québécoise par leur volonté délibérée de saper tous les repères et les structures de l’identité catholique traditionnelle. Ici, on pourra juger que l’auteur a sans doute surestimé l’influence, même si elle fut grande, des réformateurs catholiques : les années 1960, comme les années 1950 d’ailleurs avant elles, ont été celles d’une très grande transformation dans la culture et dans la société, et sous l’impact de bien d’autres facteurs que la religion, si bien que les réformateurs catholiques n’ont peut-être simplement qu’ajouté une pression sur des digues que tout menaçait de toute façon. Par ailleurs, Gauvreau néglige de considérer que le catholicisme issu de Vatican II a été porteur d’un projet « d’alliance avec le monde », pour parler dans les termes de l’Église, qui a suscité chez de nombreux croyants un engagement renouvelé en faveur de la justice sociale et contribué à la naissance de toute une série d’organismes communautaires qui jouent le rôle des anciens corps intermédiaires dans la création du lien social et la médiation des rapports entre les individus et l’État. Le chapitre 7 est sans doute le plus provocateur de l’ouvrage et il sera intéressant de voir comment il sera accueilli non seulement dans le milieu des historiens, mais aussi dans celui des théologiens.
Au total, donc, un livre qui propose une lecture de l’Église et du catholicisme québécois des années 1930 à 1970 passablement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Même s’il suscite des réserves, il faut souhaiter qu’il soit traduit en français, car à n’en pas douter, il ouvre la porte à de nouvelles recherches.
Lucia Ferretti
Département des sciences humaines/CIEQ
Université du Québec à Trois-Rivières
Un arc en ciel
Il est significatif que, depuis quelques décennies, les études sur l’histoire du Québec au xxe siècle viennent d’historiens du Canada ou du Québec anglophone (Trofimenkoff sur L’action française, Oliver, Jones, Behiels sur Cité libre), comme si le contemporain et le présent étaient difficiles à regarder. L’ouvrage de Michael Gauvreau, dont on souhaite la traduction le plus rapidement possible, est du même type : pour ceux qui aujourd’hui constatent que nous ne disposons pas d’une histoire minimalement satisfaisante de la Révolution tranquille (RT) et pour ceux qui posent la question globale de la transmission des valeurs au Québec depuis 1960, ce livre aura l’effet d’un choc salutaire. Non seulement balise-t-il la RT dans sa véritable périodicité (depuis 1930), mais il enfile une série de questions, d’institutions, d’acteurs qui, mis en séquence, dévoilent, en regard des valeurs et non plus seulement de la politique, le chemin parcouru et la diversité sinon l’ambivalence des modalités du parcours.
Les notes, qui occupent 20 % de l’ouvrage, révèlent bien la stratégie d’un historien qui est allé dans les archives de l’histoire contemporaine. Les sources manuscrites – sans compter les publications des mouvements d’action catholique, les mémoires et rapports de commissions, des périodiques comme Cité libre ou Maintenant – tracent le gué construit par l’auteur pour développer la logique de son argumentation : JOC, JEC, ACC, SPM, Commission Parent, MLLF, Commission Dumont. Les acteurs mis en scène sont à l’avenant : Gérard Pelletier, Claude Ryan, Paul Gérin-Lajoie, Maurice Blain, Jean Le Moyne, Fernand Dumont, parmi les plus souvent sur scène.
Les origines catholiques de la RT se trouvent donc dans l’analyse de cette séquence et de ces secteurs et l’une des thèses essentielles de l’ouvrage consiste à montrer non pas qu’une déferlante anticléricale a installé les valeurs de la RT, mais que s’est opérée, à l’intérieur même de certains milieux catholiques, une évolution qui a imposé à l’État même après 1960 une prise en compte de valeurs religieuses renouvelées dans la société québécoise ET dans l’Église institutionnelle, par ailleurs fort contestée de l’extérieur ET de l’intérieur. On avait une certaine idée de cette involution de l’Église par la connaissance d’itinéraires comme ceux du père Lévesque, des prêtres « sociaux », de Mgr Charbonneau, des frères Lockquel et Desbiens, des abbés O’Neill et Dion et de ces prêtres inconnus qui, dans la discrétion et la retenue temporelle, faisaient alors honneur au sacré. Mais l’analyse de M. Gauvreau des principes qui ont guidé l’action des mouvements d’action catholique – une « doctrine » pour une autre « action » – fait bien voir la trajectoire depuis la Crise de ceux et celles qui, de la JOC à la Commission Dumont en passant par Cité libre et la Commission Parent, ont renouvelé le christianisme contre l’ACJC et parfois même contre l’institution ecclésiale. L’auteur a ainsi choisi de scruter des valeurs inscrites dans des principes qui guidaient eux-mêmes une action auprès des jeunes ouvrières et ouvriers, des futurs époux, des jeunes étudiants qui allaient, trente ans plus tard, continuer dans la RT à mener le combat du renouvellement du christianisme. À telle enseigne qu’on peut voir deux formes d’anticléricalisme contester la tradition et l’excès de pouvoir temporel/politique de l’Église hiérarchique : un, libéral, qui va de T.-D. Bouchard et Jean-Charles Harvey au MLLF ; l’autre, religieux, qui, de Simonne Monet à Fernand Dumont en passant par le Frère Untel, entend rappeler à l’Église sa vocation première, spirituelle.
Cette préoccupation depuis 1931 (JOC) des mouvements d’action catholique de jeunes pour le spirituel emprunte aux penseurs catholiques des années de Crise, et M. Gauvreau, se mettant à l’enseigne de Jean-Philippe Warren et de E.-Martin Meunier, voit le personnalisme habiter tous ces mouvements de réforme. L’auteur parle de famille, de liberté, d’éthique « personnalistes ». L’inspiration personnaliste de ces jeunes catholiques engagés et à la recherche d’un ordre nouveau est certaine (p. 42-44). Mais qu’elle soit aussi pénétrante et ramifiante que le laissent entendre ces auteurs, on peut en douter jusqu’à nouvel ordre. D’abord parce qu’il faudrait voir ce que ces jeunes tiennent de Maritain et de ses « distinctions » et en quoi et sur quoi Mounier et Maritain se complètent. Ensuite parce qu’il nous manque une étude monographique du personnalisme des années 1930 qui nous permettrait de ne pas plaquer sur les décennies 1930 et 1940 les évidences d’une influence de Mounier des années 1950. On comprend dès lors que la chronologie soit peu serrée dans l’ouvrage de M. Gauvreau.
Autre thèse qui court dans toute l’analyse : la dimension générationnelle de cette évolution religieuse. Dans la foulée des travaux de Louise Bienvenue, M. Gauvreau explore l’antagonisme entre des générations qui font la modernité et celles qui ne prennent pas le train, exception faite de la Commission canadienne de la jeunesse (C. Ryan) qui ne joue pas cette carte. Cette jeune relève religieuse qui se donne ses mouvements et ses leaders développe une nouvelle conception de la famille et compte sur le SPM pour inculquer les principes nouveaux qui puissent orienter la famille nouvelle. C’est la même crise de la famille (p. 250) que l’historien scrute à travers les travaux et mémoires de la Commission Parent sur l’éducation qui est, aussi, pour une bonne part un exercice de reconsidération des rapports de l’État et de l’Église en la matière.
Les chapitres 6 et 7 sur les années 1960-1971 sont fascinants. M. Gauvreau, qui plaidait pour une analyse des valeurs dans la RT et non plus seulement pour un regard politique, livre ici des pages qui seront incontournables. En parlant de « final concordat » à propos de la réforme de l’éducation de 1960 à 1964, l’auteur restitue une épaisseur et une complexité temporelles qui font bien voir les tergiversations de la RT qui ne s’est pas faite dans le linéaire mais dans les allers et retours d’une société qui s’est jusqu’à cette époque demandé comment elle allait transmettre ce dont elle ne connaissait plus bien la teneur : la survie du religieux et du sacré sauvés de la débandade de l’institution cléricale. Ces chapitres, qui font voir comment alors l’État accepta de négocier avec UNE Église, une confession, suggèrent des repères pour l’horizon 2000 où les confessions religieuses se sont multipliées, au moment même où les effets de la sécularisation donnaient leurs résultats, au moment où les pratiquants, les athées, les indifférents doivent repenser les signes religieux extérieurs des autres religions, alors que les catholiques ont laïcisé les commissions scolaires et décroché les crucifix des écoles. Dans ces deux chapitres, le lecteur s’interrogera sur l’idée de « l’extension de la présence de la religion dans la RT » (p. 250). Il y eut sans doute plus de persistance qu’on avait besoin de le croire. Mais comment l’auteur explique-t-il, après le discours des croyants Pelletier, Dumont et tant d’autres sur le ritualisme et la vacuité d’une religion sociale – discours auquel M. Gauvreau n’attache pas l’importance accordée par ceux qui l’ont vécu –, comment donc explique-t-il la liquidation de l’institution, la multiplication des défroqués, les ventes de couvents, de collèges et d’hôtels-Dieu, le non-renouvellement des vocations ? La thèse d’une coquille évidée de la pratique d’une religion devenue sociale n’explique-t-elle pas tout autant la « fin d’une religion » que celle de la contestation spirituelle intérieure ?
Ces chapitres explorent aussi les formes de transformation de la communauté personnaliste – comment s’est-elle construite ? – des mouvements d’action catholique avec la montée du nationalisme indépendantiste. S’interrogeant peu sur le recours, dorénavant, à l’argument « démocratique » des catholiques qui se disaient ou se pensaient toujours « majoritaires » (p. 288) lorsque vint le temps pour l’Église de continuer à s’imposer face à l’État, l’auteur me semble faire ressortir une trame subtile mais combien fondamentale qui permet de voir une origine catholique à l’idée même d’indépendance, d’autodétermination, de souveraineté politiques. M. Gauvreau suggère (p. 285-286) que l’ancrage de la société québécoise ne se faisant plus par la religion, mais par la langue, celle-ci devenait avec la liberté de conscience l’absolu moral qui donnait dorénavant à ceux qui croyaient, depuis les années 1930, à l’autonomie de la « personne » comme valeur centrale, une conception nouvelle de l’autonomie. Anticléricalisme rationnel et christianisme personnaliste pouvaient tous deux mener aux distinctions du spirituel et du temporel, à la distinction plus qu’à la séparation de l’État et de l’Église, à l’affirmation personnelle et collective de la souveraineté.
Un dernier mot à propos de l’introduction où M. Gauvreau sacrifie aux dieux du révisionnisme. Ce débat a tellement dévié de son socle d’origine que les lecteurs vont de moins en moins se retrouver dans ce dédale de dérives. Tout est parti de l’article puis du livre de Ronald Rudin qui portaient sur des synthèses d’histoire du Québec et qui n’abordaient même pas la question de la modernité telle qu’elle avait été traitée jusqu’alors en divers lieux. Le malencontreux mot de « révisionnisme » a mis le feu aux interprétations. Il n’y a jamais eu lieu de fouetter un chat devant le fait que des générations d’historiens questionnent différemment le passé ; qu’ils puissent commettre le « péché mortel » de plaquer anachroniquement des valeurs contemporaines sur le passé est autre chose, et c’est ce qui intéresse R. Rudin. Je pense ici au libéralisme et à 1837 et 1838, questions historiographiques que je connais bien. Que Philippe Sylvain – ex-frère Sylvain –, Fernand Ouellet ou Jean-Paul Bernard aient questionné et analysé différemment que l’abbé Groulx ou Thomas Chapais ces aspects, cela n’en fait pas des « révisionnistes ». Mettre des gros mots sur une réalité somme toute assez simple pour continuer à gloser avec de nouveaux gros mots peut donner l’impression d’un débat historiographique, mais de quelle profondeur ?
His dictis, l’ouvrage de M. Gauvreau rafraîchit l’étude du Québec contemporain et constitue un des livres d’histoire du Québec les plus stimulants publiés ces dernières années.
Yvan Lamonde
Département de langue et littérature françaises
Université McGill
Une révolution religieuse
La Révolution tranquille a-t-elle eu lieu ? L’ouvrage de Michael Gauvreau affirme que oui, mais nous dit aussi qu’elle s’est déroulée durant près d’une quarantaine d’années et que le catholicisme y a joué un rôle central. Plus précisément, l’auteur soutient que la Révolution tranquille a été façonnée par les idéologies religieuses et par certaines institutions catholiques, en particulier par la philosophie personnaliste qui a imprégné l’Action catholique (AC), si bien qu’en définitive, cette révolution a constitué une tentative de renforcer, et non pas d’affaiblir, la présence de la religion et les relations entre le catholicisme et la société québécoise (p. 5).
La référence à l’AC, à l’éthique personnaliste et à la volonté, sinon à la capacité, de cette frange de l’Église de moderniser le catholicisme pour mieux le préserver contre les assauts de la modernité, n’est pas sans rappeler la thèse proposée par É.-Martin Meunier et Jean-Philippe Warren dans Sortir de la Grande Noirceur. L’horizon personnaliste de la Révolution tranquille (Septentrion, 2002). L’étude de Gauvreau s’en distingue cependant par au moins deux aspects fondamentaux. D’une part, le cadre chronologique qui couvre quatre décennies sans que l’année 1960 n’apparaisse comme une ligne de démarcation incontournable. En fait, du point de vue social et culturel adopté par l’auteur, la deuxième moitié des années 1960, marquée par la montée de l’individualisme, constitue une délimitation beaucoup plus pertinente. D’autre part, la place accordée aux catégories identitaires (l’âge et le genre en particulier) dans son analyse. Pour Gauvreau en effet, l’importance historique de l’AC réside pour une large part dans sa promotion de valeurs culturelles modernes, c’est-à-dire de nouvelles identités personnelles et de relations familiales (relations intergénérationnelles et conjugales) et sociales plus égalitaires. Inspirée par l’éthique personnaliste, l’AC entendait promouvoir un nouveau catholicisme propre à ranimer la spiritualité individuelle et à revitaliser la famille, meilleur moyen de rechristianiser le Québec pour mieux l’ancrer dans la modernité. Gauvreau accorde donc une importance capitale aux jeunes, aux femmes, à la sexualité et à la famille, dessinant un portrait inédit d’une Révolution tranquille prolongée.
La thèse de Gauvreau s’appuie sur une étude fouillée des nombreux écrits laissés par les principales figures de proue de l’AC, mais aussi par des éléments plus conservateurs de l’Église, autant clercs que laïcs. Son argumentation, nuancée et complexe, repose donc essentiellement sur une étude de discours, mais s’inspire également de l’historiographie internationale sur le fait religieux et la modernité. Pour les fins du présent forum, je voudrais m’attarder à deux idées-forces qui traversent le livre et qui m’ont plus particulièrement interpellée.
D’abord, l’affirmation d’une rupture générationnelle qui serait survenue dès les années 1930. Alors que Louise Bienvenue (Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la révolution tranquille, Boréal, 2003) voit dans les mouvements d’AC des années 1930 et 1940 une « autonomisation » de la jeunesse comme catégorie sociale, Gauvreau ajoute que cette catégorie est d’emblée définie en opposition avec la génération précédente. En fait, suivant l’auteur, les discours des mouvements de jeunesse des années 1930 exaltent la supériorité morale et spirituelle des jeunes en regard du conformisme religieux de leurs aînés discréditant ainsi la génération précédente et même la capacité des parents à assurer la formation religieuse de leurs enfants. Dès cette époque, on assiste donc à un renversement des hiérarchies familiales – les jeunes se voyant conférer le rôle de modèle pour les parents et la société dans son ensemble –, et à une rupture générationnelle, puisque l’AC réaffirme constamment que les valeurs catholiques traditionnelles des adultes ne peuvent servir de guides à la jeunesse. Modernité, catholicisme « authentique », c’est-à-dire inspiré du personnalisme, et jeunesse en viennent ainsi à se confondre. Dans les années 1950 et 1960, ce parti pris envers les jeunes au détriment de leurs aînés, aura pour conséquences de discréditer complètement l’autorité et les compétences parentales, surtout en ce qui concerne l’éveil religieux de leurs enfants, si bien que la réforme de l’éducation des années 1960 cherchera à réserver ce rôle à l’école, d’où le maintien d’un système scolaire confessionnel. Au coeur d’une des réformes les plus fondamentales de la Révolution tranquille, celle de l’éducation, se trouvait donc le désir d’instiller chez les jeunes des principes et des valeurs religieuses adaptés au monde moderne, seule manière de préserver le caractère catholique de la société québécoise.
Une seconde trame qui traverse l’ouvrage est celle des identités et des relations de genre, un aspect qui rebondit sur le terrain de la famille, de la sexualité et même du féminisme. Selon Gauvreau, le personnalisme de l’AC l’amène en effet à vouloir régénérer la famille, un but qu’elle poursuit en faisant la promotion de la famille nucléaire et de nouvelles relations conjugales centrées sur l’accomplissement des deux partenaires et la satisfaction de leurs besoins, y compris sur le plan sexuel. Récusant le modèle de la famille traditionnelle, ce nouveau discours sacralise le mariage (plutôt que la famille) et la sexualité, la qualité des rapports intimes devenant garante de la stabilité du couple. L’importance accordée aux relations entre les époux, à leur intimité, mais aussi aux rapports parents-enfants, que l’on voudrait plus démocratiques, encourage d’ailleurs l’AC, à travers notamment son Service de préparation au mariage (SPM), à diffuser de l’information sur la contraception. Sous des dehors modernes, ce discours demeure néanmoins conservateur, car il cherche à redonner une place au père pour mieux sauvegarder l’autorité masculine dans le couple et la famille, de même que le caractère public de l’institution familiale représentée par son chef masculin. La défense des droits de la famille comme institution publique, au détriment des droits individuels, trouvera d’ailleurs son aboutissement dans la création du ministère de la Famille et du Conseil supérieur de la famille au début des années 1960, l’institution familiale devenant ainsi un partenaire dans l’élaboration de politiques qui la concernent et empêchant l’État de s’adresser directement aux individus. La « défaite » définitive du père, dont l’AC avait cherché à préserver les prérogatives, surviendra dans la seconde moitié des années 1960, alors que la famille cesse d’être perçue comme la médiatrice entre l’État et les individus et se retrouve, tout comme la religion, reléguée à la sphère privée. Entre temps, le personnalisme et sa défense d’une certaine égalité dans le couple, face au plaisir sexuel notamment, de même que son éthos individualiste qui affirme le choix des femmes face à la reproduction aura aussi contribué à alimenter un nouveau féminisme qui expliquerait la déchristianisation rapide de la société québécoise dans la seconde moitié des années 1960. Pour Gauvreau, la religion et les pratiques religieuses prennent aussi une connotation genrée, la piété traditionnelle et la soumission au clergé, condamnées par l’AC, étant associées à la féminité, alors que la spiritualité plus « moderne », c’est-à-dire plus individuelle et « authentique », mais tournée vers l’action dans la communauté que prônait le personnalisme, prend une figure masculine.
Comme le laissent entendre ces quelques lignes, l’ouvrage de Gauvreau montre toute l’importance de considérer les phénomènes sociaux et culturels pour mieux comprendre les dimensions politiques de l’histoire, ce qui en fait une étude des plus stimulantes, déjà couronnée par le prix Sir John A. Macdonald remis par la Société historique du Canada. L’un de ses grands mérites est certainement de renverser les perspectives sur la Révolution tranquille ; son argumentation, généralement convaincante, ne m’en a pas moins inspiré plusieurs réflexions et interrogations. L’analyse de discours, qui nous est présentée ici de manière fort éloquente, conduit en effet à se questionner sur son articulation à d’autres discours et idéologies. La question se pose, entre autres, pour ce qui est du féminisme, dont la résurgence m’a paru trop exclusivement liée à l’influence d’une idéologie personnaliste qui, si on en croit les ténors de l’AC et les témoignages de la Commission Dumont rapportés par Gauvreau, a pourtant peu touché les masses. Or le féminisme des années 1960-1970 a été un véritable mouvement social qui a rejoint des femmes de toutes conditions. Tout en étant consciente des limites que posent l’accessibilité ou la disponibilité des sources, j’ai parfois aussi déploré que la classe ouvrière trouve plus difficilement sa place dans l’analyse et soit le plus souvent examinée sous la lentille des élites de l’AC qui la méprisaient. Par ailleurs, j’aurais également aimé davantage de précisions sur le phénomène de « privatisation » de la famille qui serait survenu dans la seconde moitié des années 1960, car si les individus prennent une importance plus grande dans la société et aux yeux de l’État, ce dernier n’en continuera pas moins à s’intéresser à la famille qui, jusqu’à ce jour, fait toujours l’objet de discours et de débats publics passionnés. Enfin, l’analyse de Gauvreau qui suggère que le projet de l’AC était essentiellement masculin m’inspire deux questions : comment alors expliquer que l’AC a attiré bien davantage de femmes que d’hommes ? Et peut-on, ou doit-on, en conclure que la Révolution tranquille elle-même a été masculine ?
Denyse Baillargeon
Département d’histoire
Université de Montréal
Vers une nouvelle chronologie de la modernité québécoise : deux révolutions culturelles ?
Tout d’abord, je tiens à remercier mes trois collègues, Denyse Baillargeon, Lucia Ferretti et Yvan Lamonde, pour leur accueil de Catholic Origins et pour leur lecture serrée qui soulève des enjeux historiographiques stimulants et de grande envergure. Leurs observations contribueront à ranimer le débat autour de la relation entre le catholicisme et la modernité québécoise. Dans cette brève réponse à ces généreux collègues, je souhaiterais me concentrer sur un élément mis en vedette par les trois commentaires : l’effondrement rapide (certains diraient catastrophique) de la chrétienté catholique au Québec après le milieu des années 1960 et le rôle qu’a joué la modernité catholique, par le biais des idéologies, dans cette déchristianisation. À la lumière de cette discussion, je voudrais poser à mon tour une question : le Québec a-t-il connu, à travers cette modernité catholique, un trajet « exceptionnel » en Amérique du Nord, en étant secoué par deux révolutions entre 1930 et 1970 ?
Convenons, au départ, qu’un des aspects les plus contestables de Catholic Origins est ma tentative de différencier deux courants révolutionnaires : un, plus long, la Révolution tranquille, fortement empreint des idéologies personnalistes véhiculées par l’Action catholique, qui a dominé l’horizon de la modernité québécoise entre 1930 et 1965, et l’autre, plus court et plus violent, une révolution globale des pays de l’Occident - phénomène bien décrit par l’historien anglais Arthur Marwick - ayant noyé la Révolution tranquille et la chrétienté québécoise dans un individualisme outrancier et un relativisme universel. En distinguant ainsi la Révolution tranquille, fruit d’une modernité catholique ancrée par la diffusion d’une éthique personnaliste, et la Révolution culturelle des années 1960, qui a largement vidé le Québec du catholicisme comme système de valeurs publiques et personnelles, mes collègues ont bien saisi l’intention culturaliste de Catholic Origins. Chacun des intervenants offre cependant des précisions et des questionnements différents autour des facteurs ayant causé cette déchristianisation soudaine. Les interrogations de Lucia Ferretti et d’Yvan Lamonde portent sur mon analyse du rôle joué par une élite catholique très marquée par le personnalisme et animée par un mépris pour la religion des couches populaires comme facteur clé dans le déclenchement d’un violent mouvement de déchristianisation au milieu des années 1960. Lucia Ferretti juge que ma thèse a surestimé l’influence de ces réformateurs catholiques au regard d’autres transformations significatives dans la société et la culture québécoises dans les décennies précédant 1960. Pour sa part, Yvan Lamonde, s’appuyant sur une lecture plus orthodoxe du discours des citélibristes et des catholiques de gauche, affirme qu’il faut accorder un certain crédit à leur dénonciation de la pratique religieuse des masses, qu’ils décrivent vers 1960 comme vide et périmée.
En réponse à ces deux remarques, il faut tout d’abord préciser que mon intention n’était pas d’écarter les autres facteurs socioculturels ayant contribué à séculariser la société québécoise, mais d’offrir le cas du Québec comme un contrepoids dans le grand débat international sur l’historiographie de la sécularisation. La critique d’Yvan Lamonde appelle, je pense, un travail soutenu dans la foulée de l’étude de Lucia Ferretti sur le catholicisme des milieux ouvriers à Montréal[1]. Sa question renforce la pertinence de la thèse de Simon Green sur les villes anglaises au tournant du xxe siècle qui soutient que les gens ont cessé de croire parce qu’ils ont cessé de participer à la vie des associations chrétiennes[2]. Le discours des réformateurs catholiques décrivait-il pareil phénomène ? La réponse réside sans doute dans les archives diocésaines et paroissiales. Une telle recherche sur les transformations des pratiques catholiques et sur les facteurs ayant causé le déclin des taux d’appartenance aux associations catholiques et aux organismes volontaires représente un projet de très longue envergure, engageant toute une équipe de chercheurs. Mais cette étude mettrait au premier plan les transformations au sein de l’institution elle-même comme moteur de la sécularisation et offrirait un apport tout à fait inédit au grand récit de la sécularisation du monde occidental. Même les partisans du nouveau révisionnisme, tel l’historien anglais Callum Brown, qui a relancé ce débat en déplaçant l’analyse de la modernité urbaine et industrielle vers les récits personnels et les discours identitaires[3], ont continué à voir les pratiques et idéologies religieuses au milieu du xxe siècle comme subissant la modernité et non comme des éléments dynamiques de celle-ci. Il est frappant de constater que les critiques des réformateurs catholiques n’ont pas été dénoncées ni contredites par les conservateurs – ce qui laisse penser que le clergé et les « catholiques de droite » partageaient la même perception très négative des croyances et des pratiques populaires, qu’ils ont largement contribué à la diffusion de cette image et qu’ils ont même participé à son élaboration. Mettre en relief la contribution des élites catholiques, des discours idéologiques et des institutions catholiques à la déchristianisation ouvre une question comparative plus large sur la complicité des institutions chrétiennes à la déchristianisation. Et en avançant cette nouvelle problématique, j’endosse vigoureusement l’appel d’Yvan Lamonde pour une monographie analytique sur le personnalisme, qui retracerait la diffusion et l’impact des variétés de cette idéologie au sein des élites cléricales et laïques au Québec.
Pour bien comprendre, selon Denyse Baillargeon, l’impact de la grande vague de déchristianisation qui a déferlé sur la société québécoise, il faudrait déplacer l’analyse vers les milieux populaires et, en particulier, vers les femmes québécoises. Pour Baillargeon, le personnalisme aurait eu peu d’emprise sur les ouvriers et les gens des classes populaires avant 1960. L’accélération rapide du processus de déchristianisation durant les années 1960 s’expliquerait par la montée rapide, à cette époque, d’un nouveau féminisme, décroché du personnalisme catholique, qui aurait été un « vrai » mouvement social. Ici, Baillargeon rejoint la célèbre thèse de Callum Brown, qui postule que c’est la renonciation des femmes à une identité chrétienne qui aurait provoqué la déchristianisation des années 1960. Il est évident que Catholic Origins reconnaît avec Baillargeon qu’il faut lire la modernité québécoise, et le grand processus de sécularisation des pays occidentaux, à travers le prisme du genre. Doit-on, demande-t-elle, « en conclure que la Révolution tranquille elle-même a été masculine ? » Le propos de Catholic Origins est beaucoup plus modeste puisqu’il s’intéresse avant tout au personnalisme, sans nier l’existence d’autres forts courants idéologiques après 1930. Il n’avance pas que le personnalisme a été hégémonique ni qu’il a été totalisant, mais tente de montrer de quelle manière le catholicisme a façonné les idéologies et les pratiques sociales dites « modernes ». Et il illustre comment, au sein des mouvements et idéologies d’Action catholique, il y aurait eu un conflit persistant entre visions et aspirations féminines et masculines, en soulevant cette question : sur le terrain des idéologies familiales et des pratiques sexuelles, la Révolution tranquille a été un terrain de négociations entre hommes et femmes, mais sur le plan de la réforme de la vie spirituelle et sur celui de la politique, ne serait-elle pas une tentative, comme beaucoup de projets de réforme d’inspiration chrétienne des xixe et xxe siècles, de remasculiniser la société pour enrayer la déchristianisation, tentative qui, après le milieu des années 1960, aurait produit une réaction féministe ayant, pour la première fois dans l’histoire québécoise et globale, réduit le catholicisme à la position de structure purement oppressive à la culture et aux aspirations féminines ?
Quelques mots pour finir sur la question du « révisionnisme » et la position du catholicisme au sein de la « société normale ». Comme Yvan Lamonde, je pense que ce débat a largement dévié de ses origines. Catholic Origins cherche à générer de nouvelles questions historiographiques en faisant sortir le catholicisme et les idéologies religieuses des marges de la pratique historique. Par sa chronologie, cette étude soutient que le Québec a fait l’expérience de deux révolutions culturelles profondes au xxe siècle, et que ces deux révolutions constituent une spécificité du Québec qui le distingue des sociétés anglophones en Amérique du Nord. Mais mon étude affirme aussi que cela est tout à fait « normal » si l’on considère que le catholicisme est une des sources et un des éléments dynamiques de la modernité. En fin de compte, le livre, en révélant les origines catholiques de la Révolution tranquille, déclare qu’il faut impérativement retrancher le concept de « société normale » du grand récit de la sécularisation occidentale – que la « normalité » ne consiste pas toujours en la réalisation progressive d’une modernité laïque, sous le signe du capitalisme et la montée triomphante de la bureaucratie étatique. Cela permettrait à l’historiographie québécoise de sortir le catholicisme du « traditionalisme » où les partisans de la « société normale » et de Ronald Rudin l’ont placée, et d’imaginer une histoire où la religion prendrait place comme un élément dynamique du changement social.
Michael Gauvreau
Département d’histoire
Université McMaster
Appendices
Notes
-
[1]
Lucia Ferretti, Entre voisins. La société paroissiale en milieu urbain: Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, 1848-1930 (Montréal, Boréal, 1992).
-
[2]
Simon Green, Religion in the Age of Decline (Cambridge, Cambridge University Press, 1996).
-
[3]
Callum Brown, The Death of Christian Britain: Understanding Secularisation, 1800-2000 (London/New York, Routledge, 2000).