Article body
Introduction
En 2019, lorsque nous avons rédigé l’appel pour ce numéro consacré aux liens entre émotions et politique, certaines de ces émotions constituaient le coeur de l’actualité. La colère se manifestait dans des affrontements à Hong Kong et à travers le rejet de l’Union européenne au Royaume-Uni. Au niveau mondial, l’inquiétude devant les changements climatiques et la pollution favorisait de nouveaux discours militants et l’émergence de mouvements sociaux transnationaux. En Algérie, l’exaspération suscitée par la réélection du président conduisait la jeunesse à se réapproprier le politique. Avec la vague de dénonciation #MeToo, la prise de parole des femmes transformait des expériences individuelles et passées sous silence en actions collectives.
L’année écoulée a illustré avec force le caractère central des dynamiques émotionnelles dans le champ politique. L’incertitude, la peur, la solitude, l’impuissance, l’espoir ou la frustration sont des conséquences de la pandémie de coronavirus et de sa gestion politique. Malgré le confinement, les émotions sont palpables et s’expriment collectivement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Certaines manifestations émotionnelles et politiques ont même bravé les mesures de distanciation sociale : l’année 2020 a été marquée par l’ampleur du mouvement Black Lives Matter qui s’est diffusé mondialement malgré les mesures sanitaires, et a rappelé comment la colère et la désolation pouvaient servir de levier aux revendications d’un mouvement social préexistant. Les émotions ont également été au coeur de la polarisation croissante des discours politiques sur les réseaux sociaux et dans le débat public. Elles ont participé au processus de hiérarchisation des savoirs entre les savoirs de vérité de « ceux qui savent » (les personnes expertes) et les savoirs des autres, catégorisés comme « infox ». Elles ont aussi été source d’adhésion et de mobilisation : la première ministre Jacinda Ardern s’est, par exemple, démarquée par sa gestion de la crise et par un leadership donnant une large place à l’empathie (Wilson, 2020).
Dans ce numéro de Lien social et Politiques, nous souhaitons explorer et clarifier ces multiples liens entre émotions et politique. Les auteur·e·s qui nous ont répondu proposent des outils précurseurs et heuristiques pour analyser les processus par lesquels les émotions peuvent se transformer en pouvoir social et politique, et développent des méthodes originales pour mieux saisir cette dimension émotionnelle longtemps impensée par les sciences sociales.
Émotions et politique : un champ émergent
Si l’histoire de la sociologie des émotions a montré que Max Weber ou Émile Durkheim avaient déjà fourni une première théorisation des affects, les sciences sociales contemporaines ont produit peu d’outils pour prendre en compte cette dimension des pratiques humaines jusque dans les années 1990 (Woodward, 1996), et ce, malgré le caractère central et transversal des émotions (Turner, 2009). Cette lacune peut s’expliquer par deux dichotomies. La première, issue de la pensée des Lumières, a opposé les émotions à la raison, et le corps à l’esprit (Quijano, 2007 ; Stoetzler et Yuval-Davis, 2002). Cette construction binaire a instauré une hiérarchie entre ces deux notions et a participé à dévaloriser l’émotion, perçue comme une perturbation de l’âme et du corps (Deluermoz et al., 2013). La deuxième dichotomie, découlant de la précédente, est celle qui s’est opérée entre les sciences sociales et les sciences naturelles (Brennan, 2004). Cette division entre la nature et le social, qui a eu pour effet de renvoyer l’étude du corps à la biologie, a freiné l’étude des dynamiques sociales reliées aux émotions (Ahmed, 2004).
Malgré ces difficultés, de nombreuses recherches en sciences sociales ont intégré l’étude des émotions depuis les années 1990, pour constituer ce qui a été nommé le « tournant affectif » (Clough, 2008 ; Woodward, 1996). Elles ont notamment pris appui sur les travaux pionniers de Arlie Hochschild et de David Heise, qui ont posé les bases d’une approche sociologique des émotions et des affects attentive à leurs modes de structuration sociale et à leurs implications politiques (Heise, 1979 ; Hochschild, 1979). La question des émotions et des affects s’est vue de plus en plus explorée au sein de champs de recherche dont elle était usuellement absente, tels que la santé, l’éducation, le travail, la consommation, etc. (Fernandez et al., 2008 ; Stets et Turner, 2006 ; Illouz, 2017 ; Jeantet, 2019). Dans ce contexte, la dimension politique des émotions a fait l’objet d’un intérêt particulier depuis une dizaine d’années, et ce, en lien direct avec l’histoire politique de la décennie, marquée par des mouvements sociaux massifs et par la montée des populismes.
Tout d’abord, dans le sillage des mouvements d’« indignation » des années 2011 et des suivantes, un front de recherche s’est ouvert sur la question du rôle et de la place des émotions dans les mouvements sociaux : leur place au sein de mouvements contestataires et leur pouvoir mobilisateur. Des travaux éclairent alors l’essor de nouveaux modes de diffusion des émotions, comme les médias sociaux, et le rôle central de ces derniers dans la mondialisation des protestations : ils soulignent par exemple la diffusion de « réseaux de la colère et de l’espoir » (Castells, 2015) ou l’émergence d’un « âge de la colère » au niveau planétaire (Mishra, 2017). Ils invitent parallèlement à mieux saisir la multiplicité des émotions morales et politiques présentes dans l’espace-temps des protestations, et leurs liens avec l’indignation (Benski et Langman, 2013 ; Jasper, 2014 ; Bericat, 2016 ; Van de Velde, 2020). Cette exploration se poursuit lors des mouvements pro-environnementaux de la fin de la décennie, qui montrent notamment comment les émotions peuvent participer à une forme de radicalisation des actions militantes (Pickard et al., 2020 ; Zummo et al., 2020).
Plus récemment, à la suite des dynamiques électorales de ces dernières années, l’attention s’est portée sur les relations entre émotions et populismes. En renouvelant un champ de recherche déjà existant sur les dimensions émotionnelles du vote (Marcus, 2008), les travaux mettent en lumière la force du langage émotionnel dans les dynamiques populistes, que ce soit dans la construction des discours politiques eux-mêmes ou dans les rhétoriques d’adhésion citoyenne. Plusieurs enquêtes lexicales se penchent sur les mécanismes de mobilisation de multiples émotions — notamment la peur ou la colère — au sein des discours politiques à caractère populiste (Ballet, 2012 ; Lamont, Park et Ayala-Hurtado 2017). L’accent est prioritairement mis sur le rôle du « ressentiment » social, pensé comme un ensemble d’affects mobilisés par le populisme de droite (Demertzis, 2014 ; Fassin, 2017 ; Bonikowski, 2017). Sur ces problématiques, on doit à Arlie Hochschild un travail ethnographique très remarqué sur des adhérents du Tea Party, mettant en valeur les sentiments croissants de colère et de nostalgie de ces militants plutôt âgés, enclins à se sentir « étrangers dans leur propre pays » (Hochschild, 2018). Dans cette même perspective centrée sur les processus d’adhésion citoyenne au populisme, des recherches proposent de déconstruire le rôle des « passions sociales » (Orrigi, 2019) ou des « passions tristes » (Dubet, 2019) pour comprendre comment l’indignation, le ressentiment ou l’humiliation peuvent expliquer quelques-unes des grandes transformations politiques de notre époque.
Enfin, un troisième pôle explore les liens entre émotions, sentiment d’injustice et résistance politique aux discriminations. Il vise à saisir la façon dont les émotions peuvent s’ancrer dans les rapports sociaux de pouvoir, et prendre leur source dans des épreuves collectives telles que la discrimination, la domination ou certaines inégalités (Crossley, 2009 ; Mackie et Smith, 2016). Les émotions servent alors de révélateur des discriminations et de levier vers la critique sociale et politique. Cette perspective se développe particulièrement au sein des approches féministes, à l’image d’Elizabeth Spelman qui envisage la colère comme une réaction à la « subordination » (Spelman, 1989). On la retrouve également dans des travaux portant sur les discriminations raciales, qui appréhendent les émotions comme autant de réponses au sentiment d’injustice (Mabry et Kiecolt, 2005 ; Dover, Major et Kunstman, 2015). Gayatri Chakravorty Spivak souligne quant à elle le pouvoir de l’empathie pour transformer les relations discriminantes (Spivak, 1988). De même, dans son analyse des « émotions politiques », Martha Nussbaum insiste sur le rôle primordial de l’amour et de la compassion dans la construction d’une société moins discriminatoire et plus juste, tout en désignant la peur, la jalousie et la honte comme leurs ennemis (Nussbaum, 2013).
De ce fait, penser l’émotionnel en politique n’est plus un angle mort de la recherche en sciences sociales, comme l’avait souligné en 1996 le politiste Philippe Braud (Braud, 1996 ; Sommier et Crettiez, 2019). Ces multiples travaux de recherche ont permis de lever le voile sur plusieurs formes de pouvoir politique des émotions. À ce jour, nous pouvons en retenir trois principales : un pouvoir de contestation — quand les émotions servent de levier collectif de mobilisation au sein des mouvements sociaux par exemple (Goodwin et al., 2009 ; Gould, 2009 ; Traïni, 2009) —, un pouvoir de persuasion politique — à travers les discours partisans ou les dispositifs politiques qui peuvent « capitaliser » sur les émotions (Demertzis, 2013 ; Faure, 2015 ; Blondiaux et Traïni, 2018 ; Le Bart, 2018 ; Heaney, 2019 ; Hutchison et Bleiker, 2019) — et, enfin, un pouvoir de changementsocial quand elles permettent de « révéler » certaines problématiques et discriminations sociales, et d’éveiller en retour les consciences politiques (Sprecher, 1986 ; Wilkins et Pace, 2014 ; Dover et al., 2015).
Le pouvoir des émotions : des identités sociales à l’agir politique
Or, ces recherches sur le lien entre émotions et politique ont deux points communs. Premièrement, elles se centrent essentiellement sur les formes collectives et déjà politisées de ces émotions, telles qu’elles se manifestent dans les discours militants, le vote, les contestations ou les campagnes politiques. Autrement dit, les émotions sont prioritairement saisies ex post, une fois transformées en acte politique institué. Deuxièmement, elles ne traitent généralement que des émotions perçues négativement, comme la peur, la colère ou la haine et, hormis les références à l’amour et la compassion, laissent le champ des émotions « positives » largement inexploré.
Ce numéro sur le « pouvoir des émotions » propose de renverser cette perspective pour saisir la trajectoire sociale de ces émotions, depuis leur genèse dans les parcours de vie, jusqu’à la façon dont celles-ci vont modeler en retour le rapport au politique. Sans postuler leur rôle positif ou négatif ni leur destinée politique, il vise à analyser les canaux par lesquels les émotions vont se muer en pouvoir de transformation — ou de conservation — sociale et politique. Nous avons voulu donner une place aux travaux qui éclairent les multiples processus de politisation de ces émotions, afin de remettre, selon les mots du philosophe Spinoza, « les émotions, les désirs et les affects au centre de la vie politique ». En explorant à la fois les sphères intimes, sociales et publiques, les contributions que nous avons reçues permettent ainsi de percevoir la complexité de ces dynamiques politiques et émotionnelles, et leur rôle constitutif dans l’expression des « je », des « nous » et des « eux » politiques : elles soulignent les effets déterminants des émotions sur la constitution des identités politisées et, in fine, sur l’agir politique. Cette approche dynamique et relationnelle montre ainsi que les émotions peuvent venir renforcer les engagements militants ou, au contraire, freiner les luttes. Elles peuvent naître directement dans le collectif ou émerger des subjectivités individuelles. Surtout, elles permettent de tisser des liens entre ces notions binaires polarisées — comme le « je » ou le « nous » — pour montrer que les frontières entre ces deux concepts sont extrêmement mouvantes.
Signe d’un champ en pleine effervescence, ces contributions s’appuient sur une multitude d’outils théoriques, de perspectives disciplinaires et de terrains empiriques. Elles ouvrent l’analyse à de multiples émotions jusqu’ici peu explorées — comme la fierté et la honte, l’euphorie et l’amertume, le « sang-froid », la tristesse ou l’empathie — et aux normes qui les régulent dans le champ politique. Théoriquement, ce dossier regorge de perspectives et de regards pluriels sur ce champ émergent, et se veut une véritable incitation à analyser plus avant ces liens entre émotions et politique. Les contributions mobilisent de multiples points de vue théoriques issus des sciences sociales, comme le concept de « travail émotionnel » développé par Arlie Hochschild (2003) et qui désigne l’effort réalisé pour rendre les émotions conformes aux attentes sociales, ou encore comme la notion de « registres affectifs » de Christophe Traïni, définis comme des « assortiments d’états affectifs interdépendants qui commandent des modes spécifiques de perception et de réaction à l’égard de certains objets et situations » (Traïni, 2017 : 16). D’autres chercheur·e·s mobilisent plutôt le concept de « registres émotionnels » pour mettre en lumière les effets des émotions dans les discours argumentaires ou encore celui de « séquences émotionnelles » pour saisir toutes les variations des émotions vécues dans l’engagement militant. D’autres, enfin, s’inspirent des travaux des philosophes comme Vinciane Despret ou Alexis de Tocqueville, ou vont puiser dans le pragmatisme de John Dewey (Dewey et Bidet, 2011).
Pour mieux explorer ces processus de politisation des émotions, nous avons choisi de présenter les textes reçus selon trois axes. Le premier se centre sur le rôle des émotions dans la sphère publique, et analyse en particulier leur influence sur la confrontation entre les « nous » et les « eux » politisés. Le deuxième axe se penche davantage sur les trajectoires d’engagement militant dans la sphère sociale : il examine la place des affects dans le passage du « je » au « nous » politisé et dans la constitution d’un collectif d’agir. Enfin, le troisième axe explore le potentiel des émotions dans la sphère intime, et sonde la façon dont les métamorphoses du « je » peuvent contribuer au changement social et politique.
Gouverner par les émotions : tensions et rapports de force émotionnels dans la sphère publique
Tout d’abord, en étudiant la place des émotions dans la sphère publique, les quatre premiers articles montrent combien les émotions sont constitutives des rapports de force politiques. Ils s’inscrivent ainsi dans un champ aujourd’hui très dynamique en sociologie des émotions — celui de la mobilisation des émotions dans les discours et actions politiques —, mais avec un regard renouvelé : ils éclairent en particulier le rôle central des tensions et des mises en opposition entre différents régimes émotionnels dans la genèse et la consolidation des débats publics. En s’intéressant ici à deux arènes spécifiques — celle du monde politique et celle des réseaux sociaux —, les articles montrent à quel point les rapports de force politiques mettent en jeu de profonds ressentis émotionnels, difficilement traduisibles dans une sphère où la raison s’érige en doxa. Ces émotions plurielles se manifestent souvent par des oppositions ou des confrontations polarisantes. Pour mieux comprendre ces tensions, les articles analysent différentes dualités d’émotions — la honte et la fierté, le « hype » et le « sel », le sang-froid et l’empathie — qui, dans leur opposition dialectique, structurent les rapports de force dans l’espace politique.
En premier lieu, les politologues Anne Mévellec et Nathalie Burlone nous invitent à explorer les registres émotionnels mobilisés dans l’espace public lors de controverses liées à trois cas territoriaux canadiens. En se basant sur l’étude de 310 articles canadiens francophones et anglophones publiés entre 2004 et 2017, les deux chercheures montrent que ces controverses sont traversées par quatre registres émotionnels : la colère, la joie, la peur et la tristesse. En proposant une entrée par les émotions plutôt que par les acteurs et les actrices de controverse, elles révèlent de quelle manière les affects s’avèrent indissociables des arguments invoqués. De plus, elles remettent en question la vision réductrice voulant que les controverses ne soient que des stratégies d’instrumentalisation ou qu’elles reposent uniquement sur une vision binaire où la colère serait présente chez les opposants et la joie chez les partisans. Elles exposent ainsi, au fil d’une analyse rigoureuse et délicate, la complexité des registres émotionnels constituant les controverses.
En explorant les règles qui régissent les « émotions présidentielles » sous la Ve République, l’article de Christian Le Bart analyse ensuite les tensions entre les normes de « sang-froid » et d’« empathie » dans l’exercice de l’autorité présidentielle. Il montre comment, depuis plusieurs décennies, l’exercice du pouvoir est structuré avant tout par une puissante norme de sang-froid : dans ce modèle d’autorité, le « chef » doit pouvoir faire la preuve d’une parfaite maîtrise de ses émotions, considérée comme le gage de sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Toutefois, Christian Le Bart souligne que cette norme se voit de plus en plus contrebalancée par d’autres attentes émotionnelles, en particulier, par une injonction croissante à l’empathie. Cette injonction, qui s’est imposée dans le sillage des attentats de la dernière décennie, invite au contraire le chef de l’État à partager et à exprimer ses émotions. Or, l’auteur montre combien ces deux normes peuvent désormais entrer en contradiction et fragiliser la recherche d’équilibre émotionnel lors de l’exercice du pouvoir.
À partir de l’analyse sociologique du hashtag #flygskam — littéralement, la honte de prendre l’avion —, l’article de Lucas Brunet explore les ressorts de la mobilisation politique d’un autre duo d’émotions : la honte et la fierté. Cet article s’appuie sur de multiples récits et témoignages associés à ce populaire hashtag sur Instagram, pour déconstruire les ressorts de l’expression publique de la honte — qui devient par là même politique. Lucas Brunet montre que l’affichage de la honte renvoie à une stratégie émotionnelle visant à produire de nouveaux comportements : il provoque non seulement de la culpabilité face à ses propres comportements, mais suscite aussi celle d’autrui par des pratiques de shaming ou de stigmatisation. Or, cette honte peut également se reconvertir en fierté de prendre le train : la honte devient alors une « règle de sentiment » partagée, induisant un profond travail émotionnel qui produit en retour de nouvelles pratiques génératrices de fierté. Cette dialectique émotionnelle entre honte et fierté s’érige ainsi en pouvoir de transformation sociale et politique.
Enfin, l’article de Quentin Gervasoni nous invite à explorer une autre arène numérique, celle des forums de fans de Pokémon, pour révéler les dynamiques collectives qui régissent deux régimes émotionnels concurrents : la « hype » et le « sel » — qualifications utilisées par les Internautes. À partir de l’analyse rigoureuse des discours, gifs et échanges sur ces forums, Quentin Gervasoni éclaire le rôle fondamental des expressions émotionnelles visant à susciter l’enthousiasme collectif ou, au contraire, à exprimer la critique envers un nouveau produit. D’une part, la « hype » correspond à un processus de construction d’une euphorie collective, alimentée par différentes expressions de frénésie, de multiples exclamations, ou par des visuels exprimant le débordement et l’exaltation. Ces formes de langage visent à alimenter une communauté d’adhésion et à produire ainsi une forme de bouillonnement collectif. Dans ce contexte, le régime du « sel » renvoie au contraire au registre de la critique, émis par des individus qui vont refuser de participer à ce débordement collectif. Il se traduit alors par la formulation d’un commentaire moins positif. Néanmoins, cette prise de parole plus critique a un coût, car elle va être associée à une forme de défection, réprimandée par les autres. Dans certains cas, elle peut cependant elle-même susciter l’adhésion et donc se transformer en critique collective.
Du « Je » au « Nous » : émotions et trajectoires d’engagement politique
Un second groupe d’articles s’intéresse plus directement au rôle des émotions dans les trajectoires d’engagement au sein de causes collectives — qu’elles soient par exemple féministes, antiracistes ou trotskystes. Ces articles visent à identifier à quels moments et sous quelles conditions une émotion n’est plus vécue de façon isolée, mais devient une émotion partagée. Ils éclairent ainsi les modes de passage d’émotions individuelles à des émotions collectives, qui contribuent à la constitution et au maintien d’une cause politisée. Ces modes de passage sont étudiés en deux temps principaux. D’une part, les articles montrent de quelle manière les émotions jouent un rôle central dans la construction d’un « je » politisé, que ce soient des émotions perçues comme positives ou négatives — telles que la colère, la peur ou l’admiration. D’autre part, ils identifient le processus de transformation émotionnelle qu’exige l’adhésion de ce « je » politisé à un « nous » engagé dans une cause commune, sociale ou politique.
Dans son article intitulé « Ce que la peur fait à l’engagement féministe », la sociologue Mélissa Blais nous invite tout d’abord à déconstruire la dimension normative de la peur, généralement perçue comme négative, pour envisager ce ressenti comme un levier de l’action collective féministe. En se fondant sur les discours d’activistes féministes québécoises et suisses, elle décrit les interactions de cette émotion avec la joie et la colère, et souligne son potentiel de transformation et d’empowerment. Elle met également en lumière ce que Mariam Azab et Wayne Santoro (2017) nomment le « fear management », qui désigne un processus qu’entreprend un mouvement social pour agir sur et transformer les peurs des activistes. L’analyse inductive de Mélissa Blais nous conduit à l’intérieur de séquences émotionnelles plurielles qu’expérimentent les féministes mobilisées, dont les causes peuvent être externes au mouvement, lorsqu’elles sont la conséquence de la répression policière ou de la violence des hommes, ou internes à ce dernier, lorsqu’elles relèvent du racisme, du classisme ou de la lesbophobie.
L’article de Pauline Picot explore ensuite le rôle central de la colère comme déclencheur d’engagement, puis les conditions de sa transformation en action collective. À partir d’une analyse ethnographique et d’entretiens conduits au sein de collectifs antiracistes franciliens, elle montre comment l’engagement antiraciste prend principalement sa source dans un sentiment d’injustice et de colère envers le racisme : l’expérience d’une « violence de trop », considérée comme intolérable, va souvent constituer le déclencheur de l’action militante. Pauline Picot montre qu’il va s’agir ensuite de mettre en mots et en gestes ce que l’on vit pour parvenir à partager des éléments de sa propre souffrance dans un espace collectif, voire à l’universaliser. C’est alors l’empathie qui va permettre de « faire corps » et de susciter le sentiment d’appartenance à un « nous » engagé pour transformer la colère individuelle en pouvoir d’action collectif.
En éclairant les logiques émotionnelles qui régissent les processus de recrutement dans l’organisation trotskyste Lutte ouvrière (LO), Benjamin Flammand explore les conditions subjectives qui conduisent à « se sentir politiquement engagé ». Il propose ainsi de se concentrer non pas sur les carrières militantes, mais plus en amont du « passage à l’acte », pour mettre en lumière les processus de formation du « moi » militant : autrement dit, la constitution émotionnelle du « sujet » politique. À partir d’un dispositif d’observation ethnographique des « rencards-café », destinés à susciter l’adhésion de jeunes recrues au sein du mouvement trotskyste, ainsi que de récits de vie menés auprès de ces individus recrutés, Benjamin Flammand montre l’existence d’un réel « façonnage affectuel » destiné à faire dériver l’affect politique des recrues vers un ressenti central : celui de la lutte des classes. Du côté de la recrue, ce dispositif engage un profond travail émotionnel qui peut créer l’adhésion militante, mais aussi conduire à la critique et à l’abandon du processus.
Enfin, dans un article original et audacieux, Alain Faure sort des sentiers battus du rationalisme pour retracer les émotions des élu·e·s dans leur carrière politique. Constatant l’absence d’outils conceptuels pour bâtir des ponts entre les expériences émotionnelles et l’agir politique, il prend une voie novatrice pour révéler les dynamiques sociales qui servent d’ancrage dans les ressentis des futur·e·s élu·e·s. Il emprunte des outils à d’autres disciplines, notamment à l’historien Ivan Jablonka ou à la philosophe Vinciane Despret, pour comprendre l’impact des souvenirs émotionnels rencontrés de manière récurrente dans ses recherches auprès de nombreux·euses élu·e·s politiques. En effet, il étudie deux expériences émotionnelles partagées par des dirigeant·e·s gouvernementaux·ales, qu’il nomme les sanglots enfouis et les émois fondateurs, afin de mettre en lumière leur importance dans le devenir politique. Cette démarche sort l’action politique des seules dimensions stratégiques et rationnelles, et permet d’en éclairer le caractère subjectif. De cette manière, elle traite de dimensions peu connues du pouvoir et montre que le désir de faire de la politique relève rarement d’une volonté de prendre le pouvoir, mais plus souvent de la volonté d’agir contre les inégalités sociales.
Émotions, transformation de soi et changement social
Enfin, le troisième groupe d’articles éclaire les liens entre émotions, transformation de soi et changement social. Ces écrits montrent, d’une part, que la distinction entre individuel et collectif s’avère parfois peu heuristique et, d’autre part, que les affects permettent de créer des ponts entre construction des subjectivités et changement social. Ces articles cherchent à saisir la complexité des dynamiques entre le « Je » et le « Nous », et la manière dont l’un façonne l’autre : ils révèlent qu’il s’agit davantage de processus itératifs constitués d’allers et retours difficiles à objectiver, et montrent les effets des normes sociales sur ces constructions subjectives et collectives.
Isabelle Csupor, Roxane Aubry et Mauro Mercolli présentent les résultats d’une recherche participative explorant le potentiel d’empowerment des affects dans les pratiques d’intervention sociale. Les auteur·e·s éclairent, d’une part, le travail émotionnel que les professionnelles du travail social mettent en oeuvre pour déconstruire leurs jugements et stéréotypes afin de soutenir les travailleuses du sexe dans un processus de sortie de ce travail. Elles et il montrent, d’autre part, que le fait de créer des espaces d’accueil empathique des émotions soutient la visée émancipatrice de l’intervention féministe. L’article souligne de plus que les émotions peuvent servir d’outils permettant de mieux saisir les processus de stigmatisation sociale dont font l’objet les travailleuses du sexe et de prendre conscience des effets de ces dynamiques sociales hiérarchisantes sur les subjectivités.
À partir d’une relecture des travaux de John Dewey sur la question des émotions, Emmanuel Petit met en lumière les apports de son approche pour mieux saisir la place des émotions ordinaires dans le changement social. Il montre comment, dans l’approche transactionnelle de John Dewey, l’émotion est dotée d’un pouvoir de transformation sociale, car elle constitue fondamentalement un facteur de transformation de nos habitudes : ce pouvoir de renouvellement s’exerce au niveau de l’individu, mais peut agir au final sur le plan collectif. Selon John Dewey en effet, l’émotion signale et amorce la modification des routines et des règles institutionnelles établies. Elle représente l’élément moteur et unificateur de l’« expérience » : pour obtenir une forme « aboutie » de l’expérience, cette émotion primaire doit être transformée, et l’énergie émotionnelle devient alors une force motrice et organisatrice du changement. Emmanuel Petit éclaire ainsi comment, pour John Dewey, l’émotion peut constituer un pouvoir de transformation de soi et, par prolongement, un pouvoir de transformation sociale et politique. Pour autant, il souligne que les émotions ne conduisent pas systématiquement à la transformation sociale : une habitude émotionnelle peut au contraire nous figer dans une posture qui freine le changement.
Enfin, Jérôme Melançon et Sean E. Moore offrent un regard original sur les minorités québécoises en croisant les travaux des philosophes Jacques Derrida et Alexis de Tocqueville sur la construction des minorités et l’intériorisation de certains ressentis émotionnels. En rappelant que la majorité se construit en référence à des normes sociales plutôt qu’à des chiffres démographiques, ils montrent comment le fait d’appartenir à un segment perçu comme minoritaire ou majoritaire induit des sentiments d’infériorité ou de supériorité chez certains groupes. Pour illustrer ces apports théoriques, ils proposent une analyse de la suppression de deux institutions francophones par le gouvernement ontarien. Avec cet exemple, ils indiquent comment des Canadien·ne·s francophones hors Québec se construisent en regard de l’anglonormativité, et par quels processus ils et elles expérimentent un sentiment de minorisation. À travers cet article, ces auteurs éclairent ainsi le pouvoir des normes sociales sur les subjectivités de groupes sociaux minoritaires.
En conclusion, ces articles originaux et novateurs ouvrent deux voies prometteuses pour la recherche sur les liens entre émotions et politique. D’une part, ils soulignent combien l’étude du pouvoir politique des émotions ne peut se réduire à la seule analyse des discours partisans, car c’est un pouvoir qui se joue à la fois dans les sphères intimes, sociales et publiques : les articles invitent donc à explorer plus avant la multiplicité des liens et les interrelations entre ces sphères pour mieux aborder les dynamiques de politisation des émotions. D’autre part, ces enquêtes montrent comment ces émotions longtemps ignorées en sciences sociales peuvent en réalité être approchées de multiples façons : les différents dispositifs empiriques mobilisés investissent une diversité de langages émotionnels — corporels, oraux ou écrits —, que ce soit au sein de débats politiques, d’échanges sur les médias sociaux, de paroles publiques ou de récits de vie approfondis. Cette diversité méthodologique permet de mieux rendre compte de la grande diversité des émotions qui se jouent actuellement dans le champ politique, et ouvre la voie au renouvellement des réflexions épistémologiques destinées à dépasser le caractère « insaisissable » des émotions collectives en sciences sociales (Kaufmann et Quéré, 2020 ; Perriard et al., 2020 ; De Sena et Scribano, 2020).
Appendices
Bibliographie
- Ahmed, Sara. 2004. The Cultural Politics of Emotions. Édimbourg, Edinburgh University Press.
- Azab, Mariam et Wayne A. Santoro. 2017. « Rethinking Fear and Protest: Racialized Repression of Arab Americans and the Mobilization Benefits of Being Afraid », Mobilization: An International Journal, 22, 4 : 473-491.
- Ballet, Marion. 2012. Peur, espoir, compassion, indignation : l’appel aux émotions dans les campagnes présidentielles (1981-2007). Paris, Dalloz.
- Benski, Tova et Lauren Langman. 2013. « The Effects of Affects: The Place of Emotions in the Mobilizations of 2011 », Current Sociology 61, 4 : 525-540.
- Bericat, Eduardo. 2016. « The Sociology of Emotions: Four Decades of Progress », Current Sociology, 64, 3 : 491-513.
- Blondiaux, Loïc et Christophe Traïni. 2018. La démocratie des émotions. Paris, Presses de Sciences Po.
- Bonikowski, Bart. 2017. « Ethno-nationalist populism and the mobilization of collective resentment », The British Journal of Sociology, 68 : 181-213.
- Braud, Philippe. 1996. L’émotion en politique : problèmes d’analyse. Paris, Presses de Sciences Po.
- Brennan, Teresa. 2004. The Transmission of Affect. New York, Cornell University Press.
- Castells, Manuel. 2015. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. New York, John Wiley et Sons.
- Clough, Patricia. 2008. « The Affective Turn: Political Economy, Biomedia and Bodies », Theory, Culture & Society, 25 : 1-22.
- Crossley, Craig D. 2009. « Emotional and behavioral reactions to social undermining: A closer look at perceived offender motives », Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 1 : 14-24.
- Deluermoz, Quentin, Emmanuel Fureix, Hervé Mazurel et M’hamed Oualdi. 2013. « Écrire l’histoire des émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse », Revue d’histoire du XIXe siècle, 47 : 155-189.
- Demertzis, Nikos. 2014. « Political emotions », dans Catarina Kinnvall, Teresa Capelos et Paul Nesbitt-Larking (dir.). The Palgrave Handbook of Global Political Psychology. Londres, Palgrave Macmillan : 223-241.
- Demertzis, Nicolas. 2013. Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political Tension. New York, Palgrave Macmillan.
- De Sena, Angélica et Adrian Scribano. 2020. « Social Policies and Emotions: A Look from the Global South », dans Angélica De Sena et Adrian Scribano (dir.). Social Policies and Emotions: A Look from the Global South. Londres, Palgrave Macmillan : 1-11.
- Dewey, John et Alexandra Bidet. 2011. La formation des valeurs. Paris, La Découverte.
- Dover, Tessa L., Brenda Major, Jonathan W. Kunstman et Pamela J. Sawyer. 2015. « Does unfairness feel different if it can be linked to group membership? Cognitive, affective, behavioral and physiological implications of discrimination and unfairness », Journal of Experimental Social Psychology, 56 : 96-103.
- Dubet, François. 2019. Le temps des passions tristes : inégalités et populisme. Paris, Éditions du Seuil.
- Fassin, Éric. 2017. Populisme : le grand ressentiment. Paris, Éditions Textuel.
- Faure, Alain. 2015. Les passions de l’élu local, du notable au médiateur. Histoire@Politique, 25, 1 : 197-211.
- Fernandez, Fabrice, Samuel Lézé et Hélène Marche. 2008. Le langage social des émotions. Études sur les rapports au corps et à la santé. Paris, Economica.
- Goodwin, Jeff, James M. Jasper et Francesca Polletta. 2009. Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago, University of Chicago Press.
- Gould, Deborah B. 2009. Moving politics: Emotion and ACT UP’s Fight Against AIDS. Chicago, University of Chicago Press.
- Heaney, Jonathan G. 2019. « Emotion as power: capital and strategy in the field of politics », Journal of Political Power, 12, 2 : 224-244.
- Heise, David R. 1979. Understanding Events: Affect and the Construction of Social Action. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hochschild, Arlie Russell. 2018. Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. New York, The New Press.
- Hochschild, Arlie Russell. 1979. « Emotion work, feeling rules, and social structure », American Journal of Sociology, 85, 3 : 551-575.
- Hutchison, Emma et Roland Bleiker. 2017. « Emotions, discourse and power in world politics », International Studies Review, 19, 3 : 501-508.
- Illouz, Eva. 2017. Emotions as Commodities: Capitalism, Consumption and Authenticity. New York, Taylor & Francis.
- Jeantet, Émilie. 2019. Les Émotions au travail. Paris, CNRS Éditions.
- Jasper, James M. 2014. « Constructing indignation: Anger dynamics in protest movements », Emotion Review, 6, 3 : 208-213.
- Kaufmann, Laurence et Louis Quéré. 2020. Les émotions collectives : en quête d’un objet impossible. Paris, Éditions de l’EHESS.
- Lamont, Michèle, Yun Bo Park et Elena Ayala-Hurtado. 2017. « Trump’s electoral speeches and his appeal to the American white working class », The British Journal of Sociology, 68 : 153-180.
- Le Bart, Christian. 2018. Les émotions du pouvoir : larmes, rires, colères des politiques. Paris, Armand Colin.
- Mabry, J. Beth et Jill K. Kiecolt. 2005. « Anger in black and white: Race, alienation, and anger », Journal of Health and Social Behavior, 46, 1 : 85-101.
- Mackie, Diane M. et Eliot R. Smith. 2016. From Prejudice to Intergroup Emotions: Differentiated Reactions to Social Groups. Londres, Taylor & Francis Group.
- Marcus, George E. 2008. Le citoyen sentimental : émotions et politique en démocratie. Paris, Presses de Sciences Po.
- Mishra, Pankaj. 2017. Age of Anger: A History of the Present. New York, Farrar, Straus and Giroux.
- Nussbaum, Martha C. 2013. Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambridge, Harvard University Press.
- Origgi, Gloria. 2019. Passions sociales. Paris, Presses universitaires de France.
- Perriard, Anne, Carole Christe, Cécile Greset et Micaela Lois. 2020. « Les affects comme outils méthodologiques dans la production d’un savoir collectif », Recherches qualitatives, 39, 2 : 237-259.
- Pickard, Sarah, Benjamin Bowman et Dena Arya. 2020. « "We are radical in our kindness": the political socialisation, motivations, demands and protest actions of young environmental activists in Britain », Youth and Globalization 2, 2 : 251-280.
- Quijano, Aníbal. 2007. « "Race" et colonialité du pouvoir », Mouvements, 51, 3 : 111-118.
- Sommier, Isabelle et Xavier Crettiez. 2019. Les dimensions émotionnelles du politique : chemins de traverse avec Philippe Braud. Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Spelman, Elizabeth V. 1989. « Anger and insubordination », dans Ann Garry et Marilyn Pearsall (dir.). Women, Knowledge, and Reality: explorations in feminist philosophy. Winchester, Unwin Hyman : 263-273.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. « Can the Subaltern Speak? », dans Cary Nelson et Lawrence Grossberg (dir.). Marxism and the Interpretation of Culture. Champaign, University of Illinois Press : 271-313.
- Sprecher, Susan. 1986. « The relation between inequity and emotions in close relationships », Social Psychology Quarterly : 309-321.
- Stets, Jan E. et Jonathan H. Turner. 2006. Handbook of the Sociology of Emotions. New York, Springer.
- Stoetzler, Marcel et Nira Yuval-Davis. 2002. « Standpoint theory, situated knowledge and the situated imagination », Feminist Theory, 3, 3: 315-333.
- Traïni, Christophe. 2017. « Registres émotionnels et processus politiques », Raisons politiques, 65, 1 : 15-29.
- Traïni, Christophe. 2009. Émotions… Mobilisation ! Paris, Presses de Sciences Po.
- Van de Velde, Cécile. 2020. « A global student anger? A comparative analysis of student movements in Chile (2011), Quebec (2012), and Hong-Kong (2014) », Compare: A Journal of Comparative and International Education : 1-19.
- Wilkins, Amy C. et Jennifer A. Pace. 2015. « Class, Race, and Emotions », dans Jane E. Stets et Jonathan H. Turner (dir.). Handbook of the Sociology of Emotions: Volume II. Dordrecht, Springer : 385-409.
- Zummo, Lynne, Emma Gargroetzi et Antero Garcia. 2020. « Youth voice on climate change: Using factor analysis to understand the intersection of science, politics, and emotion », Environmental Education Research, 26, 8 : 1207-1226.

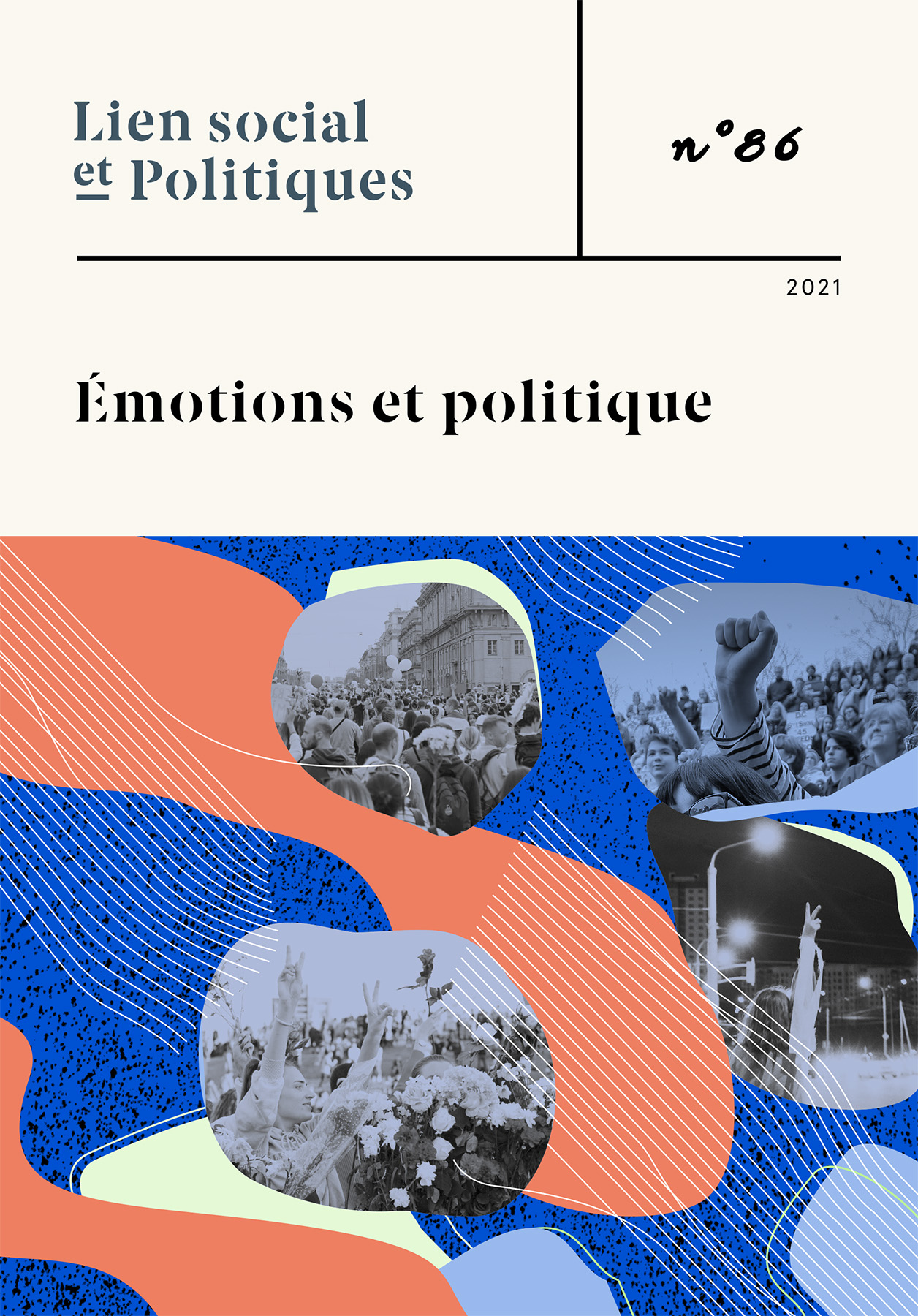
 10.7202/1073517ar
10.7202/1073517ar