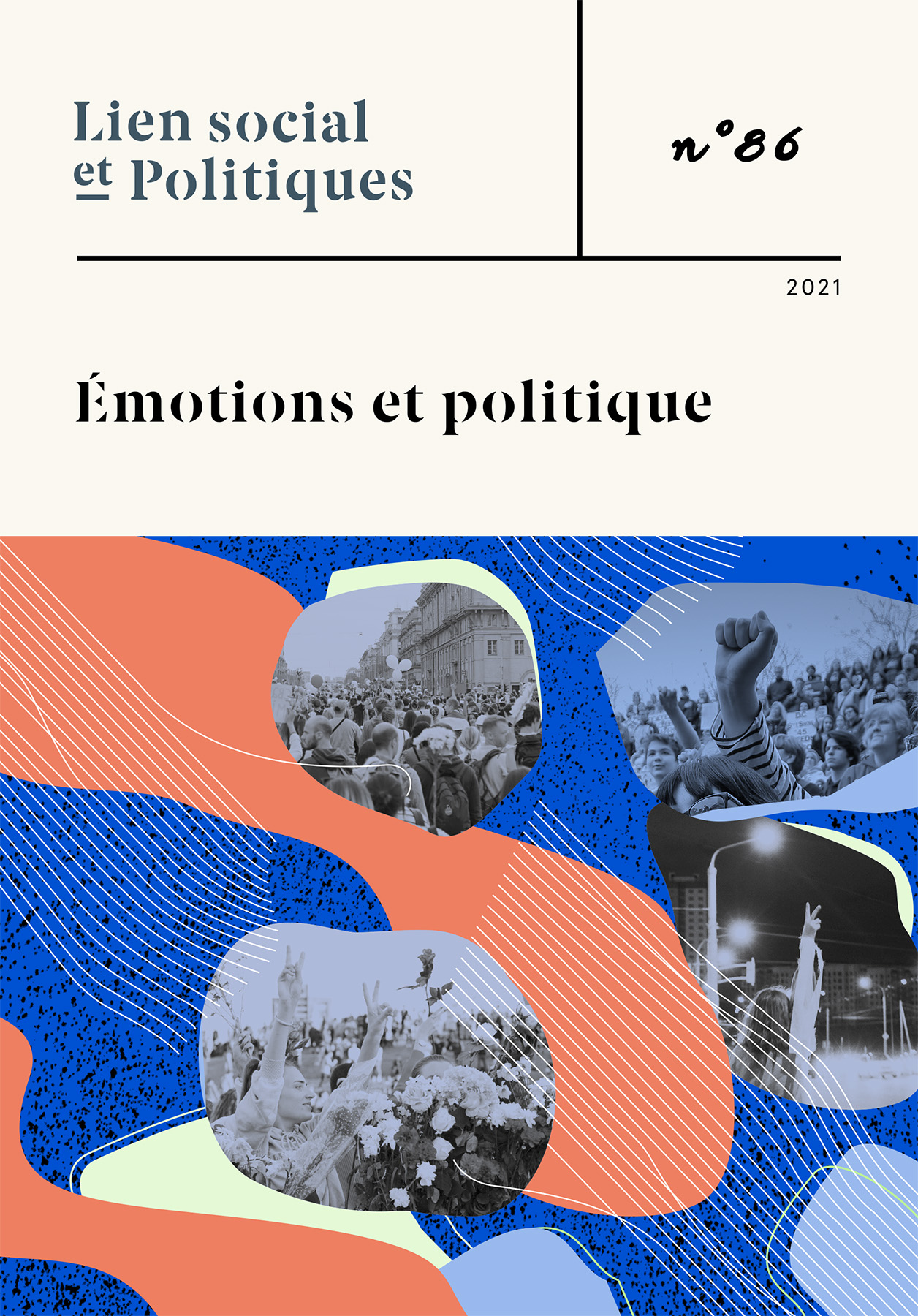Abstracts
Résumé
Alors qu’on associe généralement la peur à des réflexes tels que la fuite, l’inhibition ou la démobilisation lorsqu’il est question de militantisme, cet article examine comment cette émotion peut parfois stimuler l’engagement de militantes féministes. Située au croisement des approches « actionnistes » (Bernard, 2017) des émotions, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie féministe, la discussion proposée s’inspire de 87 entretiens semi-dirigés réalisés entre 2006 et 2015 à travers le Québec, et d’une comparaison entre les milieux féministes suisses romands et québécois grâce aux 31 entretiens réalisés en 2018 et 2019 dans ces deux régions. En tenant compte des niveaux macro, méso et micro de l’analyse, l’article interroge les effets contrastés de la peur sur l’engagement féministe selon le positionnement des actrices dans les rapports sociaux de race, de classe et de sexualité, mais aussi selon les origines de la peur (intra ou extra mouvement), son degré d’intensité, ses interactions avec d’autres émotions (dont la colère) et le travail émotionnel (Hochschild, 2012) des féministes interrogées. L’article brosse ainsi un portrait des causes de la peur chez les féministes pour ensuite analyser les séquences émotionnelles les plus récurrentes en vue de mettre en relief diverses combinaisons émotionnelles et leurs effets sur l’engagement des féministes.
Mots-clés :
- émotions,
- peur,
- engagement,
- mouvement féministe,
- Québec,
- Suisse romande
Abstract
In contrast to common meanings that associate fear with reflexes such as flight, inhibition or demobilization when it comes to activism, this article examines how fear can sometimes stimulate the engagement of feminist activists. Situated at the crossroads of "actionist" approaches (Bernard, 2017) to emotion, sociology of social movements and feminist sociology, the proposed discussion is based on 87 semi-directed interviews conducted between 2006 and 2015 across Quebec, and a comparison between feminist circles in French-speaking Switzerland and Quebec through 31 interviews conducted in 2018 and 2019 in these two regions. Taking into account the macro, meso and micro levels of the analysis, the study focuses more specifically on the contrasting effects of fear on feminist engagement according to the positioning of responded in social relations of race, class and sexuality, but also in relation to the origins of fear (intra or extra movement), its degree of intensity, its interactions with other emotions (including anger) and emotional work (Hochschild, 2012) of the feminists interviewed. The article thus paints a portrait of the causes of fear among feminists and then analyzes the most recurrent emotional sequences in order to highlight various emotional combinations and their effects on feminist engagement.
Keywords:
- emotions,
- fear,
- engagement,
- feminist movement,
- Quebec,
- French-speaking Switzerland
Article body
Souvent qualifiée d’émotion « négative », la peur est régulièrement associée à une « envie d’esquive » (avoidance motivation) en psychologie (Elliot, Eder et Harmon-Jones, 2013) et à des réflexes comme la fuite, l’inhibition, la démobilisation et le désengagement lorsqu’il est question de militantisme[1] (van Troost, van Stekelenburg et Klandermans, 2013; Jasper, 2011; Flam, 2005; Goodwin et Pfaff, 2001).
J’en suis venue à remettre partiellement en cause ces conclusions après avoir réalisé une recherche auprès de féministes québécoises sur les effets politiques, organisationnels, discursifs et biographiques de l’antiféminisme sur leur mouvement. À partir d’un corpus de 87 entretiens semi-dirigés réalisés entre 2006 et 2015 à travers le Québec[2], j’ai pu constater que la peur comptait parmi les conséquences de l’antiféminisme les plus nommées par les féministes oeuvrant contre les violences faites aux femmes. Or, cette émotion ne semblait pas freiner la motivation de certaines d’entre elles. Au contraire, confiait une féministe, face à la menace antiféministe, « je me radicalise encore plus » (Q5-ATR3[3]). En réfléchissant à ses propos, j’en suis venue à formuler l’hypothèse voulant que, par-delà l’antiféminisme, la peur provoque à elle seule des effets contrastés sur l’engagement des féministes et leur répertoire tactique, expliquant parfois même leur entrée dans le mouvement féministe. Pour vérifier cette hypothèse, j’ai réalisé une seconde enquête auprès de 15 féministes québécoises et de 16 féministes de Suisse romande, dans une perspective comparée.
Je discuterai des liens entre la peur et l’engagement des féministes en débutant avec une courte discussion d’ordre théorique et méthodologique, suivie d’une analyse des termes que les participantes utilisent pour différencier les degrés d’intensité de la peur. Après avoir traité de ce que j’appelle le « répertoire de la peur », j’analyserai ses effets sur l’engagement des féministes en fonction des causes de la peur (brutalité policière, violence des hommes et exclusion) souvent communes aux participantes, mais parfois spécifiques aux féministes des minorités (classes, race et sexualité). Ces causes m’amèneront à faire état de « séquences émotionnelles » dans lesquelles les peurs, plus ou moins intenses, s’articulent dans le temps avec d’autres émotions. En somme, il sera démontré que la peur et son interaction avec d’autres émotions (colère, joie) peuvent encourager ou consolider l’engagement des féministes, au contraire des conclusions qui avancent que la peur limite l’engagement militant, comme dans les cas de « chilling effect » (Azab et Santoro, 2017).
1. Cadre théorique, méthodologie et analyse comparée
Cette étude se situe au croisement des approches « actionnistes » des émotions, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie féministe. Par approche « actionniste », j’entends une lecture des émotions « comme partie intégrante du "raisonnement" des act[rices] » (Bernard, 2017 : 153). Combinée à la sociologie féministe, cette dernière permet de rompre avec l’opposition entre émotion et raison pour mieux appréhender le travail de cognition qui se produit lorsque les féministes ont peur. Les recherches qui s’intéressent à la « rationalité affective » (affective rationality) (Boudreau, 2017 ; Flam, 2005 ; Fischer et Jansz, 1994), notamment en observant comment les personnes militantes gèrent leur peur (fear management) lors de manifestations à risque élevé de répression, sont des plus intéressantes. Inspirée par les travaux de Hochschild (2012) sur le travail émotionnel, la notion de fear management renvoie au processus qu’entreprend un mouvement social pour diminuer, supprimer ou transformer la peur des gens mobilisés (Azab et Santoro, 2017).
À ce propos, les travaux de Mariam Azab et Wayne Santoro (2017) démontrent que la peur que ressentent les Arabes-Américains de Détroit depuis le 11 septembre 2001 est une variable explicative de leur engagement militant contre l’islamophobie. Julie-Anne Boudreau, Marilena Liguori et Maude Séguin-Manegre (2015) observent pour leur part l’empowerment que la peur engendre chez des jeunes qui pratiquent ce qu’elles nomment « l’anarchie expérimentale » ou la résistance au dictat sécuritaire des métropoles par la pratique de l’art urbain, de l’escalade d’édifices ou de la surveillance des abus policiers (copwatch) à Montréal. En écho à ces études, plusieurs participantes estiment que la peur peut agir comme un « moteur d’action » politique (Q8_R8PQ), même lorsqu’elles ont peur de la mort, parce que certaines l’ont frôlée de près (voir aussi Robin, 2004).
La comparaison entre les mouvements féministes québécois et romand prend pour objet des groupes identiques, soit des femmes féministes cisgenres[4], étudiées à l’aide d’un dispositif d’enquête symétrique (protocole de recrutement, grille d’entretien, etc.). Le groupe québécois est cependant plus important en nombre (102), étant donné la reprise d’entretiens réalisés lors de la première enquête sur l’antiféminisme (87). La comparaison est également asymétrique au niveau des échelles : en Suisse, seules des féministes de la ville de Genève ont répondu à l’appel à participation, contrairement aux répondantes québécoises qui proviennent de plusieurs régions de la province. Considérant ces asymétries, le Québec demeure, en définitive, le référent à partir duquel le contexte suisse est mis en relation (Jasper, 2019).
Cela dit, la valeur de la comparaison réside dans sa mise en lumière de facteurs communs quant aux effets de la peur, mais aussi des singularités des milieux féministes qui n’auraient pas été révélées sans l’analyse comparée. Par exemple, le rapport différencié qu’entretiennent les féministes avec la police dans les deux contextes permet de cerner les singularités du mouvement féministe québécois, notamment sa combativité, et de nuancer les analyses qui discutent de sa perte de radicalité (Blais, 2019 ; Lamoureux, 2014).
En outre, l’enquête se concentre sur des intervenantes de centres de femmes du Québec ayant principalement pour mandat d’offrir du soutien aux femmes en difficulté et de lutter contre la pauvreté, ainsi que les violences des hommes ou les violences médicales. Elles organisent notamment des dîners-causeries et des manifestations, ou déploient des bannières sur des structures urbaines. Près d’une centaine de centres de femmes sont fédérés grâce à l’association L’R des centres de femmes du Québec. Par l’entremise de cette organisation parapluie, les centres de femmes sont parfois invités à participer à des manifestations syndicales ou étudiantes. Certaines militantes participent même à des contre-sommets sociaux économiques, entre autres le G20 (Toronto, 2010) et le G7 (Québec, 2018). Des participantes sont aussi engagées en politique ou dans des comités femmes de leurs syndicats ou dans des collectifs de femmes racisées ou lesbiennes. Enfin, la majorité des féministes interrogées au Québec et à Genève sont salariées.
En Suisse, des répondantes sont aussi impliquées en politique ou dans leurs syndicats, mais le milieu associatif féministe est beaucoup plus restreint à Genève qu’à Montréal ou à Québec, par exemple. Le mouvement féministe québécois compte sur la présence de réseaux et de fédérations lui permettant d’établir un rapport de force avec l’État ; rapport de force qui n’a pas d’équivalent en Suisse romande. Les Suissesses proviennent de milieux plus divers que les Québécoises, même si leur mandat se concentre principalement sur la formation et l’éducation populaire (sur les stéréotypes de genre, par exemple) ou sur l’information (sites web ou podcasts). La plupart oeuvrent dans des organisations dotées d’un mode de gestion vertical, avec des « cheffes[5] » à leur tête, ce qui n’est pas le cas au Québec. Enfin, elles n’adoptent pas nécessairement de posture militante ni ne pratiquent d’actions directes (le déroulement de bannière, par exemple), à la différence de plusieurs féministes québécoises interrogées (Giugni, 2019 : 81).
Quant à la méthode de traitement des données, elle est largement inductive et répond au critère de l’approche phénoménologique, qui privilégie une écoute des témoignages « pour ce qu’ils ont à nous apprendre, avant que nous soyons tentés de les "faire parler" » (Paillé et Mucchielli, 2008 : 86). Bref, il s’agit de laisser la place à l’expérience des participantes, en leur demandant de raconter un moment, voire des moments où elles ont eu peur en tant que féministes, en commençant par le début de la journée jusqu’au coucher. Se plongeant ainsi dans leurs souvenirs, les participantes ne parlent pas seulement de leurs émotions ; elles les ressentent souvent et les verbalisent généralement. La « conscience du corps » (Déchaux, 2015) est ainsi mobilisée au cours des entretiens, surtout chez celles qui témoignent des violences qu’elles ont vécues. J’emprunte donc à l’approche phénoménologique son invitation à rendre compte de cet aspect de la relation d’enquête en reprenant les mots que les participantes utilisent pour exprimer ce qu’elles ressentent, à l’inverse d’une démarche qui serait tentée de classer ou de différencier ce qui relèverait tantôt de l’anxiété, tantôt de la peur, tantôt de l’affect ou de l’émotion selon les typologies prédéfinies en psychologie ou en sociologie[6].
2. Nommer la peur
L’enquête a permis de constater que les féministes ressentent la peur sous la forme d’un « continuum » (Azab et Santoro, 2017 : 477) qui tient compte des degrés d’intensité de cette émotion. Pour en faire état, les féministes ont privilégié les mots suivants :
Peur et anxiété. Ils sont généralement utilisés pour exprimer une plus grande intensité — les « grandes peurs qui figent » (Q3_R8PQ) — ou une importante fébrilité, incluant des sensations corporelles de sudation et une augmentation du rythme cardiaque. La peur renvoie souvent à un danger appréhendé ou réel, et agit comme « une alerte » (Q3_R3PS).
Crainte est utilisé lorsque les répondantes estiment que le terme peur est « un peu fort » (Q3_R4PS) pour décrire leur état émotionnel. La crainte survient parfois avant la peur, soit juste avant qu’elles se retrouvent devant une menace, ou après la peur, c’est-à-dire lorsqu’elles entament le travail émotionnel visant à diminuer l’intensité de l’émotion. Une féministe québécoise explique à ce sujet que la peur « voyage » : « j’ai une "crainte", elle devient "peur" si la personne a un comportement agressif » (Q3_R15PQ).
Stress, inquiétude et méfiance sont plutôt employés pour désigner une émotion d’intensité moindre, mais qui perdure dans le temps. Comme la crainte, le stress peut aussi survenir avant ou après la peur, par exemple lorsqu’une participante anticipe avoir peur de quelque chose (Q3_R14PQ). La durée plus longue est parfois jugée plus problématique que le temps court de la peur, si ce n’est parce que « je pense que c’est pire d’avoir des inquiétudes qu’avoir peur une journée parce que l’inquiétude reste au fil du temps. Ça nous habite » (Q7_R4PQ).
À noter que les termes de ce « répertoire de la peur » étaient partagés par les répondantes des deux côtés de l’Atlantique. Cela dit, les féministes interrogées ne font pas toujours la différence entre la peur, la crainte et le stress, par exemple, lorsqu’elles parlent des différentes intensités de l’émotion. Pour cette raison — et pour éviter de « les faire parler » (Paillé et Mucchielli, 2008 : 86) —, je ferai usage du mot « peur » comme terme générique, en précisant néanmoins le degré d’intensité et la durée de l’émotion.
3. Le genre de la peur et l’engagement féministe
Des recherches ont montré que la peur semble plus acceptée socialement et culturellement lorsqu’elle est exprimée par une femme que par un homme (Campbell et al., 2016 : 211 ; Ahmed, 2015 : 68) et que la peur des femmes n’est pas la même que celle des hommes (Goodwin et al., 2001). Marylène Lieber (2008 : 225-226) a ainsi montré qu’en France, les hommes — particulièrement blancs — ont plutôt peur du vol, tandis que les femmes — surtout les plus jeunes — ont plutôt peur d’être agressées par un homme.
Faisant partiellement écho à l’étude de Marylène Lieber (2008), la vaste majorité des répondantes raconte avoir peur de la violence des hommes depuis si longtemps que l’une d’elles ne se souvient même plus de « la première fois où j’ai eu peur en tant que femme » (Q8_R13PQ). Dans le cas de femmes racisées, cette peur des hommes s’imbrique à une peur de croiser des sympathisants d’extrême droite ; dans le cas des lesbiennes, d’être agressées par des hommes hétérosexuels ; et, pour d’autres, de subir de la « grossophobie[7] » (Q5_R14PQ). Pour plusieurs féministes, cette « insécurité » est même un « héritage » (Q3_R11PQ) de violences physiques ou sexuelles subies durant l’enfance. Conséquemment, la peur des féministes est le plus souvent influencée par le genre de la peur (Lieber, 2008 : 204 et 214), puisqu’« avant d’être militante, t’es une femme » (Q8_R2PQ).
Or, les impacts de cette peur des hommes sur l’engagement des féministes ne sont pas seulement restrictifs ou limitatifs, même chez celles qui ont été victimes de la violence des hommes ou chez les femmes noires qui apprennent « très tôt à raser les murs » (Q8_R6PQ). L’expérience de la violence genrée en amène certaines à repousser les limites de ce qui leur fait peur (Robin, 2004), à la manière de celles qui ont vécu de la violence conjugale (Q3_R8PQ). La peur de l’agression ou la peur ressentie lors d’une agression sexuelle sont à l’origine de l’engagement féministe de plusieurs participantes, comme le souligne une féministe suisse pour qui, cette émotion, « c’est la base de tout » (Q5_R15PS).
L’expérience de victimisation en tant que femmes, conjuguée aux violences qu’elles subissent en tant que féministes, permet en partie d’expliquer pourquoi les répondantes sont nombreuses à parler de l’importance, pour leur sécurité, de militer en non-mixité choisie (sans hommes cisgenres). Certaines féministes racontent que ces espaces non mixtes leur procurent un sentiment de confiance, de solidarité ou de loyauté (Q8_R14PS ; Q8_R9PQ) qui forme le socle de leur engagement militant. La non-mixité semble ainsi diminuer la fréquence de la peur. Cela dit, des femmes racisées ont souligné l’absence de sentiment de sécurité lorsqu’elles se retrouvent avec des femmes blanches. Pour l’une d’elles (Q6_R7PQ), seuls les « safe space » afroféministes lui procurent ce sentiment de solidarité tant recherché dans l’engagement féministe.
4. Les séquences émotionnelles et leurs effets
L’enquête révèle l’importance de considérer le « temps des émotions » (Boudreau, 2017 ; Hochschild, 2012 ; Flam, 2004 ; Goodwin, Jasper et Polletta, 2001), qui peut être de plus courte durée, notamment durant une manifestation, ou de plus longue durée comme pour celles qui craignent un attentat antiféministe. Pour tenir compte de cette dimension temporelle, j’ai identifié des séquences émotionnelles dans lesquelles la peur s’articule dans le temps avec des émotions comme la colère et la joie, pour former diverses « constellations émotionnelles » (emotional constellation) (van Troost, van Stekelenburg et Klandermans, 2013). Je présente ici les séquences émotionnelles les plus récurrentes, en fonction des causes les plus souvent citées, qu’elles soient extra-mouvement (répression policière et violences des hommes) ou intra-mouvement (racisme, classisme et lesbophobie des féministes).
a. La peur de la violence policière en contexte de manifestation
La recherche souligne que la peur des policiers est partagée par les féministes qui ont participé à des manifestations, indépendamment de leur positionnement dans les rapports sociaux de sexualité, de classe ou de race. Cela dit, le rapport aux policiers semble moins conflictuel en Suisse qu’au Québec, notamment parce que les Genevoises se plient à l’obligation de demander l’autorisation pour la tenue d’un rassemblement ou d’une manifestation et que les autorités sont, en général, moins répressives qu’au Québec (Giugni, 2019 : 55). Une Genevoise ayant une longue expérience de manifestations contre les sommets sociaux économiques raconte avoir « des souvenirs des flics qui nous ouvraient la manifestation à vélo. […] Une année, on les a même vus en patins à roulettes ! » (Q3-R9PS). Il en va autrement pour les féministes québécoises, qui font davantage usage de l’action directe, par exemple, en occupant des bureaux de députés, en déroulant des bannières du haut de ponts ou en organisant des contingents féministes dans des manifestations réprimées par la police. Plusieurs d’entre elles ont vécu ou vu des violences policières durant la grève étudiante de 2012 et ont pris le risque de participer à des manifestations dont l’itinéraire n’avait pas été remis aux autorités[8] (entre 2012 et 2019).
Cela dit, la joie, la fierté ou « l’émerveillement […] de voir qu’il y en a qui croient assez aux changements sociaux pour [participer à la manifestation] » (Q7_R12PQ) interviennent régulièrement avant la peur de la brutalité policière, selon plusieurs Québécoises et une minorité de Suissesses. C’est le cas de cette militante qui raconte que « c’est le fun d’être ensemble. On est là. On est fortes » (Q7_R7PQ). Autrement dit, la séquence émotionnelle liée à la violence policière débute souvent avec des émotions agréables, et se déploie généralement comme suit (tableau 1) :
Tableau 1
La peur de la violence policière
À l’instar des activistes d’ACT UP (Gould, 2002), l’intensité du plaisir semble ainsi stimuler l’engagement, voire le désir de manifester pour la vaste majorité des féministes interrogées. Parfois, les émotions de peur et de joie sont ressenties dans un même moment, comme l’explique une participante lors d’une manifestation où il y avait une forte présence policière : « j’étais quand même contente d’être là […]. Mais, je n’étais quand même pas hyper en confiance et à l’aise » (Q7_R7PS). Une autre féministe parle de la combinaison peur et plaisir, en utilisant l’image de l’alpinisme : « Dans l’alpinisme, tu as la peur, mais tu as les outils pour grimper, te protéger, une corde. Le plaisir d’aller en haut de la montagne est plus fort. » (Q7_R10PQ)
En plus du plaisir de manifester, la solidarité, « un sentiment de sororité » (Q7_R10PQ) ou la confiance ressentie lors de moments où elles sont exposées au risque de violence policière stimulent aussi le désir des féministes de participer à des manifestations. La confiance, en tant qu’émotion partagée, leur permet notamment d’entreprendre un travail émotionnel collectif visant à diminuer l’intensité de la peur, à l’instar de cette féministe pour qui « le fait de nommer [sa peur], d’échanger un peu pour savoir si les autres ressentent la même chose ou pas, c’est une manière de l’exprimer. Ça me fait déjà du bien » (Q7_R7PS). Le désir de manifester est également plus grand chez celles qui ont de « l’expérience » (Q4_R3PQ) ou une connaissance des risques, puisque ce capital militant leur permet d’anticiper le travail émotionnel et de diminuer l’intensité de la peur. Autrement dit, « [puisqu’]on sait que c’est une aventure risquée parce que, je veux dire, ce n’était pas la première manif » (Q7_R7PQ), « on ne sera pas niaiseuses. On va faire des trucs, maquillées [et les policiers] ne pourront pas nous reconnaître » (Q7_R10PQ). Grâce à cette connaissance des risques, une répondante ajoute parvenir à transformer « la peur » en « prudence » (Q7_R10PQ).
Dans un contexte de manifestation, la maternité agit toutefois comme un facteur pouvant augmenter l’intensité de la peur ainsi que sa fréquence. Elle réduit le désir de manifester surtout lorsque les enfants ne sont pas sous la responsabilité directe des répondantes et qu’une violence policière (ou la violence des hommes) les menace. Autrement dit, les mères ont peur de ne pas pouvoir s’occuper de leurs enfants si elles se font emprisonner ou hospitaliser. Inversement, la maternité peut diminuer l’intensité et la fréquence de la peur des répondantes lorsque l’enfant les accompagne et qu’elles doivent assurer leur sécurité. Se sentir responsable d’autrui n’est cependant pas l’apanage unique des mères, puisque le travail de soin fait partie intégrante de la socialisation féminine, estime une participante (Q4_R15PS). À propos du travail émotionnel qu’exige une telle responsabilité, il vise surtout à présenter une image de force, « parce qu’on veut correspondre encore une fois à des bouées et des filles fortes » (Q6_R15PQ). Dans un tel cas, elles s’efforcent de ne pas laisser paraître la peur qu’elles ressentent. Une féministe illustre bien ce travail émotionnel ou le fear management lorsqu’elle est responsable d’un groupe :
[…] quand tu es tout seul, avoir peur, c’est correct […]. Mais quand on est vingt, trente, quarante à avoir ce sentiment-là, ça grossit et tu te dis : « Bon, je ne peux pas me laisser aller à cette peur-là, c’est moi qui suis responsable. » Tu essaies de relativiser un peu tout ça et tu te dis : « Ce n’est pas si pire que ça. La police va débarquer, mais c’est à moi qu’elle va parler. Ils n’iront pas voir mes femmes tout de suite. »
Q7_R9PQ
Or, poursuit-elle :
[…] selon la crainte en question, des fois c’est facile à défaire en te disant : « Bien voyons. C’est dans ta tête. Tu n’as pas d’affaire à avoir peur. » D’autres moments, tu te dis : « Il me semblait que c’était une action que l’on dit verte, mais finalement c’est peut-être un peu plus jaune orange que vert. » Tu te demandes : « Est-ce que j’ai donné les bons renseignements à mes femmes ? Est-ce que c’est plus dangereux que je pensais ? »
Q7_R9PQ
Diffusé par l’organisme L’R des centres de femmes, le code de couleurs dont elle parle qualifie de « vertes » les actions où « il n’y a pas vraiment de risque d’arrestations », de « jaunes » celles où « il y a quand même des risques que tu te fasses arrêter » et de « rouge », « une action directe ou illégale » (Q5_R3PQ). En somme, l’évaluation de la gravité du danger, tout comme le dialogue que les femmes entretiennent avec la peur dans les cas où elles sont responsables de la sécurité d’autres femmes agissent comme des facteurs qui influencent de manière contrastée l’intensité de la peur, ainsi que la volonté de participer à des manifestations.
Enfin, la colère, qui suit de près la peur de la violence policière ou la constellation joie et peur, persiste parfois dans le temps, comme chez cette militante suissesse qui, en raison de sa longue expérience de manifestations réprimées lors de sommets internationaux, parle d’une « colère noire » qui perdure (Q7_R9PS). Lorsque la rationalité affective donne naissance à la colère, l’effet de stimulation de l’engagement s’exprime clairement : « je ne veux pas être intimidée. J’estime que j’ai le droit. La société ne me convient pas, j’ai le droit de l’exprimer dans l’espace public. On n’a pas à m’empêcher. On n’a pas à me brutaliser » (Q3_R9PS). Certaines racontent même que la crainte combinée à la colère ressentie face à un déni de leur « droit » de manifester les conduise à « reste[r] là, même si on nous dit que [la manifestation est] illégale » (Q7_R7PQ).
En résumé, la majorité des effets recensés concernent les tactiques de protection mises en place par les féministes québécoises pour augmenter leur sentiment de sécurité, incluant le code de couleur évoqué plus tôt et les nouvelles recommandations destinées aux participantes des centres de femmes (dont le fait de rester groupées et de toujours avoir le numéro de téléphone d’une intervenante sur soi). Autrement dit, la séquence émotionnelle liée à la violence policière ne produit pas d’effets délétères sur la participation des féministes aux diverses manifestations, si ce n’est que certaines, dont les mères, choisissent de ne pas se joindre à des manifestations à risque élevé de brutalité policière (Q5_R2PQ). Indépendamment de leur positionnement dans les rapports sociaux de classe, de race et de sexualité, leur plaisir de manifester semble plus important que la peur, même dans les moments où le plaisir et la peur sont indissociables, surtout chez les féministes qui ont fait plus d’une fois les frais de la violence policière.
Un dernier effet de cette séquence touche au changement de perception de la police, notamment parce que les escouades antiémeutes sont largement composées d’hommes. Certains récits recueillis témoignent d’un déplacement dans la perception de l’escouade antiémeute, cette dernière passant d’une figure de protecteur à celle d’une menace pour la sécurité des femmes. Ces récits font écho aux mots de la militante Ronni (citée par Dupuis-Déri, 2010 : 236-237) qui explique avoir retrouvé l’origine de sa peur : « et c’est un homme sans visage qui va me blesser d’une manière ou d’une autre. […]. Donc, ces policiers antiémeutes […] sont, en quelque sorte, devenus le symbole de toutes mes peurs, de tous les hommes qui pourraient me blesser ». À la lumière de ces propos, force est de constater que la capacité à contrôler la source de la peur, c’est-à-dire la violence policière, semble illusoire pour celles qui la considèrent comme l’ultime incarnation de la violence des hommes, plus diffuse et plus fréquente.
b. La peur de la violence commise par des hommes cisgenres
La peur de la violence des hommes produit quant à elle deux séquences qui causent le même type d’effet (tableau 2) :
Tableau 2
La peur de la violence commise par des hommes cisgenres
La première séquence débutant avec la colère renvoie aux agressions que les féministes subissent en tant que femmes hétérosexuelles, lesbiennes, racisées, blanches, provenant de milieux pauvres ou favorisés. Elles ressentent ainsi une « colère de l’injustice », comme cette féministe qui a reçu des insultes par courriel (Q7_R5PQ) lors d’un événement public qu’organisait son groupe. Même s’il est souvent impossible de séparer la peur de la colère, ces deux émotions sont parfois ressenties à des moments distincts : « C’est la rage en premier. […] En premier, je me disais : "c’est le genre de personne harcelante et macho, etc." Je me suis sentie attaquée. C’est la rage qui est venue en premier » (Q7_R5PQ). Peu de temps après, elle se dit que le cyber agresseur connaît son prénom. À partir de ce moment :
[…] on pourrait décliner la peur en deux faces comme une peur en lien avec ma vie personnelle, le fait qu’on puisse me retracer et voir où est mon bureau [et une] peur pour l’événement lui-même. Que pendant la semaine, un groupe de masculinistes s’organise, vienne boycotter ou nous intimider lors de la semaine. J’ai eu peur pour moi et pour les personnes qui viennent participer aussi.
Q7_R5PQ
Ces propos illustrent bien le fait que le sentiment de responsabilité envers autrui peut aussi stimuler la peur comme dans les autres cas où des féministes agressées personnellement ressentent d’abord de la colère, puis de la peur face à un risque d’une action collective antiféministe. Cette séquence les amène à développer des dispositifs de protection pour leurs activités féministes. Outre « l’hyper vigilance » (Q5_R4PQ), elles s’organisent pour ne jamais rester seules le soir au travail, s’assurant même de « sortir à deux pour se rendre à la maison » (Q5_R4PQ). D’autres n’oublient pas de bien « barrer les portes » (Q5_R15PQ) de l’établissement, d’identifier les sorties de secours lors d’événements féministes, d’assurer leur anonymat sur les médias sociaux (Q5_R14PQ), ou de faire appel à un service de sécurité.
Certains de ces dispositifs de protection rappellent ceux des femmes qui craignent le harcèlement de rue (Lieber, 2008 : 247) ; ils font écho au genre de la peur discuté plus tôt. En général, cette « stratification » de la peur des agressions commises par des hommes chez les féministes interrogées ne provoque pas d’effets de désengagement militant, bien au contraire. La colère qui accompagne cette peur de la violence ne fait que « confirmer qu’il faut que je continue à m’engager. C’est pertinent d’unir nos forces et d’aller contrer tout cela. C’est cette rage-là. Un moteur de résistance », estime une participante (Q7_R5PQ).
Lorsque la séquence débute avec la peur (peur et colère = mécanismes de protection), il convient de rappeler que la peur d’un attentat antiféministe est à l’origine d’une peur durable chez les féministes québécoises, en raison des deux attentats commis à Montréal et à Québec[9]. Selon l’historique de violence des féministes interrogées, l’anticipation d’un attentat antiféministe peut avoir des effets délétères plus importants (une hypervigilance récurrente, par exemple) que la peur de la violence policière pour quelqu’une qui n’en aurait jamais fait les frais. Une Québécoise indique à ce propos que la tuerie de l’École polytechnique peut « colonise[r] l’imaginaire » (Q3_R6PQ). D’autres parlent d’un « climat » (ATR1) ou d’un « régime de peur » (RT6), voire d’une « épée de Damoclès » (Q6_ATR5) suspendue au-dessus de sa tête lors de rassemblements féministes, depuis qu’elle a pris connaissance de l’attentat de l’École polytechnique (Q3_14PQ).
Dans cette séquence, la colère suit de près la peur, comme dans le cas de cette féministe qui raconte que lorsqu’elle lit un commentaire haineux sur les médias sociaux « que je trouve vraiment épeurant parce qu’il est violent ou peu importe, après ça je vais sentir de la colère, en plus de la peur » (Q7_R13PQ). Selon cette féministe genevoise, « des injustices qui peuvent générer de la peur, moi je pense que c’est plutôt un moteur qu’autre chose. […] C’est comme le trac. Il y a un petit moment comme ça et après, vous vous lancez » (Q7_R2PS). En somme, la colère suit de près la peur lorsque la rationalité de cette peur s’articule ainsi :
[…] quand tu as peur, tu es en colère de ressentir cette peur-là, parce que tu te dis : « Pourquoi je n’aurais pas le droit d’exister et de me défendre des attaques que je reçois comme femme ? » Il y a comme une colère envers ces personnes qui te font ressentir de la peur parce qu’ils essaient d’enlever le pouvoir que tu veux ressentir
Q7_R14PQ
À l’instar de la colère-peur, la constellation peur-colère produit des effets de protection, notamment lorsque les féministes mettent en place des dispositifs de sécurité. Lorsque la peur ne s’arrime pas à la colère (peur-colère), la peur de la violence perpétrée par des hommes peut occasionner un sentiment de lassitude, de la tristesse (Q7_R1PS) ou une crainte de ressentir une peur de haute intensité (Q7_R11PS). Il convient toutefois d’identifier le plaisir (joie) que les féministes ressentent régulièrement (Q7_R13PQ ; Q7_R8PQ) comme un facteur qui neutralise les effets de désengagement que peut produire une peur durable.
c. La peur de l’exclusion
La peur de l’exclusion est liée aux clivages internes aux mouvements féministes que produisent les rapports sociaux de classe, de sexualité et de race. Pour le dire avec les mots d’une afroféministe, il s’agit de « la peur que cela puisse générer, le fait que mon militantisme soit toujours à moitié en tant que femme à la croisée des oppressions » (Q3_R7PQ). Largement partagée par les féministes noires et celles d’origine ouvrière, la séquence de ces femmes fait d’abord intervenir la colère (tableau 3) :
Tableau 3
La peur de l’exclusion
Chez les féministes des milieux ouvriers, la colère intervient sans conteste au début de la séquence émotionnelle, comme en témoigne ce récit de mépris de classe, lors d’une discussion avec d’autres féministes sur les problèmes de logement et de pauvreté :
[Si je retourne] à [moi] d’il y a 15 ans, qui vit une peur et qui va sacrer et qui va la laisser sortir sa colère. […] [Moi qui viens de] dire une vérité, mais avec un « esti de calisse » au bout et là je me fais regarder comme : « Bien voyons donc. » Et je leur dis : « Esti, je ne les ai pas tes diplômes, mais ce n’est pas dur, regarde ! » Je vais défendre les logements pour les femmes. Je suis contre la gentrification, je suis contre la pauvreté […]. Je m’ouvre la trappe, mais je n’ai pas le bon mot qui sort du bon dictionnaire. Je ne suis pas une urbaniste […]. Mais j’ai deux yeux. J’ai marché. Mon quartier, je le connais. Chaque trottoir, chaque rue. Quand je les entends dire : « Mais là, ce n’est quand même pas si grave que ça. » Esti ! Ils vont tous dormir dehors ! C’est quoi le problème ? Et là je sens un jugement.
Q7_R8PQ
Autrement dit, la peur du « jugement », voire de l’exclusion des milieux féministes majoritaires, s’imbrique ici à une colère de la négation de leur parole en raison d’un préjugé de classe voulant qu’elle ne s’exprime pas avec « les bons mots » (Q7_R8PQ).
Parmi les féministes racisées interrogées, certaines confient ressentir une colère face au racisme des féministes blanches majoritaires et même ressentir de la « révolte. Enfin, un certain moment, j’ai comparé ce groupe à une famille traditionnelle » (Q7_R8PS). Par contre, la colère est une émotion que les féministes noires cherchent parfois à réprimer ou à ne pas verbaliser publiquement, de crainte d’incarner la caricature de la « femme noire en colère » (Amhed, 2012 ; Flam, 2005 : 34). Pour les répondantes racisées, la peur prend généralement toute la place dans la séquence. Elles sont habitées d’une peur « de se distinguer, d’être perçues comme celles qui dérangent la famille féministe en train de dénoncer le patriarcat », d’autant plus que « les femmes blanches nous font et peuvent nous défaire à n’importe quel moment » (Q3_R7PQ). À cela s’ajoute la peur des agressions racistes à l’extérieur du mouvement féministe, à l’instar d’une participante [Q8_R15PQ] qui a subi une attaque au couteau de jeunes néonazis dans le métro de Montréal. La rationalité de cette peur peut se traduire sous forme de questions, à savoir : si je dénonce le racisme, « est-ce que ça va me fermer des portes dans mon combat actuel ? Est-ce que [je vais perdre] la place si durement acquise, parmi les autres ? » (Q3_R7PQ). La peur de l’exclusion peut être très intense, comme dans le cas d’une Genevoise qui se souvient d’avoir été « frappée », quand elle a commencé à fréquenter des féministes blanches, « de ce regard réducteur sur la femme qui vient du Sud, la femme qui vient des pays arabes et tout ça. C’était terrible, les préjugés. Terrible. À tel point, je me suis dit : "Est-ce que je suis avec le bon public ?" » (Q7_R8PS)
En outre, la « solidarité obligatoire » (Flam, 2005) « exigée » par les féministes blanches majoritaires est à considérer dans l’analyse des effets de la peur autant chez les féministes racisées, que chez celles d’origine ouvrière, ou chez les lesbiennes[10]. En imposant (volontairement ou pas) un entre-soi blanc, hétérosexuel et de classes privilégiées, les féministes majoritaires génèrent une peur de l’exclusion chez celles qui ne partagent pas les privilèges de l’entre-soi ou qui voudraient les critiquer. Les femmes racisées interrogées sont certes délégitimées différemment des féministes de tradition ouvrière ou des lesbiennes (en regard de la manière dont elles se positionnent), mais elles verbalisent les mêmes effets « d’autocensure » (Q3_R7PQ) ainsi que des effets de désengagement partiel (Q7_R8PQ) (Ouali, 2015), notamment parce « [qu’]on s’identifie un peu moins à la contestation collective » (Q3_R7PQ). À propos de la censure, une féministe lesbienne choisit, par exemple, de taire son orientation sexuelle lorsqu’elle entend des propos lesbophobes (Q8_R6PQ). La constellation colère et peur conduit aussi des féministes racisées à procéder à un « transfert de loyauté », pour paraphraser Helena Flam (2004 : 30), à l’intérieur d’organisations afroféministes (Q6_R7PQ), tout en entretenant un engagement plus « distancié » (Ricci, Blais et Descarries, 2008) avec les milieux féministes majoritaires.
Malgré les effets de cette peur-colère de l’exclusion sur l’engagement des féministes racisées, l’une d’elles raconte vouloir « trouver des stratégies […] pour trouver ma place. […] C’est difficile, mais ça me pousse, ça m’apprend à aller au-delà de mes limites et de comprendre […] les dynamiques de pouvoir et tout ça » (Q3_R7PQ). Cette citation confirme que les effets de cette séquence émotionnelle n’ont pas gain de cause sur la détermination des féministes minoritaires à combattre les comportements racistes, classistes et lesbophobes dans les milieux féministes[11].
Conclusion
Cette étude a permis de démontrer l’intérêt d’étudier les émotions de manière séquentielle pour qui veut saisir les effets de la peur sur l’engagement des féministes. Non seulement les séquences sont constituées de diverses constellations émotionnelles qui n’ont pas toujours le même effet, mais la peur a beaucoup moins de risque d’occasionner un désengagement militant (Azab et Santoro, 2017 : 482) lorsqu’elle est accompagnée de la colère. Il en va de même lorsque le plaisir et la joie viennent s’ajouter à la séquence émotionnelle. Or, les féministes minoritaires semblent moins à l’abri d’un désengagement partiel lorsque la constellation « peur-colère » trouve ses origines dans les dynamiques d’exclusion des mouvements féministes. Je souhaite aussi rappeler que l’expression « peur-colère » a servi à bien marquer l’indissociabilité de ces émotions au moment où les participantes les ressentent et à insister sur le fait que « la colère et la peur sont deux émotions qui vont de pair » (Q10_R15PQ).
La peur provoque donc différents effets sur l’engagement et les tactiques des féministes (dispositifs de protection, censure, approfondissement des connaissances et retrait partiel des milieux féministes majoritaires), notamment selon leur positionnement dans les rapports sociaux de classe, de race et de sexualité. Ces effets dépendent aussi de l’intensité et des causes de la peur. Par exemple, la peur de l’exclusion chez les féministes racisées semble souvent plus intense que la peur d’une violence policière chez les féministes qui possèdent un certain capital militant. Enfin, les effets de la peur sont aussi tributaires du fear management et, plus largement, du travail émotionnel visant à diminuer l’intensité de la peur pour soi et pour les autres.
Ces quatre constats (tenir compte des rapports sociaux, de l’intensité de l’émotion, des causes de la peur et du travail émotionnel) permettent de dégager d’autres apports de la recherche à la sociologie des mouvements sociaux. Premièrement, on ne peut pas dissocier la peur de la violence des hommes que ressentent ces militantes féministes en tant que femmes de la peur que ressentent ces femmes en tant que militantes féministes, essentiellement parce que la peur est ici le moteur initial de leur engagement. En outre, plus elles ont l’impression d’avoir du contrôle sur ce qui leur fait peur ou plus elles la verbalisent entre féministes (essentiellement grâce au travail émotionnel et aux tactiques développées), plus elles parviennent à diminuer l’intensité de la peur et moins elles sont susceptibles de se distancier du mouvement féministe. En ce sens, la peur de la violence policière est plus facile à négocier chez celles qui semblent en contrôle des risques qu’elles prennent lors de manifestations, tandis que la domination masculine et la violence antiféministe, voire la violence raciste, sont, par définition, incontrôlables, considérant le caractère systémique de ces violences et le fait que les féministes ne peuvent prévoir à quel moment ni quand elles en seront la cible. En somme, la peur est une émotion complexe qu’on ne peut qualifier de « négative » (même si elle peut être désagréable à ressentir), du moins en regard de cette enquête qui souligne ses effets de stimulation sur l’engagement des féministes.
Appendices
Notes
-
[1]
Je remercie Julie-Anne Boudreau, Marco Giugni et Francis Dupuis-Déri pour leur relecture attentive et leurs judicieux conseils.
-
[2]
Une recherche appuyée par le Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC), le Réseau québécois en études féministes (RéQEF), le Syndicat des chargées de cours de l’UQAM et le Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
-
[3]
Chaque témoignage est identifié par un code alphanumérique pour garantir l’anonymat des participantes. Ce code contient les informations suivantes : « Q » pour question, suivie de son numéro. « R » pour répondante, suivie d’un numéro attribué à la personne, et « PQ » pour participante québécoise ou « PS » pour participante suissesse.
-
[4]
Dont l’identité de genre correspond à celle assignée à la naissance.
-
[5]
Je reprends ici la façon dont elles parlent de leur supérieur.e.
-
[6]
Si je mobilisais les catégories plus convenues (Jasper, 2018 ; Ahmed, 2015 ; Blum, 2005 ; Goodwin, Jasper et Polletta, 2001 ; Fischer et Jansz, 1995), je reprendrais alors la définition de Bernard (2017 : 35), selon qui les émotions sont une « modification ressentie de l’état du corps dont le motif ou la cause résulte d’une perception ou d’une pensée » (Bernard, 2017 : 35). Cette définition correspond aussi bien à la peur de courte durée qu’à celle plus diffuse ou permanente, et que l’on pourrait nommer « sentiment » (le sentiment de crainte, par exemple).
-
[7]
Un néologisme qui fait référence à l’hostilité à l’endroit des personnes grosses.
-
[8]
À la suite de l’amendement du règlement P-6 en 2012, finalement abrogé par la Ville de Montréal sous l’administration de Valérie Plante, en 2019 (Bordeleau, 2019).
-
[9]
Le 6 décembre 1989, un tueur a assassiné 14 femmes au nom de l’antiféminisme à l’École Polytechnique de Montréal (Blais, 2015). Le 29 janvier 2017, un tueur a pénétré au Centre culturel islamique de Québec pour y assassiner 6 musulmans. Ce dernier s’intéressait aussi à des groupes féministes (Mathieu, 16 avril 2018).
-
[10]
Bien que des féministes se situent à l’intersection de ces oppressions, elles discutent d’une identité ou d’une autre lors des entrevues.
-
[11]
Cette détermination suggère aussi des effets de peur chez les féministes de la majorité ; effets que le manque d’espace ne permet pas de détailler ici.
Bibliographie
- Ahmed, Sara. 2015. The Cultural Politics of Emotion. NY, Routledge.
- Ahmed, Sara. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) », Cahiers du genre, 53 : 77-85.
- Azab, Mariam et Wayne A. Santoro. 2017. « Rethinking Fear and Protest: Racialized Repression of Arab Americans and the Mobilization Benefits of Being Afraid », Mobilization : An International Journal, 22, 4 : 473-491.
- Bernard, Julien. 2017. La concurrence des sentiments. Une sociologie des émotions. Paris, Métaillé.
- Blais, Mélissa. 2019. « Effets des tactiques antiféministes auprès des institutions oeuvrant contre les violences faites aux femmes : le cas du Québec », dans Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (dir.). Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui. Paris, PUF.
- Blais, Mélissa. 2015. « I Hate Feminists! » December 6, 1989 and its Aftermath. Melbourne, Spinifex Press.
- Blum, Alan. 2005. « PANIC AND FEAR: On the Phenomenology of Desperation », The Sociological Quarterly, 37, 4 : 673-698.
- Bordeleau, Stéphane. 2019. « La Ville de Montréal se débarrasse du règlement P-6 », Radio-Canada, 13 novembre. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388389/ville-montreal-abrogation-reglement-p-6. Page consultée le 1er avril 2020.
- Boudreau, Julie-Anne. 2017. Global Urban Politics: Informalization of the State. Malden, Polity Press.
- Boudreau, Julie-Anne, Marilena Liguori et Maude Séguin-Manegre. 2015. « Fear and Youth Citizenship Practices: Insights from Montreal », Citizenship Studies. http://dx.doi.org/10.1080/13621025.2015.1006177. Page consultée le 8 septembre 2019.
- Campbell, Anne, Claire Coombes, Raluca David, Adrian Opre, Lois Grayson et Steven Muncere. 2016. « Sex Differences Are Not Attenuated by a Sex Invariant Measure of Fear: The Situated Fear Questionnaire », Personality and Individual Differences, 97 : 210-219.
- Déchaux, Jean-Hugues. 2015. « Intégrer l’émotion à l’analyse sociologique de l’action », Terrains/Théories 2. https://teth.revues.org/208. Page consultée le 10 septembre 2019.
- Dupuis-Déri, Francis. 2010. « Nouvelles du front altermondialiste : L’Armée de clowns rebelles tient bon », Les cahiers de l’idiotie, 3 : 215-250.
- Elliot, Andrew J., Andreas B. Eder et Eddie Harmon-Jones. 2013. « Approach-Avoidance Motivation and Emotion: Convergence and Divergence », Emotion Review, 5, 3 : 308-311.
- Fischer, Agneta H. et Joroen Jansz. 1995. « Reconciling Emotions with Personhood », Journal for the Theory of Social Behaviour, 25 : 59-80.
- Flam, Helena. 2005. « Emotions’ Map: A Research Agenda », dans Helena Flam and Debra Kin (dir.). Emotions and Social Movements. Londres, Routledge : 19-40.
- Flam, Helena. 2004. « Anger in Repressive Regimes: A Footnote to Domination and the Arts of Resistance by James Scott », European Journal of Social Theory, 7, 2 : 171-188.
- Goodwin Jeff, James Jasper et Francesca Polletta. 2001. « Introduction: Why Emotions Matter », dans Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta (dir.). Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago, University of Chicago Press : 1-26.
- Goodwin, Jeff et Steven Pfaff. 2001. « Emotion Work in High-Risk Social Movements: Managing Fear in the U.S. and East German Civil Rights Movements », dans Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta (dir.). Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago, University of Chicago Press : 282-302.
- Gould, Deborah B. 2002. « Life During Wartime: Emotions and the Development of ACT UP », Mobilization: An International Journal, 7, 2 : 177-200.
- Giugni, Marco. 2019. La Suisse dans la rue : Mouvements, mobilisations, manifestants. Lausanne, Savoir Suisse.
- Hochschild, Arlie R. 2012. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. 2e édition. Berkeley, University of California Press.
- Jasper, James M. 2019. « Afterword: comparative versus historical research », Social Movement Studies, 18, 1 : 130-136.
- Jasper, James M. 2011. « Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research », Annual Review of Sociology. . Page consultée le 6 juin 2018.
- Lieber, Marylène. 2008. Genre, violences et espaces publics : La vulnérabilité des femmes en question. Paris, Presses de Sciences Po.
- Lamoureux, Diane. 2014. « Retrouver la radicalité du féminisme », Possibles, 38, 1 : 56-70.
- Mathieu, Isabelle. 2018. « Bissonnette avait les musulmans et les féministes dans la mire », La Tribune, 16 avril. https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/bissonnette-avait-les-musulmans-et-les-feministes-dans-la-mire. Page consultée le 8 septembre 2019.
- Ouali, Nouria. 2015. « Les rapports de domination au sein du mouvement des femmes à Bruxelles : critiques et résistances des femmes minoritaires », Nouvelles Questions Féministes, 34, 1 : 16-34.
- Paillé, Pierre et Alex Mucchielli. 2008. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris, Armand Colin.
- Ricci, Sandrine, Mélissa Blais et Francine Descarries. 2008. « Une solidarité en mouvement : figures de la militance féministe québécoise », Amnis : Revue de civilisation contemporaine. http://www.univ-brest.fr/amnis/. Page consultée le 8 septembre 2019.
- Robin, Corey. 2004. Fear: The History of a Political Idea. Oxford, Oxford University Press.
- Van Troost, Dunya, Jacquelien van Stekelenburg et Bert Klandermans. 2013. « Emotions of Protest », dans Nicolas Demertzis (dir.). Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political Tension. https://www.academia.edu/6601430/Emotions_of_Protest. Page consultée le 8 septembre 2018.
List of tables
Tableau 1
La peur de la violence policière
Tableau 2
La peur de la violence commise par des hommes cisgenres
Tableau 3
La peur de l’exclusion