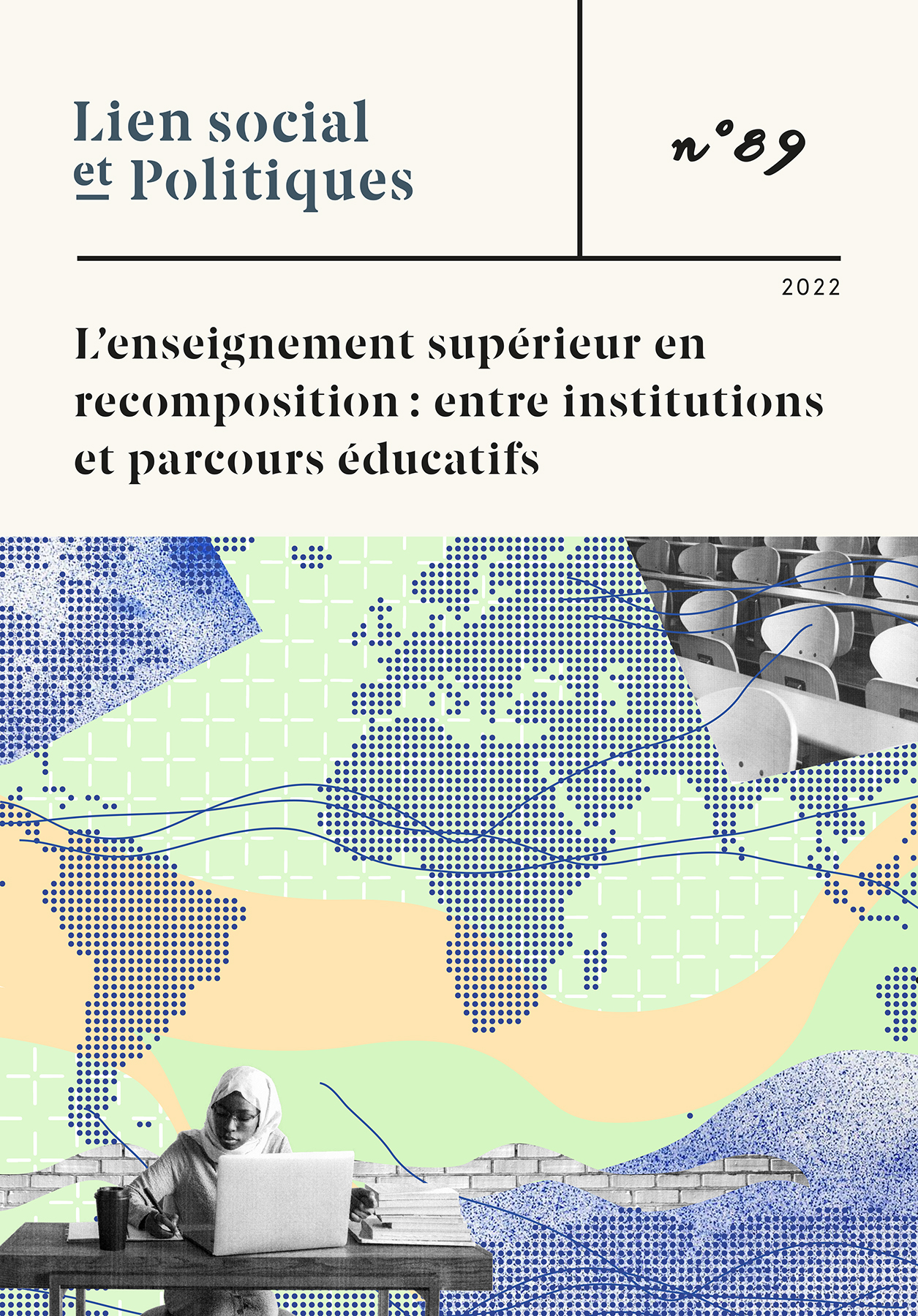Au cours des soixante dernières années, l’enseignement supérieur a connu, au gré de multiples réformes souvent majeures (Fullan, 2000), une profonde recomposition. Entendu au sens large et incluant l’ensemble des études et pratiques éducatives dites « postsecondaires » au Québec et « postbaccalauréat » en France, l’enseignement supérieur fait désormais partie du quotidien d’un nombre croissant de personnes, jeunes et moins jeunes, qui fréquentent les différents établissements scolaires qui le composent. Le passage par ses murs est devenu la voie nécessaire pour l’accès à de nombreux emplois et professions. L’organisation même du champ a connu diverses modifications, que ce soit en réaction à l’accroissement des effectifs (transformation des modalités de sélection et d’orientation, hiérarchisation des structures et établissements), en raison de la circulation et de la diffusion des normes et modèles internationaux, ou encore du fait de sa perméabilité avec les transformations sociétales et la conversion des politiques publiques (Allouch et Noûs, 2020). Devant ces profonds changements et les enjeux éducatifs et sociaux que revêt l’enseignement supérieur dans la plupart des sociétés, ce numéro de Lien social et Politiques examine divers aspects de ces transformations en croisant différentes échelles d’action publique, de la fabrique et de la mise en oeuvre des politiques aux trajectoires et aux expériences étudiantes, en passant par l’analyse du rôle des instruments de gestion. L’analyse sur le long terme de l’enseignement supérieur remet en question l’impression d’une dynamique de « crise » (Bodin et Orange, 2013) ou plus généralement l’illusion de la nouveauté : elle rappelle à quel point l’enseignement supérieur est en réalité en recomposition permanente (Charle et Verger, 2012 ; Goastellec, 2020). Ce constat rend d’autant plus nécessaire l’exercice auquel propose de se prêter ce numéro, à savoir circonscrire les formes de ces recompositions. L’enseignement supérieur connaît d’abord une expansion démographique sans précédent. En France, l’évolution des effectifs étudiants a été si rapide qu’elle a même pris de court les prévisions. Dans un état des lieux de l’enseignement supérieur publié en 2015 (Dauphin, 2015), les services ministériels rappellent que le nombre d’étudiant·es est passé de 310 000 en 1960 à 2,4 millions en 2013, soit un rapport de 1 à 8, et ils prévoient qu’en 2020, ce seront 2,6 millions d’étudiant·es qui étudieront en France. Or, l’augmentation a été encore plus importante, et ce sont 2,9 millions d’inscriptions que compte la France au passage de la décennie – et 100 000 de plus l’année suivante encore (DEPP, 2022). Au Québec, un peu plus de 50 000 étudiant·es étaient inscrit·es à l’université en 1966 ; en 2010, elles et ils sont plus de 280 000 et en 2021, plus de 315 000 (voir Doray, Kongo et Bilodeau-Carrier dans ce dossier). Plus largement, l’UNESCO estime que les effectifs de l’enseignement supérieur ont doublé dans le monde au cours des vingt dernières années, portant le nombre d’étudiant·es à 235 millions en 2022. Ces évolutions démographiques, ainsi que la transformation des politiques universitaires et des programmes de formation, provoquent de multiples conséquences : reconfigurations des instruments d’orientation et de sélection des étudiant·es ; évolution des normes institutionnelles et éducatives de gestion et de régulation au sein des écoles supérieures et des universités ; sens nouveau des études supérieures considérées à travers le prisme des injonctions à la professionnalisation ou encore celui de la mobilité sociale ; importation dans l’enseignement supérieur de problématiques qui concernaient auparavant les seuls enseignements primaires et secondaires, sommés de scolariser des générations entières (lutte contre le décrochage et l’échec scolaires, gestion disciplinaire d’élèves aux dispositions éloignées des attentes scolaires…) (voir Muel-Dreyfus, 1975 ; Cayouette-Remblière, 2016 : chap. 2). L’enseignement supérieur connaît également une diversification …
Appendices
Bibliographie
- Allouch, Annabelle et Camille Noûs. 2020. « Un modèle britannique d’université ? », Savoir/Agir, 53, 3 : 10-18.
- Bodin, Romuald et Sophie Orange. 2013. L’université n’est pas en crise. Les transformations de l’enseignement supérieur : enjeux et idées reçues. Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant.
- Cayouette-Remblière, Joanie. 2016. L’école qui classe. 530 élèves du primaire au bac. Paris, Presses universitaires de France.
- Charle, Christophe et Jacques Verger. 2012. Histoire des universités. Paris, Presses universitaires de France.
- Clément, Pierre, Marie-Paule Couto et Marianne Blanchard. 2019. « Parcoursup : infox et premières conséquences de la réforme », La Pensée, 399, 3 : 144-156.
- Cros, Louis. 1961. L’explosion scolaire. Paris, Comité universitaire d’information pédagogique.
- Dauphin, Laurence. 2015. « Les évolutions de l’enseignement supérieur depuis 50 ans : croissance et diversification », L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France, 8. https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/EESR8_ES_08-les_evolutions_de_l_enseignement_superieur_depuis_50_ans_croissance_et_diversification.php. Page consultée le 10 octobre 2022.
- Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). 2022. « Repères et références statistiques ». https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939. Page consultée le 10 octobre 2022.
- Duru-Bellat, Marie et Annick Kieffer. 2008. « Du baccalauréat à l’enseignement supérieur en France : déplacement et recomposition des inégalités », Population, 63, 1 : 123-157.
- Falque-Pierrotin, Isabelle, Jean-Richard Cytermann, Max Dauchet, Jean-Marie Filloque, Catherine Moisan et Isabelle Roussel. 2022. Rapport annuel au Parlement. Paris, Comité éthique et scientifique de Parcoursup.
- Frouillou, Leïla. 2016. « Admission post-bac : un “libre choix” sous contrainte algorithmique. La production spatiale des inégalités par l’affectation informatique des étudiants du supérieur », Justice spatiale/Spatial Justice, 10. http://www.jssj.org/article/admission-post-bac-un-libre-choix-sous-contrainte-algorithmique/. Page consultée le 10 octobre 2022.
- Frouillou, Leïla, Clément Pin et Agnès van Zanten. 2020. « Les plateformes APB et Parcoursup au service de l’égalité des chances? », L’Année sociologique, 70, 2 : 337-363.
- Fullan, Michael. 2000. « The Return of Large-Scale Reform », Journal of Educational Change, 1, 1 : 5-27.
- Goastellec, Gaële. 2020. « Le sens de la justice dans l’accès à l’université : les apports de la longue durée », L’Année sociologique, 70, 2 : 283-312.
- Kamanzi, Pierre Canisius et Pierre Doray. 2015. « La démocratisation de l’enseignement supérieur au Canada : la face cachée de la massification », Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 52, 1 : 38-65.
- Laplante, Benoît et Pierre Doray. 2022. « Le mythe indestructible. La population et l’éducation au Québec », dans Piché, Victor, Le Bourdais, Céline, Richard Marcoux et Nadine Ouellette (dir.). L’éclairage de la démographie. Mesurer pour mieux comprendre les enjeux sociaux. Montréal, Presses de l’Université de Montréal : 277-287.
- Merle, Pierre. 2000. « Le concept de démocratisation de l’institution scolaire : une typologie et sa mise à l’épreuve », Population, 55, 1 : 15-50.
- Muel-Dreyfus, Francine. 1975. « L’école obligatoire et l’invention de l’enfance anormale », Actes de la recherche en sciences sociales, 1, 1 : 60-74.
- Muller, Pierre. 1995. « Les politiques publiques comme construction d’un rapport au monde », dans Alain Faure, Gilles Pollet et Philippe Warin (dir.). La construction du sens dans les politiques publiques : débats autour de la notion de référentiel. Paris, L’Harmattan : 153-179.
- Poullaouec, Tristan et Claire Lemêtre. 2009. « Retours sur la seconde explosion scolaire », Revue française de pédagogie, 167 : 5-11.