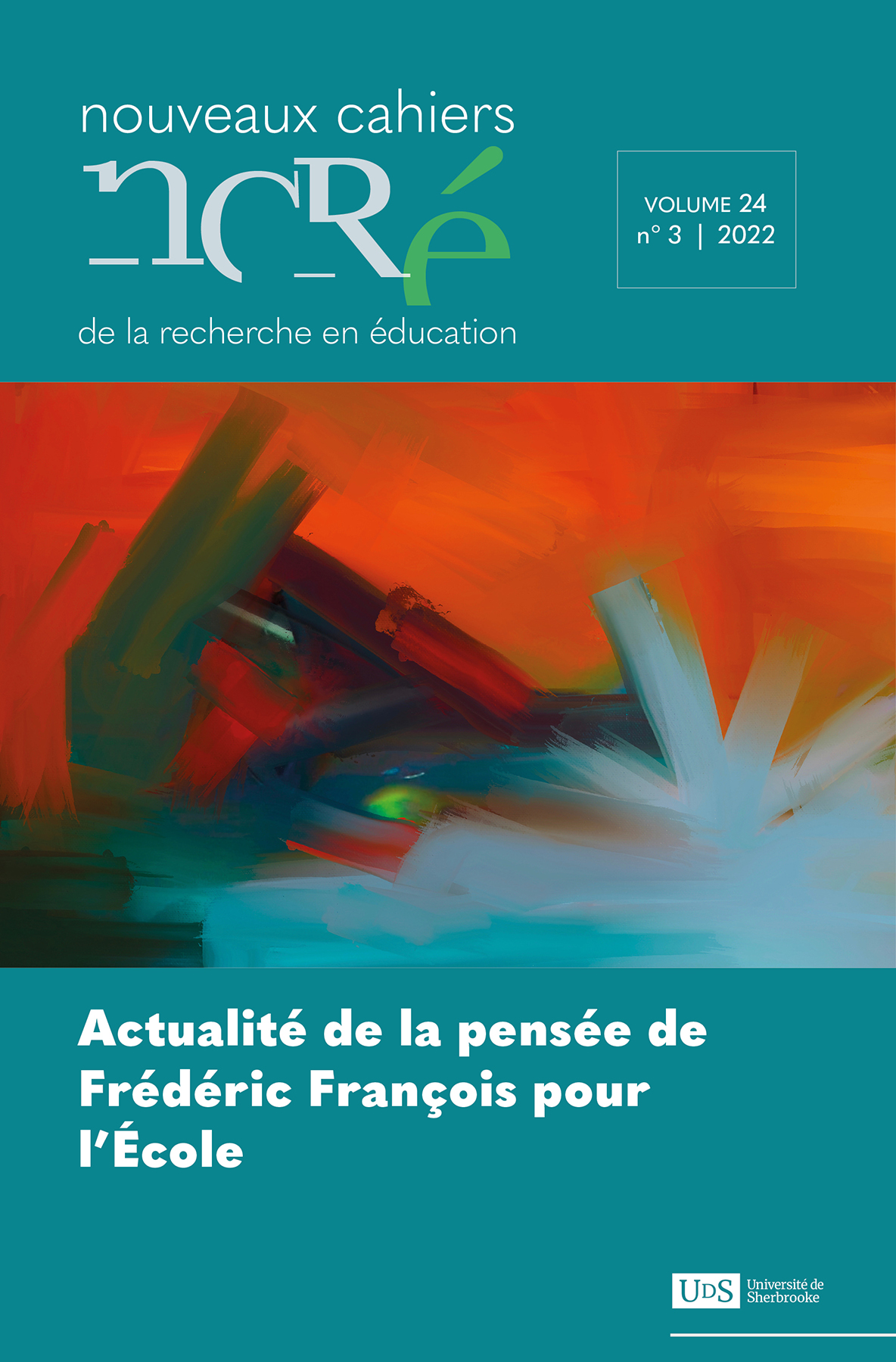Abstracts
Résumé
Cet article vise à montrer en quoi l’oeuvre du philosophe et linguiste français Frédéric François offre un cadre théorique pertinent pour étudier les définitions du verbe d’élèves de l’école primaire. Attentif aux différentes façons de mettre en mots des équivalences sémantiques, il met au jour des conduites stables, fonctionnelles quand il s’agit de définir des mots lexicaux mais des classements grammaticaux problématiques qui demandent à être interprétés. La perspective dialogique dans laquelle il aborde les justifications des élèves, comme ouvertes à différents modes d’interpréter, offre une solution alternative à une lecture normative des productions scolaires. Dans notre corpus de 93 définitions, l’alignement des réponses selon une matrice dominante – le verbe est une action – fait apparaître des «événements» au sens de Frédéric François, traduisant la fonction prédicative du verbe et sa capacité à signifier le temps.
Mots-clés :
- école primaire,
- Frédéric François,
- dialogisme,
- conduite discursive,
- activité métalinguistique,
- verbe
Abstract
This article aims to show how Frédéric François’ work presents a relevant theoretical framework for studying the definitions of the verb produced by elementary school pupils. Attentive to the different ways of putting semantic equivalences into words, he reveals stable, functional discursive choices when it comes to defining lexical words but problematic grammatical classifications that need to be interpreted. The dialogical perspective in which he approaches students justifications, as open to different modalities of interpretation, offers an alternative to a normative reading of school productions. In our corpus of 93 definitions, the alignment of responses according to a dominant matrix – a verb is an action – allowed us to reveal “events” (in the sense of Frédéric François) which translate the predicative function of the verb and its capacity to signify time.
Keywords:
- primary school,
- Frédéric François,
- dialogism,
- discursive behaviour,
- metalinguistic activity,
- verb
Resumen
Este artículo pretende mostrar cómo la obra del filósofo y lingüista francés Frédéric François ofrece un marco teórico relevante para estudiar las definiciones del verbo de los alumnos de primaria. Atento a las diferentes formas de poner en palabras las equivalencias semánticas, saca a la luz comportamientos estables y funcionales a la hora de definir palabras léxicas pero clasificaciones gramaticales problemáticas que requieren ser interpretadas. La perspectiva dialógica en la que aborda las justificaciones de los alumnos, abiertas a diferentes modos de interpretación, ofrece una solución alternativa a una lectura normativa de las producciones escolares. En nuestro corpus de 93 definiciones, la alineación de las respuestas según una matriz dominante – el verbo es una acción – revela “acontecimientos” en el sentido de Frédéric François, traduciendo la función predicativa del verbo y su capacidad de significar el tiempo.
Palabras clave:
- escuela primaria,
- Frédéric François,
- dialogismo,
- conducta discursiva,
- actividad metalingüística,
- verbo
Article body
1. Introduction
Depuis 2009, un recueil de réponses à la question qu’est-ce qu’un verbe?, créé par le groupe EPISTEVERB[1] et par la thèse de Patrice Gourdet (2009), continue d’être enrichi, offrant un panorama des propriétés que les élèves et les personnes enseignantes de l’école primaire mobilisent. La répartition chez les adultes interrogés (91 en 2019, 72 en 2013) montre une grande stabilité: la priorité est accordée à une entrée sémantique souvent réduite à l’action, devant les entrées morphologiques et syntaxiques également bien représentées, alors que les entrées phonologiques, lexicales et textuelles sont très peu citées. Chez les élèves de cours préparatoire (6-7 ans) interrogés par Corinne Gomila et Marie-Noëlle Roubaud (2013), un prototype se dégage: un verbe d’action (et non pas être), au présent, fonctionnant avec un pronom personnel. Les résultats recueillis auprès de cohortes d’élèves du CE2 (8-9 ans) au CM2 (10-11 ans) (491 en 2014-2016, 1 144 en 2019-2020) (Gourdet et Roubaud, 2014, 2016, 2022) montrent qu’ils diversifient le prototype, mais n’investissent pas les propriétés du verbe de la même façon que les personnes enseignantes: l’entrée sémantique, bien représentée, reste stable, toujours réduite à l’action; l’entrée morphologique est surinvestie, témoin de la place prise par l’apprentissage de la conjugaison, tandis que l’entrée syntaxique est la moins convoquée alors qu’elle conditionne l’emploi du verbe dans la phrase. Les limites de ces représentations se mesurent quand il s’agit de comprendre la spécificité du verbe par rapport à d’autres classes de mots, de choisir une marque d’accord, d’apprécier des valeurs temporelles ou aspectuelles à l’échelle du texte ou de réviser une construction syntaxique dans une production écrite: toutes les composantes de la maîtrise de la langue sont concernées.
C’est à l’aune de tels obstacles que les grammaires d’inspiration rénovée (Bulea Bronckart et Elalouf, 2016) ont privilégié une définition morphosyntaxique pour identifier le verbe (l’encadrement par ne… pas) et appréhender son rôle dans la phrase (repérage des marques de personne, construction des compléments), tout en articulant ses propriétés sémantiques à l’apprentissage du lexique (expression d’une action mais aussi d’état physique ou mental, mention d’un fait, attribution d’une qualité) (Nadeau et Fisher, 2006; Gourdet et al., 2016). Redéfinir ainsi l’objet d’enseignement suppose de la part de la personne enseignante une prise de distance par rapport à ses propres savoirs pour appréhender les représentations mouvantes de ses élèves dans l’interaction en classe et favoriser des «débats métalinguistiques» (Calame-Gippet, 2013, p. 83). Or, on sait que «ces situations où la personne enseignante est un médiateur agissant sur la construction du savoir de l’élève restent difficiles à mettre en oeuvre» (Nadeau et Fisher, 2006, p. 141) et que le maniement du langage, entre emplois «profanes» et «savants» du métalangage est délicat (Gourdet et Cogis, 2014; Lord et Elalouf, 2016).
Il est possible d’entrer dans le polylogue entre la personne enseignante et sa classe en relisant l’oeuvre du philosophe et linguiste Frédéric François qui a consacré ses travaux au développement des conduites langagières des enfants et à leur raisonnement métalinguistique. Cet article vise à faire connaître ses travaux sur les conduites définitionnelles et à les mettre à l’épreuve d’un nouveau corpus de définitions du verbe.
L’intérêt pour les conduites paraphrastiques et définitionnelles des enfants traverse l’oeuvre de Frédéric François. Elles y sont abordées non du point de vue des savoirs à acquérir et à restituer, mais du point de vue de ces élaborations singulières qui lèvent le voile sur l’activité métalinguistique des élèves. À la différence d’autres jeux de langage, «reformuler, dire que telle chose n’est pas telle autre ou est comme telle autre[2]» (François, 1984, p. 16) est difficile à faire avec autre chose que la langue (dessin ou geste) et mérite à ce titre l’attention du linguiste soucieux de comprendre comment se noue la relation entre les potentialités de signification et le sens du message dans le développement du langage. En ce qu’elle demande de mobiliser et expliciter des connaissances sur la langue, la définition est vue comme une activité à la fois fondamentale, naturelle et marginale (François, 1985): naturelle car elle se rencontre dans les conduites langagières ordinaires, comme en attestent les interactions entre adultes et jeunes enfants (Bonnet et Gardes-Tamine, 1984), mais marginale parce qu’elle constitue rarement une visée discursive à part entière, sauf dans le discours métalinguistique; et néanmoins fondamentale en ce qu’elle manifeste la réflexivité du langage. Or, cette réflexivité est condition du mouvement, par lequel l’enfant reformule, hésite, se corrige, apprend à parler aux prises avec les décalages entre son expérience propre et les discours échangés et transmis. Nous convoquerons cette notion centrale dans la pensée dialogique de Frédéric François, d’abord pour appréhender son apport à la compréhension des conduites définitionnelles des enfants (2), puis pour étudier son apport à leur interprétation (3) avant d’exposer comment ce cadre théorique a été sollicité pour étudier des définitions du verbe recueillies auprès d’élèves de l’école primaire (4).
2. Produire des définitions: apport de Frédéric François à la compréhension des conduites linguistiques des enfants
Comprendre comment les enfants s’engagent dans des conduites linguistiques est au début des années 1980 un enjeu scientifique et politique majeur. Dans la présentation d’un numéro de la revue Langages qu’il dirige, Frédéric François (1980a) s’élève contre la thèse du handicap linguistique qui repose sur les résultats socialement différenciés à des tests portant sur la complexité syntaxique et la richesse lexicale qui ont été «systématiquement valorisées sans qu’on s’interroge sur leur rôle éventuel, dans le circuit de l’échange ou pour celui même qui parle» (p. 5). Pour Frédéric François (1980b), les insuffisances des théories linguistiques dominantes peuvent expliquer leur incapacité à réfuter de telles conceptions. Le noeud réside selon lui dans «la relation des faits de langue à l’organisation du contenu communiqué» (p. 30) qui ne peut être pensée dans une approche exclusivement intralinguistique. Plutôt que «d’enseigner des modèles structurels qui risquent de devenir une fin en soi», il apparaît préférable «d’étudier d’abord les conduites effectives de mise en mots. Ce qui a pour premier bénéfice de nous montrer qu’il n’y a pas une seule stratégie linguistique dans une situation donnée» (p. 41).
L’étude des conduites effectives de définition permet d’observer que les enfants mobilisent différemment leur activité métalinguistique selon les contextes, qu’ils soient quotidiens ou scolaires; elle conduit à discuter la tendance à vouloir classer les définitions par rapport à la moyenne des enfants du même âge et à voir dans la définition par genre prochain et différence spécifique le seul étalon. La variété des conduites définitionnelles relève de différents facteurs. Le contenu à communiquer est contraint par les conditions d’interlocution et le type d’objet à définir: l’enfant ne définira pas de la même façon un objet dont il a l’expérience avant de pouvoir le nommer et un objet auquel il n’accède que par la transmission culturelle (François, 1984). Il est également contraint par les caractéristiques lexicales des mots à définir:
On distinguera d’une part des mots qui induisent fortement un type donné de définition: par le genre: chien - animal; par la paraphrase: se rappeler-se souvenir; par l’exemple: travailler - écrire, ce qui constitue déjà des «modes discursifs» différents. D’autre part, des mots qui peuvent relever de conduites diversifiées (riche: contraire de pauvre, c’est quand on a beaucoup d’argent ou exemples).
François, 1984, p. 48
À cette source de diversité s’ajoute celle liée à la singularité des sujets qui dans la conduite de définition affrontent les contradictions entre la mise en mots de leur expérience et des savoirs transmis, ce qui peut produire «des définitions provenant d’un travail in situ sans relation directe à un prêt-à-penser» (François, 2005, p. 170). Le «prêt-à-penser» caractérise des formes récurrentes dans la communication et l’argumentation quotidienne selon Windisch (1990). L’enfant apprend à parler en intériorisant ce préconstruit et en le transformant souvent par analogie et/ou en le recombinant. C’est cette émergence inédite sur fond d’interdiscours que Frédéric François appelle «mouvement discursif», un déplacement qui permet des codages complexes. L’enfant distingue ainsi le générique du typique (viande c’est quelque chose qu’on peut manger, parfois elle est hachée), combine différentes sources discursives (le lion c’est un animal sauvage, c’est le roi des animaux, il court vite, il a une queue longue comme une vache) (François, 1984, p. 49). Il y a ici mouvement par rapport son propre discours comme il y a mouvement par rapport au discours de l’autre dans le polylogue (ici recueilli à l’école maternelle):
Adulte: Qu’est-ce que l’eau?
Guilain: C’est celle qui fait pschitt.
Sébastien: C’est pour que les bateaux, i flottent.
Sarah: La mer c’est pour que une péniche, elle va sur l’eau par exemple.
Guilhain: Y’a des requins.
Sébastien: Y’a des crocodiles, des dauphins.
Guilain: Y’a des baleines.
Sarah: C’est pour que les requins, les tortues, les serpents de mer, des tas de choses vivent. Sinon, i meurent.
François, 2005, p. 172
Aller vers le savoir générique transmis après que l’interlocuteur a donné un exemple typique comme Sébastien, récapituler une série d’exemples par une synthèse, comme Sarah, sont autant de déplacements que révèle le dialogue.
L’intérêt pour les conduites langagières des enfants qui prennent le langage pour objet, dont les conduites définitionnelles sont un cas particulier, est partagé par un certain nombre de linguistes qui, au tournant des années 1970-1980, contribuent à la naissance de la didactique du français. Un numéro d’Études de linguistique appliquée, coordonné par Claudine Fabre (1986), est consacré aux activités métalinguistiques et métadiscursives chez l’enfant de 6 à 11 ans. Frédéric François y propose, dans une étude menée dans deux classes de CE2 et CM2, un dispositif qui tire parti de ses travaux sur les conduites définitoires pour interroger les activités de classement grammatical. Il sélectionne des noms et des verbes qui s’opposent selon le critère montrable/non montrable ainsi que des adjectifs[3] et demande pour chaque mot un classement assorti d’une justification ainsi qu’une définition. Les justifications des élèves montrent que, selon les mots, ils ne sont pas sensibles aux mêmes caractéristiques. Certains mots sont de bons candidats à l’identification comme nom (éléphant) ou comme verbe (courir) quand d’autres sont passibles de plusieurs catégorisations sur la base d’associations lexicales (mensonge/mentir) ou d’insertions syntagmatiques (jaloux/je suis jaloux). Selon les mots, les élèves manifestent une sensibilité à des critères différents mais peinent à les coordonner pour aboutir à la conclusion attendue, ce que traduisent les nombreuses hésitations. Les définitions lexicales de ces mêmes mots, en revanche, sont stables et partagées, y compris par les élèves qui échouent à catégoriser. Elles relèvent de trois conduites: donner un exemple typique, indiquer une circonstance de réalisation (c’est quand/pour), faire varier la forme (dérivation, verbe conjugué).
Comment expliquer que les élèves rencontrent des difficultés à classer les mots en verbes, noms et adjectifs alors qu’ils sont capables de définir ces mots? Est-ce par incapacité à appréhender leurs propriétés formelles? Ou la limitation ne se situerait-elle pas du côté des adultes qui ne sauraient pas interpréter leurs justifications comme des formes de «conscience linguistique» (François, 1986, p. 26)?
Pour Frédéric François, les classes qui se dégagent des définitions des élèves ont plus de réalité que celles de la grammaire, pour peu que l’adulte sache se décentrer. Le terme de classe s’entend ici non comme un ensemble aux frontières strictes mais comme une organisation dynamique autour d’un centre et de sa périphérie, sensible à de multiples variations selon les sujets parlants, les propriétés des mots, les conditions de l’échange, et les jeux de langage qui déplacent les limites du sens. Cela conduit Frédéric François à considérer que les possibilités paraphrastiques jouent un rôle plus déterminant dans l’apprentissage, en ce qu’elles permettent de dégager, par des relations d’équivalence, des sous-groupes illustrant la diversité au sein d’une classe grammaticale.
De quelle nature est l’activité qui sous-tend les définitions enfantines? Activité épilinguistique, non consciente (Culioli, 1968), ou métalinguistique, prenant explicitement la langue pour objet? La question est posée dans le même numéro d’Études de linguistique appliquée par Jean-Émile Gombert (1986) qui discute les protocoles concluant à une activité métalinguistique précoce, vers 4-5 ans. Les enfants peuvent effectuer des tâches métalinguistiques à la demande du chercheur ou produire des énoncés métalinguistiques dans l’interaction en s’adaptant au discours de l’autre, sans que le caractère réfléchi de l’activité puisse être formellement attesté. Il propose de distinguer:
-
Les activités épilinguistiques qui d’après Culioli accompagnent nécessairement toute activité langagière et qui apparaissent donc en même temps que le langage;
-
Les comportements langagiers à caractère épilinguistique, comportements qui s’apparentent au comportement métalinguistique sans que leur caractère réfléchi puisse être établi;
-
Les activités métalinguistiques non observables mais inférables à partir des…
-
Comportements langagiers à caractère métalinguistique dont le caractère réfléchi ne peut être mis en doute. (Gombert, 1986, p. 23)
Pour Frédéric François, l’enjeu est moins de distinguer ce qui relève du conscient et de l’inconscient que de saisir les mouvements de reprise-modification qui permettent leur entrelacs constant dans le dialogue de soi à soi et à autrui. Si la notion de mouvement discursif est centrale pour appréhender un jeu de langage tel que la production de définitions, elle l’est indissociablement pour interpréter ces définitions dans un cadre dialogique.
3. Interpréter des définitions: apport de Frédéric François à la compréhension responsive des productions d’élèves
L’intense activité épi/métalinguistique que révèle la production de définitions risque cependant de rester ignorée si l’attente du destinataire est avant tout normative. S’il confronte en revanche la façon dont l’énoncé reçu sélectionne le dit et le non-dit à sa propre façon de les agencer, il entre en mouvement, ajoute, modalise, déplace. Critique à l’égard des modèles pédagogiques qui considèrent qu’on met en mots «le su, l’expérimenté, le programmé» (François, 2003, p. 27), Frédéric François invite à interpréter, autour d’une signification stable et supposément partagée, la diversité des perspectives possibles relevant plutôt du difficile à dire, qui se dessinent dans la mise en mots et appellent une compréhension responsive au sens que lui donne M. Bakhtine (1984): la compréhension du tout de l’énoncé est responsive en ce qu’elle instaure un rapport dialogique avec le destinataire actuel ainsi qu’avec un sur-destinataire dont la compréhension idéalement juste serait attendue.
L’interprétation est ainsi appréhendée dans une perspective dialogique, comme une rencontre qui nous rend plus ou moins ouverts à notre propre altérité et disponibles à un «percevoir en tant que» différent du nôtre (François, 2005, p. 22). Une gradation existe entre le générique qui égalise les connaissances entre les partenaires du dialogue, le particulier intelligible dont l’interprétation exige un déplacement et le particulier opaque.
Parmi les différents modes d’interpréter, le générique, où «nous sommes en principe interchangeables» (François, 2005, p. 15), est rare dans le cadre scolaire mais cet horizon de sens sert de cadre au mouvement de celui qui interprète. Un deuxième mode d’interpréter apparaît central, c’est celui «où nous reconnaissons qu’un tiers voit autrement mais où les points de vue nous semblent légitimement différents» (François, 2005, p. 15). C’est l’expérience renouvelée dans le dialogue qu’un autre «percevoir en tant que» est possible. Loin de l’écarter comme marginal, Frédéric François en fait ce par rapport à quoi l’interprétation se construit. Dans l’article d’Études de linguistique appliquée, il rapproche ainsi un certain nombre de justifications a priori surprenantes chez différents élèves:
Le travail: c’est le verbe travailler, c’est un verbe parce que ça se conjugue.
Un mensonge: c’est le verbe mentir, parce qu’on peut dire je mens, tu mens.
Fané: c’est un verbe parce que ça se conjugue, on peut dire je suis fané, tu es fané.
Jaloux: c’est un verbe parce que ça se conjugue: je suis jaloux.
Boucher: je suis boucher.
François, 1986, p. 29
Ces élèves sont sensibles à une caractéristique du verbe, le procès (ou signifié du verbe) impliqué par les noms travail et mensonge (le fait de travailler, de mentir), la construction prédicative avec le verbe être pour fané, jaloux et boucher, mais ils apportent une justification morphologique apprise, inapte à expliquer l’appartenance des mots proposés à une classe grammaticale.
Le dernier mode d’interpréter est celui «où nous ne saisissons pas ce que peut signifier le point de vue de l’autre (et parfois notre propre point de vue)» (François, 2005, p. 15). Dans le même article, les stratégies de quelques élèves sont qualifiées d’aberrantes ou de bizarres. Elles concernent tous les mots et semblent davantage imputables au choix d’un sujet qu’aux caractéristiques des mots. Ainsi chez Aline dont les mouvements discursifs ne se retrouvent pas ailleurs:
Un cartable: un adjectif, parce que fleur c’est un mot et pi cartable aussi, c’est pareil qu’un mot, c’est pareil que une fleur, c’est pas tout à fait pareil mais ça se voit que c’est un adjectif.
Amusant: un adjectif, c’est comme une fleur.
Courir: un adjectif parce que une fleur par exemple, une fleur c’est un adjectif, une fleur moi dans ma tête, ça me dirait… par exemple courir, ça me dirait vraiment que c’est un adjectif, moi, ça me dit un adjectif.
François, 1986, p. 29
Pourquoi le mot fleur, absent de la liste proposée, est-il pour cette élève l’exemple typique à l’aune duquel tous les mots sont analysés? L’adulte ne peut formuler que des hypothèses ou s’abandonner à la rêverie: une fleur autour de laquelle gravitent les mots. En effet, ce particulier opaque, appelé tantôt «difficile à dire» (François, 2005, p. 15), tantôt «reste» (François, 2004a), entendu comme ce qui reste après les mises en mots possibles, c’est aussi ce qui nous renvoie à notre propre opacité, à l’autre constitutif en nous sans lequel il n’y aurait pas de dialogisme possible. Et ce que Frédéric François souligne, c’est que ces trois modes d’interpréter – le générique, le particulier intelligible et le particulier opaque – se mêlent de façon non décidable et évolutive.
Dans la «communication inégale» (François, 1990, p. 9) qui s’établit entre un adulte et un enfant, le mélange singulier du générique, du particulier intelligible et du particulier opaque produit inévitablement des malentendus, appelés malheurs, mais permet aussi le surgissement de leur contraire:
Heurs qui prendront bien des formes, certes l’adaptation au discours de l’autre, si l’on admet que la capacité à modifier son discours en fonction de l’interlocuteur est une caractéristique du langage plus fondamentale que «la» structure. Mais peut-être surtout heur de l’apparition d’un «événement», d’un changement de point de vue, de l’apparition d’un nouveau, dont on peut penser qu’il est peut-être plus important que l’éternel retour du même.
François, 1990, p. 9
L’«événement» résulte d’un mouvement discursif: c’est une création originale produite à partir des genres textuels et des préconstruits présents dans l’interdiscours. Nous l’illustrerons avec une définition demandée en grande section de maternelle:
Maîtresse: Et qu’est-ce qui vous fait peur encore?
X: Un dragon!
Sébastien: Un dragon qui crache le feu sur les petits enfants!
Hugo: Et aussi un dinosaure!
Maîtresse: Et tu saurais expliquer ce que c’est comme animal un dragon?
XXX: C’est un animal avec des ailes et du feu à l’intérieur.
François, 2005, p. 31
L’image du dragon crachant du feu est un prêt-à-penser culturel introduit par Sébastien. L’enfant non identifié (XXX) la reprend pour expliquer ce qu’est un dragon et la modifie, mouvement discursif remarquable d’où surgit la coordination entre les ailes et le feu intérieur.
Mais la situation dans laquelle se trouve la personne enseignante lui permet-elle cette ouverture à l’événement? Frédéric François envisage deux régimes d’interprétation.
On pourrait distinguer les moments où l’interprétation fonctionne pour elle-même comme espace de suspension, où l’on se laisse aller à jouer avec les possibles, les différentes façons de mettre en mots et où l’on propose à autrui nos propres façons de voir en même temps qu’on est prêt à recevoir les siennes. Il y aurait au contraire une «interprétation urgente» prise dans le cours de l’action ou confrontée au choc de l’inattendu.
François, 2005, p. 20
La personne enseignante se trouve plus souvent dans la seconde situation. Les travaux sur les gestes professionnels ont montré en quoi les routines nécessaires à l’exercice du métier sont constamment mises à l’épreuve: le geste professionnel se caractérise par le sens du kairos – le bon moment selon Anne Jorro (2006) ou par la capacité d’ajustement à l’imprévu selon Dominique Bucheton (2009). Les contraintes professionnelles font que la l’enseignante ou l’enseignant ne dispose guère de temps pour adopter la première attitude interprétative. Et c’est peut-être là que la collaboration entre chercheurs et enseignants peut être envisagée, en croisant différents régimes d’interprétation pour entrer en dialogue avec des productions parfois déroutantes.
4. Un cadre théorique pour l’interprétation de définitions métalinguistiques à l’école
L’approche dialogique des conduites discursives convient-elle à l’interprétation des écrits de restitution de savoir[4]? Offre-t-elle une solution alternative à la vérification de leur conformité aux savoirs enseignés? Permet-elle de comprendre les tensions entre connaissances métalinguistiques mobilisées et savoirs déclaratifs? Ayant étudié 352 réponses de CE2 (8-9 ans) et 491 réponses d’élèves de CM2 (10-11 ans) à la question qu’est-ce qu’un verbe? (Elalouf et al., 2016), nous avions mis en évidence, par-delà les réponses convenues, des métaphores traduisant une intuition du rôle prédicatif du groupe verbal, notion non enseignée et pourtant verbalisée dans certaines réponses.
Disposant d’un nouveau corpus de réponses à une consigne proche à quatre mois d’intervalle (septembre 2019 et janvier 2020), nous avons cherché à y décrire les mouvements de «reprise-modification» qui s’y dessinent au sein d’une classe. Dans le cadre du projet Réalang, dont l’objectif est de rendre compte des réalités de l’enseignement-apprentissage de la langue à l’école primaire en France (Sautot et al., 2021), les élèves de 92 classes cycle 3 se sont vu proposer à deux moments de l’année une courte dictée calibrée, un travail d’identification des verbes et des adjectifs sur un texte et deux demandes de définition, sur le verbe et l’adjectif. La présente étude porte sur les réponses à la consigne «Écris tout ce que tu sais sur le verbe» recueillies dans quatre classes: une classe de CM1, 2 classes de CM1-CM2 et une classe de CM2 en éducation prioritaire[5]. Il s’agira de montrer en quoi l’apport de Frédéric François permet d’appréhender ce corpus en faisant interagir entre eux différents modes de signification.
Cherchant à «mettre de l’ordre dans les différentes façons de prendre un “fait de langage”» (2003b, p. 64), Frédéric François distingue quatre grandes attitudes à l’égard du dit (et de l’écrit): le considérer comme discours, comme symptôme, comme corpus et comme texte. La situation de langage la plus ordinaire est le discours, l’événement de la parole hic et nunc, ouvert à la construction de points de vue dans un espace commun entre acceptions partagées et accentuations particulières. Quand ce qui a été dit ou écrit n’est pas pris pour ce qu’il veut dire mais pour l’information qu’il donne sur le locuteur, le discours fait place au symptôme. Appréhendé dans sa matérialité, le dit est pris comme corpus, il peut être décrit, quantifié. Enfin, l’oeuvre de Frédéric François plaide pour faire sa place au texte qu’il définit comme «oral ou écrit mais texte en tant qu’il ne nous est pas directement adressé» (2004, p. 85). Une parole d’enfant ou un écrit d’élève peuvent être compris sous chacune de ces quatre modalités, comme discours appelant une réponse, comme témoin typique d’une production enfantine (symptôme), comme ensemble organisé de signes (corpus) ou comme texte invitant à «nous laisser aller à l’atmosphère, à la suspension de nos usages» (François, 2005, p. 28). C’est ce que nous avons tenté de faire sur notre corpus pour mettre en perspective ce qui semble le plus difficile à saisir dans les productions d’élèves, à savoir le texte.
Peu de réponses peuvent être lues comme des discours – quatre au total, qui tentent d’établir une connivence avec le chercheur («bon merci de votre coprention[6]», E15), de prendre du recul vis-à-vis d’une difficulté à exprimer le générique («le verbe a plusieurs personne “façon de parler”», E82). Signe sans doute que le genre discursif de la réponse à une question grammaticale se transmet à l’école sur le mode assertif (Elalouf et al., 2016).
Une lecture symptômale de l’ensemble de ces réponses retient l’énoncé générique le plus fréquent, suscitant de nombreuses variations: le verbe est une action. Les travaux de Patrice Gourdet et Marie-Noëlle Roubaud (2017) montrent que 89 % des personnes enseignantes interrogées se réfèrent à l’action pour définir le verbe. La formulation typique qui leur est associée – le verbe est un ’action – s’inscrit dans une tradition grammaticale scolaire institutionnalisée dans les manuels. La particularité des réponses recueillies dans notre corpus est de maintenir la forme de la définition mais de supprimer la médiation de la langue: le verbe est une mot qui indique l’action dans la phrase. Sur le modèle d’énoncés comme Le lapin est un mammifère, les élèves semblent construire un hyperonyme, action, qui subsumerait à la fois du linguistique et de l’extralinguistique. Comment l’interpréter? Pour appréhender ces réponses comme textes, le corpus peut s’analyser de deux façons: en comparant pour chaque élève sa réponse de septembre et de janvier afin de repérer ce qui est repris, et de mettre au jour un savoir en voie de stabilisation; en alignant l’ensemble des réponses selon cette matrice dominante – le verbe est une action – afin de faire apparaître des «événements» qui instaurent une nouvelle dynamique.
Nous avons repris la grille de lecture élaborée par Patrice Gourdet dans sa thèse pour analyser les propriétés du verbe énoncées dans les définitions des élèves et des personnes enseignantes (Gourdet et Roubaud, 2017) afin de distinguer celles qui étaient reprises dans la définition de janvier et la nature des modifications: suppression, transformation ou ajout.
Parmi les propriétés reprises de septembre à janvier, celles qui relèvent d’une entrée sémantique sont étroitement associées à celles qui relèvent d’une entrée morphologique, alors que les propriétés syntaxiques sont peu mentionnées. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur un échantillon plus conséquent (15 classes).
Entrée sémantique
-
Référence à l’action ou à l’état sans référence au temps: 22[7]
-
Référence à une unité sémantique qui désigne un procès: 2
Entrée morphologique
-
Utilisation de l’expression se conjugue sans plus de précision: 19
-
Approche utilisant l’infinitif et/ou la classification en groupe: 20
-
Référence à un mot qui change en fonction du temps: 7
-
Référence à la notion de radical et de terminaison: 5
-
Référence à un mot qui change en fonction d’une personne: 2
Entrée syntaxique
-
Référence à un lien avec un pronom de conjugaison: 8
-
Référence à un positionnement topologique (verbe derrière le sujet par exemple): 1
-
Lien direct avec la phrase: 3
-
L’encadrement du verbe par la négation: 1
Mais il ne suffit pas qu’une propriété soit reprise pour qu’elle relève de la même interprétation. À côté des élèves qui reprennent textuellement le verbe est une action dans leur réponse de septembre et de juin, d’autres proposent des reformulations qui éclairent leur acception du nom action. Pour E12, c’est l’affinité avec un sujet humain qui prévaut, comme celle qui prévaut dans le codage des personnages d’un récit (François, 1984).

Ici, la généricité de l’énoncé est rendue problématique par la détermination (déterminant défini + complément déterminatif: l’action des personnes, l’action de quelqu’un) qui renvoie à une identification alors que le sujet à interprétation générique le verbe appelle une catégorisation. On notera que le choix de l’exemple signale la place variable de l’animal dans la dichotomie humain/non humain.
Pour E3, le terme d’action renvoie au sujet moral placé devant des choix (bien ou mal) et manifestant son adhésion au discours sur l’utilité du savoir scolaire.

E21 quant à lui développe la signification d’action sur le plan syntaxique en introduisant la phrase comme cadre de l’action du verbe, puis le terme de sujet, sujet du verbe faire.

On observe dans la réponse de septembre de E1 la juxtaposition d’une propriété sémantique où prévaut l’affinité avec un sujet humain et d’une propriété morphologique. La réponse de janvier les combine en une formulation qui signale les effets de la variation temporelle: l’action peut se transformer. L’élève distingue, certes de façon hésitante, la variation selon les époques appelée dimension (passé présen Fu futur passée) et le nom de certains temps verbaux (com passé imparfait) alors que seuls ces derniers étaient cités en septembre.

Pour cerner la pluralité des acceptions du nom action et son fonctionnement dans les textes d’élèves, il nous a semblé nécessaire de prendre également en considération l’ensemble des formulations proposées par la classe à une date donnée. En effet, certains élèves introduisent dans leur définition le verbe est une action en septembre, mais ne le reprennent pas en janvier tandis que d’autres font l’inverse. Sur la totalité des réponses, nous avons retenu les phrases attributives du type le verbe est qui sont le plus souvent à l’initiale des réponses. Cet ensemble de réponses peut être étudié comme corpus, ce que nous avons fait dans un premier temps en recherchant les occurrences du mot action: 36 sur 93 réponses en septembre, 39 en janvier. Cependant, alors que le nombre d’occurrences du mot action augmente entre septembre et janvier, le nombre de phrases comprenant la prédication le verbe est une action diminue. Cherchant à expliquer ce paradoxe, nous avons adopté l’analyse en grille de Claire Blanche-Benveniste (1979) conçue pour l’analyse de l’oral et adaptée à celle de l’écrit (Auriac-Slusarczyk et Blasco-Dulbecco, 2010) pour essayer à la fois de saisir un symptôme – la prégnance de la matrice définitionnelle le verbe est – et les variations qu’elle permet.
La première colonne permet de signaler ce qui peut apparaître à l’initiale de la phrase ou les coordonnants en cas de phrase complexe. La seconde colonne met en série les déterminants du nom verbe. La consigne Écris tout ce que tu sais sur le verbe appelle une réponse dialogique: le défini singulier est nettement privilégié pour exprimer la généricité, l’indéfini se rencontre plus rarement et le défini pluriel exceptionnellement. La troisième colonne est fixe: les élèves reprennent le terme verbe de la consigne pour le définir. La quatrième colonne présente les variations du verbe être qui peut être modalisé ou substitué à d’autres verbes comme dans l’exemple ci-dessus. La cinquième colonne met en série les déterminants du nom action: l’indéfini qui permet une catégorisation est nettement privilégié par rapport au défini. La sixième colonne fait apparaître ce qui se substitue au nom action. La dernière colonne contient les expansions de ce nom: c’est là que sont introduits des exemples, des verbes de parole, des termes du métalangage. L’appariement des réponses selon leurs ressemblances a permis de dégager huit séries dans chacun des corpus recueillis en septembre (A1 à A8) et en janvier (B1 à B8). Une première série (8 occurrences en septembre, A1, et 4 en janvier, B1) réunit des phrases segmentées, avec reprise par c’est.


Ces phrases ont la particularité de ne pas comporter d’expansion du nom. On note seulement la juxtaposition d’exemples, qui sont des verbes dynamiques à sujet animé. Le verbe être est également mentionné, ce qui peut être interprété comme une acception syntaxique du terme d’action, illustrée dans notre corpus par un mouvement discursif que Frédéric François a analysé dans les dialogues d’enfants sous le terme de distinguo (François, 1990, p. 110):

Dans la première occurrence, le nom action a une acception lexico-sémantique, tandis que dans la seconde la référence à la phrase oriente vers la fonction prédicative du verbe.
Les séries A2 et B2 (4 occurrences, mais 8 élèves en septembre comme en janvier) regroupent les formulations: le verbe est une action.


Comme les précédentes, ces définitions ne comportent pas d’expansion du nom. On y observe le conflit entre la polysémie du nom action et sa spécialisation dans l’opposition action et état, mais aussi entre action et verbe (E93).
Dans les séries A3 et B3 (7 occurrences en juin et 9 en janvier), l’expansion du nom action, permet l’introduction de différentes propriétés du verbe: sémantiques (A3: E1, E6, E9; B3: E7, E16, E19, E1), pragmatiques (B3: E3), mais aussi morphologiques (A3: E53; B3: E81, E34, E66) et syntaxiques (A3: E66, E15, E16; B3: E21).



Les séries A4 et B4 comportent une expansion du nom comme en A3 et B3, mais diffèrent par le choix du déterminant qui oriente vers un verbe typique plus que vers une classe grammaticale. On retrouve deux acceptions du nom action, sémantique (A4: E7, E12; B3: E12) et syntaxique (A4: E31, E7; B4: E10).


On note une difficulté à décrire l’ordre des constituants dans la phrase canonique, difficulté persistante chez une même élève, E73.
![]()

Les séries A5 et B5 comportent des expansions du noms qui permettent comme dans les séries précédentes d’introduire différentes propriétés du verbe mais se distinguent par des variations autour du verbe être.


D’une part, des modalisations avec pouvoir nuancent la portée du générique, comme dans cet exemple en B5 qui coordonne propriété morphologique et sémantique.

D’autre part, des verbes se substituent au verbe être pour signifier la médiation du langage. On observe une plus grande variété que dans les grammaires scolaires: les verbes montre, donne, marque, indique. En A5, on peut considérer comme un «événement» au sens de Frédéric François, l’emploi unique du verbe représenter dans un énoncé générique avec le déterminant indéfini: la dimension symbolique du langage est signifiée dans un énoncé qui vise un référent typique (avec l’indéfini générique un).

En A6 (1 occurrence) et B6 (7 occurrences), la variation porte sur le nom action qui est remplacé par un pronom indéfini ou un nom de sens général: quelque chose, une chose, un élément. Cela facilite l’introduction de différentes propriétés du verbe en levant l’incompatibilité qu’il pouvait y avoir entre celles-ci et le nom action.
![]()

Par ailleurs, le nom de sens général peut être caractérisé d’important ou d’essentiel, ce qui manifeste un point de vue sur le rôle du verbe dans la phrase. Dans l’exemple suivant, la conjonction des termes sens et temps peut aussi être considérée comme un «événement» original et non une simple restitution de savoir.

Dans les séries A7 (9 occurrences) et B7 (13 occurrences), la médiation du langage est signifiée par la substitution du nom mot au nom action.


Un point de bascule peut s’observer dans les énoncés qui déportent le mot action dans l’expansion du nom mot. Observons les réponses de deux élèves qui proposent en septembre le verbe est une action. E60 restitue ses connaissances sous forme de phrases juxtaposées en septembre. En janvier, il articule l’énoncé générique définissant le verbe à un constat de diversité dans un énoncé négatif qui marque un mouvement argumentatif et poursuit par une description. E63 souligne graphiquement par une flèche la médiation signifiée par le verbe désigne.

Les séries A8 et B8 regroupent les substituts les plus inattendus du nom action: le verbe est réduit à une de ses caractéristiques (terminaison, groupes), ou appelé petit mot, terme qui est utilisé dans une «métalangue de transition» pour désigner des mots grammaticaux monosyllabiques (Gomila, 2013, p. 1).


Irréductible à tout prêt-à-dire, cette réponse en B8:

L’élève associe le sens (signifie) et l’expression du temps dans une mise en mots qui dit la souffrance vécue de l’apprentissage et les ruses pédagogiques pour la contourner.
L’alignement des réponses selon une matrice dominante – le verbe est une action – a permis de suivre un parcours, depuis une restitution partielle des savoirs appris jusqu’à des formulations originales, elle montre la capacité des élèves à jouer sur tous les éléments de la chaîne syntagmatique et à mobiliser le métalangage enseigné de façon singulière pour appréhender le «difficile à dire».
5. Discussion et remarques conclusives
Plusieurs questions actuelles en didactique du français entrent en résonance avec l’oeuvre de Frédéric François. Sa recherche sur le développement des oppositions verbo-nominales chez l’enfant (1984) a orienté vers le potentiel heuristique du tri de mots, ce qui a conduit à expérimenter des dispositifs (Tisset, 2005, 2017; Lavieu-Gwozdz, 2014) et à étudier la conceptualisation progressive des classes grammaticales (Beaumanoir-Secq, 2018). La forme des définitions et leur rôle dans l’apprentissage ont été discutés, Adeline Chailly, Solveig Lepoire-Duc et Dominique Ulma (2013) défendant «une approche réticulaire du verbe consistant à fournir une définition complexe afin que chaque élève puisse privilégier la ou les caractéristiques qu’il parvient le mieux à manipuler» quand Fabienne Calame-Gippet (2013) admet des définitions provisoires prenant en compte l’existant (le verbe «désigne une action») progressivement enrichies par l’étude de corpus soumis à des manipulations. La place accordée à la sémantique, bannie avec la critique de la grammaire traditionnelle (Grossmann, 1996) a été reconsidérée. Revendiquée par Dan Van Raemdonck et Lionel Meinertzhagen (2014) qui voient dans la restauration du sens une condition de l’appropriation possible d’un discours grammatical entièrement refondé, elle l’est d’une autre façon par Jean-Paul Bronckart et Nina Bulea Bronckart (2022) qui reviennent sur l’approche saussurienne du signe pour défendre «la thèse de la sémioticité de l’ensemble des entités langagières qui ne sont telles que dans la mesure où leurs faces “signifiant” et “signifié” se présupposent et se construisent dans leur relation même» (par. 28).
Singulière et séminale, l’oeuvre de Frédéric François initie au réel travail conceptuel que révèlent les définitions d’enfants. Face à une mise en mots inédite, portée par le dit, le non-dit, aux prises avec le difficile à dire, elle invite à un temps de suspension qui ouvre aux possibles du texte et permet de déceler, parmi les reprises-modifications, des «événements» qui peuvent devenir pour la classe des objets de réflexion collective. La mise en dialogue de ces différentes façons de dire au sein d’une classe tend à favoriser la réflexion métalinguistique. Mais reconnaître ces façons singulières de dire le générique, le particulier et ce qui résiste à la mise en mots, entre en tension avec une conception homogénéisante et fixiste de la langue où la norme scolaire découlerait de principes rationnels et s’acquerrait avec la nomenclature grammaticale. Faire droit au perpétuel mouvement de négociation du sens dans le dialogue avec l’autre de l’interlocution, l’autre en soi et les absents de la culture ou des mondes possibles, comme y invite Frédéric François, c’est convoquer un autre imaginaire du langage et de la langue, ouvert à la variabilité des mises en mots selon les sujets parlants et les genres de discours, n’opposant pas perception et connaissance dans le codage de l’expérience. Serait-il moins compatible avec la forme scolaire? Le remplacement de langage par langue orale et langue écrite dans les programmes de maternelle 2021 en France, l’insistance sur le respect de l’ordre correct des mots en français dès la petite section porte à croire que les conceptions réductrices de l’activité langagière ont des racines profondes. Et que la vigilance de Frédéric François à l’égard des tests de langage, qui conduiraient à n’enseigner que ce qui peut être mesuré, conserve toute son actualité.
Appendices
Notes
-
[1]
Association composée à l’origine de sept personnes enseignantes-chercheuses françaises et canadiennes, dont l’objectif est de diffuser des travaux de recherche sur le verbe et de proposer des pistes pour son enseignement.
-
[2]
Les citations sont présentées selon la typographie choisie par l’auteur.
-
[3]
Selon la terminologie de l’auteur: noms «montrables»: boucher, éléphant, cartable; «non montrables»: liberté, mensonge, travail; verbes correspondant à des actions «montrables»: courir, pleurer/«non montrables»: deviner, se méfier; adjectif descriptif: fané; adjectifs «plus qualifiants»: amusant, jaloux, riche. Dans la terminologie en vigueur au Québec, il s’agit d’adjectifs qualifiants.
-
[4]
Pratique répandue à l’école, plus souvent pratiquée à l’oral qu’à l’écrit (Gourdet et Cogis, 2014).
-
[5]
Le test a été proposé aux personnes enseignantes volontaires de deux écoles de la région parisienne. Les élèves l’ont réalisé en classe avec leur enseignant, après obtention du consentement éclairé des représentants légaux: 93 réponses d’élèves de 9-11 ans ont été exploitables. Le CM1 et le CM2 étant deux classes du même cycle, relevant du même programme, il n’a pas semblé pertinent de distinguer les niveaux, d’autant que deux classes sur les quatre sont à double niveau. Une synthèse globale, sur les 93 classes, a été communiquée aux équipes qui le souhaitaient. Le confinement n’a pas permis un retour envisagé en conseil de cycle.
-
[6]
Les choix graphiques des élèves sont respectés. Les élèves sont représentés par la lettre E, suivie d’un numéro pour respecter l’anonymat.
-
[7]
Nombre d’élèves donnant cette propriété du verbe à la fois dans sa définition de septembre et de janvier.
-
[8]
Code couleur – noir: la matrice le verbe est une action et les expansions du nom action –
 : variations par rapport à la matrice le verbe est une action –
: variations par rapport à la matrice le verbe est une action –  : les mots qui signifient l’action langagière ex.: on peut dire –
: les mots qui signifient l’action langagière ex.: on peut dire –  : les termes du métalangage grammatical. –
: les termes du métalangage grammatical. –  : les exemples –
: les exemples –  : graphies non normées – entre becquets: ajouts – entre
parenthèses: code élève (E + numéro).
: graphies non normées – entre becquets: ajouts – entre
parenthèses: code élève (E + numéro). -
[9]
Pronoms personnels de conjugaison.
Bibliographie
- Auriac-Slusarczyk, E. et Blasco-Dulbecco, M. (2010). Interpréter des copies: l’intérêt des mises en grille syntaxique. Synergies Pays Scandinaves, 5, 31-48.
- Bakhtine, M. (1984). Esthétique de la création verbale. Gallimard. (Ouvrage original paru en 1979)
- Beaumanoir-Secq, M. (2018). Conceptualiser les classes de mots. À la recherche d’une grammaire utile aux élèves, dans la continuité et la cohérence. Peter Lang.
- Blanche-Benveniste, Cl. et al. (1979). Des grilles pour le français parlé. Recherches sur le français parlé, 2, 163-209.
- Bonnet, Cl. et Gardes-Tamine, J. (1984). Quand l’enfant parle du langage. Mardaga.
- Bucheton, D. (dir.). (2009). L’agir enseignant, des gestes professionnels ajustés. Octarès.
- Bulea Bronckart, E. et Elalouf, M.-L. (2016). Contenus et démarches de la grammaire rénovée. Dans S. G. Chartrand (dir.), Mieux enseigner la grammaire: pistes didactiques et activités pour la classe (p. 45-62). Pearson ERPI Éducation.
- Bulea Bronckart, E. et Bronckart, J.-P. (2022). Du sens et des signes dans l’enseignement de la grammaire. Scolia, 36, 17-38. https://doi.org/10.4000/scolia.2033
- Calame-Gippet, F. (2013). L’identification du verbe à l’école élémentaire: quels choix pour élaborer un outil de progression pour les enseignants. Dans C. Avezard-Roger et B. Lavieu-Gwozdz (dir.), Le verbe. Perspectives linguistiques et didactiques (p. 59-76). Artois Presses Université.
- Chailly, A., Lepoire-Duc, S. et Ulma, D. (2013). Quelques réflexions sur la transposition didactique du verbe à l’école primaire. Dans C. Avezard-Roger et B. Lavieu-Gwozdz (dir.), Le verbe. Perspectives linguistiques et didactiques (p. 21-30). Artois Presses Université.
- Culioli, A. (1968). La formalisation en linguistique. Cahiers pour l’analyse, 9, 106-117.
- Elalouf, M.-L., Gourdet, P. et Cogis, D. (2016). Le verbe et la phrase, entre production et conceptualisation – ce qu’ils font et ce qu’ils disent. Lidil, 54, 55-74.
- François, F. (1980a). Conduites langagières et sociolinguistique scolaire (présentation). Langages, 59, 5-8.
- François, F. (1980b). Analyse linguistique, normes scolaires et différenciations socio-culturelles. Langages, 59, 25-52. https://doi.org/10.3406/lgge.1980.1853
- François, F. (1984). Les oppositions verbo-nominales et leur développement chez l’enfant. Modèles linguistiques, VI, fascicule 1, 53-60.
- François, F., Hudelot, C. et Sabeau-Jouannet, É. (1984). Conduites linguistiques chez le jeune enfant. Presses universitaires de France.
- François, F. (1985). Qu’est-ce qu’un ange. Définition et paraphrase chez l’enfant. Dans C. Fuchs (dir.), Aspects de l’ambigüité et de la paraphrase dans les langues naturelles (p. 103-131). Peter Lang.
- François, F. (dir.). (1990). La communication inégale, heurs et malheurs de l’interaction verbale. Delachaux et Niestlé.
- François, F. (2003a). Qu’apprend-on? La langue ou des façons de mettre en mots? Le français aujourd’hui, 141, 21-35.
- François, F. (2003b). Linguistique de la langue et dialogue avec les textes. Un point de vue. La linguistique, 39(2), 61-74.
- François, F. (2004a). Enfants et récits. Mises en mots et «reste». Presses du Septentrion.
- François, F. (2004b). Comment nous est donné l’autre dans un texte? Le français aujourd’hui, 161, 85‑95.
- François, F. (2005). Interprétation et dialogue chez les enfants et quelques autres. ENS éditions.
- François, F., Cnockaert, D. et Leclercq, S. (1986). Noms, verbes et adjectifs ou définir et classer. De quelques formes de «conscience linguistique» chez les enfants de l’enseignement primaire (CE2 et CM2). Études de linguistique appliquée, 62, 26-39.
- Gombert, J.-É. (1986). Le développement des activités métalinguistiques chez l’enfant. Le point de la recherche. Études de linguistique appliquée, 62, 5-25.
- Gomila, C. (2013). Le petit mot de la classe: entre catégorisation pratique et classification grammaticale. Dans O. Bertrand et I. Schaffner (dir.), Enseigner la grammaire (p. 145-158). Éditions de l’École polytechnique.
- Gomila, C. et Roubaud, M.-N. (2013). Le verbe au cours préparatoire: premières constructions du concept. Dans C. Avezard-Roger et B. Lavieu-Gwozdz (dir.), Le verbe. Perspectives linguistiques et didactiques (p. 31-46). Artois Presses Université.
- Gourdet, P. (2009). L’enseignement de la grammaire à l’école élémentaire: le cas du verbe en CE2 [thèse de doctorat inédite]. Université Paris-ouest-La Défense et Università degli Studi di Roma Tre, dirigée par Danielle Leeman et Emma Nardi.
- Gourdet, P. (2014). Les explications linguistiques sur le verbe. Un suivi sur une année scolaire d’une cohorte d’élèves de CE2. Dans M.-N. Roubaud et J.‑P. Sautot (dir.), Le verbe en friche, approches linguistiques et didactiques (p. 217-234). Peter Lang.
- Gourdet, P. et Cogis, D. (2014). Un verbe, c’est quelque chose: emploi «profane» ou emploi «savant» du métalangage à l’école élémentaire? Le discours et la langue. Revue de linguistique française et d’analyse du discours, 6(1), 47-62.
- Gourdet, P., Cogis, D. et Roubaud, M.-N. (2016). L’enseignement d’une notion clé au primaire: le verbe. Dans S.-G. Chartrand (dir.), Mieux enseigner la grammaire. Pistes didactiques et activités pour la classe (p. 147-173). Pearson ERPI Éducation.
- Gourdet, P. et Roubaud, M.-N. (2016). L’enseignement du verbe à l’école. Des tensions entre enseignants et élèves de CM2. Pratiques, 169-170. https://doi.org/10.4000/pratiques.3059
- Gourdet, P. (2022). Les discours grammaticaux sur le verbe par des élèves de CE2 et de CM2. Mise en perspective des performances et des connaissances des élèves. Scolia, 36, 111-131. https://doi.org/10.4000/scolia.2225
- Grossmann, F. (1996). La mise en texte de la théorie grammaticale dans les manuels scolaires. Repères, 14, 57-82.
- Jorro, A. (2006). L’agir professionnel de l’enseignant. Séminaire de recherche du Centre de recherche sur la formation, CNAM, Paris, France. halshs-00195900
- Lavieu-Gwozdz, B. (2014). Le verbe au cycle 3. Le point sur les connaissances des élèves. Dans M.-N. Roubaud et J.-P. Sautot (dir.), Le verbe en friche. Approches linguistiques et didactiques (p. 193-216). Peter Lang.
- Lord, M.-A et Elalouf, M.-L. (2016). Enjeux de l’utilisation de la métalangue en classe de français. Dans S.-G. Chartrand (dir.), Mieux enseigner la grammaire. Pistes didactiques et activités pour la classe (p. 63-80). Pearson ERPI Éducation.
- Nadeau, M. et Fisher, C. (2006). La grammaire nouvelle, la comprendre et l’enseigner. Gaétan Morin éditeur.
- Sautot, J.-P., Beaumanoir-Secq, M. et Gourdet, P. (2021). Enjeux et choix méthodologiques pour l’étude des rendements des classes dans la recherche REAlang. Scolagram, 8. https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/revue-2/75-realang/326-rendement
- Tisset, C. (2005). Observer, manipuler, enseigner la langue au cycle 3. Hachette éducation.
- Tisset, C. (2017). Enseigner la langue française à l’école. Hachette éducation.
- Van Raemdonck, D. et Meinertshagen, L. (2014). Deux ou trois choses que l’élève devrait savoir sur le verbe. Dans M.-N. Roubaud et J.-P. Sautot (dir.), Le verbe en friche, approches linguistiques et didactiques (p. 161‑174). Peter Lang.
- Windisch, U. (1990). Le prêt-à-penser. Les formes de la communication et de l’argumentation quotidiennes. L’Âge d’homme.