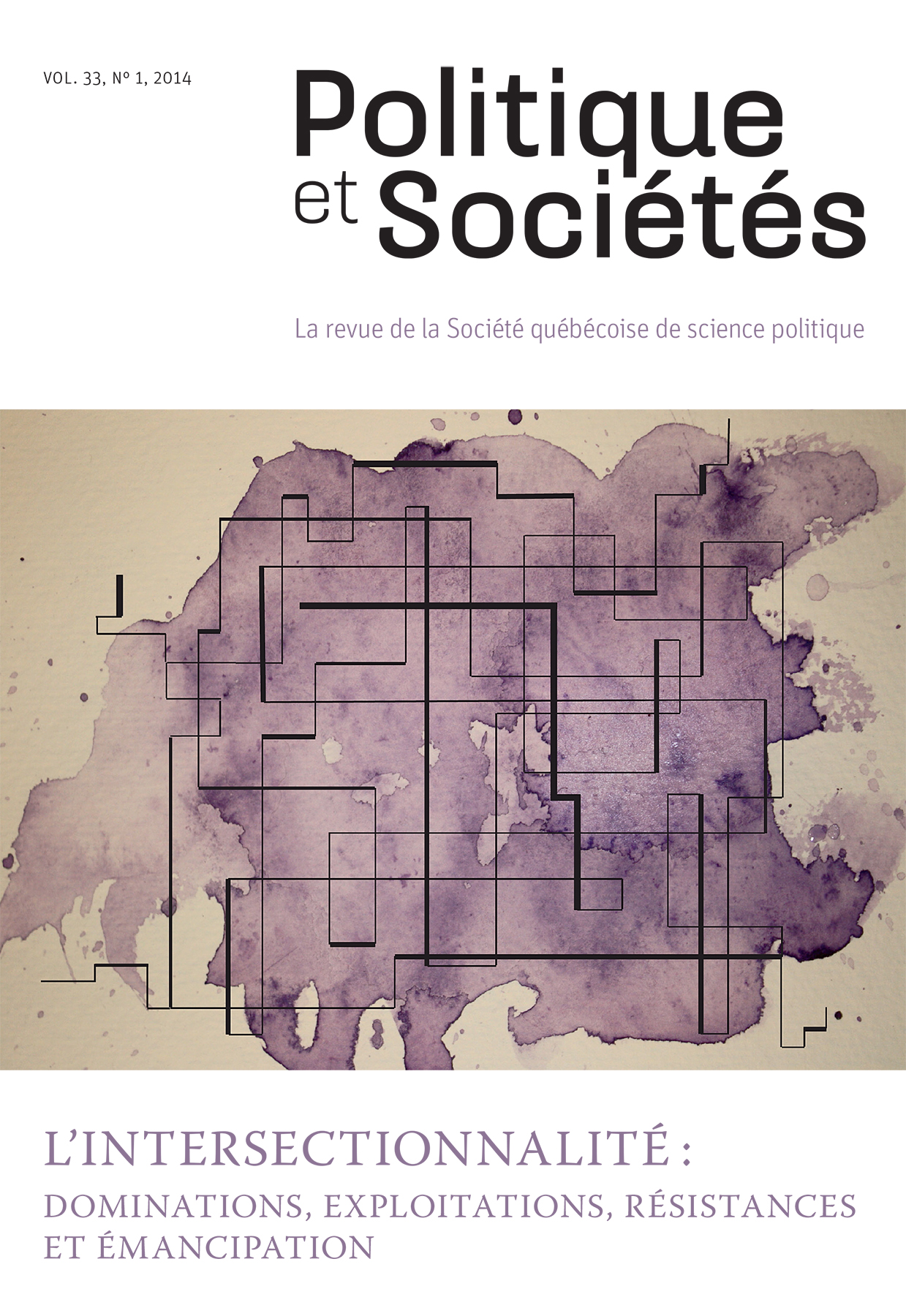Article body
La thèse classique de la construction de la théorie réaliste en relations internationales explique qu’à la suite de l’échec du libéralisme idéaliste de l’entre-deux-guerres, un grand débat s’est ouvert et que le réalisme en est sorti victorieux. Il s’agit d’une explication parcimonieuse reflétant un idéal scientifique où une théorie inapte à expliquer la réalité est remplacée, grâce au choc des idées, par un cadre d’analyse mieux outillé pour comprendre le monde. Cette thèse néglige le fait que la recherche s’inscrit dans un contexte – social, économique, culturel, politique et idéologique – et que les grandes théories en sciences sociales, par leur nature, sont particulièrement influencées par ce contexte.
L’ouvrage dirigé par Nicolas Guilhot s’intéresse à ce contexte. Il analyse le processus qui a mené à une tentative « d’invention » des relations internationales lors de la conférence de 1954 sur la théorie, conférence organisée par la Rockefeller Foundation. Pour la première fois, et c’est là l’un des éléments les plus intéressants du livre, des chercheurs ont eu accès aux transcriptions des conversations s’étant tenues lors de cette conférence des 7 et 8 mai 1954. Ces documents sont d’ailleurs reproduits en annexe du livre. Cette conférence est importante parce que, selon les contributeurs à l’ouvrage, il y avait une réelle volonté de la Rockefeller Foundation de fonder une théorie des relations internationales. Pour ce faire, les représentants de la fondation, Dean Rusk et Kenneth Thompson, discutent avec d’illustres penseurs, praticiens et journalistes : Hans J. Morgenthau, William T.R. Fox, Reinhold Niebuhr, Arnold Wolfers, Dorothy Fosdick, Robert Bowie, Walter Lippmann, Paul H. Nitze, Don K. Price et James B. Reston.
Guilhot s’entoure de collaborateurs provenant de diverses traditions de recherche pour explorer la signification de cette conférence et des transcriptions des conversations qui y ont eu lieu. Certains de ses collaborateurs proviennent du milieu des théories des relations internationales (Robert Jervis, Jack Snyder ou Ole Waever), d’autres se rattachent plutôt à l’histoire et à la sociologie des sciences sociales (dont Guilhot, mais aussi Inderjeet Parmar et Brian Schmidt) et quelques-uns sont issus de différentes branches de l’histoire (Anders Stephanson et Philip Mirowski). Chaque auteur offre un chapitre où il explore, à sa façon, les documents de la conférence.
L’apport des différents collaborateurs à l’ouvrage est inégal. En effet, l’intérêt central de The Invention of International Relations Theory ne repose pas sur le fait qu’il approfondit la compréhension de la théorie réaliste – considérée ici comme l’élément central de la théorie moderne des relations internationales –, mais plutôt sur le fait qu’à travers les transcriptions des conversations on peut voir la genèse intellectuelle ancrée dans un contexte concret de la théorie réaliste. Guilhot lui-même note que, dans leur ensemble, les conversations étaient floues, marquées par des malentendus, des notions et concepts équivoques, des désaccords, des efforts d’introspection et qu’elles ont finalement été peu concluantes (p. 11). C’est dans le domaine de l’histoire intellectuelle du réalisme que ce livre est important et fait sa marque. Ole Waever, dans son chapitre, explique que cette analyse est possible puisque les chercheurs ont accès non pas à un apport public au processus collectif de construction de sens, comme le serait un article scientifique ou un texte canonique en relations internationales, mais bien à la préparation privée d’un apport public, comme une conversation privée (p. 104).
Un autre chapitre fort est celui de Robert Jervis qui utilise à bon escient les transcriptions pour étayer son hypothèse que les penseurs réalistes de cette époque étaient profondément préoccupés par la moralité de leur théorie et de la conduite correcte de la société. Il s’inscrit ainsi dans une certaine forme de révisionnisme tentant de rendre plus acceptable la pensée réaliste en démontrant ses fondements moraux, contrairement au cliché du réaliste immoral. Ce faisant, il contribue à l’ouvrage en démontrant efficacement que les individus qui créent la théorie sont influencés, la théorie aussi par le fait même, par leur sensibilité et leur sens moral, et ce, particulièrement lorsque les preuves et les faits étudiés sont ambigus (p. 42).
Cependant, c’est dans la complémentarité des chapitres écrits par Waever, Guilhot, Parmar et Mirowski qu’on peut situer le coeur du livre, le noyau intellectuel qui en fait un grand ouvrage. Guilhot utilise une approche sociologique pour faire ressortir l’importance des chercheurs spécifiques, des arènes de discussion, des ambitions professionnelles et des contraintes matérielles (financières entre autres) dans la production des champs de savoirs et des disciplines en sciences sociales. Il démontre avec brio, bâtissant habilement sur les jalons posés en introduction, le fait que le réalisme représentait une forme de consensus négatif contre l’évolution de la science politique et des sciences sociales de l’époque ; bref, que des chercheurs ont pu trouver des ressources pour tenter d’autonomiser un sous-champ de la discipline, en partie par désaccord intellectuel, mais aussi pour des raisons pragmatiques plus sociologiquement ancrées.
Inderjeet Parmar, de son côté, utilise une approche davantage macroscopique du phénomène en se concentrant sur l’analyse des visées non pas des chercheurs, mais plutôt des visées et des intentions des fondations, entre autres la Rockefeller Foundation. Pour y parvenir, il s’appuie efficacement sur des concepts gramsciens pour caractériser les fondations comme des institutions avec un état d’esprit étatique qui visent, à travers le projet de la conférence de 1954 et les autres événements associés, à créer une classe d’intellectuels organiques qui subviendront aux besoins étatiques tels que compris par les fondations. Il y met en évidence l’importance des structures de pouvoir face aux chercheurs.
Ole Waever, théoricien important de l’école de Copenhague en relations internationales, utilise dans son chapitre les transcriptions pour produire une analyse à une échelle similaire à celle de Guilhot, mais avec un développement conceptuel plus formel inspiré de Quentin Skinner. Il utilise efficacement le modèle de Randall Collins et inverse l’ordre d’influence proposé par Parmar dans son modèle gramscien en avançant l’importance première du milieu scientifique immédiat du chercheur et en dernier lieu les forces politiques et économiques. Il expose ainsi que l’applicabilité politique d’une théorie, tant désirée par les fondations, est importante du point de vue du chercheur dans la mesure où elle se traduit par une augmentation de son pouvoir dans la sphère scientifique (p. 102).
Finalement, Philip Mirowski, qui a publié principalement en histoire et en philosophie de la pensée économique, propose une lecture très près du texte où il tente de démontrer la racine commune du réalisme et du néolibéralisme de Friedrich Hayek en la personne de Carl Schmitt. La démonstration n’est pas réussie hors de tout doute raisonnable, mais, au fil de ce chapitre, l’auteur met en évidence le fait que nombre de penseurs du réalisme ont été abreuvés par des écoles de pensée allemandes et que, en tant que savants émigrés, ils portaient tout un bagage intellectuel qui influençait leur pensée.
À travers cette perspective multiple – échelles d’analyses, cadres conceptuels, méthodes – sur le même objet qu’est « l’invention » du réalisme, ces quatre chapitres clés, efficacement mis en contexte dans l’introduction, offrent une explication riche et nuancée, parfois contradictoire, du phénomène étudié. C’est dans ces chapitres pris conjointement que l’ouvrage collectif démontre sa grande pertinence.
De ce portrait dressé par les divers contributeurs, on retient que la Rockefeller Foundation fut un partisan précoce des savants et des chercheurs s’opposant à la science politique comme une discipline rationnelle qui prétend résoudre scientifiquement les problèmes politiques et sociaux et qu’elle a donc mis en place consciemment, grâce à Kenneth Thompson qui était un ancien étudiant de Morgenthau, un projet visant à rassembler des forces vives pour autonomiser la discipline des relations internationales par rapport à la science politique positiviste. Nombre des savants qui ont été appelés à contribuer étaient des savants émigrés et partageaient une vision ancrée dans une certaine pensée allemande de la politique comme prérationnelle. Ce faisant, ces chercheurs ont tenté d’offrir aux praticiens une théorie qui satisfasse leur besoin tout en se créant une niche pour leur cadre théorique particulier, ce pour quoi on peut les considérer comme des entrepreneurs disciplinaires. Cependant, en dernière instance, les auteurs démontrent que le pari d’autonomiser les relations internationales de la science politique ne fut pas réussi.
Malgré les grandes qualités, quoique inégales selon les chapitres, de cette oeuvre, le lecteur est déçu de ne pas pouvoir lire une conclusion englobante par le directeur de l’ouvrage, Nicolas Guilhot. Pouvoir lire son analyse des différentes contributions de l’ouvrage et comment il les réconcilie pour offrir un éclairage riche et nuancé de cette tentative d’invention des relations internationales aurait été utile pour approfondir la portée de l’oeuvre collective et franchement agréable. À défaut, on se retrouve avec une oeuvre généralement intéressante, mais qui est une mosaïque de chapitres inégaux plutôt qu’un livre cohérent. En bref, une oeuvre à lire pour toute personne intéressée par l’histoire des relations internationales et la sociologie des sciences sociales et qui acceptent de ne pas lire un livre parfaitement achevé.