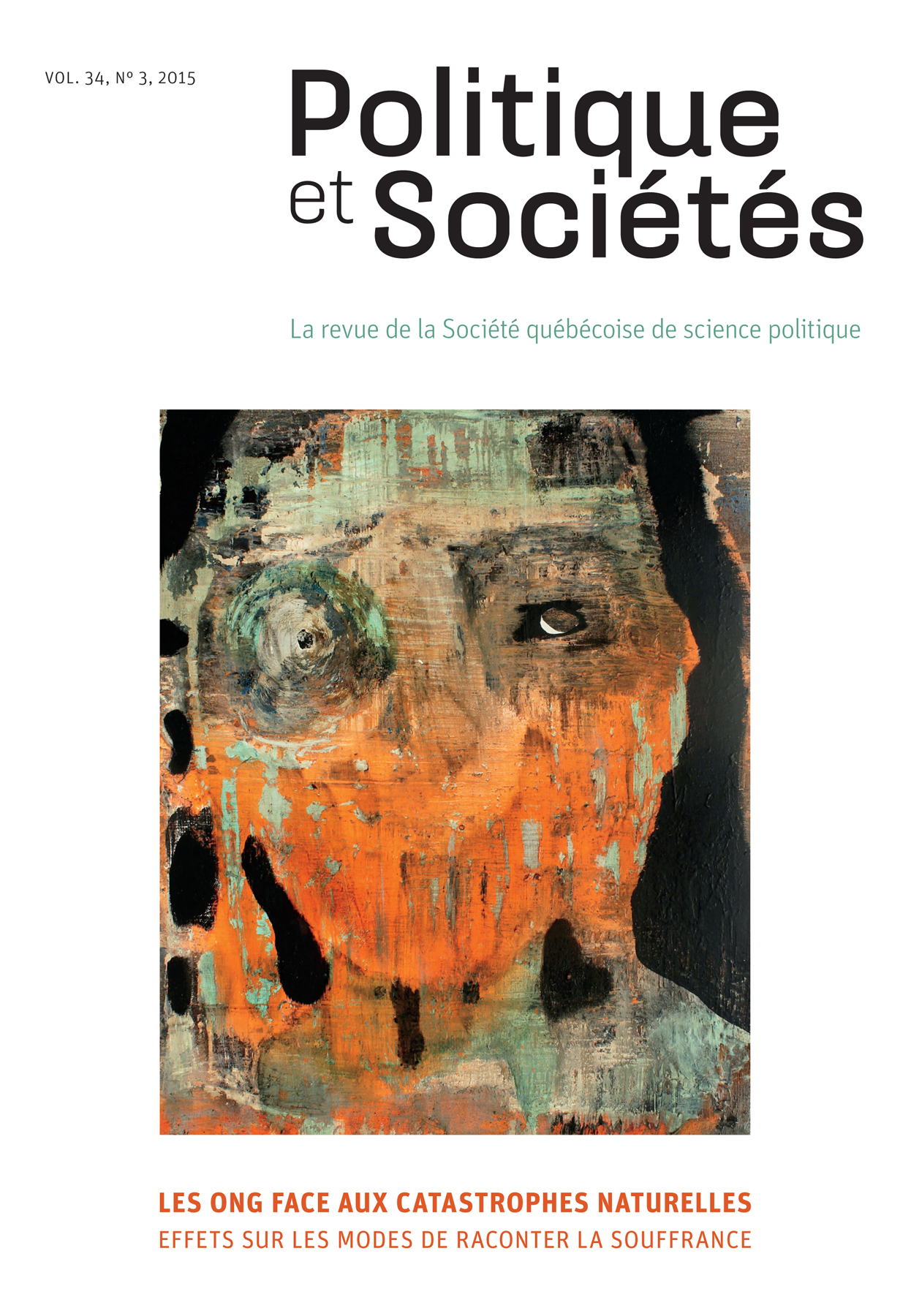Abstracts
Résumé
Le séisme a fait s’imposer en Haïti l’ordre disciplinaire des organisations non gouvernementales. Tout en apportant de façon plus ou moins satisfaisante du secours aux populations de l’immense zone affectée, l’urgence humanitaire, épurant d’affects l’expression de la souffrance, est parvenue à atteindre la capacité collective d’imaginer de la société haïtienne. Cependant, ce n’est pas tout le monde qui a répondu à l’interpellation « Eh ! toi qu’on est venu aider ». L’objet de cet article est de voir, à travers la parole recueillie lors d’entrevues de terrain à Jacmel, à Léogâne et à Port-au-Prince en 2012 et 2013, comment la figure du « mauvais sujet » qui ne réagit pas à cette interpellation réactive l’imaginaire social. Le « mauvais sujet » n’est pas une catégorie sociologique. C’est plutôt un cliché auquel on associe une certaine connivence ou qu’on pointe du doigt. Colle à cette figure la réputation de « ne pas faire comme il faut », d’être à la limite de l’acceptable. En même temps, elle renvoie à une certaine fierté, une certaine débrouillardise ; on ne se voit pas comme un démuni. Cette fierté du « mauvais sujet » est une expression de la souffrance. Elle ne débouche pas nécessairement sur des protestations collectives, mais secoue l’imaginaire social.
Abstract
The 2010 Haiti earthquake led to the imposition of the non-governmental organizations’ marching orders. Whereas emergency help to the stricken population across the vast area affected was provided, Haitian society’s collective imagination was shaken to its foundations by the extent of the suffering and not everyone reacted favourably to being addressed as, “Hey you whom we came to help.” This article aims to explain how the figure of the “bad subject” by not reacting to the above call revives the social imaginary. It is the result of field-based interviews that took place in Jacmel, Léogâne, and Port-au-Prince in 2012 and 2013. “Bad subject” is not a sociological category. Rather it is a cliché that implies a certain connivance. This figure is associated with “not doing the right thing,” “being borderline,” but at the same time, it infers a certain pride based on self-sufficiency and not being destitute. This pride of the “bad subject” is in fact an expression of suffering. In the short term, it does not lead to public demonstrations but it does impact on the social imaginary.
Appendices
Bibliographie
- Agier, Michel, 2008, Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion.
- Agier, Michel, 2013, Campement urbain. Du refuge naît le ghetto, Paris, Payot, coll. « Manuels ».
- Althusser, Louis, 1976, « Idéologie et appareils idéologiques d’État », dans Positions, Paris, Éditions sociales, p. 67-125.
- Arendt, Hannah, 1983, Condition de l’Homme moderne, Paris, Calmann-Lévy.
- Austin, John, 1970, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil.
- Boltanski, Luc, 2007 [1993], La souffrance à distance, Paris, Gallimard.
- Bourdieu, Pierre, 1982, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard.
- Bruschi, Fabio, 2013, « Appareils et sujets chez Althusser », Cahiers du GRM [Groupe de recherches matérialistes], no 4, mis en ligne le 12 décembre 2013, consulté sur Internet (http://grm.revues.org/357) le 27 avril 2014.
- Buteau, Pierre, Rodney Saint-Éloi et Lyonel Trouillot (sous la dir. de), 2010, Refonder Haïti ?, Montréal, Mémoire d’encrier.
- Butler, Judith, 2002, La vie psychique du pouvoir. L’assujettissement en théories, Paris, Léo Scheer.
- Castoriadis, Cornelius, 2006 [1975], L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil.
- Cooper, Barbara M., 2007, « La rhétorique de la ‘mauvaise mère’ », dans Xavier Crombé et Jean-Hervé Jézéchel (sous la dir. de), Niger 2005. Une catastrophe si naturelle, Paris, Karthala, p. 199-228.
- Corten, André, 2000, Haïti : misère, religion et politique. Diabolisation et mal politique, Paris, Karthala.
- Corten, André, 2011a, L’État faible. Haïti et République dominicaine, Montréal, Mémoire d’encrier.
- Corten, André, 2011b, « Souffrance sociale, parler ordinaire, imaginaires religieux et expression politique », Social Compass, vol. 58, no 2, p. 143-152.
- Corten, André et Anne-Élizabeth Côté (sous la dir. de), 2008, La violence dans l’imaginaire latino-américain, Paris / Québec, Karthala / Presses de l’Université du Québec.
- Duriez, Bruno, François Mabille et Kathy Rousselet (sous la dir. de), 2007, Les ONG confessionnelles. Religions et action internationale, Paris, L’Harmattan.
- Étienne, Sauveur Pierre, 1997, Haïti : l’invasion des ONG, Montréal, Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA).
- Fassin, Didier et Mariella Pandolfi (sous la dir. de), 2010, Contemporary States of Emergency. The Politics of Military and Humanitarian Interventions, New York, Zone Books.
- Foucault, Michel, 1969, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
- Foucault, Michel, 1971, L’ordre du discours, Paris, Gallimard.
- Hébert, Martin, 2011, « L’éthique du bon voisin : solidarité, intérêt et logique du don dans l’humanitaire », dans Shimbi Katchalewa (sous la dir. de), L’humanitaire, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 169-180.
- Kleinman, Arthur, Veena Das et Margaret Lock (sous la dir. de), 1997, Social Suffering, Berkeley, University of California Press.
- James, Erica Caple, 2010, « Ruptures, Rights, and Repair : The Political Economy of Trauma in Haiti », Social Science & Medicine, vol. 70, p. 106-113.
- Kosseleck, Reinhart, 1990, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historique, Paris, Éditions de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).
- Labov, William, 1978, Le parler ordinaire, Paris, Minuit.
- Lautier, Bruno, 2004, L’économie informelle dans le tiers monde, Paris, La Découverte.
- Lister, Sarah, 2003, « NGO Legitimacy, Technical Issue or Social Construct ? », Critique of Anthropology, vol. 23, no 2, p. 175-192.
- Louis, Ilionor, 2013, Des bidonvilles aux camps : Conditions de vie à Canaan, à Corail Cesse-Lesse, et à la Piste de l’ancienne aviation de Port-au-Prince, Rapport de recherche, Port-au-Prince, Université d’État d’Haïti.
- Louis, Jean-Mary, 2010, L’invention d’Haïti comme société pauvre. L’herméneutique de la société pauvre haïtienne, thèse de doctorat en science politique, Montréal, Université du Québec à Montréal.
- Naëllou, Anne et Jean Freyss (sous la dir. de), 2004, « ONG : les pièges de la professionnalisation », Revue Tiers Monde, no 180, octobre-décembre.
- Paul, Bénédique, Alix Dameus et Michel Garrabe, 2010, « Le processus de tertiarisation de l’économie haïtienne », Études caribéennes, no 16, août, mis en ligne le 19 mai 2012, consulté sur Internet (http://etudescaribeennes.revues.org/4728) le 17 juin 2015.
- Putnam, Robert D, 2002, Democracies in Flux : The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, New York, Oxford University Press.
- Renault, Emmanuel, 2008, Souffrances sociales. Philosophie, psychologie et politique, Paris, La Découverte.
- Schloms, Michael, 2005, « Le dilemme inévitable de l’action humanitaire », Cultures & Conflits, no 60, p. 85-102.
- Schmitt, Carl, 1985, Théologie politique, Paris, Gallimard.
- Siméant, Johanna, 2001, « Urgence et développement, professionnalisation et militantisme dans l’humanitaire », Mots. Les langages du politique, no 65, p. 28-50.
- Sommet mondial pour l’avenir d’Haïti, 2010, Déclaration finale, consulté sur internet (http://www.haitilibre.com/article-242-haiti-punta-cana-declaration-finale-texte-integral.html) le 9 juillet 2015.
- Tardif, Francine, 1997, Regard sur l’humanitaire. Une analyse de l’expérience haïtienne dans le secteur de la santé entre 1991 et 1994, Montréal, L’Harmattan.
- Zanuso, Claire, Constance Torelli et François Roubaud, 2014, Le marché du travail en Haïti après le séisme : quelle place pour les jeunes ?, document de travail DT/2014-03, Paris, Université Paris-Dauphine.