Abstracts
Résumé
L’actualité et le quotidien ont été progressivement monopolisés par la pandémie qui a fait surface à la fin de l’année 2019, en raison de son urgence et de sa gravité. L’on commencera par se demander comment les sciences nous permettent de la comprendre et pourquoi ce sont certaines sciences en particulier qui ont pris l’avant-plan. En réfléchissant aux questions relevant de la biodiversité et des rapports entre les humains et leurs divers contextes écosystémiques, il devient possible de reposer le problème en termes politiques et économiques, dans une approche qui met la prévention au coeur des attitudes requises. Une gouvernance polycentrique – faisant intervenir plusieurs pôles (Ostrom, 2005) – peut aider à renouveler notre façon de poser les problèmes de pandémie d’un point de vue éthique.
Abstract
The pandemic is front page news every day and everywhere since 2020, because of the emergency of the crisis affecting everyone’s lives seriously. Division of the scientific work has first to be interrogated here. What is the scientific treatment of these issues, and should we not also consider these questions at the source, by not staying focused on a curative only approach? Looking at biodiversity issues and human societies’ relationships with ecosystem contexts, it becomes possible to consider the pandemic in political and economic terms, aiming at a preventive approach and attitude. A polycentric governance perspective (Ostrom, 2005) is posited as a practical way to renew our problematization of the issue, from an ethical perspective.
Article body
INTRODUCTION
En date du 28 juin 2021, le SRAS-CoV-2 est la cause avérée de plus de 3 920 463 décès directs sur le globe; il a infecté au moins 181 millions de personnes, et il a aussi produit une quantité encore non précisée de décès indirects (WHO, 2020). Certaines estimations évoquent soit un tiers supplémentaire, soit le passage du simple au double; chose certaine ce n’est pas mineur.[1] À l’heure d’écrire ces lignes, malgré l’inquiétude pour le variant Delta, la vaccination semble bien engagée dans plusieurs pays, où l’on observe de fortes diminutions des taux d’infection, d’hospitalisation et de décès directs. C’est le cas du moins pour les pays fortunés, car la distribution des vaccins dans les pays les plus pauvres échoue à respecter une conception même minimale de l’équité.[2]
Bien des spécialistes sont d’accord pour dire que les mois à venir seront cruciaux et que ce n’est aucunement le moment de baisser la garde. Cela étant dit, et au-delà de tout blâme ou de tout propos culpabilisant visant les uns et/ou les autres, la pandémie de COVID-19 livre une terrible leçon sur plusieurs plans. Son avancée subite et décisive a montré l’impréparation de nos sociétés, dévoilant aussi l’absence presque totale de considération préventive. Encore une fois (on le sait déjà avec le cas des changements climatiques), il a bien fallu constater de manière répétée la prise en compte insuffisante, le manque de prise au sérieux des avis des scientifiques par les décideurs de la grande partie des pays touchés, y compris, bien entendu, au Québec et au Canada.[3] Ultérieurement, des ouvrages d’histoire seront écrits à ce sujet (ce qui échappe au présent propos); ce serait requis pour les divers pays, restera à voir quelles leçons concrètes on en tirera. Il ne faut pas non plus oublier comment la très grande vulnérabilité des sociétés notamment occidentales s’est dévoilée devant la COVID-19, qui n’est ni la première ni la dernière pandémie à frapper notre espèce. Ce texte se veut une contribution philosophique à la discussion sur cela, au croisement de l’éthique environnementale et de la philosophie pratique; mais l’on commencera par se mettre autant que possible à l’écoute des sciences dont c’est le travail propre.
1. SUR LES LIENS DE LA PHILOSOPHIE AUX SCIENCES ET SUR LES DIFFÉRENTS ASPECTS DU QUESTIONNEMENT
Admettons d’entrée de jeu que pour pouvoir se déployer, une réflexion éthique qui concerne le rapport au monde qui nous entoure (appelons-le « environnement ») a besoin des savoirs et des approches développés par les sciences qui s’en occupent. Souvenons-nous aussi du fait que les connaissances en sciences ont très souvent des liens avec des pratiques professionnelles en relation avec des enjeux sur le terrain : médecine, mais aussi remédiation environnementale, gestion concrète de l’environnement. C’est d’ailleurs le cas dans tous les domaines où la réflexion éthique se confronte à des questions qui ont besoin d’être traitées par les sciences; par exemple, quelle bioéthique serait envisageable sans les sciences du vivant, sans la médecine et les disciplines liées ? C’est le cas aussi en éthique environnementale. Et n’oublions pas qu’au sein même des disciplines comme la biologie de la conservation, l’écologie ou la chimie de l’environnement, de même que dans les disciplines visant à préserver la santé publique, de la médecine spécialisée à la virologie, les enjeux normatifs sont présents dans la mesure où les dangers et les pertes deviennent trop évidents et trop sérieux pour être passés sous silence. La médecine a des engagements axiologiques, il en va de même pour les disciplines de l’environnement.
De ce point de vue, comme nous voulons discuter du SRAS-CoV-2 et de la maladie qu’il provoque, la COVID-19, voyons ce que les sciences nous disent sur les pandémies; il y a certes des débats, des incertitudes, on le voit bien depuis le printemps 2020, mais sur le fond il n’y a pas de doutes sérieux. Si nous admettons qu’il y a un étroit rapport entre la croyance et les habitudes d’action, l’on constate qu’en l’absence de certitude, l’on ne sait plus bien comment agir (Peirce, 2002; 1877; Misak, 2016); on a pu le voir avec les fluctuations dans les mesures proposées, les changements de décisions politiques à tel et tel moment. Que pouvons-nous donc savoir sur les pandémies, pour fixer nos croyances et générer de meilleures actions ?
La question de la pandémie est fort complexe puisque les connaissances requises pour simplement comprendre la discussion se développent dans une pluralité de disciplines. Les philosophies ne peuvent pas plus que les autres en faire la synthèse; les unes et les autres n’ont pas accès à des certitudes particulières qui les mettraient au-dessus d’autres praticiens de diverses disciplines. Nous sommes aidés par le fait qu’un certain nombre de recoupements ont déjà été effectués entre plusieurs secteurs de recherche sur ces questions (pensons aux éléments partagés entre épidémiologistes et virologues). Les connaissances de base ne sont tout de même pas récentes puisque les épidémies et les pandémies sont documentées depuis plus d’un siècle et donnent lieu à des stratégies de lutte elles aussi connues.
Les pandémies sont-elles un problème médical? Bien sûr que oui en un sens, mais est-ce la cadre scientifique qui convient le mieux pour les comprendre? Il est évident que dans le feu de la crise que nous vivons depuis plus d’une année, les disciplines d’avant plan furent la biomédecine, la médecine d’urgence, la virologie, avec les enjeux de création puis de validation et de distribution des vaccins, avec le secours d’une épidémiologie liée aux recensements de cas. Le caractère massif de cette présence d’un cadrage avant tout médical et statistique de la discussion est d’autant plus fort qu’il est très lié aux états de situation dans telle et telle région : au Québec, un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); en France, les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD); etc. Chaque fois, c’est tel groupe de professionnelles ou professionnels (préposés, infirmières, urgentologues, spécialistes, etc.) qui semble concerné. Il est clair qu’alors on ne travaille pas en amont, mais en aval des problèmes; on panse les plaies, on soigne les malades, on critique l’inefficience et les retards, on discute de solutions possibles, etc. Sans doute est-ce une réaction normale, notamment puisque nous avons du moins quelques prises sur les effets directs de la pandémie sur des gens concrets; certaines et certains d’entre nous sont sur le front, d’autres ont pris des décisions, l’une et l’autre peuvent commenter ou exprimer un avis. Mais à la base, les problèmes de pandémie ne relèvent pas seulement des sciences biomédicales, ils relèvent plus largement des sciences du vivant et de l’étude de la biodiversité. Or, une simple lecture régulière des journaux combinée avec l’écoute des médias courants montre que c’est le volet biomédical qui occupe le plus d’espace dans la discussion publique sur la pandémie, et non les enjeux de préservation de la biodiversité. Est-ce en raison du fait que nous avons l’impression de ne pas avoir de pouvoir sur ces questions, liées apparemment ou bien au marché de Yuhan ou à l’élevage de visons dans les pays scandinaves ou en Colombie-Britannique?
2. QUELQUES RÉSULTATS ET POSITIONS D’UN GROUPE DE CHERCHEURS MANDATÉS ET VALIDÉS PAR L’ONU
Pour constater l’état des lieux en ce qui concerne notre interrogation dans les chantiers des sciences de l’environnement et du vivant, on peut se référer aux documents récents de l’organisation soutenue par l’ONU et qui se veut le pendant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les questions de la biodiversité, soit l’IPBES (International Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ainsi qu’aux textes qui sont à l’appui dans les publications spécialisées, notamment les revues de recherche. Quelques citations nous conduiront bientôt au coeur du sujet.
Pandemics have their origins in diverse microbes carried by animal reservoirs, but their emergence is entirely driven by human activities. The underlying causes of pandemics are the same global environmental changes that drive biodiversity loss and climate change. These include land-use change, agricultural expansion and intensification, and wildlife trade and consumption.
IPBES, 2020, p. 2
Il y a une claire connexion entre les empiètements des humains sur la biodiversité et le développement des pandémies. Ces empiètements incluent une déforestation qui sert non seulement à fournir du bois et des aliments de consommation immédiate, mais aussi à élargir les espaces disponibles pour les cultures et l’élevage. Toutefois, comme les virus possèdent des niches écologiques et utilisent des vecteurs vivants qui en ont également, et en raison des changements climatiques, certains vecteurs épidémiques sont également mobiles.[4] L’on aura noté que le cumul des activités humaines nous fait perdre certaines composantes de la diversité biologique et qu’à la fois il atteint gravement la stabilité du système climatique dont nous dépendons.[5] L’utilisation des sols est une catégorie englobant plusieurs actions; l’ensemble concerné produit d’importants effets.
Land-use change includes deforestation, human settlement in primarily wildlife habitat, the growth of crop and livestock production, and urbanization.
IPBES, 2020, p. 3
Land-use change creates synergistic effects with climate change (forest loss, heat island effects, burning of forest to clear land) and biodiversity loss that in turn has led to important emerging diseases.
IPBES, 2020, p. 3
Ajoutons que les manifestations d’une pauvreté intense recoupent étroitement de nouveaux empiétements sur les territoires chauds de la biodiversité, ce qui se voit notamment au Brésil (autour de la forêt amazonienne) et ailleurs. La citation qui suit souligne en particulier un autre élément, le lien avec la croissance populationnelle et ses usages : plus de gens entraîne plus de besoins, et donc plus de sollicitations et d’empiètements, même à supposer (avec optimisme?) une proportion relativement constante de populations pauvres.
EIDs [Emerging infectious diseases] tend to originate first in rural regions of tropical or subtropical countries with high wildlife diversity (and therefore likely high viral diversity), human populations that are growing rapidly, and where land use change is driving closer contact among people and wildlife. Therefore, rural communities in developing countries are often on the frontline of disease emergence.
IPBES, 2020, p. 8
C’est à l’occasion de la crise récente provoquée par la COVID-19 que les liens des pandémies avec la biodiversité ressortent de nouveau. L’extinction massive d’espèces à notre époque est bien attestée dans les recherches, et ce, depuis un certain temps.[6] Il faut rappeler que les pandémies passées ou encore actuelles sont des zoonoses, soit des maladies qui ont pour vecteurs des vivants non humains, des animaux parmi lesquels des insectes, mais aussi des mammifères : les plus connues sont le Zika, l’Ebola, le virus du Sida, la maladie de Lyme, le H1N1, le SRAS et finalement le SRAS-CoV-2, deux formes de coronavirus. L’affaiblissement général de l’efficacité des antibiotiques, rappelé récemment dans un texte de Boucar Diouf, ne peut qu’aggraver le cas (IPBES, 2019; Diouf, 2020).
Nous avons tendance à isoler les questions pour mieux les analyser, mais il faut conserver en vue les combinatoires de problèmes. Ainsi, la perte de biodiversité et les changements climatiques viennent augmenter le processus d’empiètement qui est lui-même à la source des pertes en biodiversité, un véritable cercle vicieux. Pertes et changements rendent plus difficile l’accès au bois et aux aliments, alors que les besoins humains ne diminuent pas; en conséquence, plus de démarches de sollicitation des « ressources » deviennent requises. De plus, cet ensemble de facteurs n’est pas sans liens avec les usages de pesticides et la perte de capacité productive des sols, pour les mêmes raisons : la lutte chimique pour la protection des cultures continuent d’apparaître comme la solution la plus évidente, surtout en contexte d’absence de conseil agronomique adéquat (Schiesari, 2013). Les bouleversements du climat et les pertes de biodiversité ont une même série de causes : l’agentivité humaine poursuivant ses buts usuels. De surcroît, la pollution plus intense de l’atmosphère, qui cause une prévalence plus élevée des maladies pulmonaires et cardiaques (Hoek et al., 2013), est étroitement liée à l’usage des combustibles fossiles, lesquels produisent aussi des GES, facteur central des bouleversements climatiques; et n’oublions pas les données récentes qui montrent que les maladies pulmonaires aggravent la réaction à la COVID-19 (Münzel, 2017). La notion du « One Health », qui rallie bon nombre de chercheurs préoccupés de ces questions, est une notion à portée normative et intégrative qui est mise de l’avant par une pluralité d’acteurs de la recherche en biodiversité : elle vise l’intégration de la santé humaine, de la santé animale et de secteurs de l’environnement dans une même problématique (Bird et Mazet, 2018).
C’est sans doute un concept à soutenir, mais le problème principal qu’on rencontre ici, c’est celui de l’agentivité humaine organisée ordinaire, pour le moins déficiente sur ces questions. Expliquons : l’on admettra aisément que l’agir humain est organisé, coordonné en groupes diversifiés selon diverses fonctions. Contrairement à une notion forte de l’agentivité assez usuelle en philosophie morale, impliquant une intention personnelle consciente d’elle-même, de ses responsabilités incluant la prise en compte des conséquences indirectes de l’action, l’agentivité humaine organisée ordinaire est simplement orientée vers des buts assez simples, comme se nourrir, se reproduire, assurer le logis, en prenant les moyens les plus efficaces. Cela correspond à ce que Habermas, à la suite de Weber, appelait l’action rationnelle par rapport à une fin (Habermas, 1987 [1981]); on se souviendra que ce type d’action selon Weber n’inclut pas l’orientation axiologique. Dans le cas qui nous intéresse ici, les pertes de biodiversité et l’appauvrissement des sols ne sont pas des buts, mais des conséquences indirectes d’une action téléologiquement orientée vers certains résultats habituellement visés.
Loin donc de pouvoir nous satisfaire de solutions individuelles, il faut considérer les questions à une échelle plus vaste. Comme les problèmes ne sont pas limités à un pays et par des frontières, il semble requis de renvoyer à une coordination internationale, à des initiatives des organisations de l’ONU. Mais rappelons les limites de ces organisations qui, malgré les bonnes volontés des uns et des autres, n’ont que peu de pouvoir, outre l’éducation ou la remédiation ponctuelle. En effet, ce sont les pays singuliers qui autorisent ou non telles pratiques de collecte du bois ou de mise en marché des espèces braconnées, qui ont ou non les lois et règlement requis, qui disposent ou non des moyens de surveiller l’application de leurs lois et règlements s’ils existent. Et ce sont les habitants de tel ou tel territoire concret, chasseurs, fermiers ou éleveurs, qui ont ou non les ressources de remplacement requises, qui disposent ou non des incitatifs requis pour opérer une éventuelle transition – laquelle n’est même pas discutée encore sérieusement quand il est question de protection de la biodiversité. Ce réflexe de « recours à l’ONU » ne doit pas faire oublier ce qui est du ressort des États : signer des ententes, notamment de préservation et de conservation des écosystèmes, de type bi ou multilatéral avec les pays qui sont voisins, avec lesquels des régions écosystémiques sont partagées.
L’on sait que le GIEC jouit d’une autorité reconnue pour les connaissances sur le climat et concernant les actions à entreprendre (composante normative) (Porter et al., 2018). Mais l’IPBES est loin d’être aussi connu et soutenu que le GIEC; et dans la mesure où le discours demeure général, il ne semble encore s’adresser qu’aux spécialistes de la santé et de la politique, sans aucunement relever et organiser les problèmes politiques et ceux qui concernent la relève économique. En effet, soulever les questions économiques et politiques est nécessaire : les besoins alimentaires sont à la base des pressions sur la biodiversité, comme on l’a vu, et il est donc urgent de mettre en place des systèmes d’organisation répondant mieux aux requêtes de préservation. Mais pourquoi s’occuper de ces problèmes alors que la question à l’ordre du jour est la pandémie?
Our business-as-usual approach to pandemics is based on containment andcontrol after a disease has emerged and relies primarily on reductionist approaches to vaccine and therapeutic development rather than on reducing the drivers of pandemic risk to prevent them before they emerge.
IPBES, 2020, p. 4
La démonstration est similaire quand l’on regarde un phénomène directement lié aux changements climatiques, soit les inondations; les événements de 2017 n’ont pas suffi à changer réellement la donne à l’arrivée de 2019. Même après cette seconde vague rapprochée de grandes inondations, la situation au Québec ne bouge que très lentement.[7] Il semble politiquement très difficile de convaincre les électeurs du besoin soutenu d’investissements préventifs, mais les décideurs n’ont pas toujours besoin de mener des consultations explicites, surtout quand une valeur est bien reconnue. Compte tenu du primat habituel de ce qui est immédiatement perceptible et saisissable comme menace ou danger, faire comprendre la valeur de la biodiversité est plus complexe qu’aider à cerner le besoin de sécurité dans sa maison (cas des inondations) : dans ce dernier cas, les conséquences sont directes et critiques.
Bien que leur discours soit parfaitement clair, les chercheurs de l’IPBES ne peuvent éviter le conditionnel et le vraisemblable, faisant appel à des changements pratiques des habitudes, des changements sur lesquels ils n’ont d’autre pouvoir que celui de recommander. Les italiques dans ce qui suit ne sont pas dans l’original:
Pandemic risk could be significantly lowered by promoting responsible consumption and reducing unsustainable consumption of commodities from emerging disease hotspots, and of wildlife and wildlife-derived products, as well as by reducing excessive consumption of meat from livestock production.
IPBES, 2020, p. 3
Il arrive néanmoins que les demandes soient plus catégoriques :
Conservation of protected areas, and measures that reduce unsustainable exploitation of high biodiversity regions will reduce the wildlife-livestock-human contact interface and helpprevent the spillover of novel pathogens.
IPBES, 2020, p. 5
On parle de débordement de pathogènes ici, compte tenu de leur quantité; elle est difficile à mesurer, mais sans nul doute très importante. Admettons toutefois que la source des problèmes, c’est cet agir organisé ordinaire, non réflexif, concernant les conséquences indirectes de l’action et dont nous avons parlé plus haut. On relève de claires corrélations : il s’agit d’effets non désirés de certaines actions finalisées, comme la chasse, l’élevage et bien sûr la pêche surtout industrielle; en effet, ces dernières peuvent avoir globalement, à une grande échelle, des effets néfastes non recherchés.[8] La situation des pandémies à source zoonotique n’est pas différente à cet égard d’autres problèmes, comme celui de l’usage des plastiques ou encore plus largement celui de l’usage des énergies fossiles. Mais le problème est de passer de ce constat à la situation souhaitée. À cette fin, il faut certes un langage normatif qui peut se présenter de différentes manières comme l’appel, l’injonction, le plaidoyer, la prescription proposée ou, plus rarement, l’obligation (si la source a un réel pouvoir). Il faudrait surtout obtenir une mise en vigueur concrète. Qu’on veuille décrire ce qui se passe, estimer/considérer ce qui est possible ou exiger/formuler ce qui devrait être – des types d’actions discursives entre lesquelles bien sûr les différences sont notables et connues –, il s’agit d’un agir qui n’est pas seulement individuel, mais qui a au contraire un caractère collectif. Les pratiques de chasse, de pêche et de cueillette qu’on peut décrire sont collectives. Estimer le possible se fait aussi par rapport à des essais collectifs documentés, pensons à une agriculture sans pesticides. Et se donner des normes exigeantes passe aussi par des agentivités délibératives et organisées. Quel que soit le cas, l’agir se déploie selon des formes multiples qui sont à chaque fois locales, mais qui en même temps outrepassent les limites soit de compétences, soit de territoire de tel ou tel État, en se retrouvant dans plusieurs d’entre eux. Avec les sciences et la philosophie politique, l’éthique peut contribuer à trouver les manières selon lesquelles les groupes humains de diverses échelles arriveraient à se gouverner afin de transformer les manières de faire, en formulant les raisons pour le faire : valeurs et autres exigences normatives. Nous venons de voir que les problèmes sont liés; l’on ne peut se contenter de perpétuer une division des savoirs et des tâches entre l’éthique et la philosophie politique. Ce caractère assez crucial des problèmes de gouvernance est peu discuté dans le rapport de 2020 de l’IPBES, mais il ressort assez clairement du cadre théorique retenu (voir la figure 1).
Figure 1
Cadre théorique de l’IPBES
Parler de gouvernance ne s’oppose pas nécessairement à un souhait d’autogouvernement à caractère politique: cela renvoie certes au rôle de l’État, mais aussi au rôle d’un ensemble d’acteurs ayant un certain pouvoir dans le contexte (Létourneau, 2019). C’est un réseau complexe de prises de décision qui est concerné, et les blocages se produisent à tout instant dans la chaîne plus ou moins lâche des acteurs. Comme les pandémies ont eu lieu à différentes époques, notamment depuis le Moyen Âge jusqu’au temps de la grippe espagnole et au-delà avec le H1N1 et le SRAS, l’on ne peut que constater que nos structures de prise de décision n’ont qu’une souplesse et une habileté relatives pour faire face de manière plus adéquate à ce genre de difficultés. Il nous faut donc faire preuve d’inventivité et proposer des manières de les traiter efficacement. Formulons l’hypothèse secondaire que les difficultés qui concernent la biodiversité sont laissées de côté parce que moins visibles et moins liées à tel acteur singulier (donc avec un faible degré d’imputabilité, sauf cas criminels; on y revient plus bas).
3. L’ABSENCE DE LA PRÉVENTION
Arrêtons-nous sur le caractère récurrent et prévisible des pandémies tant actuelles que futures. Malgré la large documentation des cas de pandémie depuis des décennies, les sociétés étaient très mal préparées et ont été prises au dépourvu. On parle ici surtout des sociétés occidentales, puisque les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont été moins graves en Asie comme on le sait; des leçons avaient été apprises des pandémies antérieures. Ce n’est pas que les chercheurs et les spécialistes n’avaient pas prévenu les décideurs des risques de pandémie encourus. Ainsi, en 2019, donc avant la pandémie actuelle, on pouvait lire ceci dans la documentation de l’IPBES (version française, qui n’est pas la version originale) :
Les zoonoses représentent une menace sérieuse pour la santé humaine, les maladies à transmission vectorielle représentant environ 17 % de l’ensemble des maladies infectieuses et causant près de 700 000 décès par an dans le monde (établi mais incomplet) {3.3.2.2}. Les maladies infectieuses émergentes chez les espèces sauvages, les animaux domestiques, les plantes ou les populations humaines peuvent être amplifiées par des activités humaines telles que le défrichement et la fragmentation des habitats (établi mais incomplet) ou par l’usage excessif des antibiotiques, qui se traduit par une rapide évolution de l’antibiorésistance chez de nombreuses bactéries pathogènes (bien établi) {3.3.2.2}.
IPBES, 2019, p. 22
Les notes prudentes attestant de la modalité du discours rappellent clairement ici le langage du GIEC sur les changements climatiques. On le sait, une politique de prévention est souvent manquante, en retard et pas assez développée. C’est patent dans plusieurs dossiers, pas seulement en ce qui regarde les virus transportés originellement par des vecteurs non humains et ensuite par nos semblables.
Il faudra mieux caractériser, dans une approche inspirée par Weber, les types réguliers descriptibles de l’agir des humains qui sont impliqués, quitte à admettre différentes versions pour chaque type – ce qu’il appelait les idéaltypes (Weber, 2016). Quels sont les acteurs pertinents qui auraient à se responsabiliser face à la question, non pas seulement sur le plan des organisations internationales comme l’ONU ou l’OCDE, mais à l’échelle des territoires, des pays, des régions partageant des frontières avec les principales régions de biodiversité de la planète? En effet, pour l’heure, il ne s’agit pas d’agentivité au sens fort, soit incluant une intentionnalité, des attitudes propositionnelles et des préférences (List et Pettit, 2011). En effet, nous sommes touchés par des effets indirects et non souhaités d’actions visant d’autres buts, des actions accomplies par des individus pas nécessairement coordonnés, mais qui partagent les mêmes types de fins : la chasse, l’élevage, le commerce, la cueillette des végétaux, éventuellement le trafic. Tout ceci vise de près ou de loin l’alimentation, pour la survie ou l’amélioration à court et moyen terme de leur existence ou de celle de leur famille, dans certains cas l’enrichissement. Remarquons-le, il y a de fait un ensemble fort différencié de pratiques, sur lesquelles plus d’études empiriques sont requises. On a ici des groupes entiers d’acteurs allant dans différents sens, mais avec la quantité suffisante pour obtenir l’effet indésirable. L’on peut aussi comprendre que la régulation sociale du chasseur individuel ne peut suffire pour les trafiquants d’espèces menacées (Bernard, 2016). De plus les gouvernements, oscillant de divers côtés selon les groupes d’intérêt dominants, rendent compte de coalitions à court ou moyen terme. Des entreprises peuvent mettre en marché de nouveaux produits, changer de filière agricole par exemple. Il est plus difficile d’offrir de nouvelles formes d’emploi ne comportant pas d’atteintes à la biodiversité. Le bois dans la forêt et les vivants non humains, avant d’être coupés, cultivés, élevés ou chassés, ne disposent d’aucune valeur économique, dans la mesure où ils n’ont pas de « prix ». En effet ce dernier suppose ce qui est approprié, possédé par un potentiel vendeur, qui pourra le transformer et le rendre accessible moyennant un coût déterminé pour l’acheteur situé à l’intérieur de quelque chose comme un marché.
4. L’ESPACE D’UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE
On a évoqué les cloisons souvent étanches entre disciplines, entre la médecine et l’écologie, entre la politique et la recherche appliquée en laboratoires, la biologie de la conservation et la virologie. C’est pourquoi plusieurs se réfèrent à une conception holiste de la santé, « One Health », une approche souvent liée à la détection des maladies sur le terrain (Bird et Mazet, 2018). La spécialisation a néanmoins fait ses preuves, bien entendu; une discipline ne peut fonctionner qu’en laissant de côté ce qui sort de son champ. Les philosophes de métier n’échappent pas à cette situation généralisée, avantage et inconvénient tout à la fois. Ainsi, depuis une quarantaine d’années, les éthiciens de l’environnement ont développé leur propre spécialité; or les spécialistes de l’éthique du climat ne sont pas vraiment des spécialistes de l’éthique de l’environnement, il suffit de les lire pour le constater (Williston, 2019; Jamieson, 2014; Broome, 2012; Gardiner, 2011; Garvey, 2008). Les philosophes de la biodiversité (notamment Maris, 2010) ne comptent pas davantage comme des spécialistes de l’éthique du climat. Depuis bon nombre d’années, les liens entre l’éthique environnementale et la biologie de la conservation sont discutés, presque toujours dans un cadre relevant de la gestion des parcs naturels ou des zoos, en termes de devoir de préservation (Soulé, dans Keller, 2010 [1989]). La question de la biodiversité dans les traités d’éthique environnementale ne soulève pas le lien possible avec les pandémies (Rolston III, 2012; Maris, 2010; Callicott, 2010 [1985]; Attfield, 2014; Curry, 2011; Light et Rolston III, 2003). Avec intérêt, on discute de la perspective antérieure, centrée sur le maintien de l’« équilibre de la nature » : si cette thématique semble pour certains dépassée, ce qui est discutable (Callicott, 2010), il faut alors prendre en compte l’importance de l’action humaine et de ses conséquences, et savoir s’adapter (Jamieson, 2008). Typiquement, l’on se préoccupe de pertes à la biodiversité et de problèmes conceptuels liés aux notions d’écosystème, ainsi que de ce qui va de pair, par exemple la question des seuils en deçà desquels l’on aurait une transformation radicale du système écologique concerné qui deviendrait néfaste – certes pour les vivants bénéficiant de l’état actuel des choses, et non pour tout vivant possible. De son côté, le pragmatiste Ben A. Minteer traite des problèmes infectieux dans le règne animal, mais pas des risques de pandémies d’origine zoonotique (Minteer et Collins, dans Minteer, 2012). De fait, en discutant de pandémie, notre réflexion est à cheval entre une problématique environnementale et une discussion de la protection de la santé publique – une intersection que certains chercheurs en bioéthique commencent à traiter (Ten Have, 2019), renvoyant aux notions de commun et de gouvernance, comme on le fera ici.
Parmi bien d’autres points restant à traiter, la préoccupation de prévention constitue un évident devoir. Elle concerne un bien important, soit de conserver un écosystème habitable; ce devoir peut se livrer sous forme de nouvelles attitudes (Dewey et Tufts, 1932). Mais plus encore, et c’est le point précis sur lequel le présent texte va insister, il est possible de construire une stratégie qui puisse être plus largement partagée en société, si la question de l’obtention de résultats nous importe. Ici, il faut refuser de se laisser enfermer dans d’étroites limites disciplinaires; une philosophie pratique pose en même temps les questions éthiques, politiques et économiques (Létourneau, 2020b). On ne peut ici que rejoindre le pragmatisme environnemental dans son constat concernant l’échec des éthiques principielles en environnement (Norton, 2005). Encore faut-il préciser autant que faire se peut des questions qui devraient se discuter le plus près possible des terrains qui sont concernés – si l’on accepte la position biorégionaliste selon laquelle l’approche régionale est souvent la meilleure pour traiter les questions d’environnement (Parson, 2000).
Mais précisons auparavant comment cette réflexion d’éthique environnementale s’insère dans un ensemble plus vaste, qu’on peut appeler la philosophie pratique (Létourneau, 2020a; 2020b).[9] Les questions politiques (structure de pouvoir inadéquate pour traiter et solutionner l’enjeu) et économiques (dépendance des populations face à un environnement à valeur d’abord alimentaire, absence de modalités économiques de remplacement) sont ici incontournables, comme nous l’avons soutenu précédemment. Et un certain nombre de difficultés tantôt épistémologiques, tantôt morales ont été relevées : la surspécialisation, une approche curative et biomédicale dominante et non pas une approche préventive, la complexité des enjeux interreliés (expansion de l’exploitation du territoire, empiètements sur la biodiversité, mobilité des zoonoses en raison des bouleversements climatiques). Et dans tout ceci, un manque complet à considérer les acteurs de gouvernance qui jouent un rôle important. Ces problèmes interreliés doivent être le point de départ d’une réflexion éthique à poursuivre.
Partant de la théorie de la valuation, admettons qu’une réflexion éthique doit transformer un agir de premier degré d’attribution de valeur à un second degré, réflexif par rapport au premier ; c’est la différence entre le prizing et l’appraisal, entre l’engagement moral spontané et la discussion réfléchie (Dewey, 1939). Certes, il a été possible par le passé de penser l’éthique du point de vue de l’agir individuel; c’était le cas par exemple au sortir de l’utilitarisme classique (Sidgwick, 1981 [1907]). Toutefois dans une perspective se réclamant à la fois du pragmatisme et de la théorie critique, l’éthique se réfléchit en même temps comme sociale et en tant qu’affaire de relation avec l’environnement. C. Larrère montre bien que la reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes n’est pas contradictoire avec la prise en compte des intérêts et besoins humains, chose qui se trouvait aussi chez A. Light et B. G. Norton (Larrère et Larrère, 2015; Light et Katz, 1996; Norton, 2015). Prétendre mettre de l’avant le primat unique des intérêts écosystémiques en refusant d’inclure en ceux-ci les intérêts humains conduirait à des paradoxes. On a tenté de trouver une solution en faisant appel à des intérêts de premier et de second ordre (Shrader-Frechette, 1996); néanmoins cela demeure une solution purement théorique; encore faudra-t-il que cette priorisation soit reprise par les décideurs concernés. En tout cas, seule une prise en compte de ces besoins et intérêts peut éventuellement régler les problèmes, étant donné que ceux-ci ont pour source principale cet agir organisé ordinaire (pas assez doté d’une fin qui soit suffisamment inclusive de tous ses effets) de l’espèce Homo sapiens. Sinon, ces intérêts humains se coalisent et font obstacle, imposant un immobilisme aussi lourd que destructeur. Les choses continuent de se déployer tout simplement dans leur logique coutumière. Sans doute que « les institutions » ou « la société » peuvent bouger avec des logiques de pression, cela s’est vu. Ces luttes sont toutefois, en l’absence de rapport de force significatif, d’une efficacité au mieux moyenne.
Une approche de gouvernance polycentrique, inspirée par Elinor Ostrom et son école, signifie un renforcement et un élargissement de la sphère politique, et non sa diminution (Ostrom, 2005; Létourneau, 2019). Une riche biodiversité n’appartient à personne, et à ce titre elle peut être traitée comme un commun (Ostrom, 2005). D. Graeber nous a montré que, de toute manière, l’appel au marché ne produit pas le rétrécissement de la place de l’État, il faut donc en prendre acte (Graeber, 2015). Sans doute qu’une éducation visant la transformation des pratiques est possible également à l’échelle des groupes humains, bien qu’il faille que chaque individu soit finalement convaincu qu’un certain questionnement est fondé, nécessaire et valide. Cela ne suffit évidemment pas puisque l’action néfaste en environnement relève des cumuls d’actions, et non de la volonté des uns ou des autres.
Il faut reconnecter la réflexion éthique aux autres lieux pertinents d’une philosophie pratique : politique, économique, épistémologique. Cela ne peut évidemment pas être tout à fait accompli dans les limites du présent texte. Il serait intéressant de revenir sur l’état stationnaire de l’économie chez J.S. Mill; sans doute se distingue-t-il des discours de critique du modèle de la croissance infinie, des discours construits depuis le rapport Meadows de 1972 et qu’on retrouve aussi chez les penseurs de la post-croissance (Mill, 2018; 1871; Meadows, 1972; Seidl et Zahrnt, 2010; Daly, 1996). La prise en compte des besoins anthropiques limite ici très sérieusement ce que nous pouvons faire, mais le fait de les ignorer ne permet pas de solution : il les occulte et promet plutôt l’échec. Il faut bien le dire, l’appel aux principes, sur la base des notions pourtant riches de la considérabilité morale ou de l’approche écocentrique, avec tout le décentrement qu’elles procurent, n’a pas conduit à l’avancement de la tâche à ce jour, et rien n’indique qu’il en sera autrement dans l’avenir (Norton, 2005). Suffit-il de se définir par le recours à un seul « centre »: bio, anthropo, éco, patho? Il y a autant de centres qu’il y a de points possibles de référence dans un ensemble (James, 1910). Toute recherche de centre présuppose une sorte de modèle sphérique par défaut qui ne va aucunement de soi (Sloterdijk, 1999), bien qu’il soit extrêmement difficile de s’en déprendre.
L’adhésion morale de certaines personnes aux principes fondamentaux n’assure apparemment pas de manière efficace le passage à l’action. Il suffit pour le justifier de penser, par contraste, au nombre élevé de personnes travaillant dans les processus de décision et d’opération dans toute la chaîne concernant l’alimentation, de la production à la distribution, et qui ne sont pas vraiment rejointes par les spécialistes de l’éthique de l’environnement. Cet élément doit être pris au sérieux et réfléchi, car les pratiques collectives en jeu, considérées globalement, s’avèrent mauvaises – et surtout les empiètements, qui sont sans cesse plus nombreux. Elles sont mauvaises pour nous comme pour les autres espèces qui actuellement peuvent vivre dans l’écosystème actuel. Certes, une fois la planète devenue inhabitable pour nous les humains, un nouvel équilibre provisoire serait produit. Mais l’on peut se demander quelles espèces pourraient encore y vivre, compte tenu de notre adaptabilité très élevée, en comparaison de bien des vivants, limités à des niches écologiques plus restreintes (Pocheville, 2015). De fait, ce sont les impératifs d’une vie économique humaine – pensons seulement au déboisement parfois sauvage et massif ainsi qu’à d’autres pratiques alimentaires dépassant le simple cadre d’une agriculture sédentaire basée sur les plantes et l’élevage – qui rendent difficilement évitable le surgissement accru de maladies d’origine zoonotique. Il n’est pas non plus assuré que faire la promotion d’une agriculture biologique, de la permaculture ou d’autres approches moins intensives suffira à arrêter un empiètement marqué sur des régions qu’on devrait protéger, pour conserver la biodiversité actuelle, en leur laissant un espace de développement et de créativité (Maris, 2010, p. 164).
5. QUELQUES QUESTIONS POUR UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE PENSÉE DANS LE CADRE D’UNE PHILOSOPHIE PRATIQUE MARQUÉE PAR LE PRAGMATISME ET LA THÉORIE CRITIQUE
En fait, la crise qu’a causée la COVID-19 montre plus que toute autre dans quelle impasse nous nous trouvons du point de vue social et du point de vue scientifique. Socialement, nous avons appris à traiter les problèmes de manière spécialisée. Tout le monde comprend qu’il y a des liens entre les domaines, mais, de manière générale, les champs de recherche demeurent cloisonnés, tout autant que le sont les ministères de nos différents gouvernements. La division du travail discutée par Durkheim et appliquée avec rigueur dans le monde industriel a été fort efficace, mais elle comporte un prix à payer. Ainsi, selon la division habituelle des tâches en sciences, les problèmes de santé ne sont pas les problèmes de pollution environnementale, et les problèmes d’agriculture ne sont pas les problèmes concernant le climat; de plus, la gestion des sols n’est pas traitée par les spécialistes de la virologie et encore moins par ceux de l’épidémiologie. Cela n’empêche pas tel épidémiologiste de travailler sur les microbes des sols, bien entendu, ou telle chercheure de relever les défis de la recherche en santé environnementale. Mais ces travaux d’interface ne donnent pas pour autant aux décideurs les compétences requises pour traiter les problèmes de manière vraiment transversale.
Le discours des scientifiques est hautement spécialisé et prévu pour des spécialistes; or les expertises peinent à être pleinement comprises par qui de droit. Dans le cas du Québec, et ce serait vrai si l’on regardait aussi dans bien d’autres régions et pays, des mois ont passé avant que des certitudes scientifiques bien établies aient pu être acceptées et mises en pratique. Donnons pour exemples la question du port du masque, celle du congé de la relâche printanière de 2020, celle aussi de l’aération dans les écoles.[10] Si les bonnes décisions sont basées sur les meilleures connaissances, encore faut-il pouvoir en tenir réellement compte, l’arbitrage entre les expertises demeure en général dans un cercle fermé. Parler ici de supériorité épistémique des uns ou des autres n’est peut-être pas le meilleur moyen de surmonter dans la pratique les écarts et les différences entre les expertises mobilisées ici et là.
Le problème a de plus un rapport éminent avec nos systèmes politiques, incluant les processus de gouvernance qui sont loin d’avoir la cohésion et le degré de collaboration requis (Létourneau, 2019). Le prix à payer d’une situation de pouvoirs distribués dans une société polycentrique au sens d’Ostrom, c’est notamment le fait que la coordination entre ces pouvoirs n’est pas donnée et au contraire demeure toujours à construire (Ostrom, 2005). Les systèmes de gouvernance « restructurés » sont forcément plus lents, moins efficaces; et la recette de la centralisation pour faire des économies d’échelle est encore appliquée, après que son manque d’efficience ait pourtant été démontré.[11]
Un peu comme cela a été fait pour le sens éthique des programmes axés sur l’adaptation aux changements climatiques, il est possible de proposer ici une approche régionale multipartite, en étroite collaboration avec les instances politiques concernées et en incluant la santé publique, pour rendre possible une approche inclusive visant la gouvernance des changements globaux, y compris sur le front de la pandémie et de sa prévention (Létourneau, 2021). En effet pour mettre en jeu la prévention, l’on ne peut prendre chacun des milieux de manière isolée (villes, forêts, régions riveraines de l’océan, régions montagneuses, plaines, etc.) (IPBES, 2021). Il faut impliquer des chaînes d’acteurs qui ne sont pas toujours sur un seul territoire, car il y a des effets mutuels et des interactions à considérer. On ne pourra faire plus ici que développer une sorte de modèle simplifié d’une gouvernance possible.
Il faut sans doute dans un premier temps obtenir ou concevoir un répertoire assez exhaustif des zones de biodiversité qui sont les principales sources des maladies zoonotiques; c’est sur ces territoires, avec la collaboration d’organisations comme l’OMS, que devraient être créées des tables de concertation. Il serait requis que les instances politiques des pays et régions concernés y soient représentées; plus encore, que des mandats officiels venus des autorités concernées sur ces territoires permettent une prise au sérieux des recommandations qui devraient en être attendues par la suite. Ces tables se donneraient pour mission de réunir ce que nous pouvons considérer comme les parties prenantes d’une sauvegarde de deux valeurs substantielles : une biodiversité robuste et une vie humaine qu’on souhaite de qualité. La seconde dépend de la première, mais la première requiert aussi la seconde, si l’on veut éviter les comportements dérogatoires, soit les empiètements dont on a parlé plus haut – cela suppose, notons-le bien, que certains usages peuvent être soutenables (pour une évaluation, la contribution des sciences est requise). Il faudrait alors convoquer certains acteurs parmi les éleveurs, les chasseurs, les vendeurs et boutiquiers qui tiennent les marchés concernés, des biologistes de la conservation actifs dans certaines régions. Dans les milieux affectés par la criminalité concernant les espèces rares, prévoir un renforcement des forces de sécurité compétentes serait requis. On ne peut laisser de côté les banques qui financent ou prêtent, ni la fonction du transport, ou les acteurs de la construction, requérant les matériaux de la forêt, ni les institutions de santé locales, quelques ONG bien implantées sur le terrain également, les spécialistes en épidémiologie et en zoonoses. Cette liste n’est pas une formule omnibus, mais bien un exemple de liste possible, ayant à être générée sur les terrains par des acteurs connaissant bien le milieu concerné pour établir les liens et mener à bien les convocations requises – ce qui suppose bien sûr qu’un groupe prenne l’initiative. Un cadre de gouvernance structuré, souple et variable selon les milieux serait à instaurer. Faudrait-il ou non en venir à des mesures coercitives? Il ne faut pas l’exclure d’emblée : en fonction d’une diversité d’enjeux et de contextes, les solutions « mur à mur » ne vont pas de soi. Pensons aussi à des mécanismes incitatifs de divers genres, qui peuvent être efficients dans ce qu’on appelle la soft law (Wanner, 2021); une revue plus poussée des bilans de ce côté demeure requise. Serait-il intéressant de se donner, à l’échelle des communautés, un ensemble de « biens » à viser en commun? Sans aucun doute, pour autant qu’un pluralisme soit possible. Une préservation de la biodiversité, liée au concept de la santé unique et commune (One Health), pourrait être un bon point de départ, surtout pour les chercheurs en santé publique.
CONCLUSION
Les réflexions informées par les sciences nous conduisent à réfléchir à l’organisation sur le plan social et régional, ce qui peut ouvrir le chemin menant à une meilleure prévention des phénomènes pandémiques – c’est une chose plus facile à dire qu’à concrétiser, bien évidemment. Au point de vue de la gouvernance, il serait temps de mettre en chantier non pas le remplacement des fonctionnements démocratiques par une nouvelle organisation élitaire et scientifique, mais bien l’intégration nécessaire des compétences scientifiques requises dans les prises de décision sans pour autant perdre les acquis d’une vie démocratique ouverte au débat et à la discussion.
On peut donc conclure qu’il faut contrer cette tendance bien documentée à l’empiétement sur les espaces du vivant non humain, notamment les espaces jugés cruciaux et importants de biodiversité, y compris les espaces déjà protégés (CBD, 2004). Certains souhaitent que cessent du jour au lendemain les pratiques alimentaires reposant sur les espèces sauvages et le braconnage. Même l’élevage d’espèces comme le vison et la dépendance des populations envers la nourriture d’origine animale ne sont pas sans risques, on le sait. Nous ne sommes toutefois pas à la veille, à l’échelle planétaire et surtout en dehors des pays du premier monde, d’en finir avec la chasse, le recours à la viande de brousse (bush meat) et aux marchés « chauds » (Burki, 2020), bien qu’un État comme la Chine ait des pouvoirs que d’autres pays n’ont pas et que la généralisation ne soit pas de bon aloi. En tout cas, une « prise de conscience » de la part des éthiciens et une «sensibilisation» de leurs homologues ne permettent apparemment pas d’avancer de façon décisive dans la résolution de ces problèmes. Les pratiques concernées sont liées, d’une part, à la pauvreté, à des conditions de vie en lesquelles les besoins alimentaires de base ne peuvent pas être considérés comme allant de soi, tant s’en faut. Elles sont liées, d’autre part, à des pratiques ancestrales, pour lesquelles il existe très peu ou pas de solutions de remplacement. Il est facile de condamner le braconnage ou des pratiques alimentaires peu orthodoxes, quand les peuples qui sont les premiers concernés disposent à peine d’organismes de protection ou de ressources alimentaires pouvant suppléer à des sources sans doute hétérodoxes pour nous, mais souvent devenues coutumières ailleurs! Le même raisonnement vaut d’ailleurs, même en laissant de côté de pures situations de pauvreté, pour l’ensemble des acteurs de la chaîne concernée par l’alimentation, ici ou ailleurs.
Pour réfléchir adéquatement la question de la pandémie d’un point de vue d’éthique, nous avons opéré un double recadrage. D’une part, les phénomènes pandémiques sont à considérer dans une perspective préventive, ce qui requiert de se référer au problème des zoonoses. Or celles-ci sont directement liées aux empiètements de plus en plus sévères sur les zones chaudes de biodiversité, situation aggravée par les changements climatiques en cours. L’autre recadrage, c’est de repenser l’éthique de l’intérieur d’une philosophie pratique capable de lier le questionnement avec les enjeux politiques, économiques et épistémologiques. Cela nous conduit tout droit à une problématique de gouvernance à pôles multiples, un polycentrisme qui souhaite renforcer le rôle des États et non le diminuer, en ouvrant la responsabilité politique à tous les acteurs affectant dans un sens ou l’autre la biodiversité. Ceci étant posé, n’ignorons pas les défis de la recherche actuelle : rendre plus concrète pour les acteurs tant nationaux que régionaux la question de la biodiversité, notamment en produisant des études documentant de manière accessible les pertes encourues et les risques qui en découlent.
Appendices
Notes
-
[1]
Pour le moment, une quantité d’articles en tout genre paraissent sur la question des victimes collatérales de la pandémie. Il est trop tôt pour se faire une idée globale à ce sujet. Par ailleurs, deux catégories de victimes se mêlent souvent : d’une part, les gens qui souffrent déjà de certaines affections et sont emportés par le virus, un lieu de débat pour les sceptiques; d’autre part, les gens qui sont laissés sur des listes d’attente en raison du triage devenu nécessaire par l’encombrement des services de soin, ce qui entraîne aussi un excès de victimes par rapport à celles qu’on aurait eu en d’autres années – sans oublier les gens qui n’ont pas accès à des services de santé parfois minimaux ou inexistants. Traitant du cas états-unien, sur une base de 300 000 morts avérés de la COVID-19, un texte de recherche avançait le nombre de 400 000 morts supplémentaires ou en excès. Voir Woolf, Chapman et al. (2020).
-
[2]
Il suffit pour s’en convaincre de lire le discours du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 18 janvier 2021 dernier. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board
-
[3]
En décembre, le rapport préliminaire de la protectrice du citoyen du Québec, Marie Rinfret, a été déposé. Il faudra bien sûr voir la version complète du rapport, mais l’on sait déjà que le transfert de nombreux patients dans les CHSLD, qui n’étaient pas équipés pour faire face à la situation, a été une erreur profonde. Je me contenterai de remarquer que les régularités habituelles du système ont simplement continué d’avoir cours.
-
[4]
Nous en avons la preuve empirique avec les fluctuations de la maladie de Lyme, notamment dans le sud du Québec depuis plusieurs années. Force est d’admettre que les zoonoses sont affectées par les changements climatiques, même si les empiètements anthropiques sont probablement le facteur prépondérant. Ces mouvements zoonotiques sont repérables aussi en Alaska, par exemple (Hueffer et al., 2013).
-
[5]
Il serait abusif d’estimer que toutes les activités humaines sont nuisibles à la biodiversité, ou qu’elles n’ont aucun bon effet. Voir sur ce point Prévost-Julliard, Maris et al., 2010, p. 20-21. De même dans le dossier climat, dans certains contextes, ni l’azote ni le dioxyde de carbone ne sont problématiques : c’est le passage de certains seuils quantitatifs qui pose un problème.
-
[6]
Cécile Aenishaenslin, professeure d’épidémiologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, publie sur cela régulièrement dans les revues scientifiques. Elle a aussi publié un bref texte accessible à tous, faisant le point sur les connaissances de manière synthétique (dans Aenishaenslin, 2020). Elle estimait très probable que le virus ait été transmis d’un animal à un humain. Ses propos sont en continuité complète avec ce que disent l’ensemble des chercheurs sur les zoonoses.
-
[7]
Le cas du Québec étant mieux connu que d’autres du rédacteur de ce texte, notons que le gouvernement de la province canadienne a certes développé le « Plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations »; il a également mis sur pied le projet INFO-Crue visant la cartographie des zones inondables sur le territoire, ce qui est en fait une importante mise à jour et modernisation complétant et rectifiant ce qui existait. Alexandrine Bisaillon (Ouranos) le détaillait lors d’une conférence (22 janvier 2021) organisée par le Réseau inondations intersectoriel du Québec, mis sur pied lui-même après les événements de 2019 avec l’appui des Fonds de recherche du Québec. Ce sont des travaux d’une grande importance, mais il est évident que beaucoup reste à accomplir, dans un régime de connaissances marqué par l’incertitude, d’une part, et la multiplicité d’acteurs parties prenantes, d’autre part.
-
[8]
Il ne s’agit pas ici de déclarer mauvaises en soi les opérations que sont la pêche, l’élevage ou la chasse. Depuis plusieurs décennies, Leopold a bien montré l’intérêt d’avoir quelques prédateurs supérieurs en liberté dans les écosystèmes, justement pour préserver un certain équilibre dynamique dans les milieux. On a affaire dans le cas des attaques à la biodiversité à des échelles quantitatives tout autres; cf. Leopold, 1949.
-
[9]
Sur la base d’une revue de littérature et d’une théorisation personnelle, j’en viens à la définition suivante de la philosophie pratique : il s’agit d’interroger l’action humaine en situation, en tenant compte d’un ensemble de questions interreliées et inséparables : les questions éthique, politique et économique, sans oublier la question épistémologique et la question communicationnelle. Ce modèle est toutefois susceptible de varier en fonction des domaines d’interrogation (Létourneau, 20202; 20203).
-
[10]
Je ne souhaite pas m’arrêter trop longtemps sur ces questions, sur lesquelles il y aurait lieu de produire force détails et chronologie. Si la première était liée à une décision politique ayant trait à la disponibilité insuffisante d’une ressource, reste que ce type de besoin était tout à fait prévisible, si du moins les épidémiologistes avaient été écoutés. Permettre des sorties en masse et des entrées incontrôlées pendant des semaines cruciales (notamment le congé de la relâche printanière) a forcément eu des conséquences, il semble ici que le raisonnement était : profitons-en pendant qu’il en est encore temps, et par conséquent laissons les autres aussi en profiter. Quant aux problèmes d’aération, il en a été question dès l’été 2020, et en plein milieu de l’hiver, certains rapports de situation commençaient à peine d’être connus : la question a avancé au mieux à pas de tortue.
-
[11]
Ainsi, amputer pour des raisons de réforme budgétaire (comme l’a fait le précédent gouvernement québécois) de leur autonomie administrative des unités de soin de taille moyenne au profit des CIUSSS et des CISSS visait des économies d’échelle, dont le prix s’est payé en vies humaines. Cette tendance à comprimer les dépenses pour épargner dans les frais encourus pour le soin des personnes âgées a été bien engagée au Québec depuis 20-30 ans, comme l’expliquait Damien Contandriopoulos, professeur à University of Victoria, lors d’une entrevue donnée en mai 2020. https://www.journaldemontreal.com/2020/04/20/la-reforme-barrette-a-eu-un-impact-negatif-sur-la-sante-publique
Bibliographie
- Aenishaenslin, Cécile, Hongoh, Valérie, Cissé, Hassane Djibrilla, Hoen, Anne Gatewood, Samoura, Karim, Michel, Pascal, Waaub, Jean-Philippe et Denise Bélanger, « Multi-criteria decision analysis as an innovative approach to managing zoonoses: results from a study on Lyme disease in Canada, » BMC Public Health, 2013, vol. 13, article 897. doi: 10.1186/1471-2458-13-897.
- Aenishaenslin, Cécile, « Réfléchir à notre responsabilité collective à l’ère de la COVID-19 », Le Devoir, 20 mars 2020; https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575971/reflechir-a-notre-responsabilite-collective-a-l-ere-de-la-covid-19
- Attfield, Robin, Environmental Ethics, New York, Polity, 2014.
- Bernard, Tiphaine, « La lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages », Criminologie, vol. 49, no. 2, 2016, pp. 71-93. https://doi.org/10.7202/1038417ar
- Bird, Brian H. et Jonna A. K. Mazet, « Detection of Emerging Zoonotic Pathogens: An Integrated One Health Approach, » Annual Review of Animal Biosciences, vol. 6, no. 1, 2018, pp. 121-139.
- Broome, John, Climate Matters. Ethics in a Warming World, New York et Londres, Norton, 2012.
- Burki, Talha, « The Origins of Sars CoV », The Lancet, August 2020, p.1018-1019. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930641-1
- Callicott, John B., Éthique de la terre, Paris, Wildproject, 2010 [1985].
- CBD (Convention on Biodiversity), Biodiversity Issues for Consideration in the Planning, Establishment and Management of Protected Area Sites and Networks, Technical series no15, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada, 2004.
- Curry, Patrick, Ecological Ethics. An Introduction, New York, Polity, 2011.
- Daly, Herman E., Beyond Growth. Boston, Beacon Press, 1996.
- Dewey, John et James H. Tufts, Ethics, in Jo Ann Boydston (dir.), The Later Works of John Dewey, vol. 7. Carbondale (Ill.), Southern Illinois University Press, 1985 [1932].
- Dewey, John, Theory of Valuation, Chicago, University of Chicago Press, 1939.
- Diouf, Boucar, « Cette autre grande menace sanitaire planétaire », La Presse, 12 décembre 2020. https://plus.lapresse.ca/screens/40943807-f4b0-428b-8c61-702349cb50ae__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
- Gardiner, Stephen M., A Perfect Moral Storm, The Ethical Tragedy of Climate Change, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- Garvey, James, The Ethics of Climate Change. Right and Wrong in a Warming World, Londres, Bloomsbury, 2008.
- Graeber, David, The Utopia of Rules. On technology, stupidity and the secret joys of bureaucracy, Londres, Melville House, 2015.
- Hoek, Gerard, Krishnan, Ranjini M., Beelen, Rob et al., « Long-term air pollution exposure and cardio-respiratory mortality: a review, » Environ Health, vol. 12, article 23, 2013.
- James, William, A Pluralistic Universe. Hibbert Lectures, 1909, 1910. Disponible en ligne : https://www.gutenberg.org/ebooks/11984.
- Jamieson, Dale, Ethics and the Environment: an Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Jamieson, Dale, Reason in a Dark Time. Why the Struggle against Climate Change failed – and what it means for our future, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- Habermas, Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel, Vol. 1 et 2, Paris, Fayard (Suhrkamp), 1987 [1981].
- Karsten Hueffer, Alan J. Parkinson, Robert Gerlach et James Berner, « Zoonotic infections in Alaska: disease prevalence, potential impact of climate change and recommended actions for earlier disease detection, research, prevention and control, » International Journal of CircumpolarHealth, vol. 72, no. 1, 2013. DOI: 10.3402/ijch.v72i0.19562
- IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz and H. T. Ngo (dir.), « Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, » EIPBES secretariat, Bonn, Germany, 2019. Retrieved from https://ipbes.net/global-assessment
- IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), Daszak, Peter., Amuasi, John, das Neves, Carlos, G., Hayman, David, Kuiken, Thijs, Roche, Benjamin, Zambrana-Torrelio, Carlos, Buss, Peter, Dundarova, Heliana, Feferholtz, Yasha, Földvári, Gabor, Igbinosa, Etinosa, Junglen, Sandra, Liu, Qiyong, Suzan, Gerardo, Uhart, Marcela, Wannous, Chadia, Woolaston, Katie, Mosig Reidl, Paola, O’Brien, Karen, Pascual, Unai, Stoett, Peter, Li, H. et Ngo, H. T., Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES secretariat, Bonn, Germany, 2020. DOI:10.5281/zenodo.4147317.
- IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), Pörtner, Hans-Otto, Scholes, Robert J., Agard, John, Archer, Emma et al., Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change, IPBES secretariat, Bonn, Germany, 2021. DOI:10.5281/zenodo.4659158.
- Larrère, Catherine et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique, Paris, La découverte, 2015.
- Leopold, Aldo, A Sand County Almanac, Oxford, Oxford University Press, 1949.
- Létourneau, Alain, « L’autogouvernement et la gouvernance. Réflexion à partir d’un projet d’adaptation aux changements climatiques sur le territoire de la MRC de Memphrémagog », Sens public, publié le 20 août 2019, ISSN 2104-3272, http://sens-public.org/article1408.html
- Létourneau, Alain, « Les coordonnées de la philosophie pratique : le “sens en usage” de l’expression dans cinq articles de Wikipédia », in André Lacroix (dir.), La philosophie pratique pour penser la société, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 2020a, pp. 17-28.
- Létourneau, Alain, « La philosophie pratique : un ensemble de questions pour examiner les projets et imaginer l’action », in Jean-Yves Beziau et Daniel Schulthess (dir.), L’Imagination. Actes du 37e Congrès de l’ASPLF (Rio de Janeiro, 26-31 mars 2018), Londres, Collège Publications, 2020, « Academia Brasileira de Filosofia », vol. 1, 2020b, pp. 719-741.
- Létourneau, Alain, « L’adaptation aux changements climatiques d’un point de vue éthique », Ethica, vol 24, no. 2, 2021, pp. 107-138.
- Light, Andrew et Holmes Rolston III (dir.), Environmental Ethics. An Anthology, Oxford, Blackwell, 2003.
- Light, Andrew et Eric Katz (dir.), Environmental Pragmatism, New York et Londres, Routledge, 1996.
- List, Christian et Philipp Pettit, Group agency. The possibility, design and status of corporate agents, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- Maris, Virginie, Philosophie de la biodiversité. Petite éthique pour une nature en péril, Paris, Buchet/Chastel, 2010.
- Meadows, Donella H., Jorgen Randers et Dennis L. Meadows, The Limits to Growth, Yale University Press, 2013 [1972].
- Minteer, Ben A., Refounding Environmental Ethics. Pragmatism, Principle, and Practice. Philadelphie, Temple University Press, 2012.
- Misak, Cheryl, Cambridge Pragmatism. From Peirce and James to Ramsey and Wittgenstein, Oxford, Oxford University Press, 2016.
- Münzel, Thomas, et al., « Environmental stressors and cardio-metabolic disease: part I-epidemiologic evidence supporting a role for noise and air pollution and effects of mitigation strategies, » Eur Heart J., vol. 38, no. 8, 2017, pp. 550-556. doi: 10.1093/eurheartj/ehw269. PMID: 27460892.
- Norton, Bryan G., Searching for Sustainability. Interdisciplinary Essays in the Philosophy of Conservation Biology, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- Norton, Bryan G., Sustainability. A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management, Chicago, University of Chicago Press, 2005.
- Norton, Bryan G., Sustainable Values, Sustainable Change. A Guide to Environmental Decision Making, Chicago, University of Chicago Press, 2015.
- Ostrom, E., Understanding Institutional Diversity, Princeton, Princeton University Press, 2005.
- Parson, E. (dir.), Gérer l’environnement. Montréal, Presses de l’Université de Montréal (traduction de Governing the Environment), 2000.
- Peirce, Charles S., « Comment se fixe la croyance », in Ch. S. Peirce, Pragmatisme et Pragmaticisme, Paris, Cerf, 2002 [1877], pp. 215-235.
- Pocheville, Arnaud, « The Ecological Niche: History and Recent Controversies, » in Thomas Heams, Philippe Huneman, Guillaume Lecointre, et al. (dir.), Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 547-586. ISBN 978-94-017-9014-7.
- Porter, Amanda J., Kuhn, Timothy R. et Brigitte Nerlich, « Organizing Authority in the Climate Change Debate: IPCC Controversies and the Management of Dialectical Tensions, » Organization Studies, vol. 39, no. 7, 2018, pp. 873-898.
- Prévost-Julliard, Anne-Caroline, Maris, Virginie et al., Biodiversités. Nouveaux regards sur le vivant. Paris, Le cherche midi, 2010.
- Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Maladie de Lyme -Traitement », 2020. https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/traitement/, consulté le 12 décembre 2020.
- Reddy, Sanjay G., « Population health, economics and ethics in the age of COVID-19,» BMJ Global Health, 2020, 5:e003259.
- Rolston III, Holmes, A New Environmental Ethics. The Next Millennium for Life on Earth, New York et Londres, Routledge, 2012.
- Schiesari, Luis, Waichman, Andrea, Brock, Theo, Adams, Cristina et Britta Grillitsch, « Pesticide use and biodiversity conservation in the Amazonian agricultural frontier, » Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, vol. 368, no. 1619, 2013, 20120378. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0378
- Seidl, Irmi et Angelika Zahrnt (dir.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Marbourg, Metropolis V, 2010.
- Shrader-Frechette, Kristin, « Individualism, Holism, and Environmental Ethics, » Ethics and the Environment, vol. 1, no. 1, 1996, pp. 55-69.
- Sidgwick, Henry, The Methods of Ethics, Indianapolis, Hackett, 1981 [1907].
- Sloterdijk, Peter, Bulles. Sphères II. Paris, Fayard/Pluriel, 1999.
- Soulé, Michael E., «What is conservation biology? », in David R. Keller (dir.), Environemental Ethics: the Big Questions, Malden (Ma), Wiley & Blackwell, 2010 [1985], pp. 384-391.
- Ten Have, Hank A.M. J., Wounded Planet: how declining biodiversity endangers health and how bioethics can help, Baltimore, Johns Hopkins, 2019.
- Wanner, Maximilian S. T., « The effectiveness of soft law in international environmental regimes: participation and compliance in the Hyogo Framework for Action, » Int Environ Agreements, vol. 21, 2021, pp. 113-132. https://doi.org/10.1007/s10784-020-09490-8
- Weber, Max « Catégories de la sociologie de compréhension », inConcepts fondamentaux de sociologie, Paris, Gallimard, 2016, pp. 165-224.
- Williston, Byron, The Ethics of Climate Change. An Introduction, New York et Londres, Routledge, 2019.
- Woolf, Steven H., Chapman, Derek A., Sabo, Roy T. et al., « Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes, » JAMA, vol. 324, no. 5, 2020, pp. 510-513.
- WHO (World Health Organization), « Weekly Epidemiological Update, September 7th, 2020 ». https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-8-december-2020
List of figures
Figure 1
Cadre théorique de l’IPBES

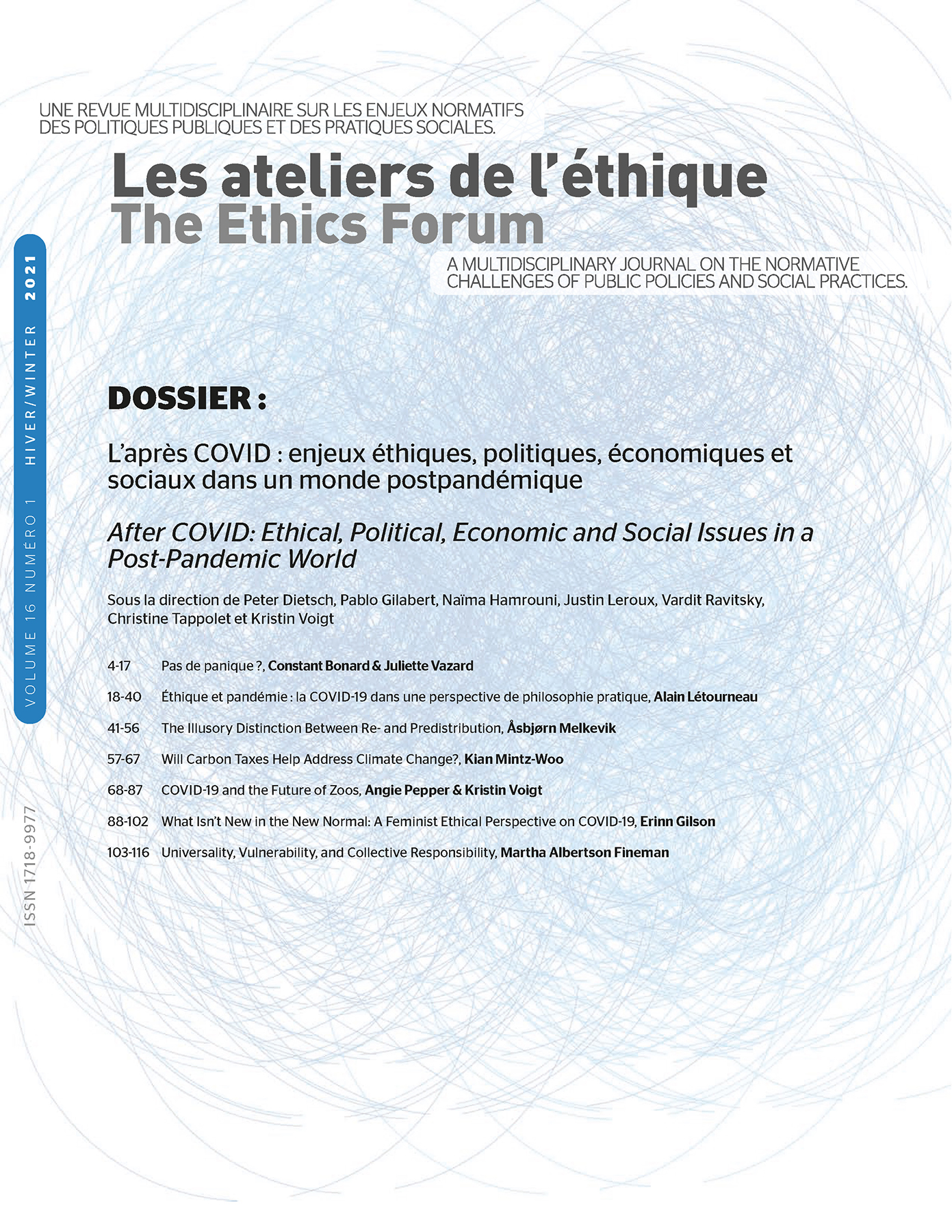


 The IPBES conceptual framework.
The IPBES conceptual framework. 10.7202/1038417ar
10.7202/1038417ar