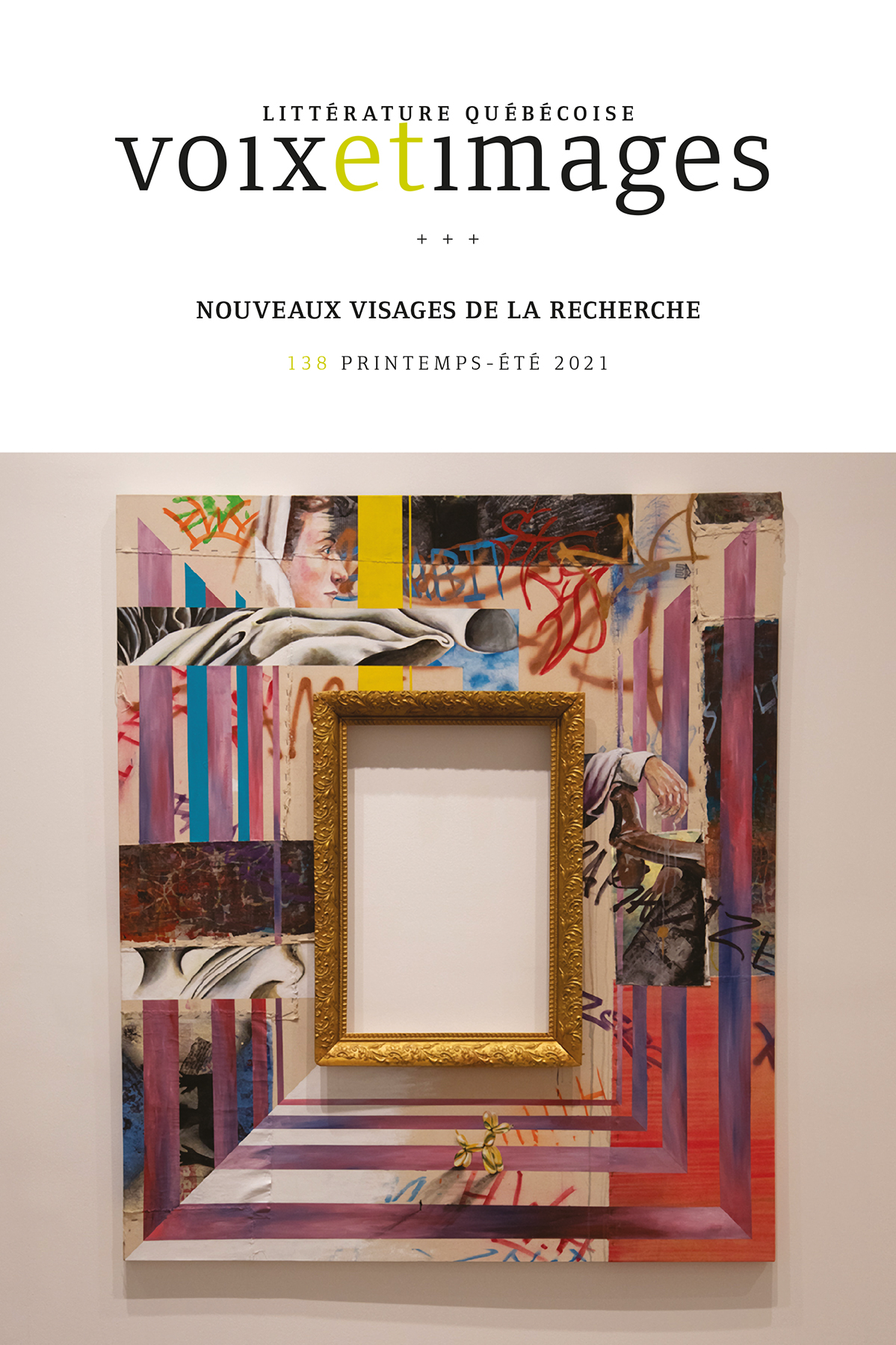Article body
Il est certes commode – et parfois même tentant, admettons-le – de déplorer la perte d’influence des Belles Lettres, ou de l’art en général, dans l’espace public. Le lettré moyen, comme affligé de la Tourette, aime sans cesse répéter que son activité a perdu de son efficacité depuis un âge d’or non identifié. Or, il faut bien remarquer que l’art choque encore, malgré ce que soutient ce discours décliniste. Récemment, en novembre 2021, une commission scolaire de l’État du Kansas a fait retirer de ses écoles de nombreux livres jugés inappropriés pour les enfants, parmi lesquels on retrouve des romans de Margaret Atwood et de Toni Morrison. Les conservateurs, si enclins à critiquer la culture de l’annulation, semblent pris d’une frénésie censoriale. Les nombreux débats sur la liberté de création sont aussi très souvent, en dernière instance, des débats sur la liberté d’expression, sur ses paramètres politiques, esthétiques, éthiques, moraux, économiques. Je parlerai ici de deux livres qui s’intéressent de près aux contacts conflictuels entre les oeuvres d’art et l’espace social.
Le collectif Arts, entre libertés et scandales[1] aborde de front ces questions en adoptant une approche interdisciplinaire. Les directrices de l’ouvrage sont issues d’horizons divers : Julie Paquette est professeure à l’École d’éthique, de justice sociale et de service public de l’Université Saint-Paul à Ottawa ; Emmanuelle Sirois est doctorante en études et pratiques des arts à l’UQAM ; et Ève Lamoureux est professeure d’histoire de l’art à la même université. Les réflexions sont réunies ici à la suite d’un cycle de conférences et de colloques tenus entre 2014 et 2016 sous la houlette d’une question centrale : que font les oeuvres d’art scandaleuses à l’espace public ? L’ouvrage couvre une période historique qui s’étend du début du xxe siècle jusqu’à la période contemporaine, en s’attardant plus spécifiquement aux scandales qui ont eu lieu depuis les années 1970.
La préface d’Olivier Neveux, dont l’assertif Contre le théâtre politique[2] exposait il y a quelques années les écueils idéologiques d’un théâtre militant qui viendrait, à son insu, neutraliser le politique, ouvre le bal. Il y insiste d’emblée sur un aspect important dans l’analyse du scandale artistique, soit les justifications qui visent à le légitimer : il s’agirait de « réveiller de leur torpeur des spectateurs amorphes, [d’]intensifier des existences mornes, [de] se conformer aux brutalités des temps présents pour les dénoncer, [d’]extrémiser des affects pour les révéler, [de] choquer, [de] transgresser, [d’]alerter, etc. » (10). Partant de ce constat, le collectif s’organise autour de cinq axes : le scandale de l’innovation artistique ; le scandale de projets patrimoniaux jugés illégitimes ; le scandale de la frontière entre le sacré et le profane ; le scandale du politique ; le scandale des résistances artistiques.
Arrêtons-nous un instant à l’introduction, qui me semble être la pièce de résistance de l’ouvrage, phénomène suffisamment rare dans ce genre de collectifs pour le souligner : « Qu’est-ce qu’un scandale en art et que révèle-t-il ? Comment se déploie-t-il dans l’espace public et comment agit-il rétrospectivement sur ce qui fait mémoire ? » (23) demandent les autrices. De nombreux scandales artistiques ont défrayé la chronique ces dernières années dans notre coin de pays. Si cette étude ne porte pas exclusivement son attention sur des cas québécois, il semble bien que ce soit depuis le Québec (où oeuvrent principalement les autrices) et avec en tête des affaires bien de chez nous que se déploie leur réflexion : l’affaire David Dulac (2015), le procès intenté à Rémy Couture (2015), le blackface du Théâtre du Rideau Vert (2015), la participation prévue (puis annulée) de Bertrand Cantat au spectacle Des femmes de Wajdi Mouawad au Théâtre du Nouveau Monde (2015), l’accusation de l’auteur Yvan Godbout (2019). Il va sans dire qu’il est impossible de ne pas minimalement lire Arts, entre libertés et scandales comme une intervention à propos des débats (houleux, pour utiliser un doux euphémisme) sur l’appropriation culturelle entourant les productions SLÀV et Kanata de Robert Lepage (2018). En bref, le livre fait indirectement acte d’étude comparative, dans la mesure où le contexte dans lequel il s’inscrit est clairement québécois, tandis que les collaborateurs et les objets sont pour la plupart internationaux ; les lecteurs, eux, liront le plus souvent depuis le Québec.
Le livre interroge patiemment le travail de remise en question et de déplacement des normes (sociales, esthétiques) que constitue aussi le scandale. Que révèle-t-il quant à la manière dont les initiés et les non-initiés reçoivent les propositions artistiques « novatrices », pour reprendre la typologie de Nathalie Heinich dont la présence se fait sentir dans ces pages ? Ce sont bel et bien les limites poreuses et les conflits de définition entre art engagé, art politique, art militant, art critique et artivisme qui sont interrogés ici. Mais ce sont aussi les normes d’un public non initié, défendant une cause (religieuse par exemple, comme dans le cas des Fées ont soif, objet de l’étude de Caroline Jacquet), qui font l’objet de l’analyse.
Les directrices identifient autour des affaires SLÀV et Kanata un changement de paradigme qu’elles jugent souhaitable : à la suite de ces scandales, la liberté d’expression n’est plus abordée uniquement à l’aune d’une revendication du droit à tout dire, mais aussi dans le cadre d’une discussion plus large sur les « conditions systémiques de marginalisation des personnes et [l]es discours [que les oeuvres] engendrent » (31). Le livre offre un aperçu de sujets sensibles qui, une fois importés dans la sphère de la représentation, provoquent levées de boucliers, affrontements, voire annulation : la sexualité, l’antisémitisme, la religion, la réhabilitation des meurtriers, la violence faite aux femmes, la véracité historique du génocide arménien, les luttes émancipatoires (féministe, anarchiste, etc.), l’éthique animale, l’embourgeoisement de certains quartiers, les tensions entre le monde des affaires et le monde de l’art. Il est à noter que si les femmes sont en majorité dans la table des matières, les scandales provoqués par des oeuvres créées par des femmes sont rares : « Est-ce que les oeuvres à potentialité scandaleuse créées par des femmes passent sous le radar, car leur voix n’a pas le même écho dans l’espace public ? » (28)
Certains scandales naissent spécifiquement de malentendus entre les oeuvres et les lieux institutionnels qui les accueillent. Les autrices pointent également, dans certains cas, une lacune dans la médiation des oeuvres. D’autres scandales sont créés par la forme même d’oeuvres qui viendraient brouiller les repères du public. Conformément aux hypothèses de Heinich, les autrices notent que les scandales viennent aussi de conflits entre différents régimes artistiques. Rappelons, pour mémoire, que la sociologue de l’art identifie trois régimes historiques qui se chevauchent plus qu’ils ne se succèdent : classique, moderne, contemporain. Des luttes de reconnaissance se superposent à ces effets de champ. Il y a également les scandales qui émergent non pas des oeuvres elles-mêmes, mais plutôt de forces hétérogènes, de censures provenant d’instances institutionnelles, policières, juridiques ou politiques. Le scandale vient à la fois des initiés et des non-initiés, de gens ayant vu les oeuvres ou pas, de ceux qui détiennent une expertise sur le champ de l’art ou pas. Ces malentendus provoquent un dissensus sur la valeur des oeuvres et les interprétations qu’on peut en offrir. On voit bien la variété des scandales artistiques possibles.
Qui dit « scandale » ne dit toutefois pas « affaire ». Toujours selon Heinich, le scandale exige une unanimité autour de valeurs qui sont défendues (ou conspuées), alors que le concept d’« affaire » correspondrait mieux à l’hétérogénéité du contexte de réception actuel. Un scandale doit impliquer, à des degrés divers, une transgression des valeurs, une indignation des sujets, et une publicité. Toutefois, les directrices de l’ouvrage prennent une certaine distance avec la position de Heinich qu’elles jugent, à juste titre, conservatrice, celle-ci évacuant de l’analyse la dimension politique au profit d’une neutralité axiologique. Lamoureux, Paquette et Sirois soumettent l’idée qu’il faut voir dans le scandale l’exploration et la mise à l’épreuve d’un dissensus ouvert par les pratiques artistiques, posture ouverte qu’elles défendent afin que les scandales artistiques ne soient pas résorbés en réduisant les adversaires à des enragés. Leur raisonnement est le suivant : puisque l’art devrait avoir le pouvoir de provoquer, alors il faut savoir entendre ceux qui sont, de fait, provoqués par l’art.
Les contributions sont (forcément, inévitablement) inégales. Elles sont toutefois plusieurs à mériter mention pour leur apport à la recherche et l’effort analytique qu’elles déploient. Le texte de Dominic Marion sur la pièce Les oranges sont vertes de Claude Gauvreau présente le scandale autour de sa production en 1972 au Théâtre du Nouveau Monde en le situant d’abord dans la réaction du public indigné par la conception de la culture défendue par la pièce. Cette polarisation du public révèle un clivage entre ce qui serait une culture québécoise mainstream et la contre-culture, notamment autour de la question de la sexualité perçue tour à tour comme un élément « bêtement » provocateur et comme un outil d’émancipation. L’analyse que fournit l’auteur à partir de la réception critique de la pièce révèle des tensions sociales qui divisaient alors le public. Marion Fournier traite pour sa part du Macbeth de Pina Bausch et montre que, dans ce cas spécifique, le scandale est créé par l’intégration de nouveaux codes artistiques dans un lieu de diffusion plus conservateur.
Analays Alvarez Hernandez s’intéresse quant à elle à ce qui peut faire scandale dans une production artistique monumentale dont l’objectif est la reconnaissance d’un trauma historique. Le choix de l’emplacement du Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens met au jour une lutte mémorielle provoquant une bagarre juridique au nom du patrimoine. Rhéa Éddé met en relief un cas semblable alors qu’une exposition de Jeff Koons au château de Versailles rend saillant un clivage dans la société française autour du sens de l’héritage historique. Interfèrent dans ce scandale une transgression de normes morales et juridiques (en raison du caractère présumément pornographique de certaines oeuvres), un choc de culture entre l’art contemporain et le patrimoine, et la personnalité clivante de l’artiste (ce qui n’est pas à négliger dans nombre de scandales artistiques !). Cela permet à Éddé de poser des questions fort pertinentes sur l’intégration d’éléments contemporains dans des lieux historiques, et aussi sur leur basculement dans une logique économique. Ce débat croise également la récupération de l’art contemporain par la logique entrepreneuriale, dont Jeff Koons est un exemple paradigmatique.
Le texte de Caroline Jacquet sur Les fées ont soif s’intéresse à la manière dont le scandale autour de la création de la pièce de Denise Boucher en 1978 constitue dans l’imaginaire collectif la dernière bataille contre l’obscurantisme religieux de la Grande Noirceur. Elle soutient que cette mythologie cache en fait les fractures gauche-droite qui s’y jouent, et même des fractures au sein des politiques internes de l’Église catholique. L’autrice rappelle qu’au moment de l’affaire (ou du scandale ?) SLÀV, certains ont fait référence aux Fées ont soif comme un exemple de victoire de la liberté d’expression contre la censure. Pourtant, Jacquet souligne avec justesse qu’il serait également légitime de rappeler que la pièce de Boucher visait à élargir l’accès à la parole pour le plus grand nombre de personnes…
Les cas de Romeo Castellucci et de Rodrigo Garcia, analysés par Sandra D’Urso et Adeline Thulard, illustrent la persistance à l’époque contemporaine des tensions liées à la représentation de la religion (ici, du catholicisme) sur scène. Les groupes de pression chrétiens s’avèrent tout particulièrement actifs dans les pétitions et dans les poursuites judiciaires liées à la christianophobie. Ces tensions viennent notamment attirer l’attention sur la définition de l’espace public, et de la place du théâtre expérimental (ou théâtre d’avant-garde) dans celui-ci — notamment en développant, dans la foulée de Michael Warner, la notion de contre-public.
Le texte d’Emmanuelle Sirois sur l’affaire Cantat adopte le cadre d’une analyse du discours afin de comprendre comment la polémique est alimentée par Wajdi Mouawad lui-même. La position de ce dernier lorsque vient le temps de défendre la présence d’un meurtrier sur scène évacue toute politique de reconnaissance pour s’attacher au symbole moral que constitue la réhabilitation de Cantat. La solidarité entre meurtriers et victimes que Mouawad vise à accomplir par l’art est-elle souhaitable sur le plan d’une justice féministe ? demande Sirois.
Les contributions n’atteignent donc pas toutes le même degré d’objectivation visé par l’introduction, et certaines tombent dans la caricature spéculative et la mythification du scandale. L’ensemble de l’ouvrage fait toutefois oeuvre utile : il fait d’une pierre deux coups en systématisant, voire en théorisant la question du scandale, et en intervenant efficacement sur la question épineuse de la liberté d’expression. S’il est impossible de réduire ce collectif à une position unifiée, on peut néanmoins voir cet ouvrage comme un appel à une compréhension plus fine des conditions de réception des oeuvres d’art dans l’espace social, et du prix de leur instrumentalisation dans des luttes qui excèdent le strict champ de l’art. Là où le livre est intéressant, c’est en ceci qu’il me semble offrir des interprétations sociologiques fortes, fournissant un contexte historique à de nombreux cas, mais s’inscrivant dans un cadre épistémologique général qui n’est pas celui de la discipline sociologique. Ainsi, si les explications philosophiques du scandale me semblent, de manière générale, plus impressionnistes, leur présence donne néanmoins au livre sa profondeur analytique. La perspective comparative (nationale, historique) lui donne quant à elle toute sa pertinence dans le contexte des études québécoises, alors que les réactions épidermiques au moindre présumé cas de censure révèlent un instantané de l’échiquier politique bien plus qu’une profonde mutation dans le statut de la liberté d’expression. Celle-ci est bien davantage menacée par le capitalisme avancé que par les tenants d’une position morale ou d’une autre, et Arts, entre libertés et scandales a la profondeur de champ souhaitée pour nous donner à le penser.
+
Un sentiment d’authenticité. Ma vie avec PME-ART[3] de Jacob Wren recèle des questions analogues à celles que pose l’ouvrage dirigé par Lamoureux, Paquette et Sirois. Mais ce n’est pas tant le scandale comme tel qui préoccupe Wren que la relation parfois difficultueuse qui se noue entre un créateur (et le collectif dont il fait partie) et son public. Il est intéressant ici d’épouser la perspective d’un artiste sur la manière dont il perçoit la relation tendue entre une tentative de renouvellement des formes et les conflits qui en découlent. C’est aussi plus largement l’inféodation des artistes aux institutions artistiques (ou leur indépendance, c’est selon) que Jacob Wren explore dans ce très riche essai qui revient avec moult détails sur les vingt ans d’activité de la compagnie théâtrale montréalaise PME-ART.
« Le travail de PME-ART a toujours été très collaboratif – on se décrit comme un pseudo-collectif –, mais, maintenant, je me retrouve par choix, semblerait-il, à écrire ce livre (en grande partie) seul. » (7) Le livre épouse la forme même de ce paradoxe. Wren tente de se départir à tout prix de la mythologie du génie créateur, mais cette dernière a la dent dure, et c’est néanmoins seul à titre de porte-parole de la compagnie qu’il prend ici la plume. Ses collaborateurs Sylvie Lachance et Richard Dufresne, qui s’occupent davantage du volet administratif et logistique de la compagnie, ne sont pas par ailleurs exclus du statut de créateurs, pas plus que les performeurs participant aux productions. Le livre comprend les contributions d’un ensemble très large de collaborateurs : Caroline Dubois, Richard Ducharme, Claudia Fancello, Marie Claire Forté, Adam Kinner, Sylvie Lachance, Nadia Ross, Yves Sheriff, Kathrin Tiedemann et Ashlea Watkin.
Les deux premières parties du livre sont chacune consacrées à dix années d’existence de la compagnie (1998-2008 ; 2008-2017), détaillant le contenu des spectacles, leur conception, leur réception, des anecdotes de tournée. Suivent un intermède « Pour Tracy », en hommage à sa collaboratrice Tracy Wright disparue prématurément en 2020, deux épilogues et deux postfaces (dont l’une signée par Daniel Canty, le traducteur de l’essai). Un sentiment d’authenticité est un essai hybride, pas au sens où il allie fiction et réflexion, mais plutôt parce que la mise en récit de l’épopée artistique qu’il retrace est sinueuse, ne cessant de partager la narration et de changer de perspective. L’effet net du dispositif est de donner le sentiment au lecteur que Wren va au bout de son idée première, soit la volonté d’intégrer la critique au coeur même d’un art qui se veut critique, pour le dire de manière tautologique, défendant la vision d’un art poreux aux redéfinitions liées au féminisme, à l’antiracisme, aux mutations technologiques. Il ne cesse de se critiquer, de mettre en doute la validité et la réussite de ses projets ; il laisse la parole aux collaborateurs qui autour de lui ont une perception parfois divergente du processus créatif. Mais au-delà des poncifs attendus sur les vertus du travail en collaboration (clichés que l’essai évite habilement), c’est la remise en question de la division traditionnelle du travail artistique qui ressort de l’ouvrage ; la distinction entre les concepteurs des oeuvres et les exécutants, entre ceux qui pensent le spectacle (qui l’écrivent) et ceux qui rendent possible sa diffusion. Ultimement, Wren tente aussi de parler de moins en moins de lui dans son art et de faire du théâtre une pratique de déprise de soi.
Cette désubjectivation dans et par l’art théâtral, Wren l’articule aussi à tout le système économique de l’industrie culturelle. Il faudrait donc parvenir à moins créer, dit-il, à faire décroître les productions artistiques pour sortir de l’injonction de la nouveauté qui frappe le théâtre d’avant-garde depuis des décennies (presque des siècles maintenant, on ne rajeunit pas). L’artiste, dit-il, devrait tendre à arrêter de produire. Cette logique productiviste le force à repenser l’ensemble de sa pratique théâtrale à l’aune de ce dépassement du nouveau. Par exemple, le « jeu » de l’acteur devrait pouvoir lui aussi être plus authentique : « La plupart des gens ont probablement l’impression que bien jouer veut dire prendre les traits du personnage. À mon sens, c’est plutôt l’inverse : il faut que le personnage devienne l’acteur. » (125)
L’ensemble de ces considérations mène Wren à réfléchir au concept de « pensée faible », qu’il emprunte au philosophe Gianni Vattimo. Celle-ci tend vers l’incomplétude, vers une pluralité des différentes positions qui finissent par s’affaiblir plutôt que d’entrer en concurrence. C’est assurément suivant cette logique que l’on peut mieux comprendre la disposition même du livre, qui fait alterner les points de vue, et dont Wren ne sort pas lui-même héroïsé, notamment en raison du chapitre très dur sur sa relation avec Tracy Wright. Mais la pensée faible est un concept positif, si l’on peut l’exprimer aussi simplement. Ramenée sur le terrain du théâtre, la pensée faible est le lieu d’une décroissance créative et intellectuelle qui devient la condition préalable à une décroissance des moyens de production déployés pour faire exister des idées sur une scène. Un sentiment d’authenticité est un essai sur l’art, mais aussi sur la création de productions collectives qui s’inscrivent dans une économie, qui emploient (voire exploitent) des ressources humaines et matérielles. La pensée faible est chez Wren au service d’une rencontre avec le public qui soit émancipée des parasitages créés par un clientélisme l’éloignant d’une expérience théâtrale authentiquement enthousiaste, précaire, vulnérable. Témoignant de ce qu’a déclenché en lui une expérience de chant collectif dans une communauté autochtone de la Saskatchewan, Wren écrit :
C’est une longue et inquiétante histoire que celle des artistes de l’avant-garde et de la modernité occidentales qui font l’expérience de formes traditionnelles et qui se les approprient sans en demander la permission. Mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser : est-ce que cela n’est pas semblable à ce sur quoi je travaille depuis toujours [?] Un sentiment performatif dans la communauté où les artistes ne sont pas différents de l’auditoire, où tout le monde connaît les règles mais les aborde de manière qu’elles ne semblent plus compter.
191
Wren se montre ici sensible aux phénomènes d’appropriation culturelle, tout comme il se montre ailleurs conscient de la manière dont la vie intime de tous les intervenants d’un spectacle interfère dans le résultat final. Mais il faudrait ajouter au propos de Wren que si les avant-gardes se sont historiquement approprié les formes rituelles pour les détourner, c’était aussi pour se rapprocher des formes de vie quotidienne. Ce que fait Jacob Wren dans ses spectacles aux titres sublimes comme Le DJ qui donnait trop d’information ou Apportez vos disques/Listening Party, c’est aussi permettre à une communauté de spectateurs et de créateurs de vivre une expérience d’improvisation autour de la musique. Cette place accordée au spectateur correspond aussi à une position esthétique, éthique et politique. Contre le travail « fasciste » de Romeo Castellucci qui « pousse le public à ressentir les mêmes choses dérangeantes en parfait unisson », Wren tente d’imposer un autre pacte : « J’essaie d’être moi-même en situation de performance et de parler de choses importantes pour moi, d’une façon directe, que j’espère très humaine, vulnérable et intime. » (81) L’art militant, pour Wren, ne consiste pas à faire scandale, mais a comme ambition de faire vivre aux spectateurs une expérience déroutante, voire dérangeante. Cela le place d’emblée dans la marge, pour ainsi dire, position dont il se réclame (sur le plan institutionnel, à tout le moins) mais qu’il réfute simultanément. Wren tourne en ridicule son propre rapport au succès, qui vire inévitablement en désir insatiable de renouvellement et de rupture.
Le livre de Jacob Wren pose avec beaucoup d’acuité la question du coût de l’indépendance dans l’univers théâtral, pointant vers des questions plus spécifiques qui sont peu soulevées, me semble-t-il, par les artistes eux-mêmes : comment faire pour qu’une oeuvre soit pérenne, ou à tout le moins qu’elle continue à évoluer dans le temps sans pour autant épouser un productivisme qui ferait ployer la créativité sous le poids de la croissance et du renouvellement infini ? L’énonciation même du livre soulève des questions originales. D’abord, l’investissement subjectif n’épouse pas la forme et la tonalité des mémoires du Grand Homme de Théâtre, mais est plutôt celui du modeste artisan (paradoxalement mégalo) qui objective sa place dans un écosystème le dépassant et qui considère l’art comme mode de production et comme force de production impliquant des rapports hiérarchiques, des ego, de la sincérité et de l’ambition professionnelle. Il faut bien le dire aussi, le livre a comme rafraîchissant effet de montrer que le théâtre à Montréal ne se limite pas à quelques grands théâtres et à une poignée de metteurs en scène vedettes qui sont aussi par ailleurs des habitués du petit écran ou des amis de Guy Laliberté. Jacob Wren est certes une figure majeure de l’institution théâtrale québécoise, dont il se situe néanmoins légèrement en marge par sa langue et sa pratique. Ce livre rend justice à son parcours atypique.
+
De la lecture en parallèle de ces deux livres ressort ce qui apparaît comme un recadrage des débats sur la liberté d’expression. Arts, entre libertés et scandales fait la démonstration que ces débats sont aussi des conflits de normes, voire des conflits de codes pour reprendre l’expression d’André Belleau qui guide souvent mes pensées. Cette intervention sur les rapports entre art et politique permet de ne pas essentialiser les termes du débat. Ici, l’historicisation, la mise en perspective sociologique et, dans une moindre mesure, la réflexion philosophique sur la notion de scandale permettent de voir le caractère forcément fluctuant de ce qui est artistiquement acceptable dans l’espace social (ou socialement acceptable dans l’espace artistique, c’est selon).
Le livre de Jacob Wren montre pour sa part comment ces conflits sont intériorisés dans la création par un artiste tout particulièrement sensible aux normes sociales, et dont le travail vise à contester les attentes d’un public bourgeois et d’institutions sclérosées, mais également les injonctions à l’innovation de l’avant-garde (celles-là mêmes qui créent le scandale), lesquelles se sclérosent aussi dans une logique du dépassement qui finit par s’épuiser. Cela ouvre sur une réflexion concernant les rapports à l’empathie, à la création collective, à la véritable création d’une intelligence collective, au tissu de relations humaines qui prennent forme dans une production artistique.
Ces deux ouvrages rendent également visibles les contours d’une réflexion sur l’art critique en régime contemporain, alors que l’on dit souvent que l’art perd de sa fonction subversive pour de nombreuses raisons : division de l’attention du public, multiplication de l’offre, effets de la réification des avant-gardes. Le livre de Wren dévoile ce qui reste malgré tout de tranchant dans les arts de la scène — peut-être précisément parce que notre consommation culturelle qui tend à être le plus souvent médiatisée rend les arts de la performance plus rugueux. En somme, la lecture conjointe de ces deux livres permet de constater une relative efficacité des avant-gardes et de poser un regard décentré sur cette question, lequel remet en perspective la situation québécoise contemporaine en la replaçant dans un contexte historique et géographique plus large, mais montre surtout que lorsque l’art est érigé en porte-étendard de la liberté, c’est souvent parce qu’on fait naïvement fi des contraintes institutionnelles et économiques qui balisent sa circulation.
Appendices
Note biographique
JULIEN LEFORT-FAVREAU est professeur adjoint au Département d’études françaises de l’Université Queen’s. Ses principales publications sont : Henri Deluy, ici et ailleurs (avec Saskia Deluy), Le Temps des cerises, 2017 ; Politique de l’autobiographie. Engagements et subjectivités (avec Jean-François Hamel et Barbara Havercroft), Nota Bene, 2017 ; Pierre Guyotat politique, Lux éditeur, 2018 ; Le luxe de l’indépendance. Réflexions sur le monde du livre, Lux éditeur, 2021.
Notes
-
[1]
Julie Paquette, Emmanuelle Sirois et Ève Lamoureux (dir.), Arts, entre libertés et scandales. Études de cas, Montréal, Nota bene, coll. « Études culturelles », 2020, 342 p.
-
[2]
Olivier Neveux, Contre le théâtre politique, Paris, La Fabrique, 2019, 314 p.
-
[3]
Jacob Wren, Un sentiment d’authenticité. Ma vie avec PME-ART, traduit de l’anglais par Daniel Canty, Montréal, Triptyque, coll. « Difforme », 2021 [2018], 318 p.